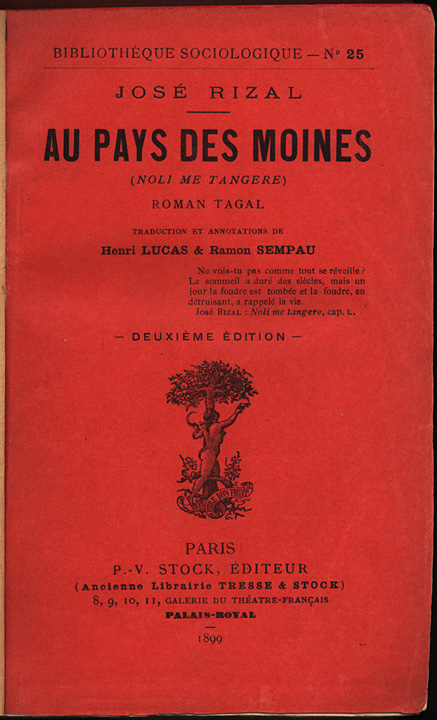[1]
[Table
des matières]
Au Pays des moines
I
Une réunion
C’était vers la fin du mois d’octobre; don
Santiago de los Santos, plus connu sous le nom de Capitan Tiago,
donnait un dîner et bien que, contre sa coutume, il ne
l’eût annoncé que dans l’après-midi
même, c’était déjà le thème de
toutes les conversations, non seulement à Binondo, mais dans les
autres faubourgs de Manille et jusque dans la ville. Capitan Tiago
passait alors pour le propriétaire le plus fastueux et
l’on savait que les portes de sa maison, comme celles de son
pays, n’étaient fermées à personne
qu’au commerce et à toute idée nouvelle ou
audacieuse.
La nouvelle se répandit donc avec une rapidité
électrique dans le monde des parasites, des oisifs et des bons
à rien que Dieu créa, par un effet de sa bonté
infinie, et multiplia si généreusement à
Manille.
Le dîner se donnait dans une maison de la calle de Anloague et
l’on pourrait encore la reconnaître, si toutefois les
tremblements de terre ne l’ont pas ruinée. Nous ne croyons
pas que son propriétaire l’ait fait démolir, Dieu
ou la Nature se chargeant ordinairement ici de ce genre de travaux,
ainsi que de quelques autres pour lesquels ils ont passé contrat
avec notre gouvernement. D’un style commun dans le pays, cet
édifice [2]suffisamment grand était situé
près d’un bras du Pasig, appelé aussi bouche de
Binondo; comme toutes les rivières de Manille, ce rio
entraîne les multiples détritus des bains, des
égouts, des blanchisseries, des pêcheries; il sert aussi
de moyen de transport et de communication et fournit même de
l’eau potable, si tel est le gré du porteur d’eau
chinois. A peine si, sur une distance d’environ un
kilomètre, cette puissante artère du faubourg où
le trafic est le plus important, le mouvement le plus actif, est
dotée d’un pont de bois délabré d’un
côté pendant six mois et infranchissable de l’autre
le reste de l’année, ce dont, pendant la saison des
chaleurs, les chevaux profitent pour sauter à l’eau,
à la grande surprise du mortel distrait qui, dans la voiture,
sommeillait tranquillement ou philosophait sur les progrès du
siècle.
La maison de Capitan Tiago est un peu basse et de lignes assez
incorrectes. Un large escalier de balustres verts, tapissé de
distance en distance, conduit du vestibule pavé
d’azulejos1 à l’étage principal, entre des
vases et des pots de fleurs placés sur des piédestaux
chinois bigarrés, parsemés de fantastiques dessins.
Si nous montons par cet escalier, nous entrons dans une large salle,
appelée ici caida, qui cette nuit sert à la fois
de salle à manger et de salon pour la musique. Au milieu, une
longue table ornée profusément et luxueusement semble
attendre le pique-assiettes et lui promettre les plus douces
satisfactions en même temps qu’elle menace la timide jeune
fille, la dalaga ingénue qui, pendant deux mortelles
heures, devra subir la compagnie d’individus bizarres, dont le
langage et la conversation ont d’ordinaire un caractère
très particulier.
Par contraste avec ces préparatifs mondains, les tableaux
bariolés qui pendent aux murailles représentent des
sujets religieux: le Purgatoire, l’Enfer, le [3]Jugement
dernier, la Mort du Juste, la Mort du Pécheur;
au fond, emprisonné dans un cadre Renaissance aussi
élégant que splendide et sculpté par
Arévalo, une curieuse toile de grandes dimensions
représentant deux vieilles femmes... l’inscription porte:
Notre-Dame de la Paix et du Bon Voyage, vénérée
à Antipolo, costumée en mendiante, visite pendant sa
maladie la pieuse et célèbre capitana Inès2. Si cette
composition ne révélait ni beaucoup de goût ni
grand sens artistique, elle se distinguait par un réalisme
exagéré: à en juger par les teintes jaunes et
bleues de son visage, la malade semblait déjà un cadavre
en putréfaction et les objets; les vases, qui constituent
l’ordinaire cortège des longues maladies étaient
reproduits avec la minutie la plus exacte. Le plafond était plus
agréablement décoré de précieuses lampes de
Chine, de cages sans oiseaux, de sphères de cristal
étamé rouges, vertes et bleues, de plantes
aériennes fanées, de poissons desséchés et
enflés, ce que l’on nomme des botetes, etc.; du
côté dominant la rivière, de capricieux arceaux de
bois, mi-chinois, mi-européens, laissaient voir sur une terrasse
des tonnelles et des berceaux modestement illuminés par de
petites lanternes en papier de toutes couleurs.
La salle était éclairée par des lustres
brillants se reflétant dans de larges miroirs. Sur une estrade
en bois de pin était un superbe piano à queue d’un
prix exorbitant, d’autant plus précieux ce soir que
personne n’en touche. Au milieu d’un panneau, un grand
portrait à l’huile représentait un homme de figure
jolie, en frac, robuste, droit, symétrique comme le bâton
de borlas3 tenu entre ses doigts rigides, couverts de bagues.
La foule des invités remplissait presque la salle, les [4]hommes
étaient séparés des femmes comme dans les
églises catholiques et les synagogues. Seule, une vieille
cousine de Capitan Tiago recevait les dames; elle paraissait assez
aimable mais sa langue écorchait un peu le castillan. Toute sa
politesse consistait à offrir aux Espagnoles un plateau de
cigarettes et de buyos4 et à donner sa main à baiser aux
Philippines, exactement comme les moines. La pauvre vieille, finissant
par s’ennuyer, profita du bruit causé par la chute
d’une assiette pour sortir précipitamment en grommelant
des menaces contre les maladroits.
Elle ne reparut pas.
Soit que les images religieuses les incitassent à garder une
dévote attitude, soit que les femmes des Philippines fissent
exception, le côté féminin de
l’assemblée restait silencieux; à peine
entendait-on parfois le souffle d’un bâillement
étouffé derrière l’éventail; à
peine les jeunes filles murmuraient-elles quelques paroles,
conversation banale se traînant mourante de monosyllabes en
monosyllabes, semblable à ces bruits que l’on entend la
nuit dans une maison et que causent les souris et les lézards.
Les hommes, eux, étaient plus bruyants. Tandis que dans un coin
quelques cadets parlaient avec animation, deux étrangers,
vêtus de blanc, les mains croisées derrière le dos,
parcouraient la salle d’un bout à l’autre comme
font, sur le pont d’un navire, les passagers lassés du
voyage. Le groupe le plus intéressant et le plus animé
était formé de deux religieux, de deux paysans et
d’un militaire, réunis autour d’une petite table sur
laquelle étaient du vin et des biscuits anglais.
Le militaire, vieux lieutenant, haut de taille, la physionomie
bourrue, semblait un duc d’Albe mis au [5]rancart dans la hiérarchie de
la garde civile; il parlait peu et d’un ton dur et bref.
L’un des moines, jeune dominicain, beau, coquet, brillant comme
la monture d’or de ses lunettes, affichait une gravité
précoce; c’était le curé de Binondo.
Quelques années auparavant, il avait été chanoine
de Saint-Jean-de-Latran. Dialecticien consommé, jamais
l’habile argumentateur B. de Luna n’avait pu
l’embrouiller ni le surprendre; il s’échappait des
distinguo comme une anguille des filets du pêcheur. Il
parlait peu et semblait peser ses paroles.
L’autre moine, par contre, parlait beaucoup et gesticulait
plus encore. Bien que ses cheveux commençassent à
grisonner, il paraissait avoir conservé toute la vigueur de sa
nature robuste. Son allure, son regard, ses larges mâchoires, ses
formes herculéennes lui donnaient l’air d’un
patricien romain déguisé. Il semblait gai cependant et,
si le timbre de sa voix était brusque comme celui d’un
homme qui ne s’est jamais mordu la langue, dont la parole est
tenue pour sainte et incontestable, son rire joyeux et franc
effaçait la désagréable impression de son aspect,
à tel point qu’on lui pardonnait d’exhiber dans la
salle des pieds sans chaussettes et des jambes velues qui auraient fait
la fortune d’un Mendieta aux foires de Quiapo5.
Un des paysans, petit homme à barbe noire, n’avait de
remarquable que le nez qui, à en juger par ses dimensions, ne
devait pas lui appartenir en entier; l’autre, jeune homme blond,
paraissait récemment arrivé dans le pays. Le franciscain
discutait assez vivement avec lui.
—Vous verrez, disait-il, quand vous serez ici depuis quelques
mois, vous vous convaincrez que gouverner à Madrid et être
aux Philippines, cela fait deux. [6]
—Mais...
—Moi, par exemple, continua le Frère Dámaso, en
élevant la voix pour ne pas laisser la parole à son
contradicteur, moi qui compte déjà vingt-trois ans de
platane et de morisqueta6, je puis en parler avec autorité. Sachez que,
lors de mon arrivée dans le pays, j’ai été
tout d’abord envoyé dans un pueblo petit, c’est
vrai, mais très adonné à l’agriculture. Je
ne comprenais pas encore très bien le tagal, mais cependant je
confessais les femmes et nous nous entendions tout de même.
Lorsque je fus nommé dans un pueblo plus grand dont le
curé indien était mort, toutes se mirent à
pleurer, me comblèrent de cadeaux, m’accompagnèrent
avec de la musique...
—Mais cela prouve seulement...
—Attendez, attendez, ne soyez pas si pressé! Eh bien!
celui qui me remplaça, bien qu’il ait été
beaucoup plus sévère et qu’il ait presque
doublé la dîme de la paroisse, eut un cortège plus
nombreux encore, plus de larmes et plus de musique.
—Mais, vous me permettrez...
—Bien plus, je suis resté vingt ans dans le pueblo de
San Diego; il y a seulement quelques mois que je l’ai...
quitté (ici, la figure du moine s’assombrit quelque peu).
En vingt ans on connaît un pueblo. San Diego avait six mille
âmes; comme je confessais tous ces gens-là, je connaissais
chaque habitant comme si je l’avais enfanté et
allaité, je savais de quel pied boitait celui-ci, comment
bouillait la marmite de celui-là, quel était
l’amoureux de cette dalaga, quelle chute avait faite une
telle et avec qui, etc., etc. Santiago, le maître de la maison,
en est témoin; il a beaucoup de biens à San Diego et
c’est là que nous avons fait connaissance. Eh bien, vous
allez voir ce que c’est que l’Indien: [7]quand je suis parti,
c’est à peine si quelques vieilles femmes et quelques
franciscains m’accompagnèrent... après vingt
ans!
—Mais je ne trouve pas que tout ceci ait rien à voir
avec la libre vente des tabacs! répondit le jeune homme blond
profitant d’une pause, pendant laquelle le franciscain prenait un
verre de Xérès.
Fr. Dámaso, surpris, manqua de laisser tomber le verre. Il
regarda fixement le jeune homme puis s’écria, l’air
fort étonné:
—Comment? comment? mais c’est clair comme la
lumière! Ne voyez-vous pas, mon fils, que c’est une preuve
palpable que les réformes projetées par les ministres
sont absurdes?
Ce fut au tour du jeune homme à rester perplexe. Le
lieutenant fronça les sourcils, le petit brun remua la
tête sans que l’on pût savoir s’il approuvait
ou non Fr. Dámaso qui se contentait de les regarder tous,
jouissant de sa victoire.
—Croyez-vous...? put enfin lui demander son contradicteur,
très sérieux, en l’interrogeant du regard.
—Comment, si j’y crois? comme à l’Evangile!
l’Indien est si indolent!
—Ah! pardonnez-moi si je vous interromps, reprit le jeune
homme d’une voix plus basse en approchant sa chaise. Vous avez
dit un mot qui appelle tout mon intérêt: existe-t-elle
véritablement, de naissance, cette indolence des naturels, ou
bien, ainsi que le dit un voyageur étranger, n’est-elle
qu’une excuse à la nôtre propre, à notre
état arriéré, à notre système
colonial? Ce voyageur parlait d’autres colonies dont les
habitants sont de même race...
—Bah! Jalousies que tout cela! demandez au señor Laruja
qui, lui aussi, connaît bien le pays, demandez-lui si
l’ignorance et la paresse des Indiens ne sont pas sans
égales!
—En effet, s’empressa de confirmer le petit brun [8]ainsi pris
à témoin, nulle part vous ne trouverez d’hommes
plus nonchalants que ces Indiens.
—Ni plus vicieux, ni plus ingrats.
—Ni plus mal élevés.
Le jeune blond regarda autour de lui avec inquiétude.
—Messieurs, dit-il à voix basse, il me semble que nous
sommes chez des Indiens et que ces demoiselles...
—Bah! vous êtes trop craintif! Santiago ne se
considère pas comme indien. Et puis, il n’est pas
là; d’ailleurs, quand il y serait, tant pis pour lui. Ce
sont là des scrupules de nouveaux débarqués.
Attendez un peu; quand vous aurez passé quelques mois ici vous
changerez de ton, surtout quand vous aurez vu des fêtes, des
bailujan7,
que vous aurez dormi dans nos lits de sangle et mangé de la
tinola.
—Ce que vous appelez tinola, ne serait-ce point, par hasard,
le fruit d’une certaine espèce de lotus qui fait perdre la
mémoire à ceux qui en mangent?
—Ni lotus, ni loterie! reprit en riant Fr. Dámaso, ne
cherchez pas si loin. La tinola est un gulai8 de poule et de citrouille. Depuis
quand êtes-vous arrivé?
—Depuis quatre jours, répondit le jeune homme un peu
piqué.
—Venez-vous comme employé?
—Non, señor, je voyage pour mon compte personnel, afin
d’étudier le pays.
—Quel oiseau rare! s’écria Fr. Dámaso, en
le regardant avec curiosité. Venir ici, de soi-même et
pour des vétilles! Quel phénomène! Alors
qu’il y a tant de livres... et qu’il suffit d’avoir
deux doigts d’intelligence.
—Votre Révérence disait, Fr. Dámaso,
interrompit brusquement le dominicain en changeant la conversation,
qu’elle avait été pendant vingt ans au pueblo de
San Diego et qu’elle l’avait quitté... Votre
Révérence n’était-elle point satisfaite de
ce pueblo? [9]
A cette demande, faite d’un ton très naturel et presque
indifférent, Fr. Dámaso devint subitement sérieux,
sa joie s’était envolée.
—Non! grogna-t-il sèchement, et il se laissa tomber
lourdement contre le dossier de son fauteuil.
Le dominicain poursuivit d’un ton plus indifférent
encore:
—Ce doit être une grande douleur de quitter un pueblo
après vingt ans de séjour, alors qu’on le
connaît comme sa poche. Moi, j’ai regretté Camiling
où cependant je n’étais resté que quelques
mois... Mais les supérieurs agissaient pour le bien de la
Communauté qui sera toujours le mien propre.
Pour la première fois dans cette soirée, Fr.
Dámaso parut très préoccupé. Tout à
coup, il donna un coup de poing sur le bras de son fauteuil et
s’écria avec force:
—Ou il y a une Religion ou il n’y en a pas; donc, ou les
curés sont libres ou ils ne le sont pas! Le pays se perd, il est
déjà perdu!
Et son fauteuil reçut un second coup de poing.
Tout le monde, surpris, se retourna vers le groupe; le dominicain
leva la tête pour regarder sous ses lunettes. Les deux
étrangers qui se promenaient s’arrêtèrent un
moment, se regardèrent, se sourirent et continuèrent leur
promenade.
—Il est de mauvaise humeur parce que vous ne l’avez pas
traité de Révérence! murmura le señor
Laruja à l’oreille du jeune homme blond.
—Que veut dire Votre Révérence? Qu’y
a-t-il? demandèrent à la fois, avec des tons de voix
différents, le lieutenant et le dominicain.
—Tous les malheurs viennent de là! Le gouvernement
soutient les mécréants contre les ministres de Dieu!
continua le franciscain en levant ses poings robustes.
—Que voulez-vous dire? demanda de nouveau le lieutenant aux
sourcils froncés, se levant à demi.
—Ce que je veux dire? répéta Fr. Dámaso
élevant encore la voix et dévisageant le lieutenant. Je
le dis ce [10]que je veux dire. Oui, moi, je dis que lorsque le
curé débarrasse son cimetière de la carcasse
d’un mécréant, personne, pas même le roi,
n’a le droit de s’en mêler et encore moins de le
punir. Et un général de rien, un petit
général de malheur...
—Père, Son Excellence est vice-roi! cria le militaire,
se levant tout à fait.
—Quelle excellence, quel vice-roi?... répondit le
franciscain se levant à son tour. En d’autres temps on
l’aurait jeté en bas des escaliers, comme l’ont fait
une fois les Congrégations avec l’impie gouverneur
Bustamente. C’étaient là des temps où
l’on avait la foi!
—Je vous avertis que je ne permets pas... Son Excellence
représente S. M. le Roi!
—Quel est ce roi? Pour nous, il n’y a qu’un seul
roi, le roi légitime...
—Halte! commanda le lieutenant, comme s’il
s’adressait à ses troupes; ou vous allez retirer ce que
vous avez dit, ou demain même j’en ferai part à Son
Excellence.
—Allez-y tout de suite, allez, répondit d’un ton
sarcastique Fr. Dámaso; et il s’approchait de lui les
poings fermés. Croyez-vous que parce que je porte l’habit
de moine je ne sois point un homme? Allez, je vous prête ma
voiture!
La scène devenait comique, par bonheur le dominicain
intervint:
—Señores, dit-il, d’un ton
d’autorité, avec cette voix nasillarde qui sied si bien
aux moines; on ne doit pas confondre les choses ni chercher des
offenses où il n’y en a pas. Nous devons distinguer dans
les paroles de Fr. Dámaso, celles de l’homme et celles du
prêtre. Celles de celui-ci, comme telles, per se, ne
peuvent jamais offenser puisqu’elles proviennent de la
vérité absolue. Dans celles de l’homme il convient
de faire une sous-distinction: celles qu’il dit ab irato,
celles qu’il dit ex ore, mais non pas in corde, et
celles qu’il dit in corde. Ces dernières sont les
seules qui puissent offenser et encore, cela dépend: si
déjà elles étaient [11]préméditées
in mente pour un motif quelconque ou si seulement elles surviennent
per accidens, dans la chaleur de la conversation; s’il y
a...
—Mais moi, par accidens et par mi, je sais
à quoi m’en tenir, père Sibyla! interrompit le
militaire qui se voyait embrouillé dans le tas de distinctions
et craignait que de subtilités en subtilités, il ne fut
prouvé que c’était lui le coupable. Je connais les
causes de cet éclat et Votre Révérence va les
distinguer. Pendant une absence du P. Dámaso, son vicaire
à San Diego enterra un homme très honorable... oui,
señor, très honorable, je l’ai reçu
plusieurs fois chez moi et il fut également mon hôte.
Qu’il ne se soit jamais confessé, c’est possible,
mais quoi! moi non plus je ne vais pas à confesse; quant
à s’être suicidé, c’est là un
mensonge et une calomnie. Un homme comme lui, qui a un fils en qui
reposent tout son amour et toutes ses espérances, un homme qui
croit en Dieu, qui connaît ses devoirs envers le monde, un homme
honorable et juste ne se suicide pas. Cela, je l’affirme. Quant
au reste, je me tais, Votre Révérence peut m’en
savoir gré.
Et tournant les épaules au franciscain il ajouta:
—A son retour au pueblo, ce prêtre, après avoir
maltraité le pauvre vicaire, fit déterrer le cadavre que
l’on jeta hors du cimetière pour l’enfouir je ne sais
où. Le peuple de San Diego fut assez lâche pour ne pas
protester. Il est vrai que la chose resta presque ignorée, le
défunt n’avait pas de parents et son fils unique
était en Europe. Mais Son Excellence a su ce qui
s’était passé et, obéissant à la
droiture de son cœur, elle a demandé une punition... Le P.
Dámaso fut transféré dans un autre pueblo,
meilleur encore. C’est tout. Maintenant, Votre
Révérence peut faire ses distinctions.
Ceci dit, il s’éloigna du groupe.
—Je regrette beaucoup d’avoir touché sans le
savoir une question si délicate, insinua le P. Sibyla,
d’un air contrarié. Mais enfin, si vous avez gagné
au changement de pueblo... [12]
—Il ne s’agit pas de gagner... Et ce qui se perd dans
les déménagements... et les papiers... et les... et ce
qu’on égare? interrompit en balbutiant Fr. Dámaso
qui pouvait à grand’peine contenir sa colère.
Peu à peu, la réunion recouvra sa tranquillité
primitive.
Diverses autres personnes étaient arrivées, parmi
lesquelles un vieil espagnol, boiteux, de physionomie douce et
inoffensive, appuyé au bras d’une vieille indigène,
affublée de boucles, de frisettes, très fardée et
habillée à l’européenne.
C’étaient le docteur de Espadaña et sa femme, la
doctora Doña Victorina. Ils prirent place avec le groupe
que nous connaissons et furent salués amicalement.
Des journalistes, des boutiquiers, allaient, venaient,
échangeaient des saluts, sans savoir que faire.
—Pouvez-vous me dire, señor Laruja, quel est le
maître de la maison? demanda le jeune blond. Je ne lui ai pas
encore été présenté.
—On dit qu’il est sorti: je ne l’ai pas vu.
—Les présentations ne sont pas nécessaires ici,
intervint Fr. Dámaso. Santiago est de bonne composition.
—Il n’a pas inventé la poudre, ajouta Laruja.
—Comment, vous aussi, señor de Laruja! reprocha
mielleusement Da. Victorina, tout en s’éventant. Comment
le pauvre homme aurait-il inventé la poudre puisque, si ce que
l’on dit est vrai, les Chinois en fabriquaient déjà
il y a plusieurs siècles?
—Les Chinois? Etes-vous folle? s’écria Fr.
Dámaso. Allez donc, c’est un franciscain qui l’a
inventée, un de mon ordre, Fr. Savalls9, je crois, au... septième
siècle!
—Un franciscain, c’est bien cela. Il aura
été missionnaire en Chine ce Fr. Savalls, répliqua
la dame qui n’abandonnait pas ainsi son idée. [13]
—Schwartz, voulez-vous dire, señora, reprit Fr. Sibyla,
sans la regarder.
—Je ne sais pas; Fr. Dámaso a dit Savalls, je
n’ai fait que répéter!
—Bien! Savalls ou Chevas10, c’est la même chose. Pour une
lettre on n’est pas Chino11, répliqua le franciscain
avec humeur.
—C’est au quatorzième siècle et non au
septième, ajouta le dominicain d’un ton pédant,
comme pour mortifier l’orgueil de Fr. Dámaso.
—Bah! un siècle de plus ou de moins n’en fait pas
un dominicain.
—Que Votre Révérence ne se fâche pas, dit
le P. Sibyla en souriant. S’il l’a inventée, tant
mieux; il a ainsi épargné cette peine à ses
frères.
—Et vous dites, P. Sibyla, que ce fut au quatorzième
siècle? demanda avec grand intérêt Da. Victorina.
Avant ou après Jésus-Christ?
Heureusement pour celui à qui cette question était
posée, deux personnes entrèrent dans la salle.
[Table
des matières]
II
Crisóstomo Ibarra
Ce n’étaient pas de belles et fringantes jeunes filles
dignes d’appeler l’attention de tous, même de Fr.
Sibyla; ce n’était pas non plus S. E. le capitaine
général avec ses aides-de-camp, et cependant le
lieutenant sortait de son recueillement et s’avançait de
quelques pas tandis que Fr. Dámaso restait comme
pétrifié: c’était [14]simplement l’original du
portrait de l’homme au frac, conduisant par la main un jeune
homme rigoureusement vêtu de deuil.
—Bonsoir, señores, bonsoir, Pères! furent les
premières paroles que prononça Capitan Tiago en baisant
la main des deux prêtres qui oublièrent de donner la
bénédiction: le dominicain avait retiré ses
lunettes pour mieux regarder le nouvel arrivé; quant à
Fr. Dámaso, il restait pâle et les yeux
démesurément ouverts.
—J’ai l’honneur de vous présenter D.
Crisóstomo Ibarra, fils de mon défunt ami, continua
Capitan Tiago. Le señor arrive d’Europe et je suis
allé le recevoir.
Le nom d’Ibarra souleva diverses exclamations; le lieutenant
ne pensa pas à saluer le maître de la maison, mais il
s’approcha du jeune homme et l’examina de pied en cap. En
ce moment, celui-ci échangeait les phrases usuelles avec tous
ceux qui composaient le groupe. Il semblait n’avoir rien qui le
distingua des autres invités que son costume noir. Sa taille
avantageuse, ses manières, ses mouvements dénotaient
cependant une saine et forte jeunesse dont l’âme et le
corps ont été également cultivés. Son
visage franc et joyeux, d’un beau brun, traversé de
quelques légères rides, traces du sang espagnol,
était légèrement rosé aux joues, par suite
de son séjour dans les pays froids.
—Tiens! s’écria-t-il, surpris et joyeux à
la fois, le curé de mon pueblo! P. Dámaso, l’intime
ami de mon père!
Tous les regards se tournèrent vers le franciscain qui ne
bougea pas.
—Pardon, s’excusa Ibarra confus, je me suis
trompé.
—Tu ne t’es pas trompé, répondit enfin le
prêtre d’une voix altérée; mais jamais ton
père ne fut mon ami.
Ibarra retira lentement la main qu’il avait tendue, [15]le regarda
d’un air étonné, se retourna et trouva devant lui
la figure bourrue du lieutenant qui ne l’avait pas quitté
des yeux.
—Jeune homme, êtes-vous le fils de D. Rafael Ibarra?
Crisóstomo s’inclina.
Fr. Dámaso s’assit à moitié dans son
fauteuil et dévisagea le lieutenant.
—Soyez le bienvenu dans votre pays, et puissiez-vous y
être plus heureux que votre père, s’écria le
militaire avec émotion. Je l’ai bien connu et je puis dire
que c’était un des hommes les plus dignes et les plus
honorables des Philippines.
—Señor, répondit Ibarra, l’éloge
que vous faites de mon père dissipe mes doutes sur son sort que
moi, son fils, j’ignore encore.
Les yeux du vieillard se remplirent de larmes, il fit demi-tour et
s’éloigna précipitamment.
Le jeune homme resta seul au milieu de la salle: le maître de
la maison avait disparu, personne n’était là pour
présenter le nouvel arrivé aux demoiselles dont beaucoup
le regardaient avec intérêt. Après avoir un instant
hésité, il s’adressa à elles avec une
grâce simple et naturelle.
—Permettez-moi, dit-il, de sortir des règles
d’une étiquette rigoureuse. Il y a sept ans que j’ai
quitté mon pays; en le revoyant, je ne puis
m’empêcher de saluer son plus précieux ornement, ses
femmes.
Personne ne répondant, le jeune homme s’éloigna,
puis se dirigeant vers un groupe qui, à son approche, se forma
en demi-cercle:
—Señores, dit-il, en Allemagne la coutume est que
lorsqu’un inconnu se trouve dans une réunion où
personne ne le présente, il dise lui-même son nom, et
chacun se nomme à son tour. Permettez-moi d’agir ainsi,
non pour introduire dans notre pays des mœurs
étrangères, les nôtres sont assez belles, mais
parce que j’y suis obligé. J’ai déjà
salué le ciel et les femmes [16]de ma patrie; je veux maintenant en saluer
les citoyens, mes compatriotes. Señores, je me nomme Juan
Crisóstomo Ibarra y Magsalin.
Les autres déclinèrent à leur tour des noms
plus ou moins insignifiants, plus ou moins inconnus.
—Je m’appelle A—a, dit un jeune homme d’un
ton sec, en s’inclinant à peine.
—Aurais-je par hasard l’honneur de parler au
poète dont les œuvres ont, au loin,
réchauffé mon enthousiasme pour ma patrie? On m’a
dit que vous n’écriviez plus, mais on n’a pu me dire
pourquoi...
—Pourquoi? Parce que l’on n’invoque pas
l’inspiration pour la traîner rampante et servile et la
prostituer au mensonge. On a poursuivi un auteur qui avait mis en vers
une vérité de Pero Grullo1. On m’a appelé
poète, on ne m’appellera pas fou.
—Pourriez-vous me dire quelle était cette
vérité?
—C’était que le fils du lion était un lion
lui-même. Il s’en est fallu de peu qu’on ne
l’exilât.
Et l’étrange jeune homme s’éloigna du
groupe.
Un homme de physionomie joviale, vêtu comme les
indigènes, avec des boutons en brillants à sa chemise,
arriva presque en courant, s’approcha d’Ibarra et lui
dit:
—Señor Ibarra, je désirais vous connaître;
Capitan Tiago est mon ami et j’ai connu votre père... Je
suis le Capitan Tinong, j’habite Tondo, où vous avez votre
maison; j’espère que vous m’honorerez de votre
visite et viendrez demain dîner avec nous.
Ibarra était enchanté de tant
d’amabilité. Capitan Tinong souriait et se frottait les
mains.
—Merci, répondit affectueusement Crisóstomo,
mais demain même, je dois partir pour San Diego...
—Quel malheur! alors ce sera pour votre retour. [17]
—La table est servie! annonça un garçon du
café La Campana.
Les invités commencèrent à se diriger vers la
table, non sans que se fissent beaucoup prier les femmes, surtout les
indigènes.
[Table
des matières]
III
Le dîner
Fr. Sibyla paraissait très content de lui. Il marchait
tranquillement, et sur ses lèvres fines et pincées ne se
lisait que le dédain; il consentait cependant à converser
avec le docteur boiteux de Espadaña, qui lui répondait
par monosyllabes, tout en bégayant quelque peu. Le franciscain
était d’une humeur épouvantable, il donnait des
coups de pied aux chaises qui se trouvaient sur son chemin et gratifia
même d’un coup de coude un élève de
l’école des cadets. Le lieutenant restait toujours aussi
grave; quant aux autres, ils parlaient avec animation et ne tarissaient
pas en éloges sur la magnificence du service.
Instinctivement, peut-être par habitude, les deux religieux se
dirigèrent vers l’extrémité de la table: ce
qui était à prévoir se produisit; comme deux
candidats pour une chaire vacante, ils commencèrent à se
décerner mutuellement les louanges les plus
exagérées, tout en se servant de sous-entendus habilement
suggestifs, quitte pour l’aspirant évincé à
exprimer son mécontentement par des grognements et des murmures.
[18]
—Cette place est pour vous, Fr. Dámaso.
—Mais non, pour vous, Fr. Sibyla.
—Je ne saurais... vous êtes plus ancien que moi parmi
les amis de la maison... confesseur de la défunte...
l’âge, la dignité, l’autorité...
—Pas si ancien que vous le dites. Par contre, vous êtes
le curé du faubourg, répondit d’un ton sec Fr.
Dámaso, sans cependant abandonner la chaise.
—Puisque vous l’ordonnez, j’obéis, conclut
le P. Sibyla en se disposant à s’asseoir.
—Mais je n’ordonne rien, protesta le franciscain, je ne
me permettrais pas...
Fr. Sibyla allait cependant s’asseoir sans faire cas de ces
protestations quand son regard se rencontra avec celui du lieutenant.
Selon l’opinion religieuse aux Philippines, le plus haut
gradé des officiers est inférieur au cuisinier du
couvent. Cedant arma togæ, disait
Cicéron au Sénat; cedant arma
cottæ, disent les moines à Manille. Mais Fr. Sibyla
était fin et il reprit:
—Señor lieutenant, nous sommes ici dans le monde et non
pas à l’église; cette chaise vous appartient.
Rien qu’à en juger par le son de sa voix il
était clair que, même dans le monde, il considérait
la place en litige comme la sienne.
Le lieutenant ne voulut-il pas le contrarier? lui déplut-il
de s’asseoir entre deux moines? toujours est-il qu’il
refusa d’un mot bref.
Pendant leur lutte de politesses, aucun des deux compétiteurs
ne s’était occupé du maître de la maison.
Ibarra s’en était aperçu, il avait
regardé tout en souriant:
—Comment, dit-il, vous ne vous asseyez donc pas avec nous, D.
Santiago?
Mais tous les invités étaient placés, aucun
siège ne restait libre, Lucullus ne dînait pas chez
Lucullus.
—Ne vous dérangez pas, restez tranquille,
répondit Capitan Tiago, posant la main sur l’épaule
du jeune [19]homme. Cette fête a été
donnée pour rendre grâces à la Vierge de votre
heureuse arrivée. Ho! qu’on apporte la tinola! J’ai
commandé de la tinola exprès pour vous qui, depuis
quelque temps, n’y avez pas goûté.
On apporta un grand plat fumant. Le dominicain, après avoir
murmuré le Benedicite, auquel presque personne ne sut
répondre, commença à servir les invités. Ce
fut sans doute par inattention, mais il ne mit dans l’assiette du
P. Dámaso qu’un peu de citrouille et de la sauce où
nageaient un cou dénudé et une aile de poule suffisamment
dure, tandis que les autres se régalaient des pattes et du
blanc. Ibarra privilégié avait reçu les rognons.
Le franciscain avait tout vu, il hacha les pépins, prit un peu
de bouillon, laissa tomber bruyamment la cuiller et repoussa bruyamment
l’assiette devant lui. Le dominicain, très distrait,
conversait avec le jeune homme blond.
—Depuis combien de temps avez-vous quitté le pays?
demanda Laruja à Ibarra.
—Depuis presque sept ans.
—Alors, vous devez l’avoir oublié?
—Bien au contraire! mon pays peut, comme il me semble, ne plus
se souvenir de moi, j’ai toujours pensé à lui.
—Que voulez-vous dire? demanda le jeune homme blond.
—Je veux dire que, depuis un an, je n’ai plus
reçu de nouvelles d’ici, de telle sorte que je me trouve
comme un étranger qui ne sait ni quand ni comment est mort son
père.
Le lieutenant ne put retenir un cri de stupéfaction.
—Et où étiez-vous que l’on ne vous a pas
télégraphié? interrogea Da. Victorina. Quand nous
nous sommes mariés, nous avons envoyé des
dépêches dans la Pegninsule2. [20]
—Señora, ces deux dernières années, je
les ai passées dans le Nord de l’Europe, en Allemagne et
dans la Pologne russe.
Le docteur de Espadaña, qui jusqu’alors ne
s’était pas risqué à prendre la parole, crut
qu’il était convenable de dire quelque chose:
—Co... connaissez-vous en Espagne un Polonais de Va...
Varsovie, appelé Stadtnitzki, si je me souviens bien de son nom?
L’avez-vous rencontré, par hasard? demanda-t-il timidement
et presque en rougissant.
—C’est très possible, répondit Ibarra avec
amabilité, mais, en ce moment, je ne me le rappelle pas.
—Mais on ne peut pas le con... confondre avec un autre, ajouta
le docteur qui commençait à retrouver un peu de
hardiesse; il était blond comme l’or et parlait un bien
mauvais espagnol.
—Le signalement est excellent, mais malheureusement, je ne
parlais pas un mot d’espagnol si ce n’est dans quelques
consulats.
—Et comment vous arrangiez-vous? remarqua avec surprise Da.
Victorina.
—Je me servais de la langue du pays, señora.
—Parlez-vous aussi l’anglais? dit le dominicain qui
avait été à Hong-kong et parlait assez bien le
Pidgin-English3, cette corruption de l’idiome de Shakespeare
défiguré par les fils de l’Empire
Céleste.
—J’ai habité un an en Angleterre avec des gens
qui ne parlaient que l’anglais.
—Et quel est le pays qui vous plaît le plus, en Europe?
demanda le jeune blond.
—Après l’Espagne, ma seconde patrie, toutes les
nations de l’Europe libre!
—Et puisque vous avez tant voyagé, dites-nous ce [21]que vous avez
vu de plus intéressant? questionna Laruja.
Ibarra parut réfléchir.
—Intéressant, dans quel sens?
—Par exemple... dans ce qui touche à la vie des
peuples, à leur vie sociale, politique, religieuse, en
général, dans leur essence même, dans
l’ensemble...
Ibarra médita un long moment.
—Franchement, ce qu’il y a de surprenant dans ces pays,
à part l’orgueil national de chacun... Avant de visiter un
pays, je cherchais à étudier son histoire, son Exode, si
je puis employer ce mot et, ensuite, tout me semblait naturel;
j’ai vu que toujours la richesse et la misère des peuples
étaient en raison directe de leurs libertés et de leurs
préjugés et, par conséquent, en proportion avec
les sacrifices ou avec l’égoïsme de leurs
devanciers!
—N’as-tu rien vu de plus? demanda avec un rire moqueur
le franciscain qui, depuis le commencement du dîner n’avait
pas dit une parole, occupé qu’il était par le soin
de son estomac. Ce n’était vraiment pas la peine de
gaspiller ton argent pour apprendre si peu de choses. Il n’est
pas un gamin à l’école qui n’en sache
autant.
Ibarra, interloqué, ne savait que dire; les convives surpris
se regardèrent, craignant un scandale.—Le dîner
touche à sa fin, et Sa Révérence en a
déjà assez, allait-il répondre, mais il se
contint:
—Señores, observa-t-il très doucement, ne vous
étonnez pas de ces familiarités de notre ancien
curé! Il me parlait ainsi quand j’étais enfant, et,
pour Sa Révérence les années ne comptent pas.
Aussi, je la remercie de ce souvenir des jours passés, du temps
où elle venait fréquemment chez nous et honorait de sa
présence la table de mon père.
D’un regard furtif, le P. Sibyla observa le franciscain qui
tremblait un peu.
Ibarra se leva:
—Vous me permettrez de me retirer. A peine arrivé,
[22]je dois
me remettre en route dès demain et j’ai encore beaucoup
d’affaires à terminer. Le dîner est presque
achevé, je bois peu de vin et prends à peine de
liqueurs.
Et, levant un petit verre qu’il n’avait pas
touché jusqu’alors:
—Señores, tout pour l’Espagne et pour les
Philippines!
Capitan Tiago lui dit à voix basse:
—Ne partez pas; Maria Clara va venir, Isabel est allée
la chercher. J’attends aussi le nouveau curé de son
pueblo; c’est un saint.
—Je ne puis rester plus longtemps, je dois faire
aujourd’hui une très importante visite; demain, je
viendrai avant de partir.
Et il s’en alla. Entre temps, le franciscain exhalait sa
bile:
—Avez-vous vu, disait-il au jeune blond tout en jouant avec le
couteau à confitures, avez-vous vu cet orgueil! Ces jeunes gens
se croient des personnages, ils ne peuvent tolérer qu’un
prêtre les reprenne. Voilà ce que l’on gagne
à les envoyer en Europe: le gouvernement devrait interdire ces
voyages.
Cette même nuit, le jeune blond ajoutait, entre autres
remarques, à ses «Etudes coloniales» le chapitre
suivant: «Comment un cou et une aile de poulet dans
l’assiette de tinola d’un moine peuvent troubler la
gaieté d’un festin» et, parmi ses observations, se
trouvaient celles-ci: «Aux Philippines, la personne la plus
inutile dans une fête ou dans un dîner est celle qui
invite: on peut commencer par mettre à la porte le maître
de la maison et tout va bien.—Dans l’état actuel des
choses, c’est presque un bien de ne pas laisser un Philippin
sortir de son pays et de ne pas apprendre à lire aux
indigènes.» [23]
[Table
des matières]
IV
Hérétique et flibustier
Ibarra était indécis. Le vent de la nuit qui,
d’ordinaire dans cette saison, apporte quelque fraîcheur
à Manille parut effacer de son front les légers nuages
qui l’avaient un instant obscurci. Il se découvrit et
respira longuement. Devant lui des voitures passaient comme des
éclairs, des calèches de louage roulaient au petit pas,
des promeneurs de toutes nationalités se coudoyaient. De cette
marche inégale à laquelle se reconnaît de suite le
distrait ou l’oisif, il se dirigea jusqu’à la place
de Binondo, regardant de tous côtés comme s’il
cherchait quelqu’un. Rien n’était changé:
c’était la même rue avec les mêmes maisons
blanches et bleues, les mêmes murs badigeonnés à la
chaux et peints à fresque, imitant mal le granit; la tour de
l’église montrait toujours la même horloge au cadran
transparent; c’étaient les mêmes boutiques chinoises
avec les mêmes rideaux sales et les mêmes tringles de fer;
jadis, un soir, imitant les gamins mal élevés de Manille,
il avait tordu une de ces tringles: personne depuis ne l’avait
redressée.
—Comme le progrès est lent! murmura-t-il, et il suivit
la calle de la Sacristia.
Les vendeurs de sorbets le suivaient en criant: Sorbeteee...
Des lampions éclairaient encore les mêmes échoppes
où des Chinois et des femmes vendaient des comestibles et des
fruits.
—C’est merveilleux, s’écria-t-il, ni le
Chinois ni la vieille femme n’ont changé depuis sept ans!
On dirait que mon voyage en Europe est un rêve et ... Santo Dios!
le pavé est toujours aussi mauvais que lors de mon
départ. [24]
En effet, la dalle du trottoir qui forme le coin des calles de San
Jacinto et de la Sacristia était restée
soulevée.
Tandis qu’il contemplait cette merveille de la
stabilité urbaine dans ce pays de l’instabilité,
une main se posa doucement sur son épaule: il leva la tête
et reconnut le vieux lieutenant qui le regardait en souriant. Le
militaire n’avait plus cette figure dure ni ces sourcils
froncés qui le caractérisaient d’ordinaire.
—Jeune homme, lui dit-il, prenez garde! Souvenez-vous de votre
père!
—Pardonnez-moi, mais il me semble que vous avez beaucoup
d’estime pour mon père. Pourriez-vous me renseigner
à son sujet? lui demanda Ibarra en le regardant.
—Ne savez-vous donc rien?
—J’ai interrogé D. Santiago, mais il ne veut pas
me répondre avant demain. Si par hasard vous connaissez son
sort, dites-le moi!
—Certainement, je le connais, comme tout le monde!... Votre
père est mort en prison.
Le jeune homme recula d’un pas; son regard fixa le
lieutenant.
—En prison? qui est mort en prison?
—Votre père! répondit le vieux soldat, non sans
quelque surprise.
—Mon père!... en prison?... que dites-vous? savez-vous
qui était mon père? êtes-vous...? et
Crisóstomo saisit le bras du vieillard.
—Il me semble que je ne me trompe pas, reprit celui-ci, il
s’agit bien de D. Rafael Ibarra?
—Oui, D. Rafael Ibarra... put à peine articuler le
jeune homme défaillant.
—Je croyais que vous saviez tout! murmura le militaire plein
de compassion, devinant ce qui se passait dans l’âme
d’Ibarra. Je supposais que vous... mais quoi! vous avez du
courage? Ici on ne peut être un honnête homme si l’on
n’a pas été en prison. [25]
—J’espère que vous ne vous moquez pas de moi,
reprit Ibarra, d’une voix faible, après quelques instants
de silence. Pourriez-vous me dire pourquoi il était en
prison?
Le vieillard parut réfléchir:
—Je m’étonne beaucoup qu’on ne vous ait pas
tenu au courant des affaires de votre famille.
—Dans la dernière lettre qu’il m’a
adressée, il y a un an, mon père me recommandait de
n’avoir pas d’inquiétude s’il ne
m’écrivait pas car il était très
occupé: il m’engageait à poursuivre mes
études... et m’envoyait sa bénédiction.
—Mais alors, cette lettre, il vous l’a écrite peu
de temps avant sa mort; voici bientôt un an que nous
l’avons enterré dans son pays.
—Pour quel motif avait-il été
arrêté?
—Rassurez-vous, ce motif ne touchait en rien à son
honorabilité. Mais, accompagnez-moi, je dois aller au quartier,
nous causerons en route. Appuyez-vous sur mon bras.
Ils marchèrent quelque temps en silence; le vieillard
réfléchissait, il caressait sa barbiche et semblait lui
demander de l’inspirer:
—Ainsi que vous le savez, commença-t-il, votre
père était l’homme le plus riche de la province et
si beaucoup l’aimaient et le respectaient, nombre d’autres,
par contre, le haïssaient et lui portaient envie. Nous autres,
Espagnols, qui venons aux Philippines, ne sommes malheureusement pas
toujours ce que nous devrions être; je dis ceci aussi bien pour
un de vos ancêtres que pour les ennemis de votre père. Les
changements continuels, la démoralisation des classes
dirigeantes, le favoritisme, le bas prix et la rapidité du
voyage sont la cause de tout le mal: ici viennent tous les gens perdus
de la Péninsule; s’il en est quelques-uns de bons, le pays
a vite fait de les corrompre. Eh bien! votre père
s’était fait de très nombreux ennemis, surtout
parmi les curés et les Espagnols.
Il s’arrêta un instant et reprit:
[26]
—Quelques mois après votre départ, les
difficultés commencèrent avec le P. Dámaso, sans
que je puisse m’expliquer le véritable motif de leur
brouille. P. Dámaso l’accusa de ne pas aller à
confesse; il ne se confessait pas plus au temps où ils
étaient amis, vous vous en souvenez! Et d’ailleurs, D.
Rafael était un homme plus honorable et plus loyal que beaucoup
qui confessent les autres et se confessent eux-mêmes: il se
conduisait selon les principes d’une morale très rigide et
me disait souvent, lorsqu’il m’entretenait de ses ennuis:
Señor Guevara, croyez-vous que Dieu pardonne un crime, un
assassinat par exemple, simplement parce que le criminel se sera
dénoncé à un prêtre,
c’est-à-dire à un homme qui a le devoir de garder
le secret, et parce que la crainte de brûler en enfer lui aura
dicté un acte de contrition? Ce serait un singulier
mélange de hardiesse, de lâcheté et de honte. Je me
fais une autre idée de Dieu: pour moi, il ne corrige pas un mal
par un autre mal, et son pardon ne s’achète pas par de
vaines pleurnicheries ni par quelques aumônes jetées
à l’Église. Si j’ai assassiné un
père de famille, si d’une femme heureuse j’ai fait
une malheureuse veuve et d’enfants joyeux des orphelins
abandonnés, serai-je quitte envers l’éternelle
Justice parce qu’avant de me laisser pendre, j’aurai
confié mon crime à un prêtre qui ne peut pas
parler, donné de l’argent aux curés qui n’en
ont guère besoin, acheté la bulle de pardon et
pleurniché nuit et jour. Ainsi raisonnait votre père, et
l’on ne peut dire qu’il ait jamais fait le moindre tort
à qui que ce soit. Au contraire, il se préoccupait de
racheter par ses bonnes œuvres certaines injustices commises par
ses parents. Mais, pour en revenir à ses débats avec le
curé, ceux-ci prirent rapidement un caractère dangereux.
Le P. Dámaso le dénonça presque du haut de la
chaire et, s’il ne prononça pas son nom, ce fut un
miracle; mais, de lui, on pouvait tout attendre. Je prévoyais
que tôt ou tard, les choses tourneraient mal. [27]
Le vieux lieutenant fit une autre pause.
—Un ex-artilleur, chassé de l’armée
à cause de sa brutalité et de son ignorance, parcourait
alors la province. Comme il devait gagner sa vie et que, en sa
qualité d’Espagnol, les travaux manuels qui pourraient
nuire à notre prestige lui étaient interdits, il obtint,
grâce à je ne sais qui, l’emploi de collecteur de
l’impôt sur les véhicules. Le malheureux
n’avait reçu aucune éducation, ce dont les
indigènes s’aperçurent bien vite: pour eux, un
Espagnol qui ne sait ni lire ni écrire est un
phénomène. Tout devint prétexte à moqueries
contre l’infortuné, on lui faisait payer en avanies de
tout genre l’impôt qu’on lui versait; au bout de peu
de temps, il n’était plus que le jouet de la risée
publique. Il s’en aperçut et son caractère
déjà brusque et méchant s’en aigrit encore.
On faisait exprès de lui remettre les écrits à
l’envers, il faisait semblant de les lire et signait où il
voyait une place blanche en griffonnant quelques traits qui le
peignaient tout entier. Les indigènes payaient, mais riaient; il
se morfondait, mais recevait l’argent; dans cette disposition
d’esprit, il en était arrivé à ne plus avoir
de considération pour personne et votre père
n’échangeait avec lui que de très rares paroles
fort peu amicales. Un jour, tandis qu’il retournait pour essayer
de le déchiffrer un papier qui lui avait été remis
dans une maison indigène, un enfant de l’école se
mit à faire des signes à ses camarades, à rire et
à le montrer au doigt. L’homme entendit les rires et vit
l’ironie dans les regards des personnes qui se trouvaient
là. Perdant patience, il se retourna et poursuivit les enfants
qui s’enfuirent en criant: Ba, be, bi, bo, bu! Fou de
colère et impuissant à les attraper, il leur jeta son
bâton qui en blessa un à la tête et
l’étendit à terre. Il courut alors au pauvre petit
et le frappa du pied; personne de ceux qui riaient n’eut le
courage d’intervenir. Par malheur, votre père passait;
indigné, il s’élança vers le percepteur, le
prit par le bras et lui adressa les plus vifs reproches. [28]Celui-ci qui, sans
doute, voyait rouge, leva la main, mais votre père vit le geste
et, avec cette force qui est l’apanage des petits-fils des
Basques... les uns disent qu’il le frappa, les autres qu’il
se contenta de le repousser; ce qui est certain, c’est que
l’homme vacilla et tomba à quelques pas de là,
donnant de la tête contre une pierre. D. Rafael releva
tranquillement l’enfant blessé et le porta au tribunal.
Quant à l’ex-artilleur, il rendait le sang par la bouche
et ne reprit pas connaissance. Quelques minutes après, il
expirait. Naturellement la justice s’émut, votre
père fut arrêté. Aussitôt tous ses ennemis se
découvrirent, les calomnies plurent de tous côtés,
il fut dénoncé comme hérétique et
flibustier1.
Passer pour hérétique est toujours mauvais, et à
cette époque où l’alcalde de la province faisait
profession de dévotion—il récitait le rosaire
à voix haute dans l’église afin que tous
l’entendissent et récitassent avec lui—le cas
était particulièrement dangereux; mais passer pour
flibustier est pire encore et mieux vaudrait avoir sur la conscience le
meurtre de trois collecteurs d’impôts sachant lire,
écrire et raisonner. Ses rares amis
l’abandonnèrent, on fit main basse sur ses livres et ses
papiers. Tout l’accusa: son abonnement au Correo de
Ultramar et à quelques autres journaux de Madrid, votre
voyage en Europe, des lettres qu’on trouva chez lui, le portrait
d’un prêtre qui avait été
exécuté, je ne sais quoi encore. On alla
jusqu’à l’incriminer parce que, comme descendant de
péninsulaires, il faisait usage de chemises. A la place de votre
père un autre eût été promptement remis en
liberté, le médecin ayant déclaré que la
mort du percepteur avait été causée par une
congestion, mais sa fortune, sa confiance dans la justice, sa haine de
tout ce qui n’était pas légal et droit le
perdirent. Moi-même, malgré ma répugnance à
implorer la grâce [29]de personne, je me présentai au capitaine
général—c’était le
prédécesseur du gouverneur actuel. Je lui
démontrai que ce ne pouvait être un flibustier, celui qui
accueillait si généreusement tout nouvel arrivé
d’Espagne, pauvre ou émigré, lui donnant
l’abri et la nourriture, celui dans les veines de qui coulait le
généreux sang espagnol, je lui répondis sur ma
tête de son innocence, je pris à témoin ma
pauvreté et mon honneur militaire, je ne trouvai qu’un
accueil hostile; on me congédia brusquement tout en me traitant
d’imbécile.
Le vieillard s’interrompit encore une fois pour reprendre
haleine. Son compagnon silencieux l’écoutait sans le
regarder.
—Votre père, reprit-il, m’avait chargé de
toutes les démarches relatives à son procès. Je
m’adressai au jeune et déjà célèbre
avocat philippin A—, mais il refusa de se charger de la cause:
«Je la perdrais, me dit-il, et ma plaidoirie serait le sujet de
nouvelles accusations; moi-même, je pourrais être
compromis. Voyez donc le señor M. C’est un orateur
véhément et fécond, ayant ce grand avantage
d’être péninsulaire et jouissant d’un
très grand prestige.» Je suivis ce conseil,
l’éloquent avocat accepta de défendre votre
père et soutint cette cause de la façon la plus brillante
et la plus grandiose. Mais les ennemis étaient nombreux,
beaucoup d’entre eux inconnus et cachés
n’étaient pas les moins redoutables. A peine son avocat
avait-il réduit à néant une calomnie en mettant
les calomniateurs en contradiction avec eux-mêmes et avec les
faits, que de nouvelles accusations renaissaient aussitôt. On lui
reprocha de s’être emparé injustement de beaucoup de
terrains, on lui réclama des dommages et intérêts
pour des torts imaginaires, on assura qu’il était en
relations avec les tulisanes2 pour [30]que ses plantations et ses troupeaux fussent
respectés. Un an après l’arrestation de votre
père, l’affaire était embrouillée de telle
sorte que personne ne s’y retrouvait plus. L’alcalde dut
quitter son poste; son successeur avait une grande réputation
d’intégrité, mais, par malheur, il ne resta que
quelques mois, et celui qui remplaça cet honnête homme
avait pour les beaux chevaux un goût trop prononcé. Quant
à votre père, les ennuis, les souffrances morales, les
incommodités du régime de la prison, la douleur de voir
tant d’ingrats se lever contre lui, altérèrent sa
santé de fer; il tomba terrassé par cette maladie que la
tombe guérit seule. Et, au moment où, en dépit de
l’acharnement et de la puissance de ses adversaires, le
procès allait être terminé, où il allait se
retrouver libre enfin, absous de la double accusation
d’assassinat sur la personne du percepteur et de trahison envers
sa patrie, il mourut en prison, sans que personne de ceux qui
l’aimaient pût se trouver à son chevet. Je
n’arrivai que pour le voir expirer.
Le vieux lieutenant se tut. Ibarra n’avait pas prononcé
une seule parole. La porte du quartier était devant eux, ils
s’arrêtèrent.
—Jeune homme, ajouta le vieillard en lui tendant la main,
Capitan Tiago vous donnera les détails, et maintenant bonne
nuit! Il faut que je voie s’il n’est rien arrivé de
nouveau.
Ibarra serra avec effusion cette main décharnée, et,
toujours en silence, il suivit des yeux son vieil ami. Quand il
l’eut perdu de vue, il se retourna lentement, aperçut une
voiture et fit un signe au cocher.
—Fonda de Lala! articula-t-il d’un accent à peine
intelligible.
—Ce doit être encore quelque échappé de
l’Hospice, pensa le cocher en donnant un coup de fouet à
ses chevaux. [31]
[Table
des matières]
V
Une étoile dans la nuit obscure
Ibarra monta à sa chambre qui donnait sur la rivière,
se laissa tomber sur un fauteuil et regarda l’espace qui se
déroulait devant lui par la fenêtre ouverte. Sur
l’autre rive, la maison qui faisait face, brillamment
illuminée, retentissait des joyeux accords d’instruments
dont les échos arrivaient jusqu’à lui. Si le jeune
homme avait été moins préoccupé et plus
curieux et qu’à l’aide de jumelles il eût
examiné ce qui se passait dans cette atmosphère de
lumières, il aurait admiré une de ces apparitions
magiques, une de ces fantastiques visions qui, parfois, dans les grands
théâtres d’Europe, accompagnées par les
mélodies éteintes de l’orchestre, se
dévoilent au milieu d’une pluie de lumières,
d’une cascade d’or et de diamants, de toute la
féerie des pompes orientales. C’est une jeune fille de
beauté merveilleuse, svelte, parée du pittoresque costume
des natives des Philippines, assise au centre d’un demi-cercle de
courtisans de toutes conditions, de toutes races: Chinois, Espagnols,
indigènes, militaires, curés, vieilles, jeunes, tous,
enivrés de lumière et de musique, gesticulent, causent,
discutent avec animation. Tout à côté de la jeune
fille, s’est installé le P. Dámaso dont la figure
souriante dénote qu’il n’eût pas changé
sa place pour celle d’un bienheureux; Fr. Sibyla, Fr. Sibyla
lui-même, daigne adresser la parole à la reine de cette
fête dans les magnifiques cheveux de qui Da. Victorina arrange un
diadème de perles et de brillants reflétant les
splendides couleurs du prisme. Elle est blanche, trop blanche
peut-être, ses yeux presque toujours baissés laissent voir
lorsqu’elle les ouvre toute la pureté de son [32]âme et, quand
elle sourit, découvrant ses dents petites et ivoirines, la rose
la plus brillante n’est plus que la plus vulgaire des fleurs des
champs. Autour de son cou blanc et parfaitement arrondi, entre le tissu
transparent de la piña1, clignotent, comme disent les Tagals, les yeux joyeux
d’un collier de brillants. Un seul homme paraît insensible
à cette attraction toute puissante de la lumière et de la
beauté: c’est un jeune franciscain, grêle,
décharné, pâle, qui de loin la contemple, respirant
à peine, immobile comme une statue.
Mais Ibarra ne voit rien de tout cela. Un autre spectacle
s’offre à sa pensée, s’impose à ses
yeux. Quatre murs dénudés et sales enferment une
étroite prison où par une grille serrée
pénètre à peine un jour incertain; sur le sol
humide et souillé, une natte; sur cette natte agonise un
vieillard. Le moribond, terrassé par la fièvre,
promène de tous côtés son regard défaillant;
d’une voix entrecoupée il prononce un nom en pleurant.
Personne ne l’assiste, d’instant en instant le bruit
d’une chaîne, l’écho d’un
gémissement traversent seuls les murailles du cachot. Et pendant
ce temps, là-bas, au loin, un jeune homme rit, crie, chante,
verse le vin sur les fleurs aux applaudissements joyeux de ses
compagnons de fête! Hélas! ce jeune homme a sa taille et
sa figure, le vieillard agonisant ressemble à son père et
le nom que le prisonnier prononce en sanglotant, c’est le
sien.
Une à une les lumières s’éteignent dans
la maison en fête, on n’entend plus ni le bruit, ni les
chants, ni la musique, mais à l’oreille d’Ibarra
résonne toujours le cri angoissé de son père
mourant. L’haleine profonde du silence a soufflé sur
Manille et tout paraît y reposer dans les bras du néant;
seul, le chant du coq alterne avec le tintement des horloges des tours
et le mélancolique cri d’alerte de la sentinelle
lassée; un [33]quartier de lune apparaît éclairant
de sa pâle lueur cet universel sommeil. Ibarra, lui aussi,
fatigué peut-être de ses tristes pensées autant que
de son long voyage, s’est endormi.
Seul, le jeune franciscain que nous avons vu tout à
l’heure immobile et silencieux au milieu de l’agitation et
du bruit de la fête, veille encore: le coude appuyé sur
l’embrasure de la fenêtre de sa cellule, la tête
pâle et émaciée posée sur la paume de sa
main, il regarde au loin une étoile qui brille dans le ciel
obscur. L’étoile pâlit et s’éclipse,
l’astre des nuits perd sa faible lueur de lune
décroissante, mais le moine ne bouge pas: immobile, il contemple
au loin l’horizon perdu dans la brume de l’aurore, vers le
camp de Bagumbayan, vers la mer encore endormie.
[Table
des matières]
VI
Capitan Tiago
Que soit faite aussi ta volonté sur la terre!...
Tandis que nos héros dorment encore ou déjeunent, nous
allons esquisser le portrait de Capitan Tiago; n’ayant jamais
été de ses invités nous n’avons aucune
raison pour le dédaigner en le passant sous silence.
Petit de taille, le teint moins foncé que celui de la
généralité de ses compatriotes, de figure ronde et
de corpulence satisfaisante, grâce à un embonpoint qui lui
venait du ciel selon ses amis, du sang des pauvres au dire de ses
détracteurs, Capitan Tiago semblait plus jeune que son
âge. A l’époque où se passaient les faits que
nous racontons, l’expression de son visage était toujours
celle d’un homme parfaitement heureux. Son crâne arrondi,
très petit, couvert de cheveux noirs comme
l’ébène, allongé par devant, très
court par [34]derrière contenait beaucoup de choses, du
moins le disait-on. Ses yeux petits, mais non obliques comme ceux des
Chinois, conservaient toujours la même expression; le nez
était fin et droit et, si sa bouche n’avait pas
été déformée par l’abus du tabac et
du buyo, dont le sapa1 en se réunissant sur une joue
déformait la symétrie de ses traits, nous dirions
qu’il ne se trompait pas en se croyant et en se faisant passer
pour un bel homme. Mais, en dépit de cet abus, il conservait
toujours ses dents parfaitement blanches, aussi bien les siennes
propres que celles que lui fournissait un dentiste à raison de
douze douros la pièce.
Il avait la réputation d’être le plus riche
propriétaire de Binondo et l’un des plus importants
hacenderos2
par ses terrains dans la Pampanga et à la lagune de Bay, mais
surtout dans le pueblo de San Diego, terrains dont le revenu
s’accroissait chaque année. Par ses bains
agréables, sa fameuse gallera3 et les souvenirs qu’il en conservait, San
Diego était son pueblo favori; il y passait environ deux mois
tous les ans.
Il avait encore des propriétés à Santo Cristo,
dans la calle de Anloague et dans la calle Rosario;
l’exploitation de la traite de l’opium était
partagée entre un Chinois et lui et il est inutile de dire
qu’ils en tiraient de très grands bénéfices.
Il avait l’entreprise de la nourriture des prisonniers de Bilibid
et fournissait de zacate4 plusieurs maisons principales de Manille,
moyennant contrat naturellement. Bien avec toutes les autorités,
habile, souple, audacieux même, lorsqu’il s’agissait
de spéculer sur les besoins des autres, c’était le
seul et redoutable adversaire d’un certain Perez pour les
adjudications des diverses charges et emplois [35]que le gouvernement des
Philippines confie toujours à des mains particulières.
Ainsi donc, à ce moment, Capitan Tiago était un homme
heureux, aussi heureux que peut l’être en ces pays un homme
dont le petit crâne dénonce l’origine
indigène: il était riche, il était en paix avec
Dieu, avec le gouvernement et avec les hommes.
Qu’il fut en paix avec Dieu, on n’en saurait douter,
cela faisait presque partie du dogme: on n’a pas de motif pour
être mal avec Dieu quand on est bien sur la terre, qu’on ne
lui a jamais rien demandé et qu’on ne lui a jamais
prêté d’argent. Jamais il ne s’était
adressé à lui dans ses prières, même dans
ses plus grands ennuis; il était riche et son or priait pour
lui; pour les messes et les prières, Dieu avait
créé des prêtres puissants et orgueilleux; pour les
neuvaines et les rosaires, le même Dieu, dans sa bonté
infinie, avait créé, pour le salut des riches, de pauvres
gens qui, pour un peso, sont capables de réciter seize
mystères et de lire tous les Livres Saints, même la Bible
hébraïque, pour peu que l’on augmente le prix. Si,
dans une grande extrémité, il avait besoin d’un
secours céleste et que ne se trouvait point à sa
portée un cierge rouge de Chinois, il s’adressait aux
saints et aux saintes qu’il vénérait
particulièrement en leur faisant toutes sortes de promesses pour
les convaincre de la justice de sa cause et du bien fondé de ses
désirs. Mais celle à qui il promettait le plus et envers
qui il tenait le mieux ses promesses était la Vierge
d’Antipolo, Nuestra Señora de la Paz y de
Buenviaje, car avec certains petits saints il ne se croyait pas
tenu à beaucoup de ponctualité ni même de
politesse; parfois, ses souhaits étant exaucés, il ne se
souvenait plus de ses promesses; il est vrai que, lorsque
l’occasion s’en présentait à nouveau, il ne
dérangeait plus les malheureux saints qu’il avait
trompés; Capitan Tiago savait que le calendrier en compte nombre
d’inoccupés, ne sachant parfois à quoi passer leur
temps dans le ciel. [36]
Nous avons vu que dans la grande salle était une petite porte
cachée par un rideau de soie; elle conduisait à une
petite chapelle, à un oratoire, accessoire obligé de
toute maison philippine: là étaient les dieux lares de
Capitan Tiago et, si nous nous servons de ce terme, dieux lares,
c’est que la religion du maître de la maison se rapprochait
en effet beaucoup plus du polythéisme que du monothéisme,
auquel d’ailleurs il n’avait jamais rien compris. On y
voyait des statues et des images de la Sainte Famille avec le buste,
les mains et les pieds en ivoire, les yeux de cristal, de longs cils et
des chevelures blondes et frisées, chefs-d’œuvre de
la sculpture de Santa Cruz. Quatre tableaux à l’huile par
les artistes de Paco et Hermita, représentaient des martyres de
saints, des miracles de la Vierge, etc., Sainte Lucie regardant le ciel
et portant dans un plat deux yeux avec cils et sourcils comme ceux qui
sont peints dans le triangle de la Trinité ou sur les
sarcophages égyptiens, Saint Pascal Baylon, Saint Antoine de
Padoue, en habit de guingon5, contemplant les larmes aux yeux un Enfant
Jésus en uniforme de capitaine général, avec
tricorne, sabre et bottes, paraissant sortir d’un bal
d’enfants de Madrid; cela, pour Capitan Tiago, signifiait que
Dieu ajoutait à sa puissance celle d’un capitaine
général des Philippines, les moines jouant toujours avec
lui comme avec une marionnette. On voyait aussi un Saint Antoine Abad
flanqué d’un cochon trottant à son
côté, cochon qui, pour le digne Capitan, était
aussi miraculeux que le saint lui-même; aussi ne se risquait-il
pas à l’appeler cochon, mais créature du
saint seigneur Saint Antoine; un Saint François
d’Assises, avec sept ailes et un habit couleur de café,
était placé au-dessus d’un Saint Vincent qui
n’en avait que deux, mais, en échange, portait une
trompette; un Saint Pierre martyr, dont la tête coupée
avec une hachette de brigand était pendue
[37]au poing d’un
infidèle agenouillé près de lui, faisait pendant
à un Saint Pierre coupant l’oreille à un Maure,
Malcus sans doute, se mordant les lèvres et se contorsionnant de
douleur, tandis qu’un coq sasabungin6 chante et bat des ailes sur une
colonne dorique; ce dont Capitan Tiago conclut que, pour être
saint, il revient au même de couper les autres en morceaux ou
d’être partagé soi-même. Qui pourrait
énumérer cette armée d’images et dire les
qualités et les perfections qui se trouvaient amassées
là? Un chapitre ne suffirait pas! Cependant, nous ne pouvons
oublier un beau Saint Michel en bois doré et peint, ayant
presque un mètre de hauteur; l’archange, se mordant la
lèvre inférieure, les yeux brillants, le front
ridé, les joues roses, du bras gauche tient un bouclier grec et
brandit de la main droite un kris comme ceux dont s’arment les
sauvages de Jolo; à son attitude comme à son regard, on
voit qu’il menace bien plus le dévot qui s’approche
de lui que le démon cornu à longue queue qui enfonce ses
crocs dans la maigre jambe de demoiselle de son vainqueur; aussi
Capitan Tiago, craignant un miracle, se tient toujours à
prudente distance. Car ce ne serait pas la première fois
qu’une image, fût-elle aussi mal taillée que celles
que fabriquent les charpentiers de Paete, se serait animée pour
le châtiment et la confusion des pécheurs
incrédules.
Capitan Tiago, un homme prudent et religieux évitait donc de
s’approcher du kriss de Saint Michel.—Fuyons les occasions,
se disait-il—je sais bien que c’est un archange, mais je ne
m’y fie pas, non, je ne m’y fie pas.
Tous les ans, sans y manquer jamais, il prenait part avec un
orchestre à l’opulent pèlerinage d’Antipolo.
Alors il payait deux messes d’actions de grâces, puis il se
baignait dans le batis, c’est-à-dire dans la
célèbre fontaine où l’image sacrée
elle-même s’était baignée. [38]Là,
près de cette même fontaine, Capitan Tiago mangeait du
cochon de lait rôti, du sinigang de dalag avec des
feuilles d’alibambang7 et d’autres mets plus ou moins
appétissants. Les deux messes lui coûtaient environ quatre
cents pesos, mais elles lui paraissaient encore bon marché en
considération de la gloire qu’acquérait la
Mère de Dieu par les roues de feu, les fusées, les
bombes, les pétards ou bersos, comme on dit
là-bas, dont elles étaient accompagnées; de plus,
il calculait aussi les gros bénéfices que, grâce
à ces messes, il était assuré de réaliser
pendant le reste de l’année.
Mais Antipolo n’était pas le seul théâtre
de sa bruyante dévotion. A Binondo, dans la Pampanga, à
San Diego, quand il avait engagé de forts paris sur un coq, il
envoyait au curé quelques pièces d’or pour des
messes propitiatoires et, comme les Romains qui, avant une bataille,
consultaient les augures en donnant à manger aux poulets
sacrés, Capitan Tiago consultait aussi les siens avec les
modifications de forme apportées par le temps et les nouvelles
vérités. Il observait la flamme des cierges, la
fumée de l’encens, la voix du prêtre, etc., et du
tout cherchait à déduire son sort futur. Il était
généralement admis que Capitan Tiago perdait peu de
paris, encore ces rares pertes étaient-elles dues à ce
que l’officiant était enroué, à ce
qu’il y avait peu de lumières, à ce que les cierges
contenaient beaucoup de suif ou à ce qu’une pièce
fausse s’était glissée dans l’argent remis au
curé, etc., etc. Le surveillant d’une confrérie lui
avait assuré aussi que ces pertes étaient des
épreuves auxquelles le ciel le soumettait pour mieux
s’assurer de sa foi et de sa dévotion. Aimé des
curés, respecté des sacristains, flatté par les
marchands de cierges chinois et les artificiers
[39]ou castelleros, notre
homme était heureux dans la religion de cette terre et des
personnes de caractère et de haute piété lui
attribuaient aussi une grande influence à la Cour
céleste.
Qu’il fût en paix avec le gouvernement, pour difficile
que la chose paraisse, on n’en doit pas douter. Incapable
d’imaginer une pensée nouvelle et content de sa situation,
il était toujours disposé à obéir au
dernier des fonctionnaires, à offrir des jambons, des chapons,
des dindons et des fruits de Chine en toute saison. S’il
entendait médire des indigènes, lui qui ne se
considérait pas comme tel, il faisait chœur et disait
pire; si l’on critiquait les métis sangleyes8 ou espagnols, il les
critiquait aussi parce qu’il se croyait déjà un pur
Ibère. Il était toujours le premier à applaudir
toute imposition nouvelle, surtout lorsqu’il flairait
qu’elle devait être suivie d’un contrat avantageux
pour lui. Il avait toujours des orchestres à sa disposition pour
féliciter et aubader toutes sortes de gouverneurs, alcaldes,
procureurs, etc., etc., aux jours de fêtes,
d’anniversaires, pour la naissance ou la mort d’un parent,
à quelque occasion que ce fût qui rompît la
monotonie habituelle de l’existence. Il commandait alors des vers
louangeurs, des hymnes dans lesquels on célébrait le
suave et aimable gouverneur, le vaillant et intrépide
alcalde qu’attend dans le ciel la palme des justes ou la
palmeta9—et beaucoup d’autres compliments encore
plus flatteurs.
Il fut pendant deux ans gobernadorcillo de la riche association des
métis, malgré les protestations de beaucoup qui le
prenaient pour un indigène. En résumé, les deux
phrases chrétienne et profane le définissaient
très exactement: «Heureux les pauvres
d’esprit!» et «Heureux ceux qui
possèdent!» Et l’on pouvait aussi lui appliquer
celle-ci que quelques-uns trouvent [40]être une équivoque traduction
du grec: «Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté!» Plus loin, la suite de
cette histoire nous apprendra qu’il ne suffit pas que les hommes
aient bonne volonté pour vivre en paix! Les impies le prenaient
pour un fou, les pauvres le disaient impitoyable, cruel, exploiteur de
la misère et ses inférieurs, despote et tyran.
Et les femmes? Ah! les femmes! des rumeurs calomnieuses
bourdonnaient dans les misérables cabanes de nipa10 et l’on
assurait avoir entendu des plaintes, des sanglots mêlés
aux vagissements d’un petit enfant. Plus d’une jeune fille
est montrée au doigt malicieux des voisins; elle a le regard
indifférent et le sein flétri. Mais rien de tout cela
n’ôte le sommeil à Capitan Tiago; aucune femme ne
trouble sa paix; seule, une vieille le fait souffrir, une vieille qui
lui fait concurrence en dévotion, à qui de nombreux
curés ont décerné d’enthousiastes louanges,
comme il n’en n’avait jamais obtenu dans ses meilleurs
jours. Entre Capitan Tiago et cette veuve, héritière de
frères et de neveux, existait une sainte émulation qui
concourait au bien de l’Église, comme la concurrence entre
les vapeurs de la Pampanga concourt au bien du public. Capitan Tiago
donnait-il un bâton d’argent enrichi
d’émeraudes et de topazes à une Vierge quelconque,
aussitôt Doña Patrocinio en commandait un autre d’or
et de brillants à l’orfèvre Gaudinez;
qu’à la procession de la Naval, Capitan Tiago ait
élevé un arc avec des façades de toile
bouillonnée, avec des miroirs, des globes de cristal, des
lampes, des lustres, aussitôt Doña Patrocinio en
élevait un autre avec quatre façades, deux colonnes plus
hautes encore, et des ornements et des pendeloques en bien plus grande
quantité. Alors, il revenait à ses habitudes, à sa
spécialité, aux messes avec [41]bombes et feux d’artifices et
Doña Patrocinio n’avait plus qu’à se mordre
les lèvres avec ses gencives, car, excessivement nerveuse, elle
ne pouvait supporter l’ébranlement des cloches et moins
encore la détonation des pétards. Elle prenait sa
revanche en payant un beau sermon au plus fameux chanoine de la
cathédrale et la lutte continuait ainsi ad majorem Dei
gloriam. Les partisans de sa vieille ennemie ont pleine
confiance qu’à sa mort elle sera canonisée et que
Capitan Tiago lui-même sera contraint de la vénérer
devant les autels; notre ami ne demande pas mieux, à la
condition qu’elle se fasse canoniser bientôt.
Tel était à cette époque Capitan Tiago.
Quant au passé, il était fils unique d’un
marchand de sucre de Malabon, suffisamment riche, mais si avare
qu’il ne voulut jamais dépenser un sou pour
l’instruction de son fils. Aussi ce fut le domestique d’un
bon dominicain, homme très vertueux, nommé Santiaguillo,
qui s’efforça de lui enseigner tout ce qu’il pouvait
et savait de bon. Lorsqu’il allait avoir la joie
d’être appelé logico par ses amis,
c’est-à-dire quand il allait commencer
l’étude de la logique, la mort de son protecteur,
bientôt suivie de celle de son père, mit fin à ses
études et il dut s’adonner tout entier aux affaires. Il se
maria avec une jeune fille de Santa Cruz, qui l’aida à
faire sa fortune et lui fit partager sa situation sociale. Doña
Pia Alba ne se contenta pas d’acheter du sucre, du café et
de l’indigo: elle voulut semer et récolter. Le nouveau
couple acquit des terrains à San Diego et c’est de ce
temps que dataient ses relations avec le P. Dámaso et D. Rafael
Ibarra, le plus riche capitaliste du pueblo.
Le manque d’héritier dans les six premières
années de mariage faisait presque de cette soif de richesses une
ambition blâmable et, cependant, Doña Pia était
svelte, robuste et bien formée. En vain elle fit des neuvaines,
visita, sur le conseil des dévotes, la Vierge de Caysasay
à Taal et prodigua des aumônes; en vain [42]dansa-t-elle
à la procession, en plein soleil de mai, devant la Vierge de
Turumba à Pakil; rien ne réussit jusqu’à ce
que Fr. Dámaso lui eût conseillé d’aller
à Obando; là, elle dansa à la fête de saint
Pascal Bailon et lui demanda un fils. On sait qu’à Obando
est une Trinité qui donne des fils ou des filles au choix:
Nuestra Señora de Salambau, sainte Clara et saint Pascal.
Grâce à ce sage conseil, Doña Pia se sentit enfin
mère... Hélas! comme le pêcheur dont parle
Shakespeare et qui cessa de chanter dès qu’il eut
trouvé un trésor, elle perdit la gaieté et plus
jamais on ne la vit sourire.—Caprices! disaient les gens, et
Capitan Tiago lui-même. Une fièvre puerpérale mit
fin à sa tristesse, laissant orpheline une belle enfant que tint
sur les fonts Fr. Dámaso; et, comme saint Pascal n’avait
pas donné le fils qu’on lui avait demandé, la
fillette fut nommée Maria Clara en l’honneur de la Vierge
de Salambau et de sainte Clara; ainsi fut châtié par le
silence l’honorable saint Pascal Bailon.
L’enfant grandit grâce aux soins de la tante Isabel,
cette bonne vieille de politesse monacale que nous avons
déjà vue; la plus grande partie de l’année,
elle habitait San Diego à cause de son climat salutaire et P.
Dámaso lui faisait toujours bon accueil.
Maria Clara n’avait pas les petits yeux de son père;
ainsi que ceux de sa mère, les siens étaient grands,
noirs, assombris par de larges cils; joyeux et rieurs quand elle
jouait, tristes, profonds et pensifs quand elle ne souriait pas.
Dès l’enfance sa chevelure bouclée était
presque blonde; son nez, de correct profil, n’était ni
effilé ni camus; la bouche, avec les agréables fossettes
des joues, rappelait celle de sa mère, petite et gracieuse; sa
peau avait la finesse du lys et aussi sa blancheur, et ses parents
bavards trouvaient le trait de parenté de Capitan Tiago dans les
oreilles petites et bien modelées de Maria Clara.
La tante Isabel attribuait ses manières
demi-européennes aux envies de Doña Pia; elle se
rappelait l’avoir [43]vue souvent, dans les premiers mois de la
grossesse, pleurer devant saint Antoine; une autre cousine de Capitan
Tiago était du même avis, seulement elle différait
dans le choix du saint; pour elle, c’était la Vierge ou
saint Michel. Un fameux philosophe, cousin de Capitan Tinong, et qui
savait l’Amat11 par cœur, cherchait l’explication de ce
fait dans les influences planétaires.
Maria Clara, idole de tous, grandit entre des sourires et des
amours. Les moines eux-mêmes lui faisaient fête quand, aux
processions, ils l’habillaient de blanc, sa chevelure abondante
et bouclée entremêlée de jasmins et de lis, deux
petites ailes d’argent et d’or enracinées aux
épaules du costume et, à la main, deux colombes blanches,
attachées avec des rubans bleus. Elle était si joyeuse
ensuite, elle avait un babil si candidement enfantin que Capitan Tiago,
fou d’amour, passait son temps à bénir les saints
d’Obando et à conseiller à tous l’achat de
belles sculptures.
Dans les pays du soleil, à treize ou quatorze ans
l’enfant se fait femme, comme le bouton de la nuit éclot
en fleur à la première aurore. À ce moment de transition
plein de mystères, elle entra sur les conseils du curé de
Binondo au couvent de Santa Catalina, pour recevoir des sœurs la
sévère éducation religieuse. Ce fut avec des
larmes qu’elle se sépara du P. Dámaso et de son
unique ami, seul compagnon des jeux de son enfance, Crisóstomo
Ibarra, qui lui aussi partit bientôt pour son voyage en Europe.
Là, dans ce couvent où l’on ne communiquait avec le
reste du monde qu’à travers une double grille, et encore
sous l’œil vigilant de la Mère-Surveillante, elle
vécut sept ans. D. Rafael et Capitan Tiago, chacun avec leurs
vues particulières et comprenant la mutuelle inclinaison des
jeunes gens, concertèrent l’union de leurs enfants. Cet
[44]arrangement, conclu quelques années
après le départ du jeune Ibarra, fut accueilli avec une
même allégresse par deux cœurs battant aux deux
extrémités du monde, placés en des conditions
aussi dissemblables qu’était grande la distance qui les
séparait.
[Table
des matières]
VII
Idylle sur une terrasse
Ce matin-là, tante Isabel et Maria Clara avaient
été à la messe de bonne heure, la jeune fille
élégamment vêtue, portant au bras un chapelet
à gros grains bleus qui lui servait à demi de bracelet,
la respectable dame munie d’un binocle pour lire son
«Ancre de Salut» pendant le saint sacrifice.
A peine le prêtre était-il descendu de l’autel
que la jeune fille voulut se retirer, ce qui causa à la bonne
tante autant de surprise que de déplaisir, car elle croyait
à sa nièce la plus grande piété et la
supposait au moins aussi amie de la prière qu’une
religieuse. Tout en se signant, tout en grommelant, elle se leva.
«Bah! croyez-moi, tante Isabel, le Bon Dieu qui connaît
mieux que vous le cœur des jeunes filles me pardonnera
bien,» lui avait dit Maria Clara pour couper court à ses
sermons sévères mais toujours maternels.
Maintenant leur déjeuner est terminé; la jeune fille
trompe son impatience en tissant une bourse de soie, pendant que la
tante s’efforce de faire disparaître avec son plumeau les
traces de la fête. Capitan Tiago examine quelques papiers.
Qu’un bruit quelconque monte de la rue, qu’une [45]voiture passe,
et Maria Clara frémit et son sein se soulève! Comme elle
regrette son tranquille couvent, ses camarades aimées!
Là, elle pouvait le voir sans trembler, sans se troubler.
N’était-ce pas son ami d’enfance, le compagnon de
ses premiers jeux; tout, jusqu’au souvenir de leurs
passagères et puériles querelles, revenait à sa
mémoire et charmait sa pensée. Je n’insiste pas; si
tu as aimé, lecteur, tu comprendras; sinon, à quoi bon
des explications? le profane n’entend rien à ces
mystères.
—Je crois, Maria, que le médecin a raison, dit Capitan
Tiago, tu as besoin d’aller à la campagne, tu es
pâle, il te faut le grand air. Que préfères-tu,
Malabon... ou San Diego?
A ce dernier nom, la jeune fille devint rouge comme un coquelicot.
Elle ne put répondre.
—Et maintenant, il te faut aller au couvent prendre tes
affaires et dire au revoir à tes amies. Isabel
t’accompagnera.
Et, sans lever la tête il ajouta:
—Tu n’y retourneras plus.
Maria Clara se sentit au cœur cette vague mélancolie
qui s’empare de l’âme quand on quitte pour toujours
un lieu où l’on a été heureux; mais une
autre pensée amortit aussitôt cette douleur.
—D’ici quatre ou cinq jours, quand tu auras une robe
neuve, nous irons à Malabon... Ton parrain n’est plus
à San Diego; le jeune Père que tu as vu ici cette nuit
l’a remplacé comme curé du pueblo; c’est un
saint.
—Je crois qu’elle préfère San Diego,
cousin! observa la tante Isabel; de plus la maison y est plus
confortable et c’est bientôt la fête.
Maria Clara aurait voulu embrasser sa tante, mais elle entendit
s’arrêter une voiture et devint subitement très
pâle:
—Ah! c’est vrai! répondit Capitan Tiago, et
changeant de ton il ajouta: D. Crisóstomo!
Maria Clara laissa tomber l’ouvrage qu’elle avait [46]dans les
mains, elle voulut se remuer mais cela lui était impossible: un
frémissement nerveux parcourait son corps. On entendit des pas
dans l’escalier, puis une voix fraîche et mâle. Comme
si cette voix avait possédé un pouvoir magique, la jeune
fille surmonta son émotion et s’enfuit dans
l’oratoire où étaient les saintes images. Les deux
cousins se mirent à rire et, en entrant, Ibarra put entendre le
bruit d’une porte qui se fermait.
Pâle, la respiration haletante, la jeune fille, comprimant son
sein palpitant, s’approcha de la porte et tendit l’oreille.
C’était bien sa voix, cette voix tant de fois entendue en
rêve, cette voix tant aimée! il s’informait
d’elle! Folle de joie, elle embrassa le saint qui se trouvait
à côté d’elle; c’était Saint
Antoine Abad! Heureux Saint Antoine, vivant ou sculpté en bois,
toujours l’objet des plus charmantes tentations!
Ensuite elle chercha un observatoire, le trou de la serrure. Quand
sa tante vint la tirer de sa contemplation, sans savoir pourquoi, elle
se jeta au cou de la bonne dame et l’embrassa à plein
cœur.
—Mais, grande sotte! qu’est-ce qui te prend? gronda la
vieille en essuyant une larme.
Maria Clara honteuse se couvrit la figure de son bras arrondi.
—Allons, va te faire belle, va! ajouta la tante d’une
voix caressante; pendant qu’il parle de toi avec ton
père... viens, ne te fais pas attendre.
La jeune fille se laissa emmener comme une enfant et toutes deux
s’enfermèrent dans leur chambre.
Capitan Tiago et Ibarra parlaient avec animation quand apparut la
tante Isabel, traînant à demi sa nièce dont les
regards errants se fixaient sur tout, excepté sur les
personnes...
Que se dirent ces deux âmes lorsqu’elles
communiquèrent par le langage des yeux, plus parfait que celui
des lèvres, langage donné à l’âme pour
que le son ne trouble pas l’extase du sentiment? En ces instants,
[47]quand
les pensées de deux êtres heureux se mêlent au
travers des pupilles, la parole est lente, grossière,
débile, elle est comme le bruit rauque et lourd du tonnerre
comparé à l’éblouissante lumière et
à la rapidité de l’éclair; elle exprime un
sentiment déjà connu, une idée déjà
comprise, et si on l’emploie, c’est que l’ambition du
cœur qui domine tout l’être et qui déborde de
joie veut que tout l’organisme humain, avec toutes ses
facultés physiques et psychiques, répète le
poème de joie qu’entonne l’esprit. A la question
amoureuse que pose un regard qui brille ou se voile, seuls peuvent
répondre les sourires, les soupirs et les baisers.
Et ensuite, lorsque le couple amoureux, fuyant le plumeau de la
tante Isabel qui soulevait la poussière de tous
côtés, se réfugia sur la terrasse et qu’ils
purent causer en liberté, que se contèrent-ils avec des
murmures dont vous frémissiez, petites fleurs rouges du cabello
de angel2?
Le ciel était bleu, une fraîche brise agitait les
feuilles et les fleurs et faisait frémir les cabellos de angel,
les plantes aériennes et les multiples ornements de la terrasse.
Le bruit d’un saguan3 qui troublait les eaux bourbeuses de la
rivière, celui des voitures et des charrettes passant sur le
pont de Binondo arrivait distinctement jusqu’à eux. Mais
ils n’entendaient pas la voix trop faible de la tante Isabel qui
leur disait tout bas:
—Vous êtes bien ici, là vous seriez
surveillés par tout le voisinage.
D’abord ils ne se dirent que ces futilités douces et
charmantes, si douces et si charmantes pour ceux qui les disent et les
entendent, si insignifiantes pour les indifférents.
Elle est sœur de Caïn, c’est-à-dire jalouse;
aussi demande-t-elle à son fiancé:
[48]
—As-tu toujours pensé à moi? ne m’as-tu
pas parfois oublié dans tous tes voyages, dans tant de grandes
villes où sont tant de belles femmes...?
Lui aussi est frère de Caïn, un peu menteur et sachant
éluder les questions embarrassantes:
—Pourrais-je t’oublier? répondit-il en regardant
comme extasié les noires pupilles de la jeune fille; pourrais-je
manquer à un serment, à un serment sacré? Te
souviens-tu de cette nuit de tempête où, me voyant seul
pleurer près du cadavre de ma mère, tu t’approchas
de moi, tu posas ta main sur mon épaule, ta main que depuis
longtemps déjà tu ne me laissais plus prendre.
«Tu as perdu ta mère,» me dis-tu, «je
n’en ai jamais eu...» et tu pleuras avec moi. Tu
l’aimais et elle t’aimait comme une fille. Dehors la pluie
tombait, les éclairs brillaient, mais il me semblait entendre
une douce harmonie et voir sourire le visage pâli de la morte...!
O si mes parents vivaient et pouvaient te voir maintenant! Alors moi je
pris ta main et celle de ma mère, je jurai de t’aimer, de
te faire heureuse quel que soit le sort que le ciel me
réservât, et comme ce serment ne m’a jamais
causé de regrets, aujourd’hui je le renouvelle. Pouvais-je
t’oublier? Ton souvenir ne m’a jamais abandonné, il
m’a sauvé des périls du chemin, il a
été ma consolation dans la solitude où se trouvait
mon âme en ces lointains pays; il a rendu impuissant le lotus
d’Europe, la fleur d’oubli qui chasse de la mémoire
de beaucoup de nos compatriotes les espérances et les malheurs
de la Patrie! Dans mes rêves, je te voyais debout, sur la plage
de Manille, regardant l’horizon lointain encore enveloppé
dans la tiède lumière de l’aurore;
j’écoutais un chant langoureux et mélancolique qui
réveillait en moi des sentiments endormis et évoquait
dans mon cœur l’image des premières années de
mon enfance, nos joies, nos jeux, tout l’heureux passé que
je vécus par toi lorsque tu étais à San Diego. Il
me semblait parfois que la fée, le génie,
l’incarnation poétique de cette Patrie,
c’était [49]toi, belle, simple, aimable, candide fille des
Philippines, de ce beau pays qui unit les vertus d’un peuple
jeune aux grandes qualités de la Mère Espagne, comme
s’unissent en tout ton être la grâce et la
beauté des deux races; et par là, l’amour que
j’ai pour toi et celui que j’ai voué à ma
Patrie se fondent en un seul... Pouvais-je t’oublier? Que de fois
j’ai cru entendre le son de ton piano ou les accents de ta voix!
En Allemagne, à la chute du jour, lorsque trop rarement les
trilles variées du rossignol venaient charmer mon oreille,
c’était ta présence qui inspirait le céleste
chanteur. Si j’ai pensé à toi! la fièvre de
ton amour donnait une âme aux brouillards et réchauffait
les glaces de ces pays du Nord. En Italie, le beau ciel azuré,
par sa limpidité et par sa profondeur me parlait de tes yeux,
les gracieux paysages me redisaient ton sourire, comme les campagnes
d’Andalousie, embaumées d’aromes, peuplées de
souvenirs orientaux, remplies de couleur et de poésie,
m’entretenaient de ton amour.
Dans les nuits de lune, de cette somnolente lune d’Europe, je
me demandais, voguant dans une barque sur le Rhin, si je ne pourrais
pas tromper ma fantaisie pour te voir apparaître entre les
peupliers de la rive, assise sur le rocher de la Lorelay ou bien
chantant au milieu des ondes, dans le silence de la nuit, comme la
jeune fée des consolations chargée d’égayer
la solitude et la tristesse de ces vieux châteaux ruinés.
J’errais par les bois peuplés des fantastiques
créatures, filles des poètes, remplis des
mystérieuses légendes des générations
passées; je prononçais ton nom, je croyais te voir dans
la brume s’élevant du fond de la vallée, je croyais
t’écouter dans le murmure des feuilles et, quand les
paysans revenant du travail faisaient entendre au loin leurs refrains
populaires, il me semblait que ces accords s’harmonisaient avec
mes voix intérieures, qu’ils chantaient pour toi,
qu’ils donnaient une réalité à mes illusions
et à mes rêveries. Parfois, je me perdais dans les
sentiers des montagnes et la nuit qui, là-bas, descend [50]très
lentement, me trouvait encore vaguant, cherchant mon chemin entre les
pins, les hêtres et les chênes; si quelque rayon de lune se
glissait entre les branches touffues, je croyais te voir au milieu du
bois comme une ombre vague, tour à tour paraissant à la
lumière et se cachant dans les épaisses
ténèbres des profonds taillis!
—Je n’ai pas voyagé comme toi, je ne connais rien
de plus que ton pueblo, Manille et Antipolo, répondit-elle en
souriant, car elle croyait jusqu’au moindre mot tout ce
qu’il lui avait raconté, mais depuis que je t’ai dit
adieu, que je suis entrée au couvent, toujours je me suis
souvenue de toi et, bien que mon confesseur me l’ait souvent
commandé et que cela m’ait valu nombre de
pénitences, jamais je n’ai pu t’oublier. Je me
souvenais de nos jeux, de nos querelles quand nous étions
enfants. Tu choisissais les plus beaux sigüeyes4 pour jouer au
siklot, tu cherchais dans la rivière les cailloux les plus
ronds et les plus fins, ceux qui s’ornaient des plus belles
couleurs, pour jouer au sintak5; tu étais très
lourd, tu perdais toujours et, pour châtiment, je te donnais le
bantil6
avec la paume de la main, pas fort, car j’avais pitié de
toi. Au jeu de la chouka7, tu étais très tricheur, plus
encore que moi, et tout cela finissait par des brouilles. Te
rappelles-tu ce jour où tu te fâchas pour de bon?
J’en eus alors beaucoup de peine, mais depuis, lorsqu’au
couvent ces souvenirs me revenaient à la mémoire, je
souriais, je te cherchais pour nous disputer encore... et faire la paix
ensuite, et je ne te trouvais pas. Nous étions encore des
enfants; avec ta mère, nous allions nous
[51]baigner dans le ruisseau,
à l’ombre des roseaux. Sur les rives, croissaient des
fleurs et des plantes nombreuses, dont, fier de la science que
déjà tu acquérais à
l’Athénée, tu me disais les noms étranges en
latin et en castillan. Je ne t’écoutais pas;
j’étais trop occupée à poursuivre les
papillons et les libellules dont le corps, fin comme une
épingle, brille de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel,
de tous les reflets de la nacre, qui pullulent, se mêlent, se
poursuivent parmi les fleurs. Parfois, avec la main, je voulais
surprendre et saisir les petits poissons qui se glissaient rapides
entre la mousse et les cailloux de la rive. Toi, tu
n’étais plus là; quand tu revins, tu
m’apportas une couronne de feuilles et de fleurs d’oranger
que tu posas sur ma tête en m’appelant Chloé; tu
t’en étais fait une autre pour toi avec des plantes
grimpantes. Mais ta mère prit ma couronne, la broya avec une
pierre et en mélangea les débris avec le gogo8 dont elle devait se
servir pour laver notre chevelure: les larmes jaillirent de tes yeux et
tu lui reprochas de ne rien comprendre à la
mythologie:—«Sot! répliqua ta mère, tu verras
comme vos cheveux sentiront bon!» Moi, je ris, tu te fâchas
de mes rires et ne voulus plus me parler de la journée; ta
rancune me donna à mon tour envie de pleurer. De retour au
pueblo, comme le soleil était très ardent, je cueillis
des feuilles de sauge croissant au bord du chemin et te les donnai pour
que tu les misses dans ton chapeau afin d’éviter les maux
de tête. Tu me fis comprendre par un sourire ta reconnaissance de
cette attention, alors je te pris la main et, bien vite, nous
étions réconciliés.
Ibarra souriait de bonheur; il ouvrit son portefeuille, en tira un
papier dans lequel étaient enveloppées quelques feuilles
noirâtres, desséchées, mais parfumées
encore.
—Tes feuilles de sauge! répondit-il au regard
qu’elle [52]tournait vers lui; c’est là tout ce
que tu m’as donné!
A son tour, elle sortit rapidement de son corsage une petite bourse
de satin blanc.
—Fi! dit-elle en lui donnant une chiquenaude sur la main; on
ne touche pas! c’est une lettre d’adieux.
—Est-ce celle que je vous ai écrite avant de
partir?
—M’en avez-vous écrit d’autres,
Señor mio?
—Et, que te disais-je alors?
—Beaucoup de mensonges, des excuses de mauvais payeur!
répondit-elle souriante et laissant voir que ces mensonges
n’avaient rien qui lui fût désagréable. Reste
sage! je te la lirai, mais je supprimerai tes galanteries pour ne pas
te faire trop souffrir.
Et levant le papier pour cacher sa figure elle commença:
«Ma...», je ne te lis pas ce qui suit parce que
c’est un mensonge! et, des yeux, elle parcourut quelques lignes.
«Mon père veut que je parte malgré toutes mes
prières.—Tu seras un homme, m’a-t-il dit, tu dois
apprendre à penser à l’avenir et aux devoirs
qu’il t’impose. Tu dois apprendre la science de la vie, que
ta patrie ne peut te donner, afin de pouvoir lui être utile un
jour. Si tu restes à mes côtés, à mon ombre,
dans cette atmosphère de préoccupations
journalières, tu ne sauras jamais regarder au loin, et le jour
où je te manquerai, tu te trouveras comme la plante dont parle
notre poète Baltazar «crue dans l’eau, quand
l’eau lui manque ses feuilles se flétrissent peu à
peu, un instant de chaleur achève de la dessécher.»
Vois! tu es presque un jeune homme et tu pleures encore!—Ce
reproche me fut sensible et je confessai alors à mon père
mon amour pour toi. Il se tut, réfléchit et me posant la
main sur l’épaule, me dit d’une voix
tremblante:—Crois-tu que toi seul saches aimer, que ton
père ne t’aime pas aussi, qu’il ne lui coûte
rien de se séparer de toi? Il y a peu nous avons perdu ta
mère. Déjà je m’approche de la vieillesse,
de cet âge où l’on cherche l’appui et les
consolations de la jeunesse, et [53]cependant, j’accepte ma solitude, je
cours le risque de ne plus te revoir! Mais d’autres
pensées plus hautes doivent guider ma conduite... Pour toi,
l’avenir s’ouvre, il se ferme pour moi; tes amours
naissent, les miennes se meurent; le feu bout dans ton sang, le froid
pénètre dans le mien et c’est toi qui pleures,
c’est toi qui ne sais pas sacrifier le présent à un
lendemain utile pour toi et pour ton pays!—Les yeux de mon
père se remplirent de larmes, je tombai à genoux à
ses pieds, je l’embrassai, lui demandai pardon et lui dis que
j’étais prêt à partir...»
L’agitation d’Ibarra la força d’interrompre
cette lecture; le jeune homme était devenu très
pâle, il allait et venait d’un côté à
l’autre.
—Qu’as-tu? es-tu malade? lui demanda-t-elle.
—Tu m’as fait oublier que j’ai des devoirs
à remplir et que je dois partir de suite pour le pueblo: demain
est la fête des morts!
Maria Clara se tut. Elle fixa sur lui ses grands yeux songeurs et,
cueillant quelques fleurs:
—Va! lui dit-elle d’une voix émue, je ne te
retiens plus. Dans quelques jours nous nous reverrons. Dépose
ces fleurs sur la tombe de tes parents.
Quelques minutes après, tandis que Maria Clara
s’enfermait dans l’oratoire, Crisóstomo
accompagné de Capitan Tiago et de la tante Isabel descendait
l’escalier.
—Faites-moi le plaisir de dire à Andeng qu’elle
prépare la maison, que Maria Clara et Isabel vont arriver. Bon
voyage! dit Capitan Tiago à Ibarra qui montait dans la voiture
et s’éloignait dans la direction de la place San
Gabriel.
Puis, voyant Maria Clara pleurant et priant aux pieds d’une
image de la Vierge:
—Allons! lui dit-il pour la consoler, brûle deux cierges
de deux réaux chacun, l’un au seigneur saint Roch,
l’autre au seigneur saint Raphaël, patron des voyageurs!
Allume la lampe de Nuestra Señora de la
[54]Paz y Buenviaje, car les
tulisanes sont nombreux et mieux vaut dépenser quatre
réaux de cire et six cuartos d’huile que leur payer une
grosse rançon.
[Table
des matières]
VIII
Souvenirs
La voiture d’Ibarra parcourait une partie du faubourg le plus
vivant de Manille; ce qui le rendait triste la nuit
précédente le faisait sourire, malgré son chagrin,
à la lumière du jour.
L’animation qui bouillait de toutes parts, tant de voitures au
galop courant en tous sens, les charrettes, les calèches, les
Européens, les Chinois, les indigènes, le mélange
des costumes, les vendeuses de fruits, les commissionnaires, le
débardeur à demi-nu, les échoppes de victuailles,
les auberges, les restaurants, les boutiques, jusqu’aux chariots
traînés par le bœuf carabao indifférent et
impassible qui semble se distraire par des dissertations philosophiques
tout en tirant de lourds fardeaux, le bruit, le roulement des voitures,
le soleil lui-même, une certaine odeur particulière, les
couleurs bigarrées, tout réveillait dans sa
mémoire un monde de souvenirs endormis.
Ces rues n’étaient pas encore pavées. Aussi le
soleil brillait-il deux jours de suite, elles se convertissaient en une
poussière qui recouvrait tout, transperçait tout,
attaquait la gorge et les yeux des passants; au contraire, pleuvait-il
une journée, c’était un marais où la nuit se
reflétaient les lanternes des voitures qui, à cinq
mètres de distance, éclaboussaient les piétons sur
les trottoirs étroits. Que de femmes avaient laissé leurs
souliers brodés dans ces vagues de boue! En ce moment des
forçats en file étaient occupés à damer les
rues; la tête rase, vêtus d’une chemise à
manches [55]courtes et d’un caleçon tombant
jusqu’au genou, leurs effets marqués de chiffres et de
lettres bleues, ils portaient aux jambes des chaînes à
demi-enveloppées de chiffons sales afin d’atténuer
le frottement et peut-être aussi le bruit du fer. Ils
travaillaient, attachés deux à deux, grillés par
le soleil, énervés par la chaleur et la fatigue,
harcelés et rossés par l’un d’entre eux qui,
armé d’une verge, se consolait en maltraitant à son
tour ses malheureux camarades. C’étaient des hommes de
haute taille, de physionomie sombre que n’éclairait jamais
la lueur d’un sourire; cependant, leurs yeux brillaient quand la
verge sifflait et tombait sur les épaules ou bien quand un
passant leur jetait le bout d’un cigare à demi
mâché et déroulé: celui qui était le
plus près le ramassait et le cachait dans son salakot1: les autres,
immobiles, regardaient les passants avec une expression étrange.
Ibarra croyait entendre encore le bruit qu’ils faisaient en
broyant la pierre pour remplir les vides du pavé et le tintement
léger des chaînes pesantes rivées à leurs
chevilles enflées. Il se rappelait avec émotion une
scène qui avait blessé son esprit d’enfant:
c’était une après-midi, le soleil laissait tomber
d’aplomb ses rayons les plus chauds. A l’ombre d’un
tombereau de bois gisait un de ces hommes; il était
inanimé, les yeux encore entr’ouverts; les autres
silencieux, sans un signe de colère ou de douleur, arrangeaient
patiemment—selon ce qui passe pour être le caractère
des indigènes—une civière de roseaux.
«Aujourd’hui toi, demain nous», semblaient-ils dire
entre eux. Autour d’eux, sans se soucier de rien, chacun allait
et venait; les femmes passaient, regardaient et continuaient leur
route, le spectacle était trop commun pour attirer
l’attention, sa fréquence endurcissait les cœurs;
les voitures couraient, reflétant dans leur caisse vernie les
rayons du soleil qui brillait dans un ciel sans nuages. [56]Lui seul, enfant de
onze ans, arrivant de son pueblo, ressentit une émotion profonde
et ne dormit pas la nuit suivante.
L’excellent et honorable pont de bateaux, ce pont bien
philippin qui faisait tout son possible pour être utile
malgré ses imperfections naturelles et s’élevait ou
s’abaissait selon les caprices du Pasig, ce brave pont
qui plus d’une fois avait été maltraité et
détruit par le fleuve, n’existait plus.
Les amandiers de la place San Gabriel toujours chétifs et
malingres, n’avaient pas grandi.
La Escolta lui parut moins belle, bien qu’un grand
édifice orné de cariatides eût remplacé les
anciennes Camarines2. Le nouveau Pont d’Espagne appela son
attention; à l’endroit où se termine la Escolta et
où commence l’île du Romero, les maisons
espacées sur la rive droite de la rivière parmi les
roseaux et les arbres lui faisaient se souvenir des fraîches
matinées où il passait là en barque, se rendant
aux bains de Ulî-Ulî. Il rencontrait de nombreuses voitures
tirées par de magnifiques attelages de petits chevaux nains;
dans ces voitures se prélassaient des employés se rendant
à leur bureau sommeillant encore à demi, des militaires,
des Chinois infatués et ridicules, de graves moines, des
chanoines, etc. Dans une élégante victoria, il crut
reconnaître le P. Dámaso, sérieux, le front
plissé, mais la victoria fila rapide; d’une voiture
découverte où il était accompagné de sa
femme et de ses deux filles, Capitan Tinong le salua amicalement.
Le pont dépassé, les chevaux prirent le trot vers la
promenade de la Sabana. A droite la fabrique de tabacs de Arroceros
faisait entendre le bruit des cigarières frappant les feuilles.
Ibarra ne put s’empêcher [57]de sourire en se rappelant cette
odeur forte qui, vers cinq heures de l’après-midi,
saturait le Pont de Bateaux et lui donnait la nausée
lorsqu’il était enfant. Les conversations animées,
les plaisanteries bruyantes emportaient son imagination vers le
quartier de Lavapiés à Madrid, vers ses émeutes de
cigarières si fatales aux malheureux guindillas3.
Le jardin botanique chassa ces agréables souvenirs. Le
démon des comparaisons le replaça devant les jardins
botaniques d’Europe où, pourtant, il faut dépenser
tant de patience, tant de soins et tant d’argent pour
qu’une feuille pousse et que s’ouvre le calice d’une
fleur; il revit même ceux des colonies, tous riches, bien
soignés et ouverts au public. Puis il détourna son regard
vers la droite et l’antique Manille, encore enfermée dans
ses fossés et ses murailles, lui fit l’effet d’une
jeune anémique affublée d’un costume datant des
beaux jours de son aïeule.
Au delà, la mer immense se perdait au loin!...
—Là-bas, de l’autre côté, est
l’Europe! pensait le jeune homme, l’Europe et ses belles
nations en perpétuel mouvement, recherchant le bonheur, faisant
tous les matins de nouveaux rêves dont elles se détrompent
au coucher du soleil... toujours heureuses au milieu de toutes les
catastrophes! Oui, là-bas, par delà la mer infinie, sont
les véritables patries spirituelles, bien qu’elles ne
condamnent pas la matière et qu’elles ne se flattent pas
d’adorer uniquement l’esprit...!
Mais il vit devant lui la petite colline du camp de Bagumbayan4 et toute autre
pensée s’enfuit de son imagination. Le monticule
isolé, près de la promenade de la Luneta, attirait seul
son attention et s’imposait à ses méditations.
Il pensait à l’homme qui avait ouvert les yeux de [58]son
intelligence, qui lui avait appris à distinguer le bon et le
juste. Les idées qu’il lui avait inculquées ne
constituaient pas un lourd bagage, mais ce n’étaient pas
de vaines répétitions de banales formules;
c’étaient des convictions qui n’avaient pas
pâli à la lumière des plus ardents foyers du
Progrès. C’était un vieux prêtre... ce saint
homme était mort là!...
A toutes ces apparitions il répondait en murmurant à
voix basse:—Non, malgré tout, d’abord la Patrie,
d’abord les Philippines, filles de l’Espagne, d’abord
la patrie espagnole! Non, ce qui ne se peut empêcher ne saurait
ternir la gloire de la Patrie!
Il passa indifférent devant la Hermita, Phénix en bois
de nipa, qui renaissait de ses cendres et étalait de nouveau ses
maisons blanches et bleues couvertes de toits de zinc peints en rouge.
Son attention ne fut pas non plus éveillée ni par Malate,
ni par le quartier de cavalerie, ni par les arbres qui lui font face,
ni par les habitants, ni par leurs petites maisons de nipa dont les
toits plus ou moins pyramidaux ou prismatiques ressemblent à des
nids cachés parmi les platanes et les bongas5.
La voiture roule toujours. Elle croise un chariot tiré par
deux chevaux dont les harnais d’abaka6 décèlent
l’origine provinciale. Le charretier fait de son mieux pour voir
le voyageur qu’emporte le brillant attelage et passe sans dire un
mot, sans un salut. Parfois, la longue et poudreuse chaussée,
baignée par l’éclatant soleil des tropiques,
s’anime du pas lent et lourd d’un carabao pensif
traînant un pesant tombereau dont le [59]conducteur, juché sur sa
peau de buffle, accompagne de son chant monotone et mélancolique
le strident grincement des roues frottant sur l’énorme
essieu; parfois aussi c’est le bruit sourd des patins usés
d’un paragos, ce traîneau des Philippines,
embarrassé parmi la poussière et les flaques d’eau
de la route. Dans les champs, paissent les troupeaux parmi lesquels de
blancs hérons se promènent gravement, quelques-uns
tranquillement se posent sur le dos de bœufs somnolents,
savourant béats les herbes de la prairie; au loin sautent et
courent les juments, poursuivies par un jeune poulain bouillant
d’ardeur, livrant au vent sa longue et abondante crinière,
hennissant et frappant la terre de ses puissants sabots.
Laissons le jeune homme rêver endormi à moitié
dans la voiture qui l’emporte. Animée ou
mélancolique, la poésie de la campagne ne le distrait pas
de ses pensées. Ce soleil qui fait briller les cimes des arbres
et courir les paysans dont le sol échauffe et brûle les
pieds à travers leurs épaisses chaussures; ce soleil qui
arrête la paysanne à l’ombre d’un amandier ou
d’un bouquet de gigantesques roseaux et la fait penser à
des choses vagues et inexplicables, ce soleil n’a plus
d’enchantement pour lui.
Tandis que, chancelant comme un homme ivre, la voiture roule sur le
terrain accidenté, qu’elle passe sur un pont de bambous,
qu’elle monte la côte rude ou descend la pente rapide,
retournons à Manille.
[Table
des matières]
IX
Choses du pays
Ibarra ne s’était pas trompé.
C’était bien le P. Dámaso qu’il avait vu dans
une victoria se dirigeant vers la maison dont lui-même venait de
sortir. [60]
Maria Clara et la tante Isabel se disposaient à monter dans
une voiture rehaussée d’ornements d’argent quand le
moine arriva.
—Où alliez-vous? leur demanda-t-il; et, au milieu de sa
préoccupation, il donnait de petites tapes légères
sur les joues de la jeune fille.
—Nous allions au couvent, chercher mes effets, répondit
celle-ci.
—Ah! ah! c’est bien! nous allons voir qui sera le plus
fort, nous allons voir... murmura-t-il distrait en laissant là
les deux femmes quelque peu surprises. Et la tête basse, il gagna
l’escalier d’un pas lent et monta.
—Il prépare quelque sermon et probablement il
l’apprend par cœur! dit la tante Isabel; monte, Maria, nous
arriverons trop tard.
Nous ne saurions dire si le P. Dámaso préparait un
sermon, mais son attention devait être absorbée par des
choses bien importantes, car il ne tendit pas la main à Capitan
Tiago qui dut faire une demi-génuflexion pour la baiser.
—Santiago! lui dit-il tout d’abord, nous avons à
causer très sérieusement; allons dans ton bureau.
Capitan Tiago se sentit inquiet; il ne put répondre, mais
obéit et suivit docilement le gigantesque prêtre qui,
derrière lui, ferma la porte.
Tandis qu’ils s’entretiennent en secret, voyons ce
qu’est devenu Fr. Sibyla.
Le savant dominicain n’était pas au presbytère;
de très bonne heure, sitôt sa messe dite, il
s’était mis en chemin vers le couvent de son ordre
situé à l’entrée de la ville, près de
la porte qui, selon la famille régnante à Madrid, porte
tour à tour les noms d’Isabelle II et de Magellan.
Sans s’occuper de la délicieuse odeur de chocolat ni du
bruit des tiroirs et des monnaies qui venaient de la procuration et
répondant à peine au salut respectueux du frère
procureur, Fr. Sibyla monta, traversa quelques couloirs et des doigts
frappa à une porte. [61]
—Entrez! soupira une voix.
—Dieu réserve la santé à Votre
Révérence! dit en entrant le jeune dominicain.
Assis dans un grand fauteuil, on voyait un vieux prêtre
décharné, quelque peu jauni, semblable à ces
saints que peignit Rivera. Les yeux se creusaient dans leurs orbites
profondes couronnées de sourcils épais qui, toujours
contractés, augmentaient encore l’éclat des
prunelles moribondes.
P. Sibyla le regarda ému; les bras croisés sur le
vénérable scapulaire de saint Dominique. Puis il inclina
la tête et, en silence, parut attendre.
—Ah! soupira le malade, on me conseille
l’opération! l’opération, à mon
âge! oh! ce pays, ce terrible pays! Tu vois ce qu’il fait
de nous tous, Hernando!
Fr. Sibyla levant lentement les yeux, les fixa sur la physionomie du
malade.
—Et qu’a décidé Votre
Révérence? demanda-t-il.
—De mourir! Puis-je faire autre chose? Je souffre trop,
mais... j’ai fait souffrir beaucoup... je paye ma dette! et toi?
comment vas-tu? qu’apportes-tu?
—Je venais vous parler de ce dont vous m’aviez
chargé.
—Ah! et qu’y a-t-il à ce propos?
—On nous a raconté des histoires, répondit avec
ennui le jeune moine qui s’assit et détourna le regard; le
jeune Ibarra est un garçon prudent; il ne me paraît pas
bête, mais je le crois un brave homme.
—Tu le crois?
—Les hostilités ont commencé hier soir.
—Ah! et comment?
Fr. Sibyla raconta brièvement ce qui s’était
passé entre le P. Dámaso et Crisóstomo.
—De plus, ajouta-t-il en concluant, le jeune homme se marie
avec la fille de Capitan Tiago dont l’éducation a
été faite à la pension de nos sœurs; il est
riche, il ne voudra pas se faire d’ennemis et compromettre
à la fois son bonheur et sa fortune. [62]
Le malade remua la tête en signe d’assentiment.
—Oui, tu as raison, avec une telle femme et un tel
beau-père, il est à nous corps et âme. Si, au
contraire, il se déclare notre ennemi, tant mieux!
Fr. Sibyla regarda le vieillard avec surprise.
—Pour le bien de notre sainte corporation, s’entend,
ajouta-t-il en respirant avec difficulté; je
préfère les attaques aux louanges et aux adulations des
amis... il est vrai que ceux-ci sont payés.
—Votre Révérence croit-elle cela?
Le vieillard le regarda attristé.
—Rappelle-toi bien ceci! répondit-il, la respiration
entrecoupée. Notre pouvoir durera tant qu’on croira en
lui. Si l’on nous attaque, le gouvernement se dit: on les combat
parce qu’on voit en eux un obstacle à la liberté,
donc conservons-les.
—Et si le Gouvernement prêtait l’oreille à
nos ennemis, si parfois...
—Il ne le fera pas!
—Cependant si, entraîné par la cupidité,
il en arrivait à vouloir pour lui ce que nous avons
amassé... s’il se trouvait un homme hardi, un
téméraire...
—Alors, gare à lui!
Tous deux gardèrent le silence.
—D’ailleurs, continua le malade, nous avons besoin
qu’on nous attaque, qu’on nous réveille; cela nous
découvre nos défauts et nous améliore. Les
louanges exagérées nous trompent, nous endorment; au
dehors, elles nous rendent ridicules, et le jour où nous
deviendrons ridicules, nous tomberons comme nous sommes tombés
en Europe. L’argent alors ne rentrera plus dans nos
églises, personne n’achètera plus ni scapulaires,
ni cordes de pénitence, ni rien, et quand nous cesserons
d’être riches, nous ne pourrons plus convaincre les
consciences.
—Bah! nous aurons toujours nos fermes, nos plantations.
—Nous perdrons tout comme nous avons tout perdu [63]en Europe! Et le
pire est que nous-mêmes travaillons à notre propre ruine.
Par exemple: cette soif démesurée de gain qui nous fait
chaque année élever arbitrairement le prix de nos
terrains; cette soif de gain qu’en vain j’ai combattue dans
tous les chapitres, cette soif nous perd! L’Indien se voit
obligé d’acheter à d’autres des terres
qu’il trouve aussi bonnes sinon meilleures que les nôtres.
Je crains que nous ne commencions déjà à baisser.
Dieu aveugle ceux qu’il veut perdre. Il est temps, le peuple
murmure déjà, n’augmentons pas encore le poids dont
nous lui pesons sur les épaules. Ta pensée était
bonne; laissons les autres arranger là-bas leurs affaires,
conservons le prestige qui nous reste et puisque, d’ici peu, nous
devons comparaître devant Dieu, lavons-nous les mains... Que le
Dieu des miséricordes ait pitié de nos
défaillances!
—De sorte que Votre Révérence croit que le
revenu...
—Ne parlons plus d’argent! interrompit le vieillard avec
une certaine aversion. Tu disais que le lieutenant avait menacé
le P. Dámaso...!
—Oui, Père! répondit en souriant à demi
Fr. Sibyla. Mais je l’ai vu ce matin et il m’a dit
qu’il était fâché de ce qui
s’était passé hier soir; que le Xérès
lui avait monté à la tête, qu’il croyait
qu’il en avait été de même pour le P.
Dámaso.—Et la menace? lui demandai-je en plaisantant.
«Père curé, me dit-il, je sais accomplir ma parole
quand elle n’entache pas mon honneur; je ne suis pas, je
n’ai jamais été un délateur et c’est
pourquoi je ne suis que lieutenant.»
Après avoir parlé de diverses choses insignifiantes,
Fr. Sibyla se retira.
En effet, le lieutenant n’avait pas été à
Malacanan1,
mais le capitaine général n’en avait pas moins
appris ce qui s’était passé.
Comme il s’entretenait avec ses aides de camp des allusions
que les journaux de Manille y faisaient sous forme de discussion entre
des comètes et des apparitions [64]célestes, un de ses jeunes
officiers lui rapporta la sortie du P. Dámaso, non sans charger
un peu les couleurs tout en se servant d’une forme plus
correcte.
—De qui le savez-vous? demanda Son Excellence en souriant.
—De Laruja, qui le racontait ce matin à la
rédaction.
Le capitaine général sourit de nouveau et il
ajouta:
—Langue de femme, langue de moine, cela ne blesse pas! Je veux
vivre en paix le temps qui me reste à passer ici et je ne tiens
pas à m’attirer des histoires avec ces hommes en jupes.
Bien plus! je sais que le provincial s’est moqué de mes
ordres; pour punir ce moine je lui avais demandé de le changer
de paroisse, eh bien! il l’a envoyé dans un autre pueblo
meilleur. Ce sont là des moineries, comme nous disons en
Espagne!
Mais quand Son Excellence se trouva seule, elle cessa de
sourire.
—Ah! si le peuple n’était pas si stupide, comme
on les briderait mes Révérences! dit-il. Mais chaque
peuple mérite son sort et nous ne faisons que ce que fait tout
le monde.
Entre temps, Capitan Tiago achevait sa conférence avec le P.
Dámaso ou, pour mieux dire, venait de recevoir ses ordres.
—Et maintenant tu es averti! disait le franciscain en
s’en allant. Tout cela aurait pu être évité
si tu m’avais consulté auparavant, si tu ne m’avais
pas menti quand je t’ai demandé ce qu’il en
était. Tâche de ne plus faire de bêtises et aie
confiance en son parrain!
Capitan Tiago fit deux ou trois tours dans la salle,
réfléchissant et soupirant. Puis, subitement, comme
s’il lui était survenu une bonne pensée, il courut
à l’oratoire et éteignit immédiatement les
cierges et la lampe qu’il avait fait allumer pour la sauvegarde
d’Ibarra.
—Il est encore temps et le chemin est bien long! murmura-t-il.
[65]
[Table des matières]
X
Le pueblo
Presque sur les rives du lac, au milieu de prairies et de
rivières, est le pueblo de San Diego1. Il exporte du sucre, du riz, du
café, des fruits ou bien vend à bas prix ces marchandises
à quelque Chinois qui exploite la simplicité ou les vices
des paysans.
Quand, par un ciel serein, les enfants grimpent au dernier
étage de la tour de l’église qu’ornent les
mousses et les plantes grimpantes, la beauté du panorama qui se
déroule à leurs yeux leur arrache de joyeuses
exclamations. Dans cet amoncellement de toits de nipa, de tuiles, de
zinc et de cabonegro2, séparés par des vergers et des
jardins, chacun sait retrouver sa petite maison, son petit nid.
Tout sert de repère, un arbre, le tamarin au feuillage
léger, le cocotier chargé de noix, un roseau flexible,
une bonga, une croix. Là-bas, c’est le rio, monstrueux
serpent de cristal endormi sur le vert tapis, dont le courant est
ridé de distance en distance par des fragments de rochers,
épars dans le lit sableux. Ici, ce lit se rétrécit
entre deux rives élevées où se cramponnent en se
contorsionnant des arbres aux racines dénudées; là
le courant se ralentit et les eaux s’élargissent et
dorment. Plus loin, une petite maison construite tout au bord
défie l’abîme, les eaux et les vents et, par ses
minces étais, donne l’impression d’un monstrueux
échassier qui épie le moment favorable pour se jeter sur
le reptile argenté. Des troncs de palmiers, des [66]arbres portant
encore leur écorce, branlants et vacillants, unissent les deux
rives et si, comme ponts, ils laissent à désirer, ce sont
en échange de merveilleux appareils de gymnastique pour exercer
aux équilibres. Plongés dans le rio où ils se
baignent, les enfants s’amusent des angoisses de la pauvre femme
qui passe, la tête chargée d’un lourd panier ou du
vieillard tremblant qui laisse tomber son bâton dans
l’eau.
Mais ce qu’il est impossible de ne pas remarquer, c’est
ce que nous pourrions appeler une péninsule boisée dans
cette mer de terre labourée. Il y a là des arbres
séculaires, au tronc creusé, qui ne meurent que lorsque
quelque éclair frappe leur cime hautaine; on dit qu’alors
le feu se circonscrit et s’éteint à l’endroit
même où il s’alluma; ailleurs sont des roches
énormes que le temps et la nature ont revêtues d’un
velours de mousse: la poussière se dépose couche par
couche dans les creux de leur tronc, la pluie la fixe et les oiseaux
apportent des graines. La végétation tropicale s’y
développe librement: buissons, broussailles, rideaux de lianes
entrelacées, passant d’un arbre à l’autre, se
suspendant aux branches, s’accrochant aux racines, au sol et,
comme si Flore n’était pas encore satisfaite, elle
sème sur les plantes; des mousses et des champignons vivent sur
les écorces crevassées et des plantes aériennes,
hôtes gracieux, confondent leurs embrassements avec les feuilles
de l’arbre hospitalier.
Ce bois était respecté: il était le sujet
d’étranges légendes, mais la plus vraisemblable, et
par suite la moins crue et la moins connue, paraît être la
suivante.
Quand le pueblo n’était qu’un misérable
amas de cabanes dans les rues duquel l’herbe croissait encore et
où, la nuit, se risquaient les cerfs et les sangliers, arriva un
jour un vieil Espagnol aux yeux profonds qui parlait assez bien le
tagal. Après avoir parcouru et visité les divers
terrains, il s’informa des propriétaires du bois dans
lequel jaillissaient des eaux thermales. Quelques-uns se
présentèrent qui tous prétendaient [67]à cette
propriété et le vieil Espagnol s’en rendit
possesseur en échange de costumes, de bijoux et aussi de quelque
argent. Ensuite, sans que l’on sût pourquoi ni comment, il
disparut. Les gens du pueblo le croyaient déjà
enchanté quand une odeur fétide qui partait du bois
voisin fut remarquée par quelques pasteurs; ils
cherchèrent et trouvèrent le cadavre du vieillard,
putréfié, pendu à une branche de balitî3. Vivant, sa
voix profonde et caverneuse, ses yeux creux et son rire muet
inspiraient déjà une certaine crainte, mais maintenant,
mort et suicidé, il troublait le sommeil des femmes. Parmi
celles qui avaient reçu quelque chose de lui, il y en eut qui
jetèrent les bijoux à la rivière et
brûlèrent les costumes; après que le cadavre
eût été enterré au pied même du
balitî, personne ne voulut plus s’aventurer de ce
côté. Un pasteur qui cherchait des animaux
égarés de son troupeau raconta avoir vu des
lumières; de jeunes gars allèrent voir et entendirent des
plaintes. Un amoureux dédaigné qui, pour toucher le
cœur de la dédaigneuse, s’était engagé
à passer la nuit sous l’arbre, mourut d’une
fièvre subite qui le prit le lendemain même de son
exploit. D’autres contes, d’autres légendes
couraient encore sur cet endroit.
Peu de mois s’étaient écoulés
lorsqu’arriva un jeune homme, paraissant être un
métis espagnol, qui dit être le fils du défunt; il
s’établit en cet endroit, s’adonnant à
l’agriculture et surtout à la culture de l’indigo.
D. Saturnino était taciturne et de caractère violent,
parfois cruel, mais très actif et très travailleur; il
entoura d’un mur la tombe de son père que seul il visitait
de temps en temps. Plus avancé en âge, il se maria avec
une jeune fille de Manille de qui il eut D. Rafael, le père de
Crisóstomo.
D. Rafael, dès sa première jeunesse, se fit aimer des
paysans: l’agriculture importée et propagée par son
[68]père se développa rapidement; de
nouveaux habitants affluèrent, de nombreux Chinois vinrent, le
hameau fut promptement un village, il eut un curé
indigène; puis le village se fit pueblo, le curé indien
mourut et Fr. Dámaso le remplaça, mais toujours la
sépulture et le terrain qui l’entourait furent
respectés. Les enfants se risquaient parfois, armés de
bâtons et de pierres, à courir dans les environs pour
cueillir des goyaves et des fruits sauvages, papayas, lomboi4, etc.; il arrivait
que, au moment où leur cueillette les occupait tout entiers ou
bien lorsqu’ils contemplaient silencieux la corde se
balançant sous la branche, une ou deux pierres tombaient on ne
sait d’où; alors au cri: le vieux! le vieux! ils jetaient
fruits et bâtons, sautaient en bas des arbres, couraient entre
les roches et les buissons et ne s’arrêtaient
qu’après être sortis du bois, tous pâles, les
uns essoufflés, les autres pleurant, bien peu ayant le courage
de rire.
[Table des matières]
XI
Les souverains
Divisez et régnez.
Nouveau
Machiavel.
Quels étaient les caciques du pueblo?
Ce n’était pas D. Rafael pendant sa vie, bien
qu’il ait été le plus riche, qu’il ait
possédé le plus de terres et que presque tous lui aient
eu des obligations. Comme il était modeste et
s’efforçait de retirer toute valeur à ce
qu’il faisait, jamais un parti qui lui fut dévoué
ne se forma au pueblo, et nous avons vu comment tous se levèrent
contre lui aussitôt que sa fortune fut ébranlée.
[69]Serait-ce Capitan Tiago? Quand il arrivait, il
est vrai qu’il était reçu en musique par ses
débiteurs, ils lui donnaient un banquet et le comblaient de
cadeaux, les meilleurs fruits couvraient sa table; si l’on
chassait un cerf ou un sanglier, un quartier lui en était
réservé; s’il trouvait beau le cheval d’un de
ses débiteurs, une demi-heure après il le voyait dans son
écurie; sans doute, on lui prodiguait toutes ces marques de
respect et de dévouement, mais on riait de lui et, en secret on
l’appelait Sacristan Tiago.
Serait-ce par hasard le gobernadorcillo? Celui-là
était un malheureux qui ne commandait pas, il obéissait;
il ne régnait pas, on régnait sur lui; il ne disposait
pas, on disposait de lui; par contre, il devait répondre
à l’Alcalde Mayor de tout ce qu’on lui avait
commandé, ordonné, de tout ce dont on avait
disposé pour lui, comme si tout était sorti de son
idée; mais, ceci soit dit à son honneur, il n’avait
ni volé ni usurpé cette dignité, elle lui
coûtait cinq mille pesos et beaucoup d’humiliations et,
étant donné ce qu’elle lui rapportait, il trouvait
que c’était très bon marché.
Eh bien! mais alors, serait-ce Dieu?
Ah! le bon Dieu ne trouble ni les consciences ni le sommeil des
habitants de San Diego; il ne les fait même pas trembler et il
est certain que si, par hasard, en quelque sermon, on leur causait de
Lui, ils penseraient en soupirant: Si seulement il y avait un Dieu!...
Du bon Seigneur ils s’occupent peu; ils ont assez à faire
avec les saints et les saintes. Pour ces braves gens Dieu semble un de
ces pauvres rois qui s’entourent de favoris et de favorites; le
peuple n’adresse jamais ses suppliques qu’à eux,
jamais à lui.
San Diego était une sorte de Rome; non pas une Rome à
l’époque où ce fripon de Romulus traçait
avec une charrue l’emplacement des murailles, mais une Rome
contemporaine où, au lieu d’édifices de marbre et
de colisées, s’élèveraient des monuments de
saualî1
[70]et une
gallera de nipa. Le curé, c’était le pape au
Vatican; l’alférez de la garde civile, le roi
d’Italie au Quirinal, le tout naturellement en proportion avec le
saualî et la gallera de nipa. Ici, comme là-bas, des
difficultés naissaient de cette situation, car, chacun voulant
être le maître, trouvait que l’autre était de
trop.
Fr. Bernardo Salvi était ce jeune et silencieux franciscain
dont nous avons déjà parlé. Par ses habitudes et
ses manières il se distinguait beaucoup de ses frères et
plus encore de son prédécesseur, le violent P.
Dámaso. Il était mince, maladif, presque toujours pensif,
strict dans l’accomplissement de ses devoirs religieux et
soigneux de son bon renom. Un mois après son arrivée,
presque tous ses paroissiens se firent frères de la V. O. T.2 à la
grande tristesse de sa rivale, la Confrérie du Très
Saint-Rosaire. L’âme sautait de joie lorsqu’on
pouvait admirer suspendus à tous les cous quatre ou cinq
scapulaires, une corde à nœuds autour de toutes les
ceintures, et toutes ces processions de cadavres ou de fantômes
en habits de guingon. Le sacristain principal gagna un petit capital en
vendant—ou en donnant comme aumônes, ainsi que cela doit se
dire,—tous les objets nécessaires pour sauver
l’âme et combattre le diable. On sait que cet esprit qui,
autrefois se risquait à attaquer Dieu lui-même face
à face et mettait en doute la parole divine, comme il est dit au
saint livre de Job, qui emporta N.-S. Jésus-Christ dans les airs
comme il fit depuis au Moyen-Age avec les sorcières et comme il
continue, dit-on, à le faire encore avec les asuang3 des
Philippines, se trouve aujourd’hui si faible et si honteux
qu’il ne résiste pas à la vue d’un morceau
d’étoffe où l’on a peint deux bras et
qu’il craint les nœuds d’une corde. Ceci ne prouve
rien sinon que le progrès s’accomplit aussi de ce
côté et que le diable est réactionnaire ou tout au
moins conservateur, [71]comme tout ce qui vit dans les
ténèbres.
P. Salvi, nous l’avons déjà dit, était
très assidu à accomplir ses devoirs religieux; selon
l’alférez, il l’était trop. Tandis
qu’il prêchait—il aimait beaucoup à
prêcher—on fermait les portes de l’église; il
ressemblait ainsi à Néron qui ne laissait sortir personne
tandis qu’il chantait au théâtre; mais lui le
faisait pour le bien et Néron pour le mal des âmes. Il
punissait le plus souvent d’amendes les fautes de ses
subordonnés, mais frappait très rarement, ce en quoi il
se différenciait encore beaucoup du P. Dámaso, lequel
arrangeait tout avec des coups de poing et des coups de bâton
qu’il distribuait en riant avec la meilleure bonne
volonté. On ne pouvait lui en vouloir; il était convaincu
que l’indigène ne se traitait qu’à coups de
bâton; un frère qui savait écrire des livres le lui
avait dit et lui l’avait cru, car il ne discutait jamais les
choses imprimées: beaucoup pouvaient se plaindre de cette
modestie.
Fr. Salvi frappait très rarement, mais, comme le disait un
vieux philosophe du pueblo, ce qui manquait en quantité,
abondait en qualité; de cela à lui aussi on
n’aurait pu faire de reproches. Les jeûnes et les
abstinences appauvrissaient son sang, exaltaient ses nerfs et, comme
disait le peuple, le vent lui montait à la tête. Il en
résultait que les épaules des sacristains ne
distinguaient pas très bien un curé qui jeûnait
d’un autre qui mangeait beaucoup.
Le seul adversaire de ce pouvoir spirituel à tendances de
temporel était, comme nous l’avons déjà dit
l’alférez. Le seul, car, selon ce que racontaient les
femmes, le diable fuyait le saint prêtre parce qu’un jour,
s’étant avisé de le tenter, il fut pris,
attaché au pied d’un lit, flagellé avec une corde
et ne fut mis en liberté qu’au bout de neuf jours.
Naturellement, celui qui malgré tout cela se déclarait
encore l’ennemi d’un pareil homme en arrivait à
avoir une renommée pire que les pauvres diables toujours [72]dupés
et battus, et l’alférez méritait son sort. Sa
femme, une vieille philippine, poudrée et fardée, se
nommait Da Consolacion; le mari et d’autres personnes encore lui
donnaient un autre nom. L’alférez vengeait ses malheurs
conjugaux sur lui-même en buvant comme un muid, sur ses
subordonnés en commandant à ses soldats de faire
l’exercice au soleil, lui restant à l’ombre, enfin,
et c’était le cas le plus fréquent, sur sa femme en
tapant sur elle à cœur joie. Certes, si la brave dame
n’était pas une bête à bon Dieu pour
décharger personne de ses péchés, elle ne devait
pas moins lui éviter beaucoup de souffrances dans le purgatoire,
si toutefois il y allait jamais, ce dont doutaient les dévots.
Lui et elle, comme pour s’amuser, se battaient merveilleusement,
donnant aux voisins des spectacles gratuits, concerts vocaux et
instrumentaux à quatre mains, piano, forte, avec pédales,
etc.
Pour contrarier le prêtre, l’officier, inspiré
par sa femme, défendit que personne se promenât
après neuf heures du soir. Da Consolacion prétendait
avoir vu le curé, déguisé avec une chemise de
piña et un salakot de nitô4 se promenant à toute heure
de nuit. Fr. Salvi se vengea saintement: voyant entrer
l’alférez dans l’église, il ordonna en secret
au sacristain de fermer toutes les portes puis il monta en chaire et
commença à prêcher jusqu’à ce que les
saints eux-mêmes s’endormissent et que lui demandât
grâce l’image de l’Esprit divin, la colombe de bois
sculptée au-dessus de sa tête. Comme tous les
pécheurs impénitents, l’alférez ne se
corrigea pas pour cela; il sortit en jurant et, aussitôt
qu’il put attraper un sacristain ou un domestique du curé,
il le retint, le frappa, lui fit nettoyer le sol du quartier et celui
de sa propre maison qui, grâce à cela, se trouva enfin
présentable. Le sacristain, en allant payer l’amende que
le curé lui avait imposée pour son absence en exposa les
motifs. Fr. [73]Salvi l’écouta silencieusement,
garda l’argent, et aussitôt lâcha ses chèvres
et ses moutons pour qu’ils pussent aller paître dans le
jardin de l’alférez, tandis qu’il cherchait un
thème nouveau pour un autre sermon beaucoup plus long et plus
édifiant. Cependant tout cela n’empêchait nullement
l’alférez et le curé, lorsqu’ils se
rencontraient, de se donner la main et de se parler courtoisement.
Quand son mari cuvait son vin ou ronflait pendant la sieste, Da.
Consolacion, ne pouvant se disputer avec lui, venait s’installer
à la fenêtre, son cigare à la bouche, vêtue
d’une chemise de flanelle bleue. Elle, qui ne pouvait supporter
la jeunesse, dardait de là ses yeux sur les jeunes filles et les
couvrait d’injures. Celles-ci qui la craignaient,
s’enfuyaient toutes confuses sans pouvoir lever les yeux,
pressant le pas et contenant leur respiration. Da. Consolacion
possédait une grande vertu: elle ne s’était
probablement jamais regardée dans un miroir.
Tels étaient les souverains du pueblo de San Diego.
[Table des matières]
XII
La Toussaint
Ce qui seul distingue l’homme de l’animal c’est le
culte qu’il rend à ceux qui ne sont plus. Et chose
étrange! ce culte semble d’autant plus enraciné
chez les peuples qu’ils sont parvenus à un degré de
civilisation plus élevé.
Les historiens racontent que les anciens habitants des Philippines
vénéraient leurs ancêtres et les déifiaient;
maintenant tout est changé: les morts doivent se recommander aux
bons soins des vivants. Il paraît que les sauvages de la
Nouvelle-Guinée gardent dans des boites les os de leurs morts et
conversent avec [74]eux; la plupart des peuples d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique leur offrent les plats les
plus raffinés, ceux qu’ils préféraient
lorsqu’ils étaient en vie, ils leur donnent des banquets
auxquels les défunts sont supposés assister. Les
Égyptiens leur élevaient des palais, les musulmans de
petites chapelles, etc., mais le peuple qui semble être le
maître en cette matière et avoir le mieux connu le
cœur humain semble être les Dahoméens. Ces
nègres savent que l’homme est rancunier, ils en concluent
que rien ne peut mieux satisfaire le défunt que de sacrifier sur
sa tombe ceux qui furent ses ennemis, et comme il est également
avide de nouvelles, et ne doit savoir comment se distraire dans
l’autre monde, on lui envoie chaque année un courrier sous
la forme d’un esclave décapité.
Nos coutumes ne ressemblent en rien à celles de tous ces
peuples. Malgré les inscriptions gravées sur les tombes,
presque personne ne croit que les morts reposent en paix. Le plus
optimiste revoit ses bisaïeuls brûlant encore dans le
Purgatoire, où, si lui-même n’est pas
définitivement condamné, il pourra leur tenir compagnie
de nombreuses années.
Que celui qui nous voudrait contredire visite les églises et
les cimetières du pays en ce jour de la fête des Morts,
qu’il observe et il jugera. Mais puisque nous sommes à San
Diego, entrons dans le cimetière de ce pueblo et
visitons-le.
Situé à l’ouest, au milieu des rizières,
ce n’est pas la ville, c’est le faubourg des morts: on y
accède par un étroit sentier, poudreux les jours de
soleil, navigable les jours de pluie. Une porte de bois, un entourage
fait moitié de pierre, moitié de tiges de bambou et de
pieux semble le séparer des hommes, mais non des chèvres
du curé ni des porcs des voisins qui entrent et sortent pour
explorer les tombes et égayer de leur présence cette
triste solitude.
Au milieu de ce vaste enclos, un piédestal de pierre supporte
une grande croix de bois. La tempête a plié [75]la feuille de fer
blanc où était peint le I. N. R. I. et la pluie a
effacé les lettres. Au pied de la croix, comme sur le
véritable Golgotha, s’amoncellent confusément des
crânes et des os que le fossoyeur indifférent rejette des
fosses qu’il vide. C’est là qu’ils attendront
probablement, non pas la résurrection des morts, mais la venue
des animaux qui les souilleront de leurs ordures. Alentour on remarque
de récentes excavations; ici le terrain est creusé,
là il forme un petit monticule. Partout croissent dans toute
leur vigueur le tarambulo1 et le pandakaki2: le premier pour percer les pierres de ses baies
épineuses, le second pour ajouter son odeur à celle du
cimetière. Cependant quelques petites fleurettes nuancent le
sol, fleurs qui, comme ces crânes entassés, ne sont
connues que de leur Créateur: le sourire de leurs pétales
est pâle et leur parfum est le parfum du sépulcre.
L’herbe et les plantes grimpantes couvrent les angles, escaladent
les murailles et les niches, habillant et embellissant cette laideur
dénudée; parfois elles pénètrent par les
fissures, œuvre des tremblements de terre, et cachent aux regards
les vénérables cavités des tombeaux.
A l’heure où nous pénétrons dans ce champ
de repos, les hommes sont occupés à chasser les animaux;
seul, un porc, difficile à convaincre, se montre avec ses petits
yeux à travers un grand trou de la muraille, il secoue la
tête, lève en l’air le groin et semble dire à
une femme qui prie:
—Ne le mange pas en entier, laisse-moi quelque chose!
Deux hommes creusent une fosse près du mur qui menace ruine;
l’un, le fossoyeur accomplit son travail avec la plus
complète indifférence; il jette de côté les
vertèbres et les crânes comme un jardinier les pierres
[76]et les
feuilles mortes; l’autre est préoccupé, il sue, il
fume, il crache à tout moment.
—Oh! dit ce dernier, en tagal. Ne ferions-nous pas mieux de
creuser en un autre endroit. Cette fosse-ci est trop
récente.
—Toutes les fosses sont les mêmes, aussi récentes
l’une que l’autre.
—Je n’en puis plus! Cet os sur lequel se trouve encore
du sang... hem! et ces cheveux?
—Quelle femmelette! s’écrie l’autre en lui
reprochant sa délicatesse. Il fallait te mettre commis du
tribunal! Si tu avais déterré, comme moi, un cadavre de
vingt jours, la nuit, par la pluie, sans lumière... ma lanterne
s’étant soufflée...
Son compagnon ému le regarda.
—Le cercueil s’était décloué, le
mort sortait à moitié... il sentait... je me vis
forcé de le prendre sur mon dos... il pleuvait, nous
étions mouillés tous deux, et...
—Brr! Et pourquoi l’as-tu déterré?
Le fossoyeur parut surpris.
—Pourquoi? Est-ce que je le sais? On me l’avait
commandé.
—Qui te l’avait commandé?
A cette question, le fossoyeur recula d’un pas et examina
l’indiscret des pieds à la tête.
—Écoute! tu es curieux comme un Espagnol; un Espagnol
m’a fait ensuite la même demande, mais en secret. Je vais
te répondre ce que je lui ai répondu: c’est le
grand curé qui me l’avait commandé.
—Ah! et qu’as-tu fait du cadavre?
—Diable! si je ne te connaissais pas et ne savais pas qui tu
es, je te prendrais pour un policier; tu me fais les mêmes
questions que l’autre. Le grand curé m’avait
ordonné de l’enterrer dans le cimetière des
Chinois, mais comme le cercueil était pesant et que le
cimetière des Chinois était loin...
—Non, non! ne creuse pas plus! interrompit l’autre [77]avec un cri
d’horreur, et jetant la pelle il sauta hors de la fosse;
j’ai détaché un crâne et je crains
qu’il ne me laisse pas dormir cette nuit.
Le fossoyeur, le voyant s’enfuir et faire des signes de croix,
se mit à rire et reprit son travail.
Le cimetière s’emplissait d’hommes et de femmes,
en habits de deuil. Quelques-uns cherchaient un instant la fosse,
discutaient entre eux et, comme s’ils n’étaient pas
d’accord, se séparaient, chacun s’agenouillant
là où lui paraissait être le bon endroit;
d’autres, ceux qui avaient des niches pour leurs parents,
allumaient des cierges et se mettaient dévotement à
prier. On entendait aussi des soupirs et des sanglots que, selon les
cas, on s’efforçait d’exagérer ou de
contenir. Et sur le tout, planait un vague ron-ron de orapreo,
d’orapreiss et de requiem
æternams.
Un petit vieux, aux yeux vifs, entra la tête
découverte. A sa vue, beaucoup se mirent à rire, quelques
femmes froncèrent le sourcil. Le petit vieux sembla ne faire
aucun cas de ces démonstrations, mais il se dirigea vers le tas
de crânes, s’agenouilla et pendant un instant, son regard
chercha quelque chose parmi les os; ensuite, avec le plus grand soin,
il écarta les crânes, l’un après
l’autre et, comme s’il n’avait pas trouvé ce
qu’il cherchait, son front se plissa, il remua la tête,
regarda de tous côtés, puis enfin se leva et se dirigea
vers le fossoyeur.
—Oh! lui dit-il.
Celui-ci leva la tête.
—Sais-tu où est une belle tête de mort, blanche
comme l’intérieur d’une noix de coco, avec les dents
au complet, qui se trouvait ici, au pied de la croix, sous ces
feuilles?
Le fossoyeur haussa les épaules.
—Regarde, ajouta le vieillard, en lui montrant une
pièce d’argent; je n’ai que cela, mais je te le
donnerai si tu me la trouves. [78]
Le brillant de la monnaie fit réfléchir l’homme;
il regarda vers l’ossuaire et dit:
—Elle n’est pas là? Non? Alors je ne sais pas
où elle peut se trouver.
—Tu ne sais pas? Quand ceux qui me doivent me paieront, je te
donnerai plus, continua le petit vieux. C’était le
crâne de ma femme, et si tu le trouves...
—Elle n’est pas là? alors je n’en sais
rien! Mais si vous voulez je puis vous en donner un autre!
—Tu es comme la tombe que tu creuses! s’écria le
bonhomme furieux, tu ne sais pas la valeur de ce que tu perds. Pour qui
est cette fosse?
—Le sais-je, moi? Pour un mort! répondit l’autre
avec humeur.
—Comme la tombe! comme la tombe! répétait
toujours le vieux avec un rire sec; tu ne sais ni ce que tu jettes ni
ce que tu portes! Creuse, creuse!
Et se retournant, il se dirigea vers la sortie.
Le fossoyeur pendant ce temps avait fini sa tâche; deux
monticules de terre fraîchement remuée et de couleur
rougeâtre s’élevaient sur les bords. Tirant du buyo
de son salakot, il se mit à le mâcher, en regardant
d’un air stupide ce qui se passait autour de lui.
[Table des matières]
XIII
Présages de tempête
Au moment même où le petit vieux sortait du
funèbre enclos, une voiture qui paraissait avoir fait un long
trajet s’arrêtait à l’entrée du
sentier; elle était couverte de poussière et les chevaux
suaient et haletaient.
Ibarra en descendit, suivi d’un vieux domestique; il
congédia le cocher d’un geste et se dirigea vers le
cimetière, silencieux et grave.
—Ma maladie et mes occupations ne m’ont pas permis [79]de revenir ici
depuis le jour des obsèques de votre père, disait
timidement le vieux serviteur; Capitan Tiago a dit qu’il se
chargerait de faire élever une niche; mais j’ai
planté des fleurs et une croix ouvrée par
moi-même.
Ibarra ne répondit pas.
—Là-bas, derrière cette grande croix,
señor, continua le domestique en montrant une encoignure, quand
ils eurent franchi la porte d’entrée.
Ibarra était si préoccupé qu’il ne
remarqua pas le mouvement d’étonnement de quelques
personnes qui, le reconnaissant, suspendirent leur prière et le
suivirent des yeux avec la plus grande curiosité.
Le jeune homme marchait, évitant soigneusement de passer sur
les fosses que l’on reconnaissait facilement à un
creusement du terrain. Autrefois, il les foulait aux pieds,
aujourd’hui il les respectait, car son père gisait dans
l’une d’elles. Arrivé de l’autre
côté de la croix, il s’arrêta et regarda de
tous côtés. Son compagnon restait confus et
embarrassé; il cherchait des traces de pas sur le sol et ne
voyait nulle part aucune croix.
—C’est ici? murmurait-il entre ses dents;... non,
c’est là;... mais la terre est retournée!
Ibarra le regardait avec angoisse.
—Oui, continua le domestique; je me souviens qu’il y
avait une pierre à côté; la fosse était un
peu courte; le fossoyeur était malade et ce fut un aide qui dut
la creuser; mais, demandons à celui-ci ce qu’il a fait de
la croix.
Ils marchèrent vers le fossoyeur qui les observait
curieusement; quand ils furent près de lui, l’homme les
salua en retirant son salakot.
—Pourriez-vous nous dire quelle est la fosse, là-bas,
qui avait une croix? demanda le domestique.
L’homme regarda l’endroit et
réfléchit.
—Une grande croix?
—Oui, une grande, affirma avec joie le vieux serviteur en
regardant significativement Ibarra dont la physionomie s’anima.
[80]
—Une croix ornée, attachée avec des lianes?
demanda à nouveau le fossoyeur.
—C’est cela, c’est cela! faite comme ceci, et le
vieillard traçait à terre un dessin en forme de croix
byzantine.
—Et, sur la tombe, on avait parsemé des fleurs?
—Des lauriers-roses, des sampagas1 et des pensées! c’est
cela! ajouta le domestique, tout joyeux, et il lui offrit un
cigare.
—Dites-nous quelle est la fosse et où est la croix.
Le fossoyeur se gratta l’oreille et tout en bâillant
répondit:
—La croix!... mais, je l’ai brûlée.
—Brûlée! et pourquoi l’avez-vous
brûlée?
—Parce que le grand curé me l’a
ordonné.
—Qui est le grand curé? demanda Ibarra.
—Qui? Celui qui frappe, le Père Garrote2.
Ibarra se passa la main sur le front.
—Mais, au moins, pouvez-vous nous dire où est la fosse?
vous devez vous en souvenir.
Le fossoyeur sourit:
—Le mort n’est plus là! répondit-il
tranquillement.
—Que dites-vous?
—Oui, ajouta l’homme avec un air ironique, à sa
place j’ai mis une femme, il y a huit jours.
—Etes-vous fou? s’écria le domestique; il
n’y a pas un an que nous l’avons enterré!
—C’est possible! mais il y a bien des mois que je
l’ai déterré. Le grand curé me l’avait
commandé, il m’avait dit de le porter au cimetière
des Chinois; mais comme il pleuvait et que le mort pesait lourd...
Il ne put en dire plus; il recula terrifié à la vue de
Crisóstomo qui s’élança sur lui, le saisit
par le bras et le secouant rudement:
—Et, tu l’as fait? demanda-t-il, avec un accent
indescriptible. [81]
—Ne vous fâchez pas, señor; répondit-il,
pâle et tremblant, je ne l’ai pas enterré avec les
Chinois! Mieux vaut être noyé que parmi les Chinois, me
dis-je à part moi, et j’ai jeté le mort à
l’eau!
Ibarra lui mit les deux poings sur les épaules et le regarda
longtemps avec une expression qui ne peut se définir:
—Tu n’es qu’un malheureux! dit-il, et il sortit
précipitamment, foulant aux pieds os, fosses, croix, comme un
aliéné.
—Voilà ce que les morts nous valent! Le Père
Grand m’a donné des coups de bâton pour
l’avoir laissé enterrer pendant que j’étais
malade; maintenant, il s’en faut de peu que celui-ci ne me casse
le bras pour l’avoir déterré. Voilà ce que
c’est que les Espagnols! Je vais encore perdre ma place!
Ibarra marchait très vite, ses regards se dirigeaient au
loin; le vieux domestique le suivait en pleurant.
Le soleil était près de se coucher; de gros nuages
tapissaient le ciel vers l’Orient; un vent sec agitait les cimes
des arbres et faisait gémir les roseaux.
Ibarra allait tête nue; de ses yeux ne jaillissait pas une
larme, de sa poitrine ne s’échappait pas un soupir. Sa
marche ressemblait à une fuite. Que fuyait-il? peut-être
l’ombre de son père, peut-être la tempête qui
s’approchait. Il traversa le pueblo, allant vers les environs,
vers cette ancienne maison que depuis de longues années il
n’avait pas habitée. Entourée d’un mur
où croissaient diverses sortes de cactus, il semblait
qu’elle lui fît des signes; les fenêtres
s’ouvraient; l’ilang-ilang3 se balançait, agitant
joyeusement ses branches chargées de fleurs; les colombes
voletaient à l’entour du toit conique de leur pigeonnier
placé au milieu du jardin.
Mais le jeune homme ne s’arrêtait pas à
contempler ces joies du retour à l’antique foyer: il
clouait ses [82]yeux sur la figure d’un prêtre qui
s’avançait vers lui. C’était le curé
de San Diego, le franciscain méditatif que nous connaissons,
l’ennemi de l’alférez. La brise pliait les larges
ailes de son chapeau; l’habit de guingon s’aplatissait et
modelait ses formes, montrant des cuisses minces et quelque peu
cagneuses. De la main droite il portait un bâton de palasan4 dont la
poignée était d’ivoire. C’était la
première fois qu’Ibarra et lui se voyaient.
Au moment où ils se rencontrèrent, le jeune homme
s’arrêta un instant et le regarda fixement; Fr. Salvi
évita le regard et parut plongé dans ses
méditations.
L’hésitation ne dura qu’une seconde: Ibarra
s’approcha rapidement du prêtre, l’arrêta en
laissant tomber avec force la main sur son épaule et d’une
voix à peine intelligible.
—Qu’as-tu fait de mon père? demanda-t-il.
Fr. Salvi, pâle et tremblant, pressentant les sentiments qui
se peignaient sur le visage du jeune homme, ne put répondre: il
se sentit comme paralysé.
—Qu’as-tu fait de mon père? répéta
celui-ci d’une voix étouffée.
Le prêtre, pliant sous la main qui le tenait, fit un effort et
répondit:
—Vous vous êtes trompé; je n’ai rien fait
à votre père!
—Comment non? continua le jeune homme en pesant si fortement
sur ses épaules qu’il le fit tomber à genoux.
—Non, je vous assure! ce fut mon prédécesseur,
le P. Dámaso...
—Ah! s’écria le jeune homme, qui se frappa le
front, lâcha le pauvre P. Salvi et se dirigea
précipitamment vers sa maison.
Le domestique arrivait sur ces entrefaites, et aida le moine
à se relever. [83]
[Table des matières]
XIV
Tasio le fou ou le philosophe
L’étrange petit vieux vaguait distrait par les
rues.
C’était un ancien étudiant de philosophie qui,
pour obéir à sa vieille mère, avait
abandonné ses études, bien qu’il ne manquât
ni de moyens ni de capacités; sa mère était riche
et l’on disait qu’il avait du talent. La bonne femme
craignait que son fils ne devînt un savant et oubliât Dieu,
aussi lui donna-t-elle à choisir entre devenir prêtre ou
quitter le collège de San José. Lui, qui était
amoureux, prit ce dernier parti et se maria. Veuf et orphelin en moins
d’une année, il chercha une consolation dans les livres
et, par eux, se délivra de la tristesse, de la gallera et de
l’oisiveté. Malheureusement ses études
l’absorbèrent à l’excès, ses achats de
livres furent trop répétés, sa fortune dont il
délaissa le soin se fondit peu à peu et un jour vint
où il se trouva complètement ruiné.
Les gens de bonne éducation l’appelaient Don Anastasio
ou Tasio le philosophe; les autres, qui formaient la majorité,
Tasio le fou, à cause de ses idées peu communes et de
l’étrange façon dont il agissait envers ses
concitoyens.
Comme nous l’avons déjà dit, la soirée
menaçait d’une tempête; quelques éclairs
illuminaient de leur lumière pâle le ciel couleur de
plomb, l’atmosphère était pesante et l’air
extrêmement chaud.
Le philosophe Tasio paraissait avoir oublié
déjà le crâne de sa chère morte; il
regardait maintenant avec un sourire les nuages obscurs.
Arrivé à la porte de l’église il entra
et, s’adressant à deux petits garçons, l’un
de dix, l’autre de sept ans environ: [84]
—Venez-vous avec moi? leur demanda-t-il. Votre mère
vous a préparé un dîner de curés.
—Le sacristain principal ne nous laisse pas sortir avant huit
heures, señor! répondit le plus âgé.
J’attends de toucher ma paye pour la donner à notre
mère.
—Ah! et où allez-vous?
—A la tour, señor, sonner les cloches pour les
âmes!
—Vous allez à la tour? mais faites attention! ne vous
approchez pas des cloches pendant l’orage.
Puis il sortit de l’église, non sans avoir
regardé avec pitié les deux pauvres gamins qui montaient
les escaliers.
Tasio se frotta les yeux, regarda une autre fois le ciel et
murmura:
—Maintenant, je serais désolé que la foudre
tombât.
Et, la tête basse, il s’en alla pensif vers les
alentours de la bourgade.
—Entrez-vous un instant? lui dit en espagnol un homme
accoudé à une fenêtre.
Le philosophe leva la tête et vit une figure, paraissant
âgée de trente à trente-cinq ans, qui lui
souriait.
—Que lisez-vous là? demanda Tasio en montrant un livre
que l’homme tenait à la main.
—C’est un livre d’actualité: Les peines
que souffrent les âmes bénies du Purgatoire!
répondit l’autre toujours souriant.
—Hombre, hombre, hombre! s’écria le vieillard sur
des tons de voix différents, et il entra dans la maison;
l’auteur doit être un homme bien malin.
En haut de l’escalier, il fut reçu amicalement par le
maître de la maison et sa jeune femme. Lui s’appelait D.
Filipo Lino et elle Da. Teodora Viña. D. Filipo était le
lieutenant principal des cuadrilleros1 et le chef
[85]d’un parti presque
libéral, si l’on peut lui donner ce nom, et s’il est
possible qu’il y ait des partis dans les pueblos des
Philippines.
—Avez-vous rencontré au cimetière le fils de D.
Rafael, qui vient d’arriver d’Europe?
—Oui, je l’ai vu comme il descendait de voiture.
—On dit qu’il y allait chercher le tombeau de son
père... Le coup doit avoir été terrible!
Le philosophe haussa les épaules.
—Ne vous intéressez-vous pas à ce malheur?
demanda la jeune femme.
—Vous savez que j’ai été l’un des
six qui ont accompagné le cadavre, c’est moi qui me
présentai au capitaine général quand je vis
qu’ici tout le monde, même les autorités, se taisait
devant la profanation dont il avait été victime; et vous
savez que je préfère honorer un homme que j’estime
pendant sa vie qu’après sa mort.
—Alors?
—Vous savez, señora, que je ne suis pas partisan de la
monarchie héréditaire. Par les gouttes de sang chinois
que ma mère m’a transmises, je pense un peu comme les
Chinois: j’honore le père pour le fils, non le fils pour
le père. Que chacun reçoive la récompense ou le
châtiment de ses œuvres, mais non pas de celles des
autres.
—Avez-vous commandé une messe pour votre défunte
épouse, comme on vous le conseillait hier? demanda la femme en
changeant de conversation.
—Non! répondit le vieillard en souriant.
—Quel malheur! s’écria-t-elle avec un
véritable chagrin; on dit que jusqu’à demain dix
heures les âmes vaguent libres, attendant les bonnes œuvres
des vivants, et qu’une messe dite ces jours-ci équivaut
à cinq les autres jours de l’année ou même
à six, comme disait ce matin le curé.
—Holà! c’est-à-dire que nous avons un
délai gracieux dont nous devons profiter?
[86]
—Mais, Doray! intervint D. Filipo; tu sais bien que D.
Anastasio ne croit pas au Purgatoire.
—Comment je ne crois pas au Purgatoire? protesta le vieillard,
se soulevant à demi sur son siège. J’y crois
tellement bien que je sais même quelque peu son histoire!
—L’histoire du Purgatoire! s’exclamèrent,
pleins de surprise, les deux époux. Voyons! racontez-nous
la?
—Ne la savez-vous pas? ne commandez-vous pas des messes
à son intention, ne parlez-vous pas des peines qu’on y
souffre? Bon! voici qu’il commence à pleuvoir, et il
semble que cela va durer; nous n’aurons pas le temps de nous
ennuyer, répondit Tasio; et il médita un moment.
D. Filipo ferma le livre qu’il avait à la main, Doray
s’assit près de lui, disposée à ne rien
croire de ce que le vieux Tasio allait dire. Celui-ci commença
ainsi:
—Le Purgatoire existait bien longtemps avant la naissance de
N.-S. Jésus-Christ; il devait être au centre de la terre,
selon le P. Astete, ou dans les environs de Cluny, d’après
le moine dont nous parle le P. Girard. Mais l’endroit est ici ce
qui importe le moins. Eh bien, qui donc brûlait dans ces feux
allumés depuis le commencement du monde? Car la philosophie
chrétienne nous prouve leur existence très ancienne,
puisqu’elle nous dit que Dieu n’a plus rien
créé après qu’il se fût
reposé.
—Le Purgatoire pourrait avoir existé in
potentia, mais non in actu! objecta le lieutenant.
—Très bien! Cependant je vous répondrai que
quelques-uns en ont eu connaissance comme existant in actu;
l’un de ceux-là fut Zarathustra ou Zoroastre, qui
écrivit une partie de l’Avesta et fonda une religion qui a
certains points de contact avec la nôtre; ce Zarathustra, selon
les savants, existait huit cents ans au moins avant
Jésus-Christ.
Je dis au moins car Gaffarel, après avoir examiné les
témoignages de Platon, de Xanthe de Lydie, de [87]Pline,
d’Hermipos, et d’Eudoxe, le croit antérieur à
notre ère de quinze cents ans. Qu’il en soit ce que
l’on voudra, il est certain que Zarathustra parlait
déjà d’une espèce de Purgatoire et donnait
les moyens de s’en délivrer. Les vivants pouvaient
racheter les âmes de ceux qui étaient morts en état
de péché, en récitant des passages de
l’Avesta, en faisant de bonnes œuvres, mais à la
condition que celui qui priait fût un parent jusqu’à
la quatrième génération. Tous les ans, cinq jours
étaient consacrés à l’accomplissement de ce
devoir. Plus tard, quand cette croyance se fut répandue dans le
peuple, les prêtres de cette religion y virent l’occasion
d’un grand commerce et exploitèrent
«ces prisons profondément obscures où
règne le remords», comme avait dit Zarathustra. Ils
établirent alors que, pour le prix de un derem, il
paraît que c’était une monnaie de peu de valeur, en
pouvait épargner à une âme un an de tortures; mais,
comme dans cette religion il y avait des péchés qui
coûtaient de 300 à 1000 ans de souffrances, le mensonge,
la mauvaise foi, le manquement à une parole donnée, par
exemple, etc., il en résultait que les voleurs empochaient des
millions de derems. Ici vous voyez déjà quelque
chose qui ressemble à notre Purgatoire, bien qu’il faille
tenir compte de la différence des religions.
Un éclair, suivi d’un retentissant coup de tonnerre,
fît lever la tête à Doray qui dit en se signant:
—Jésus, Marie, Joseph! je vous laisse! je vais
brûler la palme bénite et allumer les chandelles de
pardon.
La pluie commença à tomber à torrents. Le
philosophe Tasio poursuivit, tandis qu’il regardait
s’éloigner la jeune femme:
—Maintenant qu’elle est partie, nous pouvons parler sur
ce sujet plus raisonnablement. Doray, bien qu’un peu
superstitieuse est bonne catholique et je n’aime pas arracher la
foi du cœur; une foi pure et simple ne ressemble pas plus au
fanatisme que la flamme à la [88]fumée, que la musique à un
charivari: les imbéciles et les sourds peuvent seuls s’y
tromper. Entre nous, nous pouvons dire que l’idée du
Purgatoire est bonne, sainte et raisonnable; elle continue
l’union entre ceux qui furent et ceux qui sont encore; elle
oblige à une plus grande pureté de vie. Le mal est dans
l’abus qui s’en fait.
Mais voyons maintenant comment a pu passer dans le catholicisme
cette idée qui n’existait ni dans la Bible ni dans les
Saints Évangiles. Ni Moïse ni Jésus-Christ
n’en font la plus petite mention et l’unique passage que
l’on cite des Macchabées est insuffisant, sans compter que
ce livre fut déclaré apocryphe par le concile de
Laodicée et que la Sainte Église Catholique ne
l’admit que longtemps après. La religion païenne non
plus n’avait rien qui y ressembla. Le passage tant cité de
Virgile: Aliæ panduntur inanes2, qui donna occasion à
Saint Grégoire le Grand de parler des âmes
opprimées et que Dante amplifia dans sa Divine
Comédie, ne peut être l’origine de cette
croyance. Ni les brahmanes, ni les boudhistes, ni les Égyptiens
qui donnèrent à la Grèce et à Rome leur
Caron et leur Averne, n’avaient non plus rien qui
ressemblât à cette idée. Je ne parle pas ici des
religions des peuples du Nord de l’Europe; celles-là,
religions de guerriers, de bardes et de chasseurs mais non de
philosophes, si elles conservaient encore leurs croyances et
jusqu’à leurs rites, même christianisées,
n’ont pu accompagner les hordes de leurs fidèles aux sacs
de Rome ni s’asseoir au Capitole: c’étaient des
religions de brumes qui se dissipaient au soleil du midi.—Donc,
les chrétiens des premiers siècles ne croyaient pas au
Purgatoire; ils mouraient avec cette joyeuse confiance de voir
aussitôt Dieu face à face. Les premiers pères de
l’Église qui semblent le mentionner, furent S.
Clément d’Alexandrie, Origène et S.
Irénée; peut-être [89]avaient-ils été
influencés par la religion de Zarathustra qui, alors, florissait
et était très répandue dans tout l’Orient,
car nous lisons très fréquemment des reproches
adressés à l’orientalisme d’Origène.
S. Irénée voulut en prouver l’existence par le fait
que Jésus-Christ était resté «trois jours
dans les profondeurs de la terre», trois jours de Purgatoire, et
il en concluait que chaque âme devait y rester
jusqu’à la résurrection de la chair, bien que cette
assertion semble être contredite par le Hodie mecum eris in
Paradiso3.
S. Augustin parla aussi du Purgatoire, mais, s’il n’affirme
pas son existence, il ne la croit pas cependant impossible, en
supposant que dans l’autre vie pourraient se continuer les
châtiments que nous recevons en celle-ci pour nos
péchés.
—Diantre soit de S. Augustin! s’écria D. Filipo;
n’était-il pas satisfait de ce que nous souffrons ici-bas
qu’il en voulut la continuation?
—Donc, les choses allaient ainsi: les uns y croyaient, les
autres n’y croyaient pas. Malgré que S. Grégoire en
soit déjà arrivé à l’admettre dans
son de quibusdam levibus culpis esse ante judicium purgatorius ignis
credendus est4, rien sur ce sujet ne fut définitivement
établi jusqu’à l’année 1439,
c’est-à-dire huit siècles après, dans
laquelle le concile de Florence déclara qu’il devait
exister un feu purificateur pour les âmes de ceux qui sont morts
dans l’amour de Dieu mais sans avoir satisfait encore à la
justice divine. Enfin, le Concile de Trente, sous Pie IV en 1563, dans
la XXVe session, rendit le décret du Purgatoire qui
commence ainsi: Cum catholica ecclesia, Spiritu Sancto edocta,
etc5,
où il est dit que les secours des vivants, les prières,
les aumônes et autres œuvres pieuses et surtout [90]et avant tout
le sacrifice de la messe, sont les moyens les plus efficaces de
délivrer les âmes. Les protestants n’y croient pas,
ni non plus les pères grecs, car ils cherchent au moins à
leurs dogmes un fondement biblique quelconque et disent que le
délai pour le mérite ou le démérite se
termine à la mort et que le Quodcumque ligaberis in
terra6 ne
peut dire usque ad purgatorium7, mais à cela on pourrait
répondre que le Purgatoire étant au centre de la terre
tombe naturellement sous la domination de S. Pierre. Mais je n’en
finirais pas si je devais répéter tout ce qui s’est
dit sur ce fait. Un jour que vous voudrez discuter avec moi
là-dessus, venez chez moi et là nous ouvrirons les livres
et nous parlerons librement et tranquillement. Maintenant, je
m’en vais; je ne sais pourquoi cette nuit la piété
des chrétiens permet le vol—les autorités laissent
faire—et je crains pour mes livres. Si on devait me les voler
pour les lire, je ne dirais rien, mais je sais que beaucoup voudraient
les brûler par charité pour moi et ce genre de
charité, digne du calife Omar, est terrible. Il en est qui,
à cause de ces livres, me croient déjà
damné...
—Mais je suppose que vous croyez à la damnation?
demanda en souriant Doray qui revenait en apportant dans un petit
brasero des feuilles sèches de palme répandant une
fumée insupportable mais un agréable parfum.
—Je ne sais pas, señora, ce que Dieu fera de moi,
répondit le vieux Tasio tout pensif. Quand je serai près
de mourir, je m’abandonnerai à lui sans crainte: il fera
de moi ce qu’il voudra. Mais il me vient une idée.
—Laquelle?
—Si les seuls qui se puissent sauver sont les catholiques et
si, comme disent beaucoup de curés, cinq sur cent d’entre
eux à peine y réussissent, les catholiques [91]ne formant, à
en croire les statistiques, que la douzième partie de la
population de la terre, il serait donc vrai qu’après des
milliards et des milliards d’hommes damnés pendant les
innombrables siècles qui précédèrent la
venue du Sauveur, maintenant, après qu’un fils de Dieu est
mort pour nous, il ne pourrait échapper aux flammes
éternelles que cinq âmes sur douze cents? Oh! certainement
non! je préfère dire et croire avec Job: Seras-tu
sévère contre une feuille qui vole et poursuivras-tu de
ta colère un épi desséché? Non! une
telle prédominance du mal est impossible, le croire c’est
blasphémer!
—Que voulez-vous, la justice, la pureté divine...
—Oh! mais la justice et la pureté divine voyaient
l’avenir avant la création! répondit le vieillard
tout ému en se levant. L’homme est un être
secondaire et non nécessaire et ce Dieu ne devrait pas
l’avoir créé si, pour faire un heureux, il lui
fallait en condamner des centaines à une éternité
de souffrances, et pourquoi? pour des fautes originelles ou des erreurs
d’un moment? Non, si vous êtes sûr de cela,
étouffez alors votre fils endormi; si cette croyance
n’était pas un blasphème contre un Dieu qui doit
être le Suprême Bien, le Moloch phénicien qui se
nourrissait de sacrifices humains et de sang innocent, dans les
entrailles de bronze duquel étaient brûlés vivants
les petits enfants arrachés au sein de leurs mères, cette
divinité horrible et sanguinaire serait à
côté de lui une douce jeune fille, une amie, la
mère de l’Humanité!
Et rempli d’horreur, le fou ou le philosophe—comme on
voudra l’appeler—sortit de la maison, courant dans la rue
malgré la pluie et l’obscurité.
Un éclair éblouissant, accompagné d’un
épouvantable coup de tonnerre remplissant l’espace
d’étincelles meurtrières, illumina le vieillard
qui, les mains tendues vers le ciel, criait:
—Tu protestes! Je sais que tu n’es pas cruel, que toi
seul dois être appelé le Bon! [92]
Les éclairs redoublaient, la tempête devenait de plus
en plus furieuse...
[Table des matières]
XV
Les sacristains
Les coups de tonnerre retentissaient coup sur coup, chacun
étant précédé d’un terrifiant zig-zag
de feu. La pluie tombait à torrents et, dominant à peine
le sifflement lugubre du vent, les cloches entonnaient d’une voix
plaintive leur mélancolique prière en un triste tintement
qui semblait une lamentation.
Les deux enfants que nous avons vus tout à l’heure
causant avec le philosophe, se trouvaient au second étage de la
tour. Le plus jeune, d’apparence timide malgré ses grands
yeux noirs, essayait, de se coller contre son frère qui lui
ressemblait beaucoup mais dont le regard était plus profond et
la physionomie plus décidée; tout deux étaient
pauvrement vêtus de costumes où abondaient les
pièces et les reprises. Assis sur une poutre, ils tenaient en
main chacun une corde dont l’extrémité se perdait
au troisième étage, là-bas, plus haut, dans
l’ombre. La pluie, poussée par le vent, arrivait
jusqu’à eux et faisait vaciller la flamme d’un reste
de cierge brûlant sur une grande pierre dont on se servait le
vendredi-saint pour imiter le tonnerre en la faisant rouler dans le
chœur.
—Tire ta corde, Crispin! dit le plus grand à son petit
frère.
Celui-ci obéit et on entendit en haut une faible plainte
qu’éteignit aussitôt un coup de tonnerre,
répété par mille échos.
—Ah! si nous étions à la maison avec maman!
soupira le plus jeune, je n’aurais pas peur. [93]
L’autre ne répondit pas; il regardait la cire
s’épancher et semblait soucieux.
—Au moins là, personne ne me traiterait de voleur!
ajouta Crispin; maman ne le permettrait pas. Si elle savait
qu’ils me battent...
Le plus grand détourna son regard de la flamme, leva la
tête, saisit avec force la grosse corde qu’il tira
violemment: on entendit une vibration sonore.
—Allons-nous toujours vivre ainsi, frère! continua
Crispin. Je voudrais rentrer malade demain à la maison, avoir
une grande maladie pour que maman me soignât et ne me
laissât pas retourner au couvent! Alors ils ne
m’appelleraient plus voleur et ne me battraient plus! Et toi
aussi, frère, tu devrais être malade avec moi.
—Non! répondit l’aîné; cela nous
ferait mourir tous; maman de peine, nous autres de faim.
Crispin ne répliqua point.
—Combien as-tu gagné ce mois-ci? demanda-t-il au bout
d’un moment.
—Deux pesos; on m’a infligé trois amendes.
—Paye ce qu’ils disent que j’ai volé; ainsi
on ne nous appellera plus voleurs; paye-le, frère!
—Es-tu fou, Crispin? Maman n’aurait pas de quoi manger;
le sacristain principal dit que tu as dérobé deux onces,
et deux onces font trente-deux pesos.
Le petit compta sur ses doigts jusqu’à trente-deux.
—Six mains et deux doigts! Et chaque doigt fait un peso,
murmura-t-il ensuite tout pensif. Et chaque peso... combien de
cuartos?
—Cent soixante.
—Cent soixante cuartos? Cent soixante fois un cuarto? Maman!
Et combien est-ce cent soixante?
—Trente-deux mains, répondit le plus grand. Crispin
s’arrêta un moment, regardant ses petites mains.
—Trente-deux mains! répétait-il; six mains et
deux doigts et chaque doigt trente-deux mains... et chaque doigt un
cuarto... Maman, que de cuartos! Un homme [94]ne pourrait les compter tous en trois
jours... et avec, on peut acheter des souliers pour les pieds, un
chapeau pour la tête quand le soleil chauffe, un grand parapluie
pour les mauvais temps, des vêtements pour toi et notre
mère, des...
Crispin devint pensif.
—Maintenant, je regrette de ne pas avoir volé!
—Crispin! gronda son frère.
—Ne te fâche pas! Le curé a dit qu’il me
tuerait à coups de bâton s’il ne retrouvait pas
l’argent; si je l’avais pris, je pourrais le faire
retrouver... si je dois mourir, au moins vous auriez eu des
vêtements, maman et toi. J’aurais dû le voler!
Le plus grand se tut et tira sa corde: puis il répondit en
soupirant:
—Ce que je crains c’est que notre mère ne se
fâche après toi quand elle le saura.
—Le crois-tu? demanda le petit surpris. Tu diras qu’ils
m’ont battu beaucoup, je lui montrerai les bleus qu’ils
m’ont fait et ma poche déchirée: je n’ai
jamais eu qu’un cuarto qu’ils m’ont donné
à Pâques et le curé me l’a repris hier. Je
n’ai jamais vu de cuarto plus beau. Maman ne croira pas que
j’aie volé, elle ne le croira pas!
—Si le curé lui dit...
Crispin commença à pleurer, murmurant entre ses
sanglots:
—Alors, va-t’en tout seul, je ne veux pas m’en
aller; dis à maman que je suis malade; je ne veux pas m’en
aller.
—Crispin, ne pleure pas! dit l’aîné. Maman
ne le croira pas; le vieux Tasio a dit qu’un bon dîner nous
attendait...
—Un bon dîner! Je n’ai pas encore mangé;
ils ne veulent pas me donner à manger jusqu’à ce
que les deux onces aient été retrouvées...
—Et puis, si maman semblait croire que tu as volé, tu
lui dirais que le sacristain principal ment, que le [95]curé qui
l’écoute ment aussi; que tous mentent, qu’ils disent
que nous sommes des voleurs parce que notre père est un
méchant qui...
Mais une tête apparut sortant de l’ombre du petit
escalier qui conduisait à l’étage principal et,
comme si c’eût été celle de la Méduse,
la parole se gela sur les lèvres de l’enfant. La
tête était longue, sèche, avec de grands cheveux
noirs; des lunettes bleues cachaient un œil borgne.
C’était le sacristain principal qui faisait ainsi son
entrée à la sourdine.
Les deux frères se sentirent trembler.
—Toi, Basile, je t’impose une amende de deux
réaux pour ne pas tirer régulièrement, dit-il
d’une voix caverneuse. Et toi, Crispin, tu resteras cette nuit
jusqu’à ce que se retrouve ce que tu as volé.
Crispin regarda son frère comme pour lui demander
protection.
—Nous avons la permission... mère nous attend à
huit heures, murmura timidement Basile.
—Tu ne t’en iras pas non plus à huit heures; tu
resteras jusqu’à dix.
—Mais, señor, à partir de neuf heures on ne peut
plus passer dans les rues, et la maison est loin.
—Est-ce que tu voudrais me commander? lui demanda
l’homme irrité. Et, prenant Crispin par le bras, il
chercha à l’entraîner.
—Señor, depuis une semaine nous n’avons pas vu
notre mère! supplia Basilio, prenant son frère comme pour
le défendre.
D’une gifle, le sacristain principal lui fit lâcher
prise, puis il entraîna Crispin qui commença à
pleurer, se laissa tomber à terre et cria à son
frère:
—Ne me laisse pas, ils vont me tuer!
Mais le sacristain, sans s’occuper de sa résistance,
l’entraîna brusquement et l’emporta dans les
escaliers qu’il descendit, disparaissant dans les ombres...
Basilio restait muet. Il entendit dans l’escalier les heurts
du corps de son petit frère contre les marches, [96]un cri, des coups et
des accents déchirants qui se perdirent peu à peu.
L’enfant ne respirait pas, il écoutait debout, les yeux
grands ouverts, les poings serrés.
—Quand donc serai-je assez fort! murmura-t-il entre ses dents,
et il descendit précipitamment.
Arrivé au chœur, il écouta avec attention: la
voix de son petit frère s’éloignait rapidement et
le cri: Maman! mon frère! s’éteignit tout
à fait; il entendit une porte se fermer. Tremblant, suant, il
s’arrêta un moment; mordant son poing pour étouffer
un cri qui s’échappait de son cœur, il laissa ses
regards errer dans la demi-obscurité de l’église.
La lampe du chœur brûlait faiblement, le catafalque
était au milieu, toutes les portes fermées, des grilles
aux fenêtres.
Il remonta le petit escalier de la tour, ne s’arrêta pas
au second étage où brûlait le reste du cierge et
alla jusqu’au troisième. Là, il détacha les
cordes qui assujettissaient les battants des cloches, puis redescendit
tout pâle, les yeux brillants mais sans larmes.
La pluie commençait à s’apaiser et le ciel
s’éclaircissait peu à peu.
Basilio noua les cordes, attacha une extrémité
à un montant de la balustrade et, oubliant
d’éteindre la lumière, il se laissa glisser dans
l’obscurité.
Quelques minutes après, dans une des rues du pueblo, on
entendit des voix, deux coups de feu retentirent; mais personne ne
s’alarma et tout rentra dans le silence.
[Table des matières]
XVI
Sisa
La nuit est obscure, les voisins dorment en silence, les familles
qui se sont souvenues de ceux qui n’étaient [97]plus tranquilles et
satisfaites s’abandonnent au sommeil, après avoir
récité trois parties de rosaire avec requiem, la
neuvaine pour les âmes et brûlé nombre de cierges en
cire devant les images sacrées. Les riches et les puissants ont
accompli leurs devoirs envers ceux dont ils ont hérité;
demain ils entendront les trois messes que dit chaque prêtre,
donneront deux pesos pour une autre à leur intention et ensuite
achèteront la bulle d’indulgence des défunts. Il
semble que la Justice divine est moins difficile à satisfaire
que celle des hommes.
Mais le pauvre, l’indigent qui gagne à peine de quoi
vivre et doit encore payer tous les directeurs, fonctionnaires, scribes
et soldats pour qu’ils le laissent vivre en paix, ne dort pas
avec cette tranquillité que se plaisent à
célébrer les poètes courtisans qui n’ont pas
souffert des âpres caresses de la misère. Le pauvre est
triste et pensif. Cette nuit, s’il a peu récité, il
a prié beaucoup, le cœur plein de douleur, des larmes
plein les yeux. Il ne sait pas les neuvaines, il ignore les
prières jaculatoires, et les vers, et les oremus
composés par les moines pour ceux qui n’ont pas
d’idées à eux, de sentiments qui leur soient
propres; à peine s’il les comprend. Il prie dans la langue
de sa misère; son âme pleure pour lui et pour les chers
morts dont l’amour était son seul bien. Ses lèvres
peuvent réciter des salutations, tout son être crie des
plaintes et révèle des sanglots. Dis-nous, toi qui as
béni l’indigence, dites-nous aussi vous, pauvres ombres
tourmentées, est-elle suffisante la simple prière du
misérable agenouillé devant une estampe mal
gravée, à la lueur d’un timsin1, ou bien, par hasard,
est-il nécessaire de brûler des cierges de cire devant des
Christs sanglants, des Vierges à bouche petite, aux yeux de
cristal et de faire dire des messes en latin que récite
mécaniquement un prêtre indifférent? Et toi,
Religion prêchée pour l’humanité [98]qui souffre, as-tu
oublié ta mission, ne te souviens-tu plus que tu es la
consolation des opprimés dans leur misère,
l’humiliatrice des puissants dans leur orgueil et n’as-tu
plus de promesses que pour les riches, pour ceux qui peuvent te les
payer!
La pauvre veuve veille entre ses fils qui dorment à son
côté; elle pense aux bulles qu’il faut acheter pour
le repos de ses parents et du mari défunt. «Un peso,
dit-elle, c’est une semaine d’amours pour mes fils, une
semaine de plaisirs et de joies, mes économies d’un mois,
une robe pour ma fille qui grandit...»
—Mais il est nécessaire que tu les apaises ces feux,
dit la voix qu’elle entendait prêcher, il faut que tu te
sacrifies.» Oui, il le faut! Pour toi l’Eglise ne sauvera
pas gratuitement les âmes chères, elle ne donne pas ses
indulgences. Tu dois les acheter et, au lieu de dormir la nuit, tu
travailleras. Ta fille, qu’elle continue à marcher
à demi-dénudée; toi, jeûne; le ciel
coûte cher. Malgré la divine parole, le ciel n’est
pas fait pour les pauvres!
Ces pensées prennent leur vol dans le demi-cercle qui
sépare le sahig2, où est étendue l’humble natte,
du palupu3, où est suspendu le hamac dans lequel se
balance le petit enfant. La respiration du pauvre être endormi
est régulière; de moment en moment il mâche sa
salive et articule des sons inintelligibles: il rêve qu’il
mange, qu’il satisfait enfin son pauvre estomac toujours
affamé...
Les cigales continuent leur chant monotone et unissent leur note
invariable aux fredonnements du grillon, caché dans
l’herbe, ou de la courtillière qui sort de son trou pour
chercher sa nourriture, tandis que le chacon4, peu craintif de l’eau,
trouble le concert de sa [99]voix fatidique et passe la tête par le trou
d’un tronc délabré. Les chiens hurlent
lamentablement dans les rues et le superstitieux qui les écoute
est persuadé que les esprits et les âmes sont visibles
pour les animaux. Mais ni les chiens ni les insectes ne voient les
douleurs des hommes et cependant, hélas! le nombre en est
immense.
A presque une heure de marche du pueblo, habite la mère de
Basilio et de Crispin, femme d’un homme sans cœur qui passe
son temps à fainéanter et à jouer au coq, tandis
qu’elle s’efforce de faire vivre ses enfants. Le mari et la
femme se voient rarement et ces entrevues sont toujours
pénibles. Lui l’avait dépouillée de ses
rares bijoux pour alimenter ses vices et, quand la malheureuse Sisa5 n’eut
plus rien pour satisfaire à ses caprices, il commença
à la maltraiter. Faible de caractère, douée de
plus de cœur que de raison, elle ne savait qu’aimer et
pleurer. Son mari était son Dieu, ses fils étaient ses
anges. Lui, qui savait combien il était à la fois
adoré et craint, se conduisait comme tous les faux dieux, il
devenait de plus en plus autoritaire, barbare, cruel.
Quand Sisa, un jour qu’il paraissait plus sombre que jamais,
lui demanda s’il consentait à ce que l’on fît
de Basilio un sacristain, il continua à caresser son coq, ne dit
oui ni non, et ne s’inquiéta que de savoir s’il
gagnerait beaucoup d’argent. Elle n’insista pas cette fois
mais, pressée par le besoin et voulant que ses enfants
apprissent à lire et à écrire à
l’école du pueblo, elle reparla de son projet. Son mari ne
lui répondit rien encore.
Cette nuit-là, il pouvait être dix heures et demie ou
onze heures, les étoiles brillaient de nouveau dans le ciel que
la tempête avait éclairci; Sisa était assise sur un
banc de bois, regardant quelques branches qui brûlaient [100]à
demi dans son âtre composé de pierres vives, plus ou moins
régulières. Sur ces pierres était posée une
petite marmite où cuisait du riz et, sur les cendres, trois
sardines sèches, de celles que l’on vend à raison
de trois pour deux cuartos.
Le menton appuyé sur la paume de la main, elle regardait la
flamme jaune et débile que donnaient les roseaux, dont la braise
fugitive se réduisait bien vite en cendres: un triste sourire
illuminait son visage. Elle se souvenait de la naïve devinette de
la marmite et du feu que Crispin lui avait un jour proposée.
L’enfant disait:
Naupû si Maitim, sinulut ni
Mapulà
Nang malaó y kumará-kará6.
Elle était jeune encore et l’on voyait qu’elle
avait dû être belle et gracieuse. Ses yeux que, avec son
âme, elle avait donnés à ses fils, étaient
beaux, d’un profond regard ombragé de longs cils; son nez
correct, ses lèvres pâles, d’un dessin
élégant. Elle était ce que les tagals appellent
kayumanging-kaligátan, c’est-à-dire brune
mais de teint clair et pur. Malgré sa jeunesse, la douleur,
parfois même la faim, commençait à creuser les
joues pâlies; la chevelure abondante, autrefois l’ornement
de sa personne, était encore soignée mais par habitude,
non par coquetterie: un chignon très simple, sans aiguilles ni
peignes...
Depuis plusieurs jours elle n’était pas sortie, restant
chez elle pour achever le plus promptement possible un travail de
couture dont on l’avait chargée. Pour gagner quelque
argent elle avait manqué la messe ce matin; il lui aurait fallu
perdre deux heures pour aller au pueblo et en revenir—la
pauvreté force à pécher. Son travail
terminé, elle le porta à celui qui l’avait
commandé, mais il lui en promit seulement le payement.
Toute la journée elle avait pensé au plaisir qui
l’attendait [101]ce soir, elle savait que ses fils allaient
venir et voulait les régaler d’un bon repas. Elle acheta
des sardines, cueillit dans son jardin les tomates les plus belles,
parce qu’elle savait que c’était le mets favori de
Crispin; à son voisin, le philosophe Tasio, qui habitait
à un demi-kilomètre, elle demanda un filet de sanglier et
une cuisse de canard sauvage pour Basilio, puis, toute à son
espérance, elle fit cuire le riz le plus blanc qu’elle ait
elle-même pu choisir sur les aires; ce devait être pour les
pauvres enfants un véritable repas de curés.
Mais par malheur le père arriva. Adieu le dîner! Il
mangea le riz, le filet de sanglier, la cuisse de canard, les cinq
sardines et les tomates. Sisa ne dit rien, heureuse de voir son mari
satisfait; d’autant plus heureuse qu’aussitôt repu,
il se souvint qu’il avait des enfants et demanda où ils
étaient; la pauvre mère sourit; elle se promit de ne rien
manger, car il ne restait pas assez pour trois, mais le père
avait pensé à ses fils, cela valait plus pour elle que le
meilleur des repas.
Puis il prit son coq et fit mine de s’en aller.
—Ne veux-tu pas les voir? demanda-t-elle tremblante; le vieux
Tasio m’a dit qu’ils tarderaient un peu; Crispin sait
déjà lire et... peut-être que Basilio apportera sa
paie!
Cette dernière raison parut le toucher, il hésita,
mais son bon ange triomphant:
—En ce cas, garde-moi un peso! dit-il et il partit. Sisa,
restée seule, pleura amèrement; mais elle se souvint de
ses enfants et sécha ses larmes. Elle fit cuire un peu de riz
qui lui restait et prépara les trois dernières sardines:
chacun en aurait une et demie.
—Ils auront bon appétit, pensait-elle, la route est
longue et les estomacs affamés n’ont pas de
cœur.
Attentive à tout bruit, nous la trouvons écoutant les
plus légers bruits de pas; forts et nets, c’était
Basile; légers et inégaux, Crispin. [102]
La kalao7
avait déjà chanté deux ou trois fois dans le bois
depuis que la pluie avait cessé, mais ses fils
n’arrivaient pas.
Elle mit les sardines dans la marmite pour qu’elles ne se
refroidissent pas, puis s’approcha de l’entrée de la
porte pour regarder sur le chemin. Pour se distraire, elle fredonna
à voix basse; sa voix était belle et, quand ses fils
l’entendaient chanter «kundiman8», ils pleuraient sans
savoir pourquoi. Mais ce soir, sa voix tremblait et les notes
paresseuses sortaient avec peine de ses lèvres.
Elle suspendit son chant et fouilla l’obscurité de son
regard. Personne ne venait du côté du pueblo, on
n’entendait rien que le vent secouant les larges feuilles des
platanes dont l’eau tombait en grosses gouttes.
Regardant dehors pour la seconde fois, elle vit devant elle un chien
noir; il semblait chercher quelque chose sur le chemin. Sisa eut peur,
elle ramassa une pierre et la jeta au chien qui s’enfuit en
hurlant lugubrement.
Sisa n’était pas superstitieuse, mais elle avait
entendu parler si souvent des pressentiments et des chiens noirs que la
terreur la saisit. Elle ferma précipitamment la porte et
s’assit à côté de la lumière. La nuit
favorise les folles croyances et, facilement, l’imagination
peuple de spectres l’obscurité des deux.
Elle pria, invoqua la Vierge, Dieu lui-même, pour qu’ils
prissent soin de ses fils, surtout de son petit Crispin. Puis distraite
de la prière par son unique préoccupation, elle ne pensa
plus qu’à eux, se rappelant les manières de chacun,
ces manières qui lui paraissaient si douces, dans toutes leurs
actions comme pendant leur sommeil. Mais de nouveau, elle sentit ses
cheveux se hérisser, ses yeux démesurément
s’ouvrirent: illusion ou réalité, elle voyait
Crispin debout, près de l’âtre: c’était
là qu’il s’asseyait pour babiller avec elle.
Maintenant [103]il ne disait rien; il la regardait avec de
grands yeux pensifs et souriait.
—Mère, ouvre-moi! ouvre-moi, mère! disait au
dehors la voix de Basilio.
Sisa frémit et la vision disparut.
[Table des matières]
XVII
Basilio
Basilio eut à peine la force d’entrer; tout
trébuchant, il se laissa tomber dans les bras de sa
mère.
Un froid inexplicable s’empara de Sisa lorsqu’elle le
vit arriver seul. Elle voulut parler, mais ne trouva pas de mots; elle
voulut embrasser son fils mais ne trouva pas non plus de forces;
pleurer et parler lui étaient également impossibles.
Cependant, à la vue du sang qui baignait le front de
l’enfant, elle recouvra la voix et cria d’un accent qui
semblait annoncer la rupture d’une corde de son cœur:
—Mes enfants!
—Ne crains rien, maman! lui répondit Basilio; Crispin
est resté au couvent.
—Au couvent? Il est resté au couvent? Vivant?
L’enfant levant ses yeux vers elle.
—Ah! s’écria-t-elle, passant de la plus grande
angoisse à la plus grande joie. Elle pleurait, embrassant son
fils, couvrant de baisers son front ensanglanté.
—Crispin vit! tu l’as laissé au couvent... et
pourquoi es-tu blessé, mon fils? Tu es tombé.
Elle l’examinait soigneusement.
—En emmenant Crispin, le sacristain principal me dit que je ne
pourrais sortir avant dix heures, et comme il est très tard, je
me suis échappé. En traversant [104]le pueblo, deux soldats me
crièrent: qui vive? je me mis à courir, ils firent
feu et une balle m’effleura le front. Je craignais qu’ils
ne me prissent et ne me fissent nettoyer le quartier à coups de
bâtons comme ils l’ont fait avec Pablo qui en est encore
malade.
—Mon Dieu! mon Dieu! murmura la mère tout émue;
merci, tu l’as sauvé!
Et tandis qu’elle cherchait des mouchoirs, de l’eau, du
vinaigre et de la charpie, elle ajouta:
—Un doigt de plus et ils te tuaient, ils tuaient mon fils! Les
gardes civils ne pensent pas aux mères!
—Tu diras que je suis tombé d’un arbre, personne
ne doit savoir que l’on m’a poursuivi.
—Et pourquoi Crispin est-il resté? demanda Sisa
après qu’elle eut soigné son fils.
Celui-ci la regarda un instant, puis l’embrassa, puis enfin
lui raconta peu à peu l’histoire de l’argent
volé; mais cependant il ne lui parla pas des tourments que
l’on infligeait à son petit frère.
La mère et l’enfant confondirent leurs larmes.
—Mon bon Crispin, accuser mon bon Crispin! C’est parce
que nous sommes pauvres et que les pauvres doivent tout souffrir!
murmura Sisa en regardant, les yeux pleins de larmes, le
tinhoy1
dont l’huile finissait de brûler.
Ils restèrent un moment ainsi sans rien dire.
—As-tu mangé? Non? il y a du riz et des sardines
sèches.
—Je n’ai pas mangé, mais je n’ai pas faim;
donne-moi de l’eau, je ne veux rien de plus.
—Si, mange, reprit la mère avec tristesse; je savais
que tu n’aimais pas les sardines sèches, je t’avais
préparé autre chose, mais ton père est venu, mon
pauvre enfant!
—Mon père est venu? demanda Basilio, et instinctivement
il examina la figure et les mains de sa mère. [105]
La question de son fils peina Sisa qui comprit quelle était
la pensée de l’enfant; aussi s’empressa-t-elle de
répondre.
—Oui, il est venu et il a demandé après vous; il
voulait vous voir; mais il avait très faim. Il a dit que si vous
étiez de bons enfants il reviendrait vivre avec nous...
—Ah! interrompit Basilio, et ses lèvres se
contractèrent avec déplaisir.
—Mon fils! reprit-elle.
—Pardonne-moi, mère! ne sommes-nous pas bien nous
trois, toi, Crispin et moi? Mais tu pleures; je ne dis rien.
Sisa soupira.
—Tu ne manges pas? Alors couchons-nous, car il est
déjà tard.
Sisa ferma la porte de la hutte et couvrit avec de la cendre la
braise qui restait encore pour conserver un peu de feu. L’homme
fait de même avec les sentiments de l’âme, il les
couvre de cette cendre de la vie qui s’appelle
l’indifférence, pour que ne les étouffent pas les
rapports quotidiens avec ses semblables.
Basilio murmura ses oraisons et se coucha près de sa
mère qui priait agenouillée.
Il avait froid, il avait chaud; il chercha à fermer les yeux
en pensant à son petit frère qui espérait dormir
cette nuit dans le sein de sa mère et, maintenant, tremblait de
peur dans un coin obscur du couvent.
Ses oreilles lui répétaient les cris du pauvre petit
tels qu’il les avait entendus dans la tour, mais la nature
confondit bientôt ses idées et le génie du sommeil
descendit sur ses yeux.
Il vit une sorte d’alcôve où brûlaient deux
cierges. Le curé, un jonc à la main, l’air sombre,
écoutait le sacristain principal qui lui parlait dans une langue
étrangère avec des gestes horribles. Crispin tremblait et
tournait de tous côtés des yeux pleins de larmes, comme
s’il cherchait quelqu’un pour le protéger ou un
[106]endroit pour se cacher. Le curé se
retournait vers lui et l’interpellait irrité, le jonc
sifflait. L’enfant courait se cacher derrière le
sacristain, mais celui-ci le prenait et l’exposait à la
fureur du curé; le malheureux frappait des poings, des pieds,
criait, s’attachait au sol, se roulait, se levait, fuyait,
glissait, tombait et parait les coups avec ses mains que,
blessées, il cachait vivement en hurlant. Basilio le vit se
tordre, frapper le sol de la tête: il vit, il entendit siffler le
jonc! Désespéré, son jeune frère se levait;
fou de douleur, il se ruait sur ses bourreaux et mordait le curé
à la main.
Celui-ci poussait un cri, laissait tomber le terrible jonc; le
sacristain principal prenait un bâton, en frappait un coup sur la
tête de l’enfant qui tombait assommé; le
curé, le voyant blessé, lui donnait un coup de pied, mais
le pauvre petit ne se défendait plus, il ne criait plus;
roulé sur le sol comme une masse inerte, il laissait une trace
humide2...
La voix de Sisa le rappela à la réalité.
—Qu’as-tu? pourquoi pleures-tu?
—Je rêve... Mon Dieu! s’écria Basilio
couvert de sueur en se blottissant près de sa mère.
C’était un rêve; dis-moi, maman, n’est-ce pas
que ce n’était qu’un rêve et rien de plus!
—Qu’as-tu rêvé?
L’enfant ne répondit pas. Il s’assit pour essuyer
ses larmes et éponger la sueur qui coulait de son front. Dans la
pauvre cabane, l’obscurité était
complète.
—Un rêve, un rêve! répétait Basilio
à voix basse.
—Raconte-moi ce que tu as rêvé, je ne puis
dormir! dit la mère quand son fils revint se coucher.
—Eh bien! dit-il à voix basse, je rêvais que nous
étions en train de glaner... dans un champ où il y avait
beaucoup de fleurs... les femmes avaient des paniers pleins
d’épis... les hommes avaient aussi des paniers [107]pleins
d’épis... et les enfants aussi! Je ne me rappelle plus,
mère, je ne me souviens pas du reste!
Sisa n’insista pas; elle n’attachait aucune importance
aux songes.
—Mère, j’ai projeté quelque chose ce soir,
dit Basilio après quelques minutes de silence.
—Quel est ce projet? demanda-t-elle à son fils, humble
en tout, même devant ses enfants à qui elle croyait plus
de bon sens qu’à elle-même.
—Je ne voudrais pas être sacristain.
—Comment?
—Écoute, maman, ce que j’ai projeté: Le
fils du défunt D. Rafael est arrivé aujourd’hui
d’Espagne, il sera aussi bon que père. Eh bien! demain, va
chercher Crispin, touche ma paye et dis que je ne serai pas
sacristain.
Aussitôt que je le pourrai, j’irai voir D.
Crisóstomo et je le supplierai de me prendre comme gardeur de
vaches ou de carabaos, je suis assez grand pour cela. Crispin pourra
continuer à apprendre chez le vieux Tasio, qui ne frappe pas et
est très bon, meilleur que ne le croit le curé.
Qu’avons-nous à craindre du Père? Peut-il nous
faire plus pauvres que nous ne le sommes? Crois-moi, mère, le
vieux est un brave homme; je l’ai vu souvent à
l’église quand il n’y avait personne; il
s’agenouillait et priait. Crois-moi! Que perdrai-je à
n’être pas sacristain? On gagne peu et, encore, tout ce que
l’on gagne sert à payer des amendes! Tous en sont
là. Je serai berger, et en soignant bien les animaux qu’il
m’aura confiés, je me ferai aimer de mon maître;
peut-être qu’il nous laissera traire une vache pour prendre
le lait; Crispin aime beaucoup le lait. Qui sait! peut-être nous
fera-t-il cadeau d’une petite génisse s’il voit que
je me comporte bien; nous la soignerons et l’engraisserons comme
notre poule. Dans le bois je cueillerai des fruits et je les vendrai au
pueblo avec les légumes de notre potager, et ainsi nous aurons
de l’argent. Puis je disposerai des lacets et des pièges
pour [108]prendre des oiseaux et des chats sauvages, je
pêcherai dans la rivière et, quand je serai plus grand,
j’irai à la chasse. Je pourrai aussi couper du bois pour
le vendre ou le donner au maître des vaches, et ainsi il sera
content de nous. Quand je pourrai labourer, je lui demanderai de me
confier un bout de terrain pour semer de la canne à sucre ou du
maïs et tu n’auras plus besoin de coudre
jusqu’à minuit. Nous aurons des habits neufs à
chaque fête, nous mangerons de la viande et de grands poissons.
Et cependant je vivrai libre, nous nous verrons tous les jours et
prendrons ensemble nos repas. Et puisque le vieux Tasio dit que Crispin
a beaucoup de facilité, nous l’enverrons étudier
à Manille et je travaillerai pour lui. N’est-ce pas, ma
mère? Il sera docteur. Qu’en dis-tu?
—Qu’en puis-je dire sinon que tu as raison!
répondit Sisa en embrassant son fils.
Elle remarqua que, dans ses projets d’avenir, l’enfant
ne tenait pas compte de son père et pleura silencieusement.
Basilio, poursuivant ses projets, parlait avec cette confiance
propre à la jeunesse qui ne voit rien de plus que ce
qu’elle veut voir. Sisa disait oui à tout, tout lui
paraissait bien. Le sommeil cependant redescendait de nouveau peu
à peu sur les paupières fatiguées de
l’enfant et, cette fois, le Ole-Luköie dont nous parle
Andersen déploya au dessus de sa tête son beau parasol
orné d’allègres peintures.
Il se voyait pasteur avec son petit frère; ils cueillaient
dans le bois des goyaves, des alpay3 et d’autres fruits encore; ils allaient de
branche en branche, légers comme des papillons, ils entraient
dans les cavernes et en admiraient les parois brillantes; ils se
baignaient dans les sources et le sable était comme de la poudre
d’or, les pierres comme les brillants de la couronne de la
Vierge. Les petits poissons les saluaient [109]et leur souriaient; les plantes
inclinaient vers eux leurs branches chargées de monnaies et de
fruits. Ensuite, il vit une cloche pendue à un arbre, avec une
longue corde pour la mettre en branle; à la corde une vache
était attachée, entre ses cornes était un nid
d’oiseaux, et Crispin était dans la cloche qui se mit
à sonner...
Mais la mère, qui n’était plus à
l’âge des insouciants sommeils et n’avait pas couru
pendant une heure, ne dormait pas.
[Table des matières]
XVIII
Ames en peine
Il était sept heures du matin quand Fr. Salvi acheva de dire
sa dernière messe: les trois avaient été
expédiées en une heure.
—Le Père est malade, disaient les dévotes; il
n’a pas officié avec la lenteur élégante qui
lui est habituelle.
Il se dépouilla de ses ornements sacerdotaux sans dire une
parole, sans regarder personne, sans faire aucune observation.
—Attention! chuchotaient les sacristains; sa mauvaise humeur
augmente. Les amendes vont pleuvoir, et tout cela par la faute de ces
deux enfants!
Il sortit de la sacristie pour monter au presbytère sous le
perron duquel l’attendaient sept ou huit femmes assises sur un
banc et un homme qui se promenait de long en large. En le voyant venir
elles se levèrent, une femme se leva pour lui baiser la main,
mais le religieux fit un tel geste d’impatience qu’elle
s’arrêta net.
—Il aura perdu un réal Kuriput1? s’écria,
d’un ton [110]moqueur, la femme vexée d’une
telle réception. Ne pas donner la main à baiser à
la zélatrice de la confrérie, à la sœur
Rufa! voilà qui ne s’est jamais vu!
—Il n’a pas siégé au confessionnal, ce
matin! ajouta sœur Sipa, une vieille édentée. Je
voulais me confesser pour communier et gagner les indulgences...
—Oh! moi, répondit une jeune femme de physionomie
candide, j’ai gagné trois indulgences
plénières et je les ai appliquées à
l’âme de mon mari.
—Vous avez eu tort, sœur Juana! dit Rufa
offensée. Une plénière suffisait pour le sortir du
Purgatoire; vous ne devez pas prodiguer les saintes indulgences, faites
comme moi.
—Je me disais: plus il y en aura, mieux cela vaudra!
répondit en souriant l’innocente sœur Juana. Mais
dites-moi, qu’est-ce que vous en faites?
Sœur Rufa ne répondit pas immédiatement;
d’abord elle demanda un buyo, le mâcha, regarda son
auditoire attentif, cracha, puis enfin se décida à parler
tout en suçant encore un peu de tabac.
—Je ne gâche jamais un jour du Paradis! Depuis que
j’appartiens à la confrérie, j’ai
gagné 457 indulgences plénières et 760.598
années d’indulgences simples. Je marque tout ce que je
gagne, parce que j’aime à tenir mes comptes en
règle ne voulant pas tromper personne ni être
trompée moi-même.
Sœur Rufa fit une petite pause et continua à
mâcher son tabac; les femmes la regardaient avec admiration, mais
l’homme qui se promenait s’arrêta et lui dit un peu
dédaigneusement.
—Eh bien, moi! dans cette année seulement, j’ai
gagné quatre plénières et cent ans
d’indulgences de plus que vous, sœur Rufa, et cependant
j’ai fort peu prié.
—Vous en avez gagné plus que moi? plus de 689
plénières et de 994.856 années?
répéta sœur Rufa sans cacher son dépit.
—Mais oui, huit plénières et cent quinze
années de plus, et tout cela en quelques mois! assura
l’homme [111]au cou de qui pendaient des rosaires et des
scapulaires crasseux.
—Ce n’est pas étonnant, fit la Rufa,
s’avouant vaincue, vous êtes le maître et le chef de
la province!
L’homme sourit flatté:
—En effet, il n’est pas étonnant que je gagne
plus d’indulgences que vous; je puis presque dire que, même
en dormant, j’en gagne.
—Et qu’en faites-vous? demandèrent quatre ou cinq
voix à la fois.
—Bah! répondit l’homme avec un geste de souverain
mépris, je les dépense par ci par là!
—Il n’y a pas de quoi vous en vanter! protesta la Rufa.
Vous irez vous-même au Purgatoire pour avoir gâché
des indulgences. Sachez que chaque parole inutile se paie par quarante
jours de feu, d’après ce que dit le curé; chaque
bout de fil par soixante, chaque goutte d’eau par vingt! Vous
irez au Purgatoire!
—Je saurai bien en sortir, répondit le frère
Pedro avec une confiance sublime. J’ai retiré du feu tant
d’âmes, j’ai fait tant de saints! Et de plus,
à l’article de la mort, je puis gagner encore, si je veux,
sept plénières et ainsi, même mourant, me sauver
moi-même et en sauver d’autres!
Ceci dit, il s’éloigna orgueilleusement.
—Cependant, vous devriez faire comme moi, reprit sœur
Rufa; je n’en perds pas un jour et je tiens bien mes comptes. Je
ne veux tromper personne, mais je ne veux pas non plus qu’on me
trompe.
—Que faites-vous donc? demanda la Juana.
—Eh bien! il faut imiter ce que je fais. Par exemple: supposez
que je gagne une année d’indulgences; je la marque sur mon
cahier et je dis: Bienheureux Père Señor saint Dominique,
faites-moi la grâce de voir si dans le Purgatoire il y a
quelqu’un qui ait précisément besoin d’une
année, ni un jour de plus, ni un jour de moins. Puis je joue
à pile ou face; s’il retourne face, non; s’il
retourne pile, oui. Supposez qu’il sorte
[112]pile, j’écris
reçu; s’il sort face? alors je retiens l’indulgence
et je fais ainsi des petits groupes de cent ans dont j’ai
toujours l’emploi. Il est malheureux qu’on ne puisse faire
avec les indulgences ce que l’on fait avec l’argent: les
prêter à intérêts, on pourrait sauver plus
d’âmes. Croyez-le, faites comme moi.
—Mais, je fais mieux que cela! répondit sœur
Sipa.
—Comment mieux? mais c’est impossible, mon
système ne peut pas être perfectionné!
—Écoutez-moi un moment et vous serez convaincue, ma
sœur! reprit sévèrement la vieille Sipa.
—C’est à voir, écoutons! dirent les
autres.
Après avoir toussé un peu
cérémonieusement la vieille s’expliqua ainsi:
—Vous savez très bien qu’en récitant le
Bendita-sea-tu-Pureza et le Señor-mio-Jesucristo,
Padre-dulcisimo-por-el-gozo2, on gagne dix ans pour chaque lettre...
—Vingt!—Non, pas tant!—Cinq! dirent quelques
voix.
—Un an de plus ou de moins, cela ne fait rien! Maintenant,
quand un domestique ou une servante me casse une assiette, un vase ou
une tasse, je lui fais ramasser tous les morceaux et pour chacun,
même pour le plus petit, le coupable doit me réciter le
Bendita-sea-tu-Pureza et le
Señor-mio-Jesucristo-Padre-dulcisimo-por-el-gozo; les
indulgences qu’il gagne ainsi je les applique aux âmes du
Purgatoire. Chez moi, il n’y a que les chats qui ne savent pas
ces prières.
—Mais ces indulgences ce sont vos servantes qui les gagnent,
ce n’est pas vous, sœur Sipa, objecta la Rufa.
—Et mes tasses, et mes plats, qui me les rembourse? Elles sont
contentes de les payer de cette façon et moi aussi. Je ne les
frappe pas, mais pas un éclat, pas une pincée... [113]
—Je vais faire comme vous!—Et moi aussi!—Et moi!
disaient les femmes.
—Mais si l’assiette ne s’est cassée
qu’en deux ou trois morceaux, vous ne gagnez pas grand chose!
observa encore l’obstinée Rufa.
—Vous croyez! répondit la vieille Sipa; non seulement
je les fais prier aussi, mais de plus ils recollent les morceaux et je
ne perds rien.
Sœur Rufa ne sut plus que dire.
—Permettez-moi de vous soumettre un doute, dit timidement la
jeune Juana. Vous autres, señoras, vous comprenez très
bien toutes ces choses du Ciel, de l’Enfer et du Purgatoire...
j’avoue que je ne suis qu’une ignorante.
—Parlez!
—J’ai vu souvent dans les neuvaines et dans les autres
livres cette recommandation: Trois Pater noster, trois Ave Maria et
trois Gloria Patri...
—Eh bien?
—Je voudrais savoir comment on doit les dire: est-ce trois
Pater noster de suite, trois Ave Maria de suite et trois Gloria Patri
de suite, ou trois fois un Pater noster, un Ave maria et un Gloria
patri?
—Cela doit être ainsi: trois fois un Pater noster...
—Pardonnez, sœur Sipa, interrompit la Rufa; on doit
réciter autrement: on ne doit pas mêler les mâles
avec les femelles; les Pater noster sont les mâles, les Ave Maria
les femelles et les Gloria sont les fils.
—Hé! pardonnez, sœur Rufa, Pater noster, Ave
Maria et Gloria sont comme du riz, de la viande et de la sauce;
c’est un seul mets pour les saints...
—Vous êtes dans l’erreur! Voyez un peu: vous qui
priez de cette façon vous n’obtenez jamais ce que vous
demandez!
—Et vous, parce que vous priez autrement, vous ne retirez rien
de vos neuvaines! répliqua la vieille Sipa.
—Que dites-vous? dit la Rufa en se levant; il n’y a pas
longtemps, j’ai perdu un petit cochon, j’ai fait une [114]prière à saint Antoine et je
l’ai retrouvé; peu après je l’ai vendu un bon
prix, voilà!
—Oui, c’est pour cela que votre voisine dit que vous
avez vendu un petit cochon qui lui appartenait.
—Quoi! l’effrontée! Alors je suis comme
vous...?
Pedro dut intervenir pour rétablir la paix; on ne se
souvenait plus des Pater noster, on ne parlait que des cochons.
—Allons, allons, il ne faut pas se brouiller pour un cochon,
mes sœurs! Les saintes Écritures nous en donnent un
exemple: les hérétiques et les protestants n’ont
pas renié N.-S. Jésus-Christ qui avait jeté
à l’eau un troupeau de porcs qui leur appartenait, et nous
qui sommes chrétiens, et de plus frères du Très
saint Rosaire, nous devrions nous fâcher pour un petit cochon?
Que diraient de nous nos rivaux, les frères du
Tiers-Ordre?
Toutes se turent, admirant la profonde sagesse du maître et
craignant les moqueries des frères du Tiers-Ordre. Lui,
satisfait de tant d’obéissance, changea de ton et
poursuivit:
—Le curé va bientôt nous appeler. Il faut lui
dire quel prédicateur nous choisissons parmi les trois
qu’il nous a proposés hier: le P. Dámaso, le P.
Martin ou le vicaire. Je ne sais si ceux du Tiers-Ordre ont
déjà choisi; il faut décider.
—Le vicaire... murmura timidement la Juana.
—Hem! le vicaire ne sait pas prêcher! dit la Sipa, le P.
Martin vaudrait mieux.
—Le P. Martin! s’écria une troisième avec
dédain; il n’a pas de voix; le P. Dámaso,
voilà celui qu’il faut.
—C’est cela, c’est cela! dit la Rufa. Le P.
Dámaso sait très bien prêcher, lui. On dirait un
acteur, c’est cela!
—Mais nous ne le comprenons pas! murmura la Juana.
—C’est parce qu’il est très profond! Pourvu
qu’il prêche bien...
Sur ces entrefaites, Sisa entra portant une corbeille [115]sur la
tête; elle dit bonjour aux femmes et monta les escaliers.
—Puisque celle-là monte, montons aussi!
dirent-elles.
Sisa sentait battre son cœur avec violence; elle ne savait que
dire au curé pour apaiser sa colère ni quelles raisons
lui donner pour défendre son fils. Ce matin, aux
premières lueurs de l’aurore, elle était descendue
au potager cueillir les plus beaux de ses légumes qu’elle
avait placés dans une corbeille entre des feuilles de platane et
des fleurs. Comme elle savait que le curé aimait la salade de
pakô3, elle en avait été chercher sur les
bords de la rivière. Puis, parée de ses plus beaux
vêtements, la corbeille sur la tête, sans réveiller
son fils, elle était partie pour le pueblo.
S’efforçant de faire le moins de bruit possible, elle
monta les marches lentement, écoutant attentivement si, par
hasard, elle n’entendait pas une voix connue, fraîche,
enfantine.
Mais elle ne rencontra ni n’entendit personne et s’en
fut droit à la cuisine.
Là, elle regarda de tous côtés; les domestiques
et les sacristains la reçurent froidement. Elle salua,
c’est à peine s’ils lui rendirent son salut.
—Où pourrai-je laisser ces légumes?
demanda-t-elle sans paraître offensée.
—Là... où vous voudrez! répondit le
cuisinier sans se déranger de son travail; il plumait un
chapon.
Sisa plaça en ordre sur la table les aubergines, les
amargosos, les patolas, les zarzalidas4 et les tendres branches de
pakô. Puis, par dessus, elle étendit les [116]fleurs, sourit
à demi et demanda à un domestique qui lui paraissait plus
aimable que le cuisinier:
—Pourrais-je parler au Père?
—Il est malade, lui répondit cet homme à voix
basse.
—Et Crispin, savez-vous s’il est à la
sacristie?
Le domestique la regarda surpris:
—Crispin? répondit-il en fronçant les sourcils.
N’est-il pas chez vous?
—Basile est bien à la maison, mais Crispin est
resté ici, reprit Sisa; je veux le voir...
—Oui, fît le domestique; il est resté, mais
ensuite... ensuite il s’est sauvé, en volant toutes sortes
de choses. Le curé m’a envoyé ce matin de bonne
heure au quartier pour en prévenir la garde civile. Les gardes
doivent être partis chez vous pour chercher les enfants.
Sisa ne voulait pas entendre, elle ouvrit la bouche, mais ses
lèvres se remuèrent vainement, aucun son n’en
sortit.
—Allez avec vos fils! ajouta le cuisinier. On voit bien que
vous êtes une femme fidèle; les enfants sont le portrait
de leur père! Prenez garde, le petit pourrait bien le
dépasser!
Sisa étouffa un amer sanglot; à bout de forces, elle
se laissa tomber sur un banc.
—Ne pleurez pas ici! lui cria le cuisinier. Vous savez que le
Père est malade, ne le dérangez pas! Allez pleurer dans
la rue.
La pauvre femme descendit l’escalier presque de force, en
même temps que les sœurs qui murmuraient et bavardaient sur
la maladie du curé.
La malheureuse mère cachait sa figure dans son mouchoir et
comprimait ses larmes.
Dans la rue, elle regarda autour d’elle indécise, puis
comme si elle avait pris une résolution subite,
s’éloigna rapidement. [117]
[Table des matières]
XIX
Aventures d’un maître
d’école
Le vulgaire est stupide et, comme il paye, il est
juste
De lui parler stupidement pour lui faire plaisir.
Lope de Vega.
Le lac, entouré de ses montagnes, dort tranquille, comme si
la nuit précédente il n’avait pas lui aussi
été secoué par la tempête. Aux premiers
reflets de lumière qui réveillent dans les eaux les
génies phosphorescents, se dessinent au loin, presque aux
confins de l’horizon, des silhouettes grises; ce sont les barques
des pêcheurs qui lèvent leurs filets, des cascos et des
paraos1, qui
tendent leurs voiles.
Du sommet d’une hauteur, deux hommes, vêtus de deuil,
regardaient l’eau, silencieux; l’un n’est autre
qu’Ibarra; son compagnon est un jeune homme d’humble aspect
et de physionomie mélancolique.
—C’est ici! disait ce dernier. C’est ici que le
fossoyeur nous a conduits, le lieutenant Guevara et moi.
Ibarra serra avec effusion la main du jeune homme.
—Vous n’avez pas à me remercier. Je devais
beaucoup à votre père et tout ce qu’a pu faire ma
reconnaissance a été de l’accompagner au tombeau.
J’étais venu ici sans y connaître personne, sans
recommandations, sans fortune, comme maintenant. Mon
prédécesseur avait abandonné l’école
pour se consacrer à la vente du tabac. Votre père me
protégea, me procura une maison et m’aida autant
qu’il fut nécessaire au [118]commencement de mon installation;
il venait visiter l’école et distribuait des cuartos aux
enfants pauvres et appliqués; il leur fournissait aussi des
livres et du papier. Mais hélas! comme tout ce qui est bon, ce
temps fut de courte durée.
Ibarra se découvrit et sembla prier un long moment. Puis il
se retourna vers son compagnon et lui dit:
—Vous disiez que mon père secourait les enfants
pauvres, mais maintenant?
—Maintenant ils font de leur mieux et écrivent comme
ils peuvent, répondit le jeune homme.
—Et pourquoi?
—La cause en est dans leurs chemises trouées et dans
leurs yeux humiliés.
Ibarra garda le silence.
—Combien d’élèves avez-vous? demanda-t-il
avec un certain intérêt.
—Plus de deux cents sur la liste; dans la classe
vingt-cinq.
—Comment cela se fait-il?
Le maître d’école sourit
mélancoliquement:
—Vous en dire les causes serait vous raconter une longue et
fastidieuse histoire.
—N’attribuez pas cette question à une vaine
curiosité, reprit Ibarra en regardant gravement au loin.
J’ai beaucoup réfléchi et je crois que
réaliser les pensées de mon père vaut mieux que de
le pleurer, mieux même que de le venger. Sa tombe est la Nature
sacrée et ses ennemis le peuple et un prêtre: je pardonne
à l’ignorance du premier; je respecte le caractère
du second, parce que l’on doit respecter la Religion qui fait
l’éducation de la société. Je veux
m’inspirer de l’esprit de celui qui m’a donné
la vie et c’est pour cela que je désire connaître
les obstacles qui s’opposent ici à l’instruction des
enfants.
—Le pays bénira votre mémoire, señor, si
vous réalisez les beaux projets de votre défunt
père, dit l’instituteur. Vous voulez connaître les
obstacles auxquels [119]nous nous heurtons? Eh bien, dans les
circonstances actuelles, sans un puissant concours jamais il n’y
aura d’enseignement organisé ici, d’abord parce que
l’enfance n’est ni attirée ni stimulée,
ensuite parce que, quand même il serait remédié
à ce double défaut, les moyens manquent et les besoins
sont trop nombreux. On dit qu’en Allemagne le fils du paysan
étudie pendant huit ans à l’école du
village; qui voudrait ici consacrer à apprendre la moitié
de ce temps quand on en retirerait si peu de fruits? On lit, on
écrit, on apprend par cœur des passages, des livres
entiers même, en castillan sans en comprendre un seul mot; de
quelle utilité est l’école pour le fils de nos
campagnards?
—Puisque vous voyez distinctement le mal, quel remède y
proposeriez-vous?
—Ah! répondit le pauvre maître en remuant
tristement la tête, seul, je ne puis lutter contre tous les
besoins ni contre certaines influences. Il faudrait avant tout avoir
une école, un local et non, comme maintenant, faire la classe
à côté de la voiture du P. Curé, en bas du
couvent. Là, les enfants qui aiment lire tout haut incommodent
le Père; souvent il descend énervé, surtout quand
il a ses attaques; il crie après eux et parfois même
m’insulte. Comprenez-vous que de cette façon je ne puis
les instruire, ils ne puissent rien apprendre; l’enfant ne
respecte plus le maître qu’il a vu maltraiter, qu’il
sait ne pouvoir faire prévaloir ses droits. Le maître,
pour être écouté, pour que l’on ne doute pas
de son autorité, a besoin de prestige, de bonne renommée,
de force morale, d’une certaine liberté; permettez que je
vous parle de ces tristes détails. J’ai voulu introduire
des réformes et l’on s’est moqué de moi. Pour
remédier à ce mal que je vous signalais, je cherchai
à enseigner l’espagnol aux enfants, non seulement parce
que c’était l’ordre du gouvernement mais parce que
je pensais que ce serait avantageux pour tous. J’employai la
méthode la plus simple, des phrases et des mots, sans me servir
de
règles [120]compliquées, attendant pour leur
apprendre la grammaire qu’ils aient acquis un vocabulaire. Au
bout de quelques semaines, déjà les plus intelligents me
comprenaient et composaient de petites phrases.
Le maître s’arrêta et parut hésiter, puis,
comme s’il avait pris une décision, il continua.
—Je ne dois pas être honteux des insultes que j’ai
reçues; qui que ce soit à ma place aurait agi de
même. Comme je vous le disais, cela commençait bien; mais
quelques jours après le P. Dámaso, le curé
d’alors, me fit appeler par le sacristain principal. Comme je
connaissais son caractère et craignais de le faire attendre, je
montai immédiatement, le saluai et lui dis bonjour en castillan.
Lui qui pour tout salut me tendait sa main à baiser la retira
et, sans me répondre, se mit à rire aux éclats
d’une façon burlesque. Je restai déconcerté;
devant moi était le sacristain principal. Je ne savais que dire,
je le regardais, il riait toujours. Je commençais à
m’impatienter et craignais de commettre une imprudence, car il me
semble que l’on peut à la fois être bon
chrétien et garder sa dignité. J’allais lui
demander ce que cela signifiait quand, passant du rire à
l’insulte, il me dit d’un air sournois: «Que de
buenos dias? buenos dias? c’est très gracieux! tu sais
parler l’espagnol?» Et il continua à se
réjouir.
Ibarra ne put réprimer un sourire.
—Vous riez, reprit l’instituteur; moi aussi, maintenant;
mais j’avoue qu’alors je n’en avais pas envie.
J’étais debout; je sentis que le sang me montait à
la tête, un éclair obscurcit mon cerveau. Je voyais le
curé loin de moi, très loin; je m’approchai pour
lui répondre, sans savoir ce que j’allais dire. Le
sacristain principal s’interposa; le P. Dámaso se leva et
me dit très sérieusement en tagal: «Ne porte pas
des habits qui ne sont pas les tiens; contente-toi de parler ton idiome
et n’estropie pas l’espagnol qui n’est pas fait pour
vous. Connais-tu maître Ciruela? Eh bien! Ciruela était un
maître qui ne savait ni lire ni écrire et pourtant il
[121]faisait l’école2.» Je voulus le retenir,
mais il partit dans sa chambre et ferma violemment la porte.
Qu’allais-je faire, moi qui avais à peine de quoi vivre
avec mes appointements, qui pour les toucher avais besoin du visa du
curé et devais aller au chef-lieu de la province? que pouvais-je
contre lui, la première autorité morale, politique et
civile du pueblo, soutenu par sa corporation, craint par le
gouvernement, riche, puissant, consulté, écouté et
cru toujours par tous? S’il m’insultait, je devais me
taire; si je répliquais, je perdais ma place, je brisais ma
carrière sans espoir de gagner ma vie autrement; au contraire,
car tous se seraient mis avec le prêtre, m’auraient maudit,
appelé vaniteux, orgueilleux, fanfaron, mauvais chrétien,
peut-être même anti-espagnol et flibustier. D’un
maître d’école on n’attend ni savoir ni
zèle, on ne lui demande que de la résignation, de
l’humilité et de l’inertie. Que Dieu me pardonne si
j’ai renié ma conscience et ma raison, mais je suis
né en ce pays, je dois y vivre, j’ai une mère et je
m’abandonne à mon sort comme un cadavre à la vague
qui le roule!
—Et cet obstacle vous a découragé pour toujours?
Vous n’avez plus rien tenté depuis?
—Plût à Dieu que cela m’eût
corrigé! répondit-il; mes malheurs se seraient
terminés là. Il est vrai que depuis lors j’avais
pris en dégoût mon métier; je pensais pouvoir faire
comme mon prédécesseur et chercher une autre occupation,
parce que le travail, quel qu’il soit, quand on le fait avec
honte et dégoût, est un martyre et l’école,
me rappelant tous les jours mon affront, me faisait passer des heures
bien amères. Mais, que faire? Je ne pouvais détromper ma
mère; je devais lui dire que les trois années de
sacrifices qu’elle s’était imposés pour me
donner cette carrière faisaient maintenant mon bonheur; il
fallait lui faire croire que cette profession était la plus
honorable, que [122]le travail y était agréable, le
chemin semé de fleurs, que l’accomplissement de mes
devoirs ne me valait que des amitiés; que les gens me
respectaient et me comblaient de leur considération; autrement,
sans cesser d’être malheureux, je faisais une autre
malheureuse, ce qui eût été un péché
inutile. Je restai donc à mon poste et, ne me laissant pas
décourager, j’essayai de lutter.
Le maître d’école s’arrêta un
instant, puis il poursuivit:
—Du jour où j’avais été si
grossièrement insulté, je m’examinai moi-même
et je me vis en effet, tel que j’étais, très
ignorant. Je me mis à étudier jour et nuit
l’espagnol et tout ce qui se rapportait à ma
carrière: le vieux philosophe me prêta quelques livres, je
lus ce que je trouvai et j’analysai ce que je lus. Avec les
nouvelles idées que j’acquérais ainsi de part et
d’autre, mon point de vue se modifia et l’aspect de
beaucoup de choses changea à mes yeux. Je vis des erreurs
là où j’avais vu des vérités, des
vérités m’apparurent que j’avais cru
être des erreurs. Les châtiments corporels, par exemple,
qui depuis un temps immémorial étaient la base de
l’éducation et passaient pour le seul moyen efficace de
forcer l’attention des enfants, me semblèrent non
seulement inutiles mais nuisibles aux progrès de leur
éducation. Je me convainquis qu’il était impossible
de raisonner la verge ou le fouet en main; la crainte, la terreur
troublent l’esprit du plus tranquille, et d’autant plus que
l’intelligence de l’enfant est plus vive et plus
impressionnable. Et comme, pour que l’esprit
s’imprègne des idées il est nécessaire
qu’il conserve le calme intérieur et extérieur,
qu’il ait la sérénité, la
tranquillité matérielle et morale et la bonne
volonté, je crus qu’il me fallait avant tout inspirer aux
enfants la confiance, la sûreté et la juste
appréciation d’eux-mêmes. Je compris de plus que le
spectacle journalier des châtiments corporels tuait la
pitié dans le cœur et éteignait cette flamme de la
dignité, le levier du monde, [123]avec laquelle se perd aussi cette
pudeur morale qui ne revient jamais. J’observai aussi que
lorsqu’un enfant est frappé, il trouve une consolation
à ce que les autres le soient à leur tour et sourit avec
satisfaction en entendant les pleurs de ses camarades; quant à
celui que l’on charge de frapper, si le premier jour il
n’obéit qu’avec répugnance, par la suite il
s’accoutume et finit même par prendre plaisir à sa
triste mission. Le passé me peinait, je voulus sauver le
présent en modifiant l’ancien système. Je
m’efforçai de rendre l’étude aimable et
souriante, je voulus faire du petit livre de classe, non pas le triste
et noir instrument de torture baigné des larmes de
l’enfance, mais l’ami qui va lui découvrir de
merveilleux secrets; je voulus que l’école au lieu
d’être un lieu de douleurs devînt un endroit de
récréation intellectuelle. Je supprimai donc, peu
à peu, les punitions corporelles, je laissai chez moi verges et
fouet et les remplaçai par l’émulation et par
l’estime de soi-même. Si une leçon n’avait pas
été apprise, j’en attribuais la faute au manque de
volonté, jamais au manque d’intelligence; je leur faisais
croire qu’ils avaient de meilleures dispositions qu’ils
n’en pouvaient avoir en réalité et cette croyance
qu’ils s’efforçaient de confirmer les obligeait
à travailler, de même que la confiance qui conduit
à l’héroïsme. Au commencement il semblait que
le changement fût impraticable, beaucoup cessèrent
d’étudier; mais je ne me laissai pas rebuter et je vis que
peu à peu les âmes s’élevaient, que les
enfants venaient à l’école plus nombreux et plus
assidus; de plus celui qui avait été
félicité devant les autres apprenait mieux encore le
lendemain. Le bruit se répandit rapidement dans le pueblo que je
ne frappais plus les élèves; le curé me fit
appeler et, craignant une autre scène, je le saluai
sèchement en tagal. Cette fois, il resta très
sérieux. Il me dit que je gâtais les enfants, que je
perdais leur temps et le mien, que je n’accomplissais pas mon
devoir, que le père qui ne châtiait pas son fils ne
l’aimait pas, ainsi que le dit l’Esprit-Saint, [124]que l’on
n’apprend que par la force, etc., etc.; il me rappela une partie
de tous les dictons des temps barbares, comme s’il suffisait
qu’une chose eût été dite par les anciens
pour être indiscutable. Enfin, il me recommanda de faire
attention à ses observations et de revenir à
l’ancien système, sinon il ferait à l’Alcalde
un rapport contre moi. Mon malheur ne s’arrêta pas
là; quelques jours après, les parents des enfants se
présentèrent devant le couvent et je dus appeler à
mon aide toute ma patience et toute ma résignation.
Ils commencèrent à me faire l’éloge du
vieux temps où les maîtres avaient du caractère et
enseignaient comme enseignèrent leurs ancêtres.
«Ceux-là étaient des savants, disaient-ils,
ceux-là battaient et redressaient l’arbre tordu. Ce
n’étaient pas des jeunes, c’étaient des
vieillards à cheveux blancs, expérimentés et
sévères. D. Catalino, le roi de tous et le fondateur de
cette école, ne donnait jamais moins de vingt-cinq coups de
bâton, aussi fit-il de savants élèves dont
quelques-uns devinrent prêtres. Ah! les anciens valaient mieux
que nous, oui, señor, mieux que nous.» D’autres ne
se contentèrent pas de ces grossièretés
indirectes; ils me dirent clairement que si je suivais mon
système, leurs fils n’apprendraient rien et qu’ils
se verraient obligés de les retirer de l’école. Il
était inutile de raisonner avec eux: comme j’étais
jeune ils n’avaient guère confiance en moi. Que
n’aurais-je pas donné pour avoir des cheveux blancs? On me
cita l’autorité du curé, de celui-ci, de
celui-là, ils se citèrent eux-mêmes, disant que
s’ils n’avaient pas été battus par leurs
maîtres, ils n’auraient jamais rien appris. La sympathie
que quelques personnes me témoignèrent adoucit un peu
l’amertume de mon chagrin.
Je dus donc renoncer à un système qui, après
beaucoup de travail, commençait à porter ses fruits.
Désespéré, je rapportai le lendemain à
l’école les verges et les fouets, je repris ma tâche
barbare. La joie disparut, la tristesse revint sur
les visages de ces pauvres enfants [125]qui, déjà,
commençaient à m’aimer; c’étaient les
seules personnes que j’eusse fréquentées, mes seuls
amis. Bien que je m’efforçasse d’économiser
les punitions et de les infliger avec toute la douceur possible, les
pauvrets ne s’en sentaient pas moins vivement blessés,
humiliés, ils pleuraient avec amertume. J’en avais le
cœur déchiré mais, bien qu’irrité
intérieurement contre leurs stupides familles, je ne pouvais
cependant me venger sur ces innocentes victimes des préventions
de leurs parents. Leurs larmes me brûlaient; le cœur se
gonflait dans ma poitrine et, ce jour-là, je quittai la classe
avant l’heure et partis pleurer chez moi dans la solitude... Ma
sensibilité vous étonne peut-être, mais si vous
aviez été à ma place vous eussiez fait comme moi.
Le vieux D. Anastasio me disait: «Les parents demandent des
corrections? Pourquoi ne les corrigez-vous pas eux-mêmes?»
A la fin, le chagrin me rendit malade.
Ibarra écoutait pensif.
—A peine rétabli, je revins à
l’école; le nombre de mes élèves
était réduit au cinquième. Les meilleurs avaient
déserté lorsqu’on avait rétabli
l’ancien système et, parmi ceux qui restaient,
quelques-uns ne venaient en classe que pour fuir les travaux
domestiques. Aucun ne manifesta de joie en me revoyant, aucun ne me
félicita de ma guérison; ma santé leur importait
peu; ils auraient préféré même que je
restasse malade, car mon substitut, s’il frappait plus que moi,
s’absentait la plupart du temps.
Mes autres élèves, ceux que leurs parents continuaient
à envoyer à l’école, allaient se promener
aux champs. On m’accusait de les avoir gâtés et tous
les jours c’étaient de nouvelles récriminations. Un
seul, le fils d’une paysanne, était venu me voir pendant
ma maladie; il s’est fait sacristain et le sacristain principal
dit que les serviteurs de l’église ne doivent pas
fréquenter l’école: ce serait déchoir.
—Et vous vous êtes résigné à votre
nouvelle situation? demanda Ibarra. [126]
—Pouvais-je faire autrement, répondit
l’instituteur. D’ailleurs, pendant ma maladie, divers
événements s’étaient produits, nous avions
changé de curé. Je conçus un nouvel espoir et
tentai une autre expérience, pour que les enfants ne perdissent
pas tout à fait leur temps et tirassent le plus grand profit
possible des corrections.
Puisque maintenant ils ne pouvaient m’aimer, je voulais que
leur ayant appris quelque chose d’utile, ils conservassent au
moins de moi un souvenir qui ne fût pas uniquement amer. Vous
savez que, dans la plus grande partie des écoles, les livres
sont en castillan, à l’exception du catéchisme
tagal qui varie selon la corporation religieuse à laquelle
appartient le curé. Ces livres ne sont que des recueils de
neuvaines et de rosaires avec le catéchisme du P. Astete; ils
sont aussi édifiants que les ouvrages des
hérétiques. Comme il m’était impossible de
leur apprendre le castillan ni de traduire tant d’écrits
divers, je m’efforçai de les remplacer peu à peu
par de courts passages, extraits d’œuvres tagales utiles
telles que le traité de politesse de Hortensio et Feliza,
quelques petits manuels d’agriculture, etc., etc. Parfois, je
traduisais moi-même des opuscules comme l’Histoire des
Philippines du P. Barranera et les leur dictais ensuite pour
qu’ils les réunissent en cahiers, les augmentant parfois
de leurs propres observations. Comme je n’avais pas de cartes
pour leur apprendre la géographie, je copiai celle de la
province que j’avais vue au chef-lieu et, avec cette reproduction
et les carreaux du sol, je leur donnai quelques idées sur le
pays. Cette fois, ce furent les femmes qui s’ameutèrent;
les hommes se contentaient de sourire ne voyant là qu’une
de mes folies. Le nouveau curé me fit appeler et si, à
vrai dire, il ne me reprocha rien, il me déclara cependant que
je devais en premier lieu m’occuper de l’enseignement de la
religion et que, avant d’apprendre toutes ces choses, les enfants
devaient prouver par un examen qu’ils savaient bien et [127]par
cœur les Mystères, le Rosaire et le Catéchisme de
la Doctrine Chrétienne.
Et depuis lors je travaille de mon mieux à convertir ces
pauvres petits en perroquets qui apprennent et récitent tant de
choses auxquelles ils ne comprennent pas un seul mot. Beaucoup savent
déjà les Mystères et le Rosaire, mais je crains
que mes efforts ne se brisent contre le P. Astete, car ils ne
distinguent pas encore bien les demandes des réponses ni ce que
ces deux choses peuvent signifier. Et nous mourrons ainsi, et ainsi
feront à leur tour ceux qui doivent naître, et en Europe
on parlera de progrès!
—Ne soyons pas si pessimistes! répondit Ibarra. Le
lieutenant principal m’a envoyé une invitation pour
assister à une assemblée au tribunal... Qui sait si
là vous n’aurez pas une réponse à vos
questions?
L’instituteur secoua la tête en signe de doute.
—Vous verrez que le projet dont on m’a parlé ne
s’exécutera pas plus que les miens. Sinon, nous le
verrons!
[Table des matières]
XX
L’assemblée au tribunal1
C’était une salle de douze à quinze
mètres de long sur huit à dix de large. Les murs,
blanchis à la chaux, étaient couverts de dessins au
charbon, plus ou moins laids, plus ou moins indécents, avec des
inscriptions qui complétaient leur sens. Dans un coin,
appuyés ordinairement au mur, une dizaine de vieux fusils
à pierre parmi des sabres rouillés, des espadons et des
casse-tête: c’était l’armement des
cuadrilleros..
A une extrémité de la salle qu’ornaient des
rideaux rouges sales se cachait, accroché au mur, le portrait de
[128]S. M.
le Roi; sous le portrait, sur une estrade de bois, un vieux fauteuil
ouvrait ses bras dépecés; devant, une grande table
tachée d’encre, gravée et entaillée par des
inscriptions et des monogrammes comme beaucoup de tables des tavernes
allemandes fréquentées par les étudiants. Des
chaises boiteuses et des bancs délabrés
complétaient le mobilier.
Dans cette salle se tenaient les réunions, siégeait le
tribunal, s’infligeait la torture, etc. En ce moment les
autorités du pueblo et des divers quartiers y sont
réunies; le parti des vieillards ne se mélange pas avec
celui des jeunes, les uns et les autres ne peuvent se souffrir: ils
représentent les conservateurs et les libéraux, seulement
ces luttes politiques acquièrent dans les pueblos un
caractère très violent.
—La conduite du gobernadorcillo m’indigne! disait
à ses amis le chef du parti libéral, D. Filipo; il
apporte un plan préconçu pour retarder jusqu’au
dernier moment la discussion du projet. Notez qu’il nous reste
à peine onze jours.
—Il est resté au couvent à conférer avec
le curé qui est malade! observa un des jeunes.
—Cela ne fait rien! reprit un autre; nous avons
déjà tout préparé. Pourvu que le projet des
vieux n’obtienne pas la majorité...
—Je ne le crois pas! dit D. Filipo; je présenterai le
projet des vieux...
—Comment? que dites-vous? demandèrent ses auditeurs
surpris.
—Je dis que, si je parle le premier, je présenterai le
projet de nos adversaires.
—Et le nôtre?
—Vous vous en chargerez, vous, répliqua le lieutenant
en souriant et il s’adressa à un jeune cabeza de
barangay2:
vous parlerez après que ma proposition aura été
rejetée. [129]
—Nous ne vous comprenons pas, señor! dirent ses
interlocuteurs en le regardant, pleins de doute.
—Écoutez! dit D. Filipo à voix basse
à deux ou trois amis qui l’écoutaient. Ce matin je
me suis rencontré avec le vieux Tasio.
—Eh bien?
—Il m’a dit: «Vos ennemis en veulent plus à
votre personne qu’à vos idées. Voulez-vous
qu’une chose ne se fasse pas? Proposez-la et, serait-elle plus
utile qu’une mitre, elle sera repoussée. Une fois
qu’ils vous auront battu, faites que le plus modeste
d’entre vous présente ce que vous vouliez, et, pour vous
humilier, vos adversaires l’approuveront.» Mais, gardez-moi
le secret.
—Mais...
—C’est pour cela que je proposerai le projet de nos
adversaires en l’exagérant jusqu’au ridicule.
Silence! voici le señor Ibarra avec le maître
d’école!
Les deux jeunes gens saluèrent tous les groupes, sans prendre
part à leurs conversations.
Quelques instants après le gobernadorcillo entra, l’air
mécontent. Aussitôt les murmures cessèrent, chacun
prit place et le silence régna peu à peu.
Le capitaine3 s’assit dans le fauteuil placé sous le
portrait de Sa Majesté, toussa quatre ou cinq fois, se passa la
main sur le crâne et sur la figure, toussa de nouveau et,
d’une voix défaillante, commença enfin:
—Señores, je me suis risqué à vous
convoquer tous [130]pour cette assemblée... hem! hem!...
parce que nous devons célébrer le 12 de ce mois la
fête de notre patron S. Diego... hem! hem! aujourd’hui,
nous sommes le 2... hem! hem!
Il en était à ce point de son discours
lorsqu’une toux sèche et régulière le
réduisit au silence.
Alors, du banc des vieux, se leva un homme d’aspect arrogant,
paraissant âgé d’environ quarante ans.
C’était le riche Capitan Basilio, un ennemi du
défunt D. Rafael; il prétendait que, depuis la mort de
saint Thomas d’Aquin, le monde n’avait pas fait un pas en
avant et que, depuis que saint Jean de Latran l’avait
quitté, l’Humanité avait commencé à
reculer.
—Que Vos Seigneuries me permettent, dit-il, de prendre la
parole dans une circonstance si intéressante. Je parle le
premier, bien que beaucoup de ceux qui sont ici aient plus de droits
que moi, mais si je parle le premier c’est qu’il ne me
semble pas que, dans ce cas, parler le premier signifie que l’on
soit le premier, de même que parler le dernier ne signifierait
pas non plus que l’on soit le dernier. De plus, les choses que
j’aurai à dire sont d’une telle importance
qu’elles ne doivent ni être laissées de
côté ni être dites en dernier, et c’est pour
cela que j’ai voulu parler le premier afin de leur donner la
place qui leur convenait. Vos Seigneuries me permettront donc de parler
le premier dans cette assemblée où je vois de très
notables personnes comme le señor Capitan actuel, son
prédécesseur, mon distingué ami D. Valentin, son
autre prédécesseur, mon ami d’enfance D. Julio,
notre célèbre capitaine des cuadrilleros, D. Melchior et
tant d’autres encore que, pour être bref, je ne veux pas
mentionner et que vous voyez ici présents. Je supplie Vos
Seigneuries de me permettre l’usage de la parole avant que
quelqu’un d’autre ne parle. Aurai-je le bonheur que
l’Assemblée accède à mon humble
prière?
Et l’orateur s’inclina respectueusement, souriant
à demi. [131]
—Vous pouvez parler, nous vous écoutons avec plaisir!
dirent les amis louangeurs et les autres personnes qui le tenaient pour
un grand orateur; les anciens toussaient avec satisfaction et se
frottaient les mains.
Capitan Basilio, après avoir épongé la sueur de
son front avec un mouchoir de soie, continua:
—Puisque Vos Seigneuries ont été assez aimables
et assez complaisantes envers mon humble personne pour me
concéder l’usage de la parole avant tout autre de ceux qui
sont ici présents, je profiterai de cette permission, si
généreusement accordée, et je vais parler. Je
m’imagine, avec mon imagination, que je me trouve au milieu du
très respectable Sénat romain, senatus populusque
romanus, comme nous disions en ces beaux temps qui, malheureusement
pour l’Humanité, ne reviendront plus, et je demanderai aux
patres conscripti, comme dirait le sage Cicéron
s’il était à ma place, je leur demanderai, puisque
le temps nous manque et que le temps est d’or, comme disait
Salomon, que, dans cette importante question, chacun expose son avis
clairement, brièvement et simplement. J’ai dit.
Et, satisfait de lui-même et de l’attention de la salle,
l’orateur s’assit, non sans adresser à Ibarra qui
était placé dans un coin un regard de
supériorité et à ses amis un autre fort expressif,
leur disant: «Ha! Ai-je bien parlé? Ha!»
Ses amis reflétèrent les deux regards en se tournant
vers les jeunes, comme pour les faire mourir d’envie.
—Maintenant la parole est à celui qui voudra que...
hem! reprit le gobernadorcillo sans pouvoir achever sa phrase, la toux
lui livrant une nouvelle attaque.
A en juger par le silence général, personne ne voulait
accepter d’être l’un des patres conscripti,
personne ne se leva; alors D. Filipo profita de l’occasion et
prit la parole.
Les conservateurs se regardèrent, échangeant des
œillades et se faisant des gestes significatifs. [132]
—Señores, je vais présenter mon projet pour la
fête, dit D. Filipo.
—Nous ne pouvons pas l’admettre! répondit un
vieux poitrinaire, conservateur intransigeant.
—Nous votons contre! dirent les autres adversaires.
—Señores, dit D. Filipo en réprimant un sourire,
je ne vous ai pas encore exposé le projet que nous, les
jeunes, nous apportons ici. Ce grand projet, nous en sommes
sûrs, sera préféré par tous, quoi
que pensent ou que puissent penser nos contradicteurs.
Ce présomptueux exorde acheva d’irriter les
conservateurs qui jurèrent in corde de lui faire une
terrible opposition. D. Filipo poursuivit:
—Nous avons un budget de 3,500 pesos. Eh bien! avec cette
somme nous pouvons faire une fête qui surpasse toutes celles que
nous avons vues jusqu’ici, soit dans notre province, soit dans
les provinces voisines.
—Quoi? s’écrièrent les incrédules;
tel pueblo avait 5000, tel autre 4000! C’est de la
plaisanterie!
—Ecoutez-moi, señores, et vous serez convaincus,
continua D. Filipo intrépide. Je propose que, au milieu de la
place, on élève un grand théâtre, qui
coûtera 150 pesos.
—150 ne suffiront pas, il faut en mettre 160! objecta un
tenace conservateur.
—Notez, señor directeur, 200 pesos pour le
théâtre! dit D. Filipo. Je propose que l’on traite
avec la troupe de comédie de Tondo pour qu’elle donne des
représentations pendant sept soirées consécutives.
Sept représentations à 200 pesos par soirée font
1400. Notez 1400, señor directeur.
Vieux et jeunes se regardèrent surpris; seuls, ceux qui
étaient dans le secret ne bougèrent pas.
—Je propose encore de grands feux d’artifices; pas de
ces toutes petites lumières, de ces toutes petites fusées
qui n’amusent que les enfants et les vieilles filles, rien de
tout cela! Nous voulons de grosses bombes et de colossales
fusées. Je propose donc 200 grosses [133]bombes à deux pesos
chacune et 200 fusées du même prix. Nous les commanderons
aux artificiers de Malabon.
—Hum! interrompit un vieux, une bombe de deux pesos ne
m’effraye guère et ne me rend pas sourd; elles doivent
être à trois pesos.
—Notez 1000 pesos pour 200 bombes et 200 fusées.
Les conservateurs ne purent se contenir; quelques-uns se
levèrent et conférèrent entre eux.
—De plus, pour que nos voisins voient que nous sommes des gens
qui n’épargnent rien et que l’argent ne nous manque
pas, continua D. Filipo en élevant la voix et en lançant
un rapide regard vers le groupe des vieux, je propose: 1o
quatre frères principaux pour les deux jours de fête et
2o, que chaque jour on jette au lac 200 poules rôties,
100 chapons farcis et 50 cochons de lait, comme faisait Sylla,
contemporain de ce Cicéron dont vient de parler Capitan
Basilio.
—C’est cela, comme Sylla! répéta Basilio
flatté.
L’étonnement s’accroissait par degrés.
—Comme beaucoup de gens riches vont accourir et que chacun
apporte les pesos par milliers, ses meilleurs coqs, le liampo4 et les cartes,
je propose quinze jours de gallera, la liberté d’ouvrir
toutes les maisons de jeu...
Mais les jeunes se levèrent, l’interrompirent; ils
croyaient que le lieutenant principal était subitement devenu
fou. Les vieux discutaient avec chaleur.
—Et enfin, pour ne pas négliger les plaisirs de
l’âme...
Les murmures et les cris partis de tous les coins de la salle
couvrirent totalement sa voix: ce ne fut bientôt plus qu’un
tumulte.
—Non! criait un intransigeant conservateur; je ne veux pas
qu’il se flatte d’avoir fait la fête, non!
Laissez-moi, laissez-moi parler!
—D. Filipo nous a trompés! disaient les
libéraux. Nous voterons contre. Il est passé aux vieux.
Nous votons contre. [134]
Le gobernadorcillo, plus abattu que jamais, ne faisait rien pour
apaiser le tumulte; il attendait que l’ordre se
rétablît de lui-même.
Le capitaine des cuadrilleros demanda la parole; on la lui octroya,
mais il n’ouvrit pas la bouche et retourna s’asseoir confus
et honteux.
Par bonheur, Capitan Valentin, le plus modéré des
conservateurs, se leva et dit:
—Nous ne pouvons admettre ce qu’a proposé le
lieutenant principal, cela nous semble une exagération. Tant de
bombes et tant de théâtres ne peuvent être
proposés que par un jeune homme comme le lieutenant, qui peut
passer beaucoup de soirées au théâtre et entendre
de nombreuses détonations sans devenir sourd. J’ai pris
l’opinion des personnes sensées et toutes
désapprouvent unanimement le projet de D. Filipo. N’est-il
pas vrai, señores?
—Oui! oui! dirent à la fois jeunes et vieux. Les jeunes
étaient enchantés d’entendre un vieux parler
ainsi.
—Qu’avons-nous à faire de quatre frères
principaux? poursuivit D. Valentin. Qu’est-ce que ces poules, ces
chapons et ces cochons de lait jetés dans le lac? Plaisanterie!
diraient nos voisins, et ensuite nous jeûnerons la moitié
de l’année. Qu’avons-nous à voir avec Sylla
et avec les Romains? Nous ont-ils par hasard invités à
leurs fêtes? Pour ma part, tout au moins, je n’ai jamais
reçu aucun billet de leur part et réfléchissez que
je suis déjà vieux!
—Les Romains vivent à Rome, où est le Pape! lui
murmura tout bas Capitan Basilio.
—Je comprends maintenant, continua l’orateur sans se
troubler. Ils célébraient leur fête lors
d’une vigile et le Pape leur commanda de jeter les victuailles
à la mer pour ne pas commettre un péché. Mais, de
toutes façons, votre projet de fête est inadmissible,
impossible, c’est une folie.
D. Filipo, vivement combattu, dut retirer sa proposition. [135]
Les conservateurs les plus intransigeants, satisfaits de la
défaite de leur plus grand adversaire, virent sans
inquiétude se lever un jeune cabeza de barangay qui demanda la
parole:
—Je prie Vos Seigneuries de m’excuser si, à mon
âge, je me permets de parler devant tant de personnes très
respectables, tant par leur expérience que par la prudence et
par le discernement avec lesquelles elles jugent toutes choses, mais
puisque l’éloquent orateur, Capitan Basilio, nous a
invités tous à manifester notre opinion, sa parole
autorisée servira d’excuse à l’insuffisance
de ma personne.
Les conservateurs satisfaits inclinèrent la tête.
—Ce jeune homme parle bien!—Il est modeste!—Il
raisonne admirablement, se disaient-ils.
—Si je vous présente, señores, un programme ou
un projet, ce n’est pas avec la pensée que vous le
trouverez parfait ni que vous l’accepterez; je veux, en
même temps que je me soumets une fois de plus à la
volonté de tous, prouver aux anciens que nous pensons toujours
comme eux puisque nous faisons nôtres les idées que
Capitan Basilio a si élégamment exprimées.
—Très bien! très bien! s’écriaient
les conservateurs si délicatement encensés. Capitan
Basilio faisait des signes au jeune homme pour lui indiquer comment il
devait remuer le bras et placer le pied. Seul, le gobernadorcillo
restait impassible; il semblait à la fois distrait et
préoccupé. Le jeune homme poursuivit en
s’animant:
—Mon projet, señores, se réduit à ceci:
inventer de nouveaux spectacles qui ne soient pas les banalités
que nous voyons chaque jour et faire en sorte que l’argent
recueilli ne sorte pas du pueblo, ne se dépense pas vainement en
poussière, en un mot l’employer à quelque chose
d’utile pour tous.
—C’est cela! c’est cela! interrompirent les
jeunes, c’est ce que nous voulons.
—Très bien! ajoutèrent les vieillards. [136]
—Quel profit tirerons-nous d’une semaine de
comédie, comme le demande le lieutenant? Que nous apprendront
ces rois de Bohême ou de Grenade qui commandent de couper la
tête à leurs filles ou les font mettre en guise de boulet
dans un canon lequel, à leur grande surprise, se convertit en
trône? Nous ne sommes ni des rois, ni des barbares, nous
n’avons pas de canons et, si nous imitions tous ces
gens-là, on nous ferait pendre à Bagumbayan.
Qu’est-ce que ces princesses qui prennent part aux combats et
frappent de taille et d’estoc, font la guerre comme des princes
et chevauchent seules par monts et vallées, comme
séduites par le Tikbâlang5? Nous avons pour habitude
d’aimer dans une femme la douceur et la tendresse et nous ne
pourrions unir sans crainte notre main à la main tachée
de sang de quelque damoiselle, ce sang fût-il celui d’un
More ou d’un Géant; de même nous méprisons et
tenons pour vil l’homme qui lève la main sur une femme,
que ce soit un prince, un alférez ou même un rude paysan.
Ne vaudrait-il pas mieux mille fois que nous fissions la peinture de
nos propres mœurs, pour corriger nos vices et nos défauts
et faire l’éloge des qualités que nous nous
reconnaissons?
—C’est cela! répétèrent ses
partisans.
—Il a raison, murmurèrent pensifs quelques vieux.
—Je n’avais jamais pensé à cela! murmura
Capitan Basilio.
—Mais, comment allez-vous faire? objecta
l’obstiné conservateur.
—C’est très facile, répondit
l’orateur. J’apporte ici deux comédies que,
très certainement, le bon goût et le discernement bien
connus des hommes respectables qui sont ici réunis trouveront
acceptables et divertissantes. La première a pour titre:
L’Election du Gobernadorcillo; [137]c’est une comédie
en prose, en cinq actes, écrite par l’une des personnes
présentes. L’autre est en deux actes et la
représentation en durera deux soirées; c’est un
drame fantastique, de caractère satirique, écrit par un
des meilleurs poètes de la province; il est intitulé
Mariang Makiling6. Voyant que la discussion des préparatifs de
la fête était retardée et craignant que le temps ne
manquât, nous avons cherché en secret nos acteurs et nous
leur avons fait apprendre leurs rôles. Nous espérons
qu’avec une semaine de répétitions ils pourront
jouer avec succès. Et remarquez, señores, que non
seulement cette façon de faire est neuve, utile et raisonnable,
mais qu’elle a le grand avantage d’être
économique. Point de costumes à acheter, les
nôtres, ceux que nous portons tous les jours, sont les seuls qui
doivent servir.
—Je paie le théâtre! s’écria
enthousiasmé Capitan Basilio.
—S’il est besoin de cuadrilleros je prête les
miens, dit le capitaine de cette brave milice.
—Et moi... et moi... s’il faut un vieux... balbutiait un
vieillard avec ostentation.
—Accepté! accepté! crièrent nombre de
voix.
Le lieutenant principal était pâle
d’émotion, ses yeux se remplirent de larmes.
—Il pleure de dépit, pensa l’intransigeant et il
cria: Accepté, accepté sans discussion!
Et satisfait de sa vengeance et de la complète défaite
de son adversaire, il commença à faire
l’éloge du projet du jeune homme. Celui-ci poursuivit:
—Une partie de l’argent recueilli, le cinquième
par exemple, peut être employée à distribuer
quelques prix, au plus studieux élève de
l’école, au meilleur berger, au plus habile laboureur, au
plus adroit pêcheur, etc. Nous pourrons organiser des
régates sur la rivière et [138]sur le lac, des courses de
chevaux, élever des mâts de cocagne et organiser
d’autres jeux auxquels nos paysans prendront part. Quant aux feux
d’artifice, comme l’habitude prise est telle qu’on
s’imaginerait difficilement une fête où ils seraient
supprimés, je leur laisse une place: des roues et des
châteaux de feu offrent d’ailleurs de très beaux et
très intéressants spectacles, mais je crois inutiles les
bombes que proposait le lieutenant. Deux orchestres sont suffisants
pour donner de la gaieté à la fête et nous
éviterons ainsi ces inimitiés et ces querelles qui
faisaient de ces malheureux, dont le travail est de nous
réjouir, de véritables coqs de combat s’en allant
ensuite mal payés, mal nourris, battus et parfois
blessés. Avec le surplus des fonds on pourrait commencer la
construction d’un petit édifice pour servir
d’école, car nous ne pouvons guère attendre que
Dieu lui-même descende du ciel et nous la bâtisse; il est
triste de penser qu’alors que nous avons une gallera de premier
ordre l’endroit où nos enfants s’instruisent
n’est pas même l’écurie du curé. Voici
le projet tracé dans ses grandes lignes, le perfectionner sera
l’œuvre de tous.
Un léger murmure s’éleva dans la salle; presque
tous étaient de l’avis du jeune homme, quelques-uns
seulement murmuraient:
—Nouveautés que tout cela! ce sont des choses
nouvelles! Dans notre jeunesse...!
—Acceptons-les pour aujourd’hui, disaient les autres, le
principal est d’humilier celui-ci!
Et ils montraient le lieutenant.
Quand le silence se rétablit, tous étaient
d’accord. Il ne manquait plus que la décision du
gobernadorcillo.
Celui-ci suait, s’agitait, se retournait, se passait la main
sur le front et put enfin bégayer en baissant les yeux:
—Moi aussi, j’approuve... mais, hem!
Toute l’assemblée écoutait en silence.
—Mais? demanda Capitan Basilio. [139]
—J’approuve complètement, répéta le
fonctionnaire; c’est-à-dire... je n’approuve pas...
je dis oui,... mais...
Il se frotta les yeux avec le revers de la main.
—Mais, continua le malheureux se décidant enfin, mais
le curé, le Père curé veut autre chose.
—Est-ce le curé ou bien nous qui payons la fête?
A-t-il donné au moins un cuarto? s’écria une voix
pénétrante.
Tous regardèrent du côté d’où
était partie cette demande: là siégeait le
philosophe Tasio.
Le lieutenant restait immobile, les yeux fixés sur le
gobernadorcillo.
—Et que veut le curé? demanda D. Basilio.
—Mais le curé veut... six processions, trois sermons,
trois messes solennelles... et, s’il reste de l’argent, une
comédie avec du chant dans les entr’actes.
—Mais nous ne voulons pas de cela, dirent les jeunes et
quelques vieux.
—Le Père curé le veut! répéta le
gobernadorcillo, j’ai promis au curé que ce qu’il
voulait serait fait.
—Alors, pourquoi nous avez-vous convoqués?
—Précisément, pour vous en faire part.
—Et pourquoi ne l’avez-vous pas dit dès le
commencement?
—Je voulais le dire, señores, mais Capitan Basilio a
parlé et je n’ai pas eu le temps... Il faut obéir
au curé!
—Il faut lui obéir! répétèrent
quelques vieux.
—Il faut lui obéir, ou l’Alcalde nous enverrait
tous en prison! ajoutèrent tristement d’autres
conservateurs.
—Eh bien! obéissez et faites la fête à
vous seuls! s’écrièrent les jeunes en se levant.
Nous retirons notre contribution.
—Tout a déjà été recouvré!
dit le gobernadorcillo.
D. Filipo s’approcha de lui et lui dit amèrement:
—J’ai sacrifié mon amour-propre en faveur
d’une bonne cause; vous sacrifiez votre dignité
d’homme pour une mauvaise et vous brisez tout ce qui pouvait
être fait de bien. [140]
Ibarra disait au maître d’école:
—Avez-vous une commission pour le chef-lieu de la province, je
pars immédiatement?
—Pour vos affaires?
—Pour nos affaires! répondit Ibarra d’un ton
mystérieux.
Sur la route, en s’en retournant, le vieux philosophe disait
à D. Filipo qui maudissait son sort:
—C’est notre faute! Vous n’avez pas
protesté quand ils vous ont donné pour chef un esclave et
moi, fou que je suis, je l’avais oublié!
[Table des matières]
XXI
Histoire d’une mère
. . . . . . . . . . . . . . .
Il marchait incertain—il courait errant,
Sans se reposer—un seul instant.
Alaejos.
Sisa courait maintenant vers son pauvre logis; dans son cerveau
s’était opéré ce bouleversement qui se
produit dans notre être quand, au moment d’un grand
malheur, nous ne voyons aucun recours possible et que s’enfuient
toutes nos espérances. Il semble alors que tout
s’obscurcisse en nous; si parfois quelque petite lueur brille au
loin nous courons vers elle, sans nous inquiéter de savoir si le
sentier n’est pas coupé par un précipice.
Cette mère voulait sauver ses fils; comment? les mères
ne s’occupent guère des moyens quand il s’agit de
leurs enfants.
Elle courait rapide, poursuivie par toutes sortes de craintes et de
sinistres pressentiments. Auraient-ils déjà pris son
Basilio? Où s’était enfui son Crispin?
Arrivée près de chez elle, elle distingua les casques
de deux soldats dépassant la clôture de son jardin. On
[141]ne
saurait décrire ce qui se passa en son cœur; elle oublia
tout, et la brutalité de ces hommes qui n’usaient de
ménagements qu’avec les riches, et ce qui pouvait advenir
d’elle et de ses fils accusés de vol. Les gardes civils ne
sont pas des hommes, ils n’écoutent pas les
prières, ils sont accoutumés à voir couler les
larmes, ce ne sont que des gardes civils.
Instinctivement Sisa leva les yeux au ciel: le ciel souriait
d’une ineffable lumière, quelques petits nuages blancs,
nageaient dans le transparent azur. Elle s’arrêta pour
réprimer le frisson qui s’emparait de tout son corps.
Les soldats avaient abandonné sa maison; ils revenaient seuls
n’ayant rien pris que la poule qu’elle engraissait. Elle
respira et recouvra ses sens.
—Comme ils sont bons, quel bon cœur ils ont!
murmura-t-elle, presque pleurant de joie.
Les soldats auraient brûlé la maison mais laissé
ses fils en liberté qu’elle les aurait encore
comblés de bénédictions.
Elle regarda de nouveau, cette fois avec des yeux reconnaissants, le
ciel que sillonnait une bande de garzas, ces nuages gris et
légers particuliers au ciel des Philippines, et, la confiance
renaissant en son cœur, elle reprit son chemin.
En approchant de ces hommes terribles, la malheureuse
s’efforça de regarder de tous côtés comme
distraite; elle feignit de ne pas voir sa poule qui piaillait en criant
au secours. A peine les avait-elle croisés qu’elle voulut
courir, mais la prudence modéra ses pas.
Elle n’était pas encore éloignée
qu’elle s’entendit appeler impérieusement. Tout
émue, elle fit la sourde et continua sa route. Ils
l’appelèrent de nouveau, mais cette fois avec un cri et
une parole insultante. Elle se retourna, malgré elle pâle
et tremblante. Un garde civil lui faisait des signes avec la main.
Machinalement, elle revint sur ses pas; elle sentait que sa langue
se paralysait, que sa gorge se séchait.
[142]
—Dis-nous la vérité ou sinon nous
t’attachons à cet arbre et te fusillons, dit l’un
d’eux d’une voix menaçante.
La malheureuse ne put que regarder l’arbre.
—Tu es la mère des voleurs!
—La mère des voleurs! répéta Sisa sans
comprendre.
—Où est l’argent que tes fils t’ont
apporté cette nuit?
—Ah! l’argent...
—Ne nie pas, ce sera pire pour toi! ajouta le premier. Nous
sommes venus pour arrêter tes fils; le plus grand s’est
sauvé; où as-tu caché le petit?
Sisa respira.
—Señor, répondit-elle, il y a longtemps que je
n’ai pas vu mon Crispin; j’espérais le trouver ce
matin au couvent et c’est là seulement que j’ai
appris que...
Les deux soldats échangèrent un regard
significatif.
—C’est bon! s’écria l’un d’eux;
donne-nous l’argent et nous te laisserons tranquille.
—Señor, supplia la malheureuse; mes fils ne volent pas,
même quand ils ont faim; nous sommes habitués à
souffrir. Basilio ne m’a pas apporté un cuarto; fouillez
toute la maison et, si vous y trouvez un réal, faites de nous ce
que vous voudrez. Les pauvres que nous sommes ne sont pas tous des
voleurs.
—Alors, reprit lentement le soldat en fixant ses yeux dans les
yeux de Sisa, viens avec nous; tes fils se décideront
peut-être à se montrer et à rendre l’argent
qu’ils ont pris. Suis-nous!
—Moi?... vous suivre? murmura-t-elle en reculant d’un
pas et terrifiée, elle regardait les uniformes des soldats.
—Pourquoi pas?
—Ah! ayez pitié de moi! supplia-t-elle presque à
genoux. Je suis bien pauvre, je n’ai rien à vous donner,
ni or, ni bijoux; la seule chose que j’avais vous me l’avez
déjà prise, c’est la poule que je pensais vendre...
emportez tout ce que vous trouverez dans ma misérable [143]cabane,
mais laissez-moi, laissez-moi mourir ici en paix!
—En avant! tu dois venir, si tu ne nous suis pas de bon
gré nous t’attacherons.
Sisa poussa une amère plainte. Ces hommes étaient
inflexibles.
—Laissez-moi au moins marcher devant à quelque
distance! supplia-t-elle, quand elle sentit qu’ils se
saisissaient d’elle et la poussaient brutalement.
Les deux soldats s’émurent et causèrent entre
eux à voix basse.
—Bien, dit l’un d’eux; comme d’ici à
ce que nous soyons au pueblo tu peux t’échapper, tu seras
entre nous deux. Une fois là tu pourras marcher devant à
une vingtaine de pas, mais fais attention! n’entre dans aucune
boutique, ne t’arrête pas. En avant et vivement!
Les prières furent vaines, vaines les raisons, inutiles les
promesses. Les soldats répondaient qu’ils se
compromettaient déjà suffisamment et lui accordaient trop
de faveurs.
A se voir ainsi, entre ses deux gardiens, elle se sentit mourir de
honte. Personne il est vrai ne venait sur la route, mais et
l’air? et la lumière du jour? N’est-ce pas le fait
de la véritable pudeur de voir des regards de tous
côtés? Elle se couvrit la figure de son mouchoir et
marchant ainsi, comme une aveugle, elle pleura en silence sur son
humiliation. Certes sa misère était grande, elle savait
que tous, même son mari, l’avaient abandonnée, mais
jusque-là elle s’était toujours
considérée comme honorable et estimée:
c’était avec compassion qu’elle regardait ces femmes
aux toilettes scandaleuses que tous flétrissaient du nom de
«femmes à soldats». Et voici qu’il lui
semblait descendre sur l’échelle sociale à un
degré inférieur encore à celui de ces
malheureuses.
Des pas de chevaux résonnèrent: c’était
une de ces petites caravanes d’hommes et de femmes qui,
juchés [144]sur de mauvais bidets, entre deux paniers
pendus de chaque côté de l’animal, portent le
poisson dans les pueblos de l’intérieur. Parmi ces
voyageurs quelques-uns la connaissaient, soit pour lui avoir
donné un peu de poisson, soit pour lui avoir demandé de
l’eau lorsqu’ils passaient devant sa cabane.
Lorsqu’elle fut près d’eux, il lui sembla
qu’ils l’insultaient, qu’ils
l’écrasaient, que leurs regards pitoyables ou
dédaigneux traversaient son mouchoir et
s’enfonçaient dans sa figure comme des dards.
La caravane s’éloigna, Sisa se sentit soulagée.
Elle écarta un instant son mouchoir pour voir à quelle
distance se trouvait le pueblo. Il restait encore à franchir
quelques postes de télégraphe avant d’arriver au
bantayan1.
Jamais le chemin ne lui avait paru si long.
Au bord de la route croissait une cannaie très feuillue.
Souvent à son ombre elle s’était reposée
autrefois. Jeune fille, elle s’y arrêtait pour
écouter les doux propos de son fiancé; il l’aidait
à porter le panier plein de légumes et de fruits, elle le
récompensait d’un sourire. Ah! comme tout ce passé
était loin maintenant! le fiancé était devenu le
mari, le mari... Le malheur avait frappé à sa porte et
s’était pour toujours assis à son foyer.
Comme le soleil dardait ses plus chauds rayons, les soldats lui
offrirent de se reposer. Terrifiée à l’idée
de voir se prolonger encore son martyre, elle les remercia.
Ils étaient près du pueblo, la peur la saisit.
Angoissée, elle regarda de tous côtés cherchant
dans la nature un secours quelconque: de vastes rizières, un
petit canal de navigation, des arbres rachitiques, c’était
tout; pas un rocher, pas un précipice où pouvoir se
briser. Pourquoi avait-elle suivi les soldats si longtemps? elle se le
reprochait; près de sa pauvre maison, la rivière
profonde, aux rives escarpées, semée de [145]roches
aiguës, lui aurait offert une mort si douce! Mais non! elle pensa
à ses enfants, à son Crispin dont elle ignorait le sort,
et dans cette nuit ce fut une lumière qui éclaira son
âme. Résignée, elle murmura:
—Après!... après, nous irons habiter au plus
profond des bois.
Elle sécha ses yeux, prit un air plus assuré et
s’adressant à voix basse aux gardes:
—Nous voici maintenant au pueblo!
Son accent était indéfinissable; c’était
à la fois une prière, un raisonnement, une plainte, une
supplication, toute la douleur condensée dans une parole.
Les soldats eurent pitié: ils répondirent d’un
geste. Rapidement elle les devança et s’efforça de
marcher d’un pas tranquille.
Un tintement de cloches annonçait la fin de la
grand’messe. Elle pressa le pas pour éviter la foule qui
sortait de l’église: ce fut en vain.
Deux femmes qu’elle connaissait passèrent,
l’interrogeant du regard; elle les salua avec un amer sourire;
mais pour éviter de nouvelles mortifications elle baissa la
tête et fixa ses yeux sur le sol, ce qui ne
l’empêchait pas de trébucher contre les pierres du
chemin.
A sa vue, on se retournait, on chuchotait, on la suivait des yeux;
malgré qu’elle ne regardât rien, elle devinait, elle
sentait, elle voyait tout.
Une femme qu’à sa tête nue, à sa robe
jaune et verte, à sa chemise de gaze bleue, à son costume
et à ses manières on reconnaissait comme faisant le
bonheur de la soldatesque cria aux gardes d’une voix
effrontée:
—Où l’avez-vous prise? et l’argent,
l’avez-vous?
Sisa crut avoir reçu un soufflet: cette femme l’avait
publiquement mise à nu. Elle leva la tête pour
connaître d’un seul coup tout le sarcasme et toute la
honte; les gens qui la montraient au doigt étaient loin
d’elle, très loin même, mais cependant elle sentait
le froid de leurs regards, elle entendait la méchanceté
de leurs propos. Le sol se dérobait sous ses pieds. [146]
—Par ici! lui cria un garde.
Comme un automate dont se brise le mécanisme, elle tourna
rapidement sur ses talons et, sans rien voir, sans penser à
rien, courut pour se cacher; une porte gardée par une sentinelle
était devant elle; elle voulut y entrer; mais, plus
impérieuse encore, une autre voix la détourna. Comme elle
cherchait d’où venait cette voix, elle sentit qu’on
la poussait par les épaules. Ses yeux se fermèrent, elle
fit deux pas, puis les forces lui manquèrent et la malheureuse
se laissa tomber sur le sol, d’abord à genoux, assise
ensuite. Un sanglot sans larmes, sans cris, sans exclamations,
l’agitait convulsivement.
C’était le quartier. Il y avait là des soldats,
des femmes, des porcs, des poules. Quelques gardes raccommodaient leurs
habits; une des femmes couchée sur le banc, la tête
appuyée sur la cuisse d’un soldat, fumait et regardait
vers le toit d’un air ennuyé; d’autres aidaient les
gardes à laver leurs hardes, à nettoyer leurs armes,
etc., fredonnant des chansons lubriques.
—Tiens, les poulets se sont sauvés, vous ne ramenez que
la poule! dit l’une, sans que l’on pût savoir si elle
faisait allusion à Sisa ou au malheureux volatile qui continuait
à piailler.
—Oui, la poule vaut toujours mieux que les poussins!
ajouta-t-elle, quand elle vit que les soldats se taisaient.
—Où est le sergent? demanda l’un des gardes
d’un ton fâché. A-t-on prévenu
l’alférez?
Un haussement d’épaules fut la seule réponse
qu’il obtint: personne ne voulait se déranger pour la
pauvre femme.
Elle resta ainsi deux longues heures, à demi folle, accroupie
dans un coin, la tête cachée dans les mains,
échevelée. A midi l’alférez arriva; il
commença par ne rien croire des accusations du curé.
—Bah! mesquines moineries! dit-il, et il ordonna que
l’on rendît la liberté à la femme et que
personne ne s’occupât plus de cette affaire. [147]
—S’il veut retrouver ce qu’il a perdu,
ajouta-t-il, qu’il le demande à son saint Antoine ou
qu’il se plaigne au nonce! Voilà!
Sisa, qui pouvait à peine se mouvoir, fut donc conduite
presque de force hors du quartier.
Lorsqu’elle se vit au milieu de la rue, elle partit rapide, se
dirigeant vers sa maison, la tête découverte, la chevelure
défaite, le regard fixe. Le soleil, alors au zénith,
brûlait de tous ses feux; pas un nuage ne voilait son disque
resplendissant; le vent agitait faiblement les feuilles des arbres, la
route était déjà presque sèche;
malgré la tempête de la veille, pas un oiseau ne se
risquait à abandonner l’ombre des branches.
Enfin Sisa était arrivée. Emue, silencieuse, elle
entra dans son triste logis, le parcourut, sortit, alla, vint de tous
côtés. Elle courut ensuite chez le vieux Tasio, frappa
à la porte; le vieux n’y était pas. La malheureuse
retourna chez elle et commença à crier, à appeler:
Basilio! Crispin! s’arrêtant à chaque instant,
prêtant l’oreille avec attention. L’écho qui
répétait ses appels, le doux murmure de l’eau dans
la rivière voisine, la musique des roseaux agités par la
brise étaient les uniques voix de la solitude. De nouveau elle
appela, monta sur une hauteur, descendit dans un ravin; ses yeux
errants prenaient une expression sinistre, d’instant en instant
ils s’illuminaient de vifs reflets, puis s’obscurcissaient
comme le ciel dans une nuit de tourmente; on aurait dit que la
lumière de la raison, prête à
s’éteindre, se ranimait et se mourait tour à
tour.
Revenue chez elle, elle s’assit sur la natte où ils
s’étaient couchés la nuit précédente
et leva les yeux: au bout de l’un des roseaux de la cloison qui
pendait près du précipice elle aperçut un morceau
de la chemise de Basilio. Se levant, elle le prit et l’examina
à la lumière du soleil: le morceau d’étoffe
avait des taches de sang. Par hasard Sisa ne les vit pas: elle se
baissa et continua à examiner ce débris du vêtement
de son fils, [148]l’élevant dans l’air,
baigné des rayons embrasés: puis, comme si elle avait
senti tout s’obscurcir et la clarté lui manquer, elle
regarda le soleil en face, les yeux démesurément
ouverts.
Enfin elle erra de côté et d’autre, criant,
hurlant d’étranges sons; qui l’eut entendue aurait
eu peur, sa voix avait un timbre que ne saurait donner le larynx
humain. Lorsque pendant la nuit rugit la tempête et que,
vertigineusement rapide, le vent bat de ses ailes invisibles une
armée d’ombres qui le poursuivent, si vous vous trouvez
dans un édifice ruiné et solitaire, vous entendez
certaines plaintes, certains soupirs que vous savez être le
murmure du vent battant les hautes tours et les murs
délabrés; vous n’en êtes pas moins saisi de
terreur et vous frémissez! eh bien, l’accent de cette
mère était plus lugubre et plus terrible encore que ces
sanglots inconnus retentissant dans les nuits obscures où rugit
la tempête.
Le soleil se coucha, l’ombre la surprit. Peut-être le
ciel lui accorda-t-il quelques heures de sommeil pendant lesquelles
l’aile invisible d’un ange, caressant son visage
pâli, emporta sa mémoire qui ne lui rappelait plus que des
douleurs; peut-être que, tant de souffrances dépassant la
résistance possible de l’humanité débile, la
Mère Providence intervint, apportant sa plus douce consolation,
l’oubli. Le jour suivant, Sisa vaguait souriante, chantant et
conversant avec tous les êtres de la grande Nature.
[Table des matières]
XXII
Lumières et ombres
Trois jours se sont écoulés, trois jours et trois
nuits que les habitants de San Diego ont employés à
commenter [149]les faits qui s’étaient
passés et à faire les préparatifs de la fête
du pueblo.
Tout en savourant par avance les réjouissances futures, les
uns médisaient du gobernadorcillo, les autres du lieutenant
principal, ceux-ci des jeunes, ceux-là des vieux, il
n’était personne qui ne dît son mot et beaucoup
rejetaient la faute sur tous.
On commentait aussi l’arrivée de Maria Clara
accompagnée de la tante Isabel. On s’en réjouissait
parce qu’on l’aimait, mais en même temps que
l’on admirait sa beauté on s’étonnait aussi
des changements qui survenaient dans le caractère du P.
Salvi.—«Il a des distractions nombreuses pendant le saint
sacrifice; il ne nous parle presque plus; à vue
d’œil il devient plus maigre et plus sombre», telles
étaient les réflexions de ses pénitentes. Le
cuisinier le voyait s’émacier de jour en jour et se
plaignait du peu d’honneur qu’il faisait à ses
plats. Mais ce qui soulevait le plus de murmures c’étaient
les deux lumières que l’on voyait briller au couvent
lorsque le P. Salvi était en visite... en visite chez Maria
Clara! Les dévotes faisaient des signes de croix mais
continuaient à jaser.
Personne ne s’occupait plus de la malheureuse Sisa ni de ses
fils.
Crisóstomo Ibarra avait télégraphié du
chef-lieu de la province pour saluer la tante Isabel et sa
nièce, mais sans leur expliquer la cause de son absence.
Beaucoup croyaient qu’on l’avait arrêté
à cause de sa conduite envers le P. Salvi dans
l’après-midi de la Toussaint. Mais les commentaires
changèrent de ton lorsque, le soir du troisième jour, on
le vit descendre d’une voiture devant la petite maison de sa
fiancée et saluer courtoisement le prêtre qui s’y
rendait lui aussi.
C’était un délicieux petit nid parmi les
orangers et les ilang-ilang. Nous y retrouvons les deux jeunes gens
accoudés à une fenêtre d’où l’on
voyait le lac. Des fleurs et des plantes grimpantes, s’enroulant
autour des roseaux et des fils métalliques disposés pour
les recevoir, [150]répandaient à l’entour leur
ombre fraîche et leur parfum léger.
Ils causaient: leurs lèvres murmuraient des mots plus doux
que le bruissement des feuilles et plus parfumés que l’air
tout imprégné des aromes du jardin. C’était
l’heure où les sirènes du lac, profitant des ombres
du crépuscule rapide, sortaient des flots leurs têtes
rieuses pour admirer et saluer de leurs chants le soleil moribond.
Ibarra disait à son amie:
—Demain, avant que l’aube paraisse, ton désir
sera satisfait. Je disposerai tout dès cette nuit pour que rien
ne manque.
—Alors j’écrirai à mes amies pour les
inviter. Fais en sorte que le curé ne vienne pas!
—Pourquoi?
—Parce qu’il semble qu’il me surveille. Ses yeux
creux et sombres me font mal; quand il les fixe sur moi, j’ai
peur. Quand il me cause il a une voix... il me parle de choses si
extraordinaires, si incompréhensibles, si étranges... un
jour il m’a demandé si je n’avais pas
rêvé à des lettres de ma mère; je crois
qu’il est à moitié fou. Mon amie Sinang et Andeng,
ma sœur de lait, disent qu’il est un peu... atteint, parce
qu’il ne mange pas, ne se baigne pas et vit constamment dans
l’ombre. Arrange-toi pour qu’il ne vienne pas.
—Nous sommes forcés de l’inviter, répondit
Ibarra pensif. Les habitudes du pays nous y obligent; il vient chez toi
et, de plus, sa conduite avec moi a été pleine de
noblesse. Quand l’Alcalde l’a consulté sur
l’affaire dont je t’ai parlé, il n’a eu que
des louanges pour moi et n’a pas fait la moindre
réclamation: mais je vois que tu es contrariée; je
prendrai soin qu’il ne puisse nous accompagner.
On entendit des pas légers: c’était le
curé qui s’approchait, un sourire forcé sur les
lèvres.
—Le vent est frais, dit-il, quand on a pris un rhume on le
garde jusqu’à ce que revienne la chaleur. Ne craignez-vous
pas de vous refroidir? [151]
Sa voix était tremblante et son regard fixé au loin se
détournait des jeunes gens.
—Au contraire, la soirée nous paraît
agréable et le vent délicieux! répondit Ibarra. En
cette saison nous avons notre automne et notre printemps; quelques
feuilles tombent, mais les bourgeons poussent.
Fr. Salvi soupira.
—Je trouve très belle la réunion de ces deux
saisons sans qu’intervienne l’hiver glacé, continua
Ibarra. En février les branches des arbres fruitiers
bourgeonnent, en mars déjà nous aurons les fruits
mûrs. Viennent les mois de chaleur, nous irons
ailleurs.
Fr. Salvi sourit. La conversation s’engagea sur des sujets
indifférents: le temps, le pueblo, la fête; Maria Clara
chercha un prétexte et se retira.
—Puisque nous parlons de la fête, dit Ibarra,
permettez-moi de vous inviter à celle que nous donnerons demain
matin. C’est une fête champêtre que nous organisons
entre amis.
—Et, où se fera-t-elle?
—Près du ruisseau qui serpente dans le bois voisin,
à côté du balitî: aussi nous
lèverons-nous de bonne heure pour que le soleil nous rejoigne en
route.
Le moine réfléchit, puis répondit:
—L’invitation est très tentante et je
l’accepte pour vous prouver que je ne vous garde pas rancune.
Mais je ne pourrai m’y rendre qu’après avoir rempli
mes devoirs. Vous êtes heureux d’être libre!
Quelques minutes après, Ibarra partit pour s’occuper de
la fête du lendemain. La nuit était déjà
très obscure.
Dans la rue, un homme s’approcha qui le salua
respectueusement.
—Qui êtes-vous? lui demanda le jeune homme.
—Vous ne connaissez pas mon nom, señor. Je vous attends
depuis deux jours.
—Que me voulez-vous?
—Personne ne prend pitié de moi parce que l’on
dit que je suis un bandit, señor. Mais j’ai perdu mes
[152]fils,
ma femme est folle et tout le monde prétend que je mérite
mon sort.
Ibarra examina rapidement l’homme et lui demanda:
—Que voulez-vous en ce moment?
—Implorer votre pitié pour ma femme et pour mes
enfants.
—Je ne puis m’arrêter. Si vous voulez me suivre,
vous me direz en route ce qui vous est arrivé.
L’homme le remercia, et tous deux disparurent bientôt
dans les ténèbres des rues où
l’éclairage faisait presque entièrement
défaut.
[Table des matières]
XXIII
La pêche
Les étoiles brillaient encore à la voûte de
saphir et, dans les branches, les oiseaux n’avaient pas
terminé leur sommeil que déjà une troupe joyeuse
parcourait les rues du pueblo se dirigeant vers le lac, à la
faible lueur de ces torches de goudron, que l’on appelle
communément huepes.
C’étaient cinq jeunes filles, marchant d’un pas
rapide, se tenant par les mains ou par la ceinture, suivies de quelques
vieilles dames et de servantes portant gracieusement sur leur
tête des paniers remplis de provisions, de plats, etc. A voir
leurs figures où rit la jeunesse, où brille
l’espérance, à contempler leurs abondantes et
noires chevelures flottant au vent et les larges plis de leurs
vêtements, nous les prendrions pour des divinités de la
nuit s’enfuyant à l’approche du jour, si nous ne
savions pas que ce sont Maria Clara et ses quatre amies: la joyeuse
Sinang, sa cousine, la sévère Victoria, la belle Iday, et
la pensive Neneng qui représente la beauté modeste et
tremblante. [153]
Elles bavardaient avec animation, riaient, se pinçaient, se
parlaient à l’oreille et ensuite lançaient en
fusées les éclats de rire.
Mais, à leur rencontre, s’avançait un groupe de
jeunes gens portant de grandes torches de roseaux; ils marchaient
presque sans bruit au son d’une guitare que Sinang, toujours
moqueuse, compara à une «guitare de mendiant».
Quand les deux groupes se rencontrèrent,
c’étaient les jeunes filles qui avaient pris un air
sérieux et grave comme si elles n’avaient jamais appris
à rire; au contraire, les hommes parlaient, saluaient,
souriaient et faisaient six questions pour obtenir la moitié
d’une réponse.
—Le lac est-il tranquille? Croyez-vous que nous aurons beau
temps? demandaient les mamans.
—Ne vous inquiétez pas, señoras, je sais
très bien nager, répondit un grand garçon, sec et
mince.
—Auparavant, nous aurions dû entendre la messe!
soupirait tante Isabel en joignant les mains.
—Il est encore temps, señora. Albino qui est un ancien
séminariste peut la dire dans la barque, répondit un
autre en désignant le grand sec.
Celui-ci, qui avait une bonne physionomie de fourbe, entendant ce
propos, prit aussitôt un air componctueux, caricature parfaite du
P. Salvi.
Sans rien perdre de sa gravité, Ibarra prenait part à
la gaieté de ses compagnons.
Mais on était au bord du lac: des cris de surprise et de joie
s’échappèrent involontairement des lèvres
des femmes. On voyait deux grandes barques, réunies entre elles,
pittoresquement ornées de guirlandes de fleurs et de feuilles
avec des étoffes bouillonnées de diverses couleurs; de
petites lanternes de papier pendaient alternant avec des roses, des
œillets, des fruits, piñas, kasuy, platanos, goyaves,
lanzones1.
Ibarra [154]avait apporté des nattes, des tapis, des
coussins et, avec le tout, formé de commodes et moelleux
sièges pour les dames. Les tikines2 et les avirons étaient
également décorés. Dans la barque la mieux
parée se trouvaient une harpe, des guitares, des
accordéons et une corne de carabao; dans l’autre
brûlait un feu de kalanes3 de boue; on préparait du
thé, du café et du salabat4 pour le déjeuner.
—Ici les femmes, là les hommes! disaient les mamans en
s’embarquant. Allons! restez tranquilles, ne remuez pas ou nous
allons chavirer.
—Faisons le signe de la croix! disait tante Isabel.
—Et nous allons rester ici toutes seules? demanda Sinang en
faisant la moue. Nous seules... Aïe!
Cette exclamation avait pour cause un pinçon opportun dont
l’avait gratifiée sa mère.
Lentement les barques s’éloignaient de la plage,
reflétant dans le miroir du lac les multiples lumières de
leurs lanternes. A l’orient apparaissaient les premières
teintes de l’aurore.
Un silence relatif régnait. La séparation
établie par les vieilles dames semblait avoir pour effet de
dédier la jeunesse à la méditation.
—Fais attention! dit à voix haute Albino à un
autre jeune homme; appuie bien sur l’étoupe qui est sous
ton pied.
—Comment?
—Parce que l’eau pourrait entrer; cette barque est
pleine de trous.
—Aïe! nous coulons! s’écrièrent les
femmes épouvantées.
—N’ayez pas peur, señoras! reprit le
séminariste pour les tranquilliser. Votre barque est très
sûre, elle n’a que cinq trous et ils ne sont pas
très grands. [155]
—Cinq trous! Jésus! Voudriez-vous nous noyer?
—Pas plus de cinq, señoras, grands comme cela! et il
leur montrait le petit rond formé par son pouce et son index
réunis. Refoulez bien les étoupes pour les boucher.
—Mon Dieu! sainte Marie! l’eau entre déjà,
s’écria une vieille.
Il y eut un petit tumulte, les unes poussaient des cris, les autres
se préparaient à sauter à l’eau.
—Assurez bien les étoupes, là! continuait Albino
en montrant l’endroit où étaient les jeunes
filles.
—Où donc? où donc? nous ne savons pas! Par
pitié venez nous montrer ce qu’il faut faire! imploraient
les femmes tremblantes.
Il fallut que cinq jeunes gens passassent dans l’autre barque
pour rassurer les mères effrayées. Singulier hasard! un
endroit dangereux se trouvait à côté de chaque
jeune fille; du côté des vieilles dames pas une voie
d’eau ne menaçait la sécurité commune. Et
plus singulier hasard encore! Ibarra avait dû se placer
près de Maria Clara, Albino près de Victoria, chacun
près de sa préférée. La tranquillité
revint régner du côté des prévoyantes
mères; mais de ce côté seulement.
L’eau était complètement tranquille,
les champs de pêche peu éloignés, l’heure
très matinale, aussi fut-il décidé
d’abandonner les avirons et de se mettre à
déjeuner. L’aurore illuminant déjà
l’espace, on éteignit les lanternes.
La matinée était belle, la lumière qui tombait
du ciel et celle que reflétaient les eaux faisaient briller la
surface du lac; de là une clarté illuminant tout, ne
produisant presque pas d’ombres, une clarté fraîche,
saturée de couleurs, comme on en devine parfois dans quelques
marines.
Presque tous étaient joyeux, ils respiraient la
légère brise qui commençait à
s’élever; les vieilles dames elles-mêmes, toujours
surveillant et grondant, riaient et se divertissaient entre elles.
[156]
—Te souviens-tu, disait l’une d’elles à la
Capitana Ticá, du temps où nous étions encore
jeunes filles et où nous allions nous baigner dans la
rivière? Nous descendions le courant dans de petites barques
faites d’écorce de platane, nous emportions des fruits et
des fleurs parfumées. Nous portions chacune une petite
bannière où se lisaient nos noms...
—Et quand nous revenions à la maison, ajoutait
l’autre sans la laisser terminer, nous trouvions les ponts de
bambou détruits et nous étions forcées de passer
les ruisseaux à gué... les brigands!
—Oui! disait la Capitana Ticá, mais je
préférais mouiller ma jupe que de me découvrir le
pied; je savais que dans les buissons de la rive étaient
cachés des yeux qui nous observaient.
Les jeunes filles qui entendaient cette conversation se faisaient
des signes et souriaient.
Seul un homme restait silencieux, étranger à toute
cette gaieté: c’était le pilote. Jeune, de formes
athlétiques, ses grands yeux tristes et le sévère
dessin de ses lèvres donnaient à l’expression de sa
physionomie un caractère intéressant que
renforçaient encore ses longs cheveux noirs retombant
naturellement, sans artifice de toilette, sur un cou robuste; une
chemise sombre, de toile grossière, laissait deviner des muscles
puissants et nerveux et ses bras nus maniaient comme une plume une
large et lourde rame qui lui servait de timon pour guider les deux
barques.
Maria Clara avait plusieurs fois surpris son regard attaché
sur elle: il détournait aussitôt les yeux, contemplant
l’horizon, les montagnes, les arbres de la rive. Elle eut
pitié de sa solitude et, prenant quelques galettes, les lui
offrit. Avec une certaine surprise il la regarda, mais ce regard ne
dura qu’une seconde; prenant une galette, il refusa les autres en
remerciant d’une voix à peine perceptible.
Personne ne s’occupa plus de lui. Les rires joyeux, les
plaisirs des autres jeunes gens ne le déridaient pas; [157]même
les éclats de gaieté de la rieuse Sinang ne le faisaient
pas départir de sa gravité.
Le premier déjeuner terminé, on continua
l’excursion vers les enclos de pêche.
Il y en avait deux, placés à une certaine distance
l’un de l’autre; tous deux étaient la
propriété du Capitan Tiago. On distinguait de loin
quelques hérons posés parmi les roseaux de la rive; de
ces oiseaux blancs, que les tagals appellent kalauay5, volaient de ci de
là, rasant de leurs ailes la surface des eaux, remplissant
l’air de stridents croassements.
Maria Clara suivait du regard les hérons qui, lorsque les
barques s’approchèrent, s’enfuirent dans la
direction des montagnes voisines.
—Ces oiseaux ont-ils leurs nids dans ces montagnes?
demanda-t-elle au pilote, bien moins peut-être pour le savoir que
pour faire parler ce silencieux.
—Probablement, señora, répondit-il, mais
jusqu’ici personne encore n’a vu leurs nids.
—N’ont-ils pas de nids?
—Je suppose qu’ils doivent en avoir, sinon ils seraient
bien malheureux!
Maria Clara ne remarqua pas l’accent de tristesse avec lequel
le jeune homme avait fait cette remarque.
—Alors?
—On dit, señora, que les nids de ces oiseaux sont
invisibles et qu’ils ont la propriété de rendre
également invisible celui qui les a en son pouvoir; de
même que l’âme ne peut se voir que dans le brillant
miroir des yeux, ce ne doit être que dans le miroir des eaux que
ces nids se peuvent contempler.
Maria Clara devint pensive.
Mais on était arrivé au baklad6; le vieux marinier
attacha les embarcations à un roseau, tandis que son fils se
disposait à monter sur le bord de l’enclos pourvu [158]de son
panalok, c’est-à-dire de la ligne avec la poche de
filet.
—Attends un instant, dit à ce dernier la tante Isabel,
il faut disposer le sinigang pour que les poissons sortant de
l’eau puissent être mis dans la marmite.
—Quoi! bonne tante Isabel, s’écria le
séminariste, ne voulez-vous pas que le poisson puisse rester au
moins un instant hors de l’eau.
Malgré sa figure blanche et joyeuse, Andeng, la sœur de
lait de Maria Clara, était renommée comme bonne
cuisinière. Elle prépara de l’eau de riz, des
tomates et des camias7; quelques jeunes gens qui peut-être voulaient
mériter ses sympathies l’aidaient dans ces
préparatifs. Les autres jeunes filles épluchaient les
cœurs de citrouilles, les pois et coupaient les paayap8 en petits
morceaux longs comme des cigarettes.
Pour tromper l’impatience de ceux qui désiraient voir
comment les poissons, vivants et frétillants, sortiraient de
leur prison, Iday prit la harpe; non seulement elle touchait
très bien de cet instrument mais de plus elle avait une
très jolie main.
La jeunesse applaudit, Maria Clara l’embrassa; la harpe est
l’instrument dont on joue le plus dans cette province, surtout
dans ces occasions.
—Chante, Victoria, chante la Chanson du Mariage!
demandèrent les vieilles dames.
Les hommes protestèrent et Victoria, qui avait fort bonne
voix, se plaignit d’être enrouée. La Chanson du
Mariage est une belle élégie tagale où sont
peintes toutes les tristesses et toutes les misères de la vie de
ménage sans aucune de ses consolations et de ses joies.
Alors, Maria Clara fut à son tour sollicitée.
—Toutes mes chansons sont tristes, dit-elle. [159]
—Cela ne fait rien, lui répondirent ses compagnes.
Elle ne se fit plus prier, prit la harpe et d’une voix
vibrante, harmonieuse et pleine de sentiment, chanta ces couplets:
«Les heures sont
douces dans la patrie
Où est l’ami, quand brille le soleil.
La vie, c’est la brise qui souffle sur ses
campagnes,
La mort y est douce, plus tendre y est
l’amour.
»D’ardents
baisers jouent sur les lèvres,
Lors du réveil sur le cœur d’une
mère;
Les bras cherchent à ceindre le cou,
Et les yeux en se regardant se sourient.
»La mort est douce
pour la patrie
Où est l’ami, quand brille le soleil;
Morte est la brise, pour qui n’a pas
Une patrie, une mère, un amour.»
La voix s’éteignit, le chant cessa, la harpe devint
muette... on écoutait encore: personne n’applaudit. Les
jeunes filles sentaient leurs yeux se remplir de larmes, Ibarra
paraissait contrarié; quant au jeune pilote, immobile, il
regardait au loin.
Mais un fracas retentit, semblable au bruit du tonnerre. Les femmes
poussèrent un cri et se bouchèrent les oreilles.
C’était l’ex-séminariste Albino qui, de toute
la force de ses poumons, soufflait dans la corne de carabao, appelant
tambulî9. Il n’en fallut pas plus pour ramener le rire
et l’animation et sécher les yeux larmoyants.
—Veux-tu nous rendre sourdes, païen? lui cria la tante
Isabel.
—Señora, répondit-il avec solennité;
j’ai entendu parler d’un pauvre sonneur de trompette qui,
pour avoir joué de son instrument, s’est marié avec
une noble et riche demoiselle.
—C’est vrai, le Trompette de Säckingen! ajouta
Ibarra qui ne pouvait se dispenser de prendre part à la
conversation. [160]
—Vous l’avez entendu? continua Albino, eh bien, je veux
voir si je serai aussi heureux.
Et de nouveau, il se mit à souffler avec plus de force encore
dans la corne résonnante, approchant particulièrement la
trompe des oreilles des jeunes filles qui, moins gaies,
s’étaient assises. Naturellement, il y eut un petit
soulèvement; les mères le firent taire à force de
coups de pied et de pinçons.
—Aïe! Aïe! disait-il, en se frottant les bras,
qu’il y a loin des Philippines aux rives du Rhin! O
tempora, o mores! Pour le même acte, on décore les
uns, aux autres on donne des sambenitos10.
Toutes riaient, même Victoria; cependant Sinang disait
à voix basse à Maria Clara:
—Tu es heureuse toi! moi aussi je chanterais bien, si je
pouvais!
Enfin, Andeng annonça que le bouillon était prêt
à recevoir ses hôtes.
Le jeune fils du pêcheur, monta alors sur la resserre ou
bourse de l’enclos de pêche, placée à
l’extrémité la plus étroite. Là, si
les malheureux poissons avaient su lire et comprendre l’italien,
on aurait pu écrire le Lasciate ogni speranza voi
ch’entrate11, car ils n’en sortaient que pour mourir.
C’était un espace presque circulaire d’environ un
mètre de diamètre, disposé de telle façon
qu’un homme pût se tenir debout sur la partie
supérieure afin de retirer les poissons avec un petit filet.
—J’aimerais pêcher à la ligne comme cela,
disait Sinang tout heureuse.
Tous étaient attentifs. Déjà quelques-uns
croyaient voir frétiller et s’agiter les poissons et
briller leurs étincelantes écailles: le jeune homme
abaissa le filet, rien n’en sortit.
—La resserre doit être pleine, dit Albino à voix
basse, depuis cinq jours on ne l’a pas visitée. [161]
Le pêcheur retira la ligne: pas plus que le filet aucun
poisson ne l’ornait; l’eau retombant en abondantes gouttes,
où se jouait le soleil, semblait rire d’un rire argentin.
Un cri de désappointement s’échappa de toutes les
bouches.
La même opération répétée obtint
le même résultat.
—Tu ne connais pas ton métier! dit Albino en grimpant
auprès du jeune homme, et il lui arracha le filet des mains.
Regarde, maintenant! Andeng, ouvrez la marmite!
Mais Albino ne fut pas plus adroit, le filet était toujours
vide. Tous commencèrent à rire.
—Ne faites pas de bruit, vous chassez les poissons, dit-il. Ce
filet doit être troué.
Mais toutes les mailles étaient intactes.
—Laissez-moi faire! lui dit Léon, le fiancé
d’Iday. Celui-ci s’assura bien de l’état du
cercle, examina le filet et, satisfait, demanda:
—Êtes-vous sûr qu’on n’a pas
visité l’enclos depuis cinq jours?
—Nous en sommes absolument sûrs; la dernière fois
c’était pour la vigile de la Toussaint.
—Mais alors! ou le lac est enchanté, ou je vais tirer
quelque chose.
Léon plongea sa ligne, mais l’ennui se peignit sur sa
figure. Il regarda un moment silencieux la montagne voisine, puis
promena l’hameçon dans l’eau: il ne le retira pas,
mais murmura à voix basse:
—Un caïman!
—Un caïman!
Le mot courut de bouche en bouche au milieu de
l’épouvante et de la stupéfaction
générales.
—Que dites-vous? lui demanda-t-on.
—Je dis qu’un caïman est pris là, affirma
Léon qui enfonçant dans l’eau le manche de la ligne
ajouta:
—Écoutez ce son? ce n’est pas le sable,
c’est la peau, la peau épaisse, l’épaule du
caïman. Voyez le mouvement des roseaux! c’est lui qui se
démène car il est enroulé
[162]sur lui-même,
attendez... il est grand: son corps mesure une palme au plus de
large.
—Que faire? demanda-t-on.
—Le prendre! dit une voix.
—Jésus! et qui le prendra?
Personne ne s’offrait à descendre dans
l’abîme. L’eau était profonde.
—Nous devrions l’attacher à notre barque et le
traîner en triomphe, dit Sinang; il a mangé nos poissons
à notre place!
—Je n’ai pas encore vu de caïman vivant! murmura
Maria Clara.
Le pilote se levant, prit une longue corde et monta agilement sur
l’espèce de plate-forme. Léon lui céda la
place.
Excepté Maria Clara, personne jusqu’alors ne
l’avait regardé; maintenant on admirait sa svelte
stature.
A la grande surprise de tous et malgré les cris, il sauta
dans la resserre.
—Emportez ce couteau! lui cria Crisóstomo en tirant une
large lame de Tolède.
Mais déjà l’eau un instant troublée
redevenait calme et l’abîme se fermait
mystérieux.
—Jésus, Marie, Joseph! criaient les femmes. Nous allons
avoir un malheur!
—Ne craignez rien, señoras, leur disait le vieux
marinier; s’il y a quelqu’un dans la province qui puisse en
venir à bout, c’est lui.
—Comment s’appelle ce jeune homme? demanda
quelqu’un.
—Nous l’appelons le Pilote: c’est le
meilleur que j’ai vu; seulement il n’aime guère le
travail.
L’eau s’agitait; il semblait que dans les profondeurs un
combat se fût engagé. Tous se taisaient, contenaient leur
respiration. Ibarra, d’une main convulsée, serrait la
poignée de son couteau aigu.
La lutte semblait prendre fin. La tête du jeune [163]homme apparut,
saluée de cris joyeux; les yeux des femmes étaient pleins
de larmes.
Il grimpa sur la plate-forme, tenant d’une main
l’extrémité de la corde, puis il tira
fortement.
On vit alors le monstre; la corde le liait autour du cou et sous les
extrémités antérieures, il était grand,
ainsi que l’avait annoncé Léon, tacheté; sur
ses épaules croissait une mousse verte qui est aux caïmans
ce que les cheveux blancs sont à l’homme. Il mugissait
comme un bœuf, frappait de la queue les roseaux, s’y
accrochait et ouvrait une gueule noire et terrible, découvrant
des crocs longs et acérés.
Le pilote le hissait seul; personne ne songeait à
l’aider.
Lorsque la bête fut hors de l’eau, le jeune homme mit le
pied dessus, ferma d’une main robuste les redoutables
mâchoires et essaya d’attacher le museau avec de forts
nœuds. Le reptile tenta un dernier effort, arqua son corps,
battit le sol de sa puissante queue et, s’échappant,
s’élança d’un saut dans le lac, hors de
l’enclos, entraînant son dompteur. Le pilote était
un homme mort; un cri d’horreur sortit de toutes les
poitrines.
Rapide comme l’éclair, un autre corps tomba à
l’eau: à peine eut-on le temps de voir que
c’était Ibarra. Si Maria Clara ne s’évanouit
pas, c’est que les indigènes des Philippines ne savaient
pas encore s’évanouir.
Les eaux se colorèrent, se teignirent de rouge. Le jeune
pêcheur sauta à son tour dans l’abîme, le
bolo12
à la main, son père le suivit. Mais à peine
disparaissaient-ils qu’Ibarra et le pilote remontaient à
la surface, cramponnés au cadavre du caïman. Le ventre
blanc du reptile était lacéré et le couteau
d’Ibarra cloué dans sa gorge.
Il est impossible de décrire la joie générale;
tous les bras se tendirent pour tirer, les deux jeunes gens de [164]l’eau. Les vieilles dames étaient
à demi-folles, elles riaient, elles priaient, elles pleuraient.
Andeng oublia que son sinigang avait bouilli trois fois; tout le
bouillon se répandit sur le feu et l’éteignit. La
seule qui ne put dire un mot fut Maria Clara.
Ibarra était indemne; le pilote n’avait qu’une
légère égratignure au bras.
—Je vous dois la vie! dit-il à Ibarra que l’on
entourait de manteaux de laine et de tapis.
La voix du pilote avait un timbre particulier; elle semblait
nuancée d’ennui.
—Vous êtes trop intrépide! répondit
Ibarra; une autre fois vous ne tenterez plus Dieu!
—Si tu n’étais pas revenu!... murmura Maria Clara
encore pâle et tremblante.
—Si je n’étais pas revenu et que tu m’aies
suivie, répondit le jeune homme en complétant sa
pensée, au fond du lac j’aurais été en
famille.
Ibarra n’oubliait pas que c’était là que
gisaient les restes de son père.
Les vieilles dames ne voulaient pas aller au second baklad;
pour elles le jour avait mal commencé, il ne pouvait manquer
d’arriver d’autres malheurs, mieux valait s’en
aller.
—Et tout cela parce que nous n’avons pas entendu la
messe!
—Mais, quel malheur avons-nous eu? répondit Ibarra. Le
seul à plaindre dans l’affaire, c’est le
caïman.
—Ce qui prouve, conclut l’ex-séminariste, que
dans toute sa vie pécheresse jamais cet infortuné
reptile n’a entendu la messe. Jamais on ne l’a vu parmi
tant de caïmans qui fréquentent l’église.
Les barques se dirigèrent donc jusqu’à
l’autre baklad. Andeng dut préparer un autre
sinigang.
La matinée s’avançait; la brise
s’élevait et commençait à agiter les vagues
qui se plissaient autour du caïman, soulevant «des montagnes
d’écume où étincelante brille, riche en
couleurs, la lumière du soleil», comme dit le poète
P. A. Paterno. [165]
La musique résonna de nouveau: Iday jouait de la harpe, les
hommes de l’accordéon et de la guitare avec plus ou moins
de régularité; le meilleur était Albino qui
grattait son instrument absolument à faux, perdait la mesure
à chaque instant ou bien oubliait quelques principales mesures
et passait sans transition à un autre air absolument
distinct.
Le second enclos fut visité sans confiance; beaucoup
s’attendaient à y trouver la femelle du caïman; mais
la nature est moqueuse et le filet sortit toujours plein.
La pêche terminée, on se dirigea vers la rive.
Là, à l’ombre de ce bois d’arbres
séculaires qui appartenait à Ibarra, près du
ruisseau cristallin, on devait déjeuner parmi les fleurs, sous
des tentes improvisées.
La musique résonnait dans l’espace; la fumée des
kalanes s’élevait joyeuse en tourbillons légers;
l’eau chantait dans la marmite bouillante. Le cadavre du
caïman tournait de tous côtés, tantôt
présentant son ventre blanc et déchiré,
tantôt son dos tacheté et ses épaules moussues.
L’homme, favori de la Nature, ne s’inquiétait
guère de tant de fratricides.
[Table des matières]
XXIV
Dans le bois
Ce matin-là, le P. Salvi avait dit sa messe de bonne heure,
de très bonne heure, et débarbouillé en quelques
minutes une douzaine d’âmes sales.
La lecture de quelques lettres qui étaient arrivées
dûment timbrées et cachetées sembla lui avoir fait
perdre l’appétit, car il laissa refroidir
complètement son chocolat.
—Le Père est malade, disait le cuisinier en
préparant une autre tasse; il y a quelques jours qu’il ne
mange pas; des six plats que je lui apporte, il n’en touche pas
deux. [166]
—C’est qu’il dort mal, répondit le valet de
chambre; il a des cauchemars depuis qu’il a changé de lit.
Ses yeux se creusent, il maigrit et jaunit de jour en jour.
En effet, le P. Salvi faisait peine à voir. Il n’avait
pas voulu toucher à la seconde tasse de chocolat ni goûter
aux gâteaux feuilletés de Cebú1; il se promenait pensif dans la
vaste salle serrant dans ses mains osseuses quelques lettres
qu’il parcourait par moments. Enfin il se décida à
demander sa voiture, s’habilla et ordonna qu’on le
conduisît au bois où se trouvait l’arbre fatidique,
dans les environs duquel se donnait la fête champêtre.
Près du bois, le P. Salvi descendit de voiture et
s’enfonça seul sous les ombrages.
Un sentier couvert traversait, avec beaucoup de détours,
l’épaisseur du bois et conduisait à un ruisseau
formé de diverses sources thermales, comme il en est beaucoup
sur les flancs du Makiling. Les rives en sont ornées de fleurs
sylvestres dont un grand nombre n’ont pas encore reçu de
noms latins mais sont connues quand même des insectes
dorés, des papillons de toutes tailles et de toutes couleurs,
bleus et rouges, blancs et noirs, nuancés, brillants,
bronzés, portant sur leurs ailes des rubis et des
émeraudes, comme aussi des milliers de coléoptères
aux reflets métalliques poudrés d’or fin. Le
bourdonnement de ces insectes, le grésillement de la cigale qui
retentit nuit et jour, le chant de l’oiseau ou le bruit sec de la
branche morte qui tombe en s’accrochant de toutes parts troublent
seuls le silence mystérieux.
Le prêtre erra quelque temps parmi les lianes épaisses,
évitant les épines qui s’enfonçaient dans
l’habit de guingon comme pour le retenir, les racines des arbres
qui sortaient du sol et le faisaient trébucher à chaque
pas. Tout à coup il s’arrêta: des éclats de
voix fraîches, des rires arrivaient à ses oreilles; ces
sons joyeux venaient [167]du ruisseau et se rapprochaient de plus en
plus.
—Je vais voir si je trouve un nid, disait une belle et douce
voix, que le curé reconnaissait, je voudrais le voir sans
que lui me vît; je voudrais le suivre partout.
Le P. Salvi se cacha derrière le tronc d’un gros arbre
et écouta.
—C’est-à-dire que tu voudrais faire avec lui ce
que le curé fait avec toi, puisqu’il te surveille
continuellement? répondit une voix joyeuse. Prends garde, car la
jalousie fait maigrir et creuse les yeux.
—Non, ce n’est pas par jalousie, c’est par pure
curiosité! répliquait la voix argentine, tandis que la
joyeuse répétait: Oui! jalouse, jalouse! et riait aux
éclats.
—Si j’étais jalouse, au lieu de vouloir me rendre
invisible, c’est à lui que je donnerais ce
privilège pour que personne ne puisse le voir.
—Mais toi, tu ne le verrais pas non plus et ce ne serait pas
bien. Le mieux, si nous trouvons le nid, sera que nous le donnions au
curé; il pourra ainsi nous surveiller sans qu’on soit
forcé de le voir, n’est-ce pas ton avis?
—Je ne crois pas aux nids de hérons, répondit
l’autre voix; mais si jamais je devenais jalouse, je saurais
surveiller et me faire invisible...
—Comment? comment? comme une Sœur surveillante
peut-être?
Ce souvenir de pension provoqua encore un accès de
gaieté.
—Tu sais comment on la trompait, la Sœur
surveillante!
De sa cachette, le P. Salvi reconnut Maria Clara, Victoria et Sinang
se promenant dans le ruisseau. Les trois jeunes filles, tout en
marchant, regardaient la surface des eaux, cherchant le
mystérieux nid de héron; elles allaient, mouillées
jusqu’aux genoux, les larges plis des jupes de bain laissant
deviner la gracieuse courbe de leurs jambes. Les cheveux
déliés, les bras nus, le buste recouvert de chemises
à grandes raies de couleurs [168]claires, elles cherchaient
l’impossible et cueillaient en même temps des fleurs et des
plantes croissant sur les rives.
L’Actéon religieux, immobile et pâle, contemplait
Maria Clara, cette pudique Diane; ses yeux brillant dans leurs sombres
orbites ne se lassaient pas d’admirer ces bras blancs et bien
modelés, ce cou élégant, cette gracieuse gorge:
les pieds mignons et roses qui jouaient avec l’eau
réveillaient dans son être appauvri
d’étranges sensations et faisaient rêver son ardent
cerveau.
Mais le petit cours d’eau faisait un coude et bientôt
les roseaux épais cachèrent ces douces figures dont il
cessa d’entendre les allusions cruelles. Ivre, chancelant,
couvert de sueur, le P. Salvi sortit de sa cachette et regarda autour
de lui avec des yeux égarés. Il restait immobile, ne
sachant à quoi se résoudre, faisant quelques pas comme
pour suivre les jeunes filles, mais bientôt se retournant il
marcha le long de la rive afin de rejoindre le reste des
invités.
A quelque distance, au milieu du ruisseau, il vit une sorte de bain,
bien enclos, dont le toit était fait de roseaux feuillus; de
là sortaient aussi de joyeux accents de jeunes filles; des
feuilles de palmier, des fleurs, des banderoles ornaient cette tente
légère. Plus loin, un pont de bambous; de l’autre
côté de ce pont se baignaient les hommes, tandis
qu’une multitude de serviteurs et de servantes s’empressait
autour des kalanes improvisés, occupés à
plumer des poules, à laver du riz, à rôtir des
cochons de lait, etc. Sur la rive opposée, dans une
clairière faite de main d’homme, beaucoup d’hommes
et de femmes étaient réunis sous un toit de cotonnade,
attaché en partie aux branches des arbres séculaires, en
partie à des pieux nouvellement fichés en terre.
Là causaient l’alférez, le vicaire, le
gobernadorcillo, le lieutenant principal, le maître
d’école, nombre de capitaines et de lieutenants ayant
cessé leurs fonctions et même le père de Sinang, le
Capitan Basilio, qui avait été l’adversaire de D.
Rafael [169]dans un vieux procès non encore
terminé. Ibarra lui avait dit: «Nous discutons un droit,
mais discuter ne veut pas dire être ennemis.» Et le
célèbre orateur des conservateurs avait non seulement
accepté l’invitation avec enthousiasme mais, de plus,
envoyé trois domestiques à la disposition du jeune
homme.
Le curé fut reçu avec respect et
déférence par tous, même par
l’alférez.
—Mais, d’où vient Votre Révérence?
demanda celui-ci en voyant son visage plein d’égratignures
et son habit couvert de feuilles et de morceaux de branches
sèches. Votre Révérence serait-elle
tombée?
—Non, je me suis égaré! répondit le P.
Salvi en baissant les yeux pour examiner son costume.
On ouvrait des bouteilles de limonade, on partageait des cocos verts
afin que ceux qui sortaient du bain pussent boire leur eau
fraîche et manger leur chair tendre, plus blanche que le lait;
les jeunes filles recevaient de plus un chapelet de sampagas,
entremêlés de roses et de ilang-ilang qui parfumaient les
chevelures dénouées. Elles s’asseyaient ou se
couchaient dans les hamacs suspendus aux branches ou bien encore
s’installaient pour jouer autour d’une large pierre sur
laquelle on voyait des cartes, des échiquiers, de petits livres,
des coquillages et de petites pierres servant de marques.
On montra le cadavre du caïman au curé, mais il parut
distrait, son attention s’éveilla seulement
lorsqu’en lui montrant la plus large blessure on lui dit que
c’était l’œuvre d’Ibarra. Quant au
pilote, célèbre quoique inconnu, il n’était
plus là; avant l’arrivée de l’alférez
il avait déjà disparu.
Maria Clara sortit enfin du bain, accompagnée de ses amies;
fraîche comme une rose à son premier matin, couverte de
rosée, des gouttelettes de diamant dans ses pétales
divins. Son premier sourire fut pour Crisóstomo, pour le P.
Salvi le premier nuage de son front. Celui-ci le remarqua mais ne
soupira pas. [170]
L’heure de manger était arrivée. Le curé,
le vicaire, l’alférez, le gobernadorcillo et quelques
capitaines avec le lieutenant principal s’assirent à une
table que présidait Ibarra. Les mamans n’avaient pas
permis qu’aucun homme prît place à la table des
jeunes filles.
—Cette fois, Albino, tu n’inventes plus de voies
d’eau comme dans les barques, dit Léon à
l’ex-séminariste.
—Quoi? qu’est-ce que cela veut dire? demandèrent
les vieilles.
—Señoras, cela veut dire que les barques étaient
aussi peu trouées que ce plat, déclara Léon.
—Jésus, saramullo! s’écria en souriant la
tante Isabel.
—Avez-vous appris quelque chose, señor alférez,
sur le criminel qui a maltraité le P. Dámaso? demandait
F. Salvi:
—De quel criminel parlez-vous? répondit
l’alférez en regardant le moine au travers d’un
verre de vin qu’il vidait.
—Comment? mais de celui qui avant-hier a frappé le P.
Dámaso sur la route!
—Le P. Dámaso a été attaqué?
interrogèrent diverses voix.
Le vicaire parut sourire.
—Oui, le P. Dámaso est au lit en ce moment. On croit
que l’auteur de l’attentat est Elias, celui qui vous
autrefois vous a jeté dans la mare, señor
alférez.
L’alférez devint rouge de honte, à moins que ce
ne fût d’avoir vidé son verre de vin.
—Mais je croyais, continua le P. Salvi avec une certaine
ironie, que vous étiez au courant du fait; je me disais
qu’alférez de la garde civile...
Le militaire se mordit les lèvres et balbutia une excuse
quelconque.
A ce moment, une femme pâle, maigre, misérablement
vêtue, apparut comme un spectre; personne ne l’avait vue
venir, car elle s’avançait silencieuse et faisait [171]si peu de
bruit que, la nuit, on l’eût prise pour un
fantôme.
—Donnez à manger à cette pauvre femme! disaient
les vieilles dames; hé! venez ici!
Continuant son chemin, elle s’approcha de la table où
était le curé; celui-ci tourna la tête, la reconnut
et le couteau lui tomba de la main.
—Donnez à manger à cette femme! ordonna
Ibarra.
—La nuit est obscure et les enfants disparaissent! murmurait
la malheureuse.
Mais à la vue de l’alférez qui lui adressait la
parole, elle prit peur et se mit à courir, disparaissant entre
les arbres.
—Qui est-ce? demanda-t-on.
—Une malheureuse qui est devenue folle à force de
craintes et de douleurs! répondit D. Filipo; il y a quatre jours
qu’il en est ainsi.
—Ne serait-ce pas une certaine Sisa? demanda Ibarra avec
intérêt.
—Vos soldats l’ont arrêtée, continua le
lieutenant principal avec une certaine amertume; ils l’ont
conduite à travers tout le pueblo pour je ne sais quelle
histoire sur ses fils... que l’on n’a pu
éclaircir.
—Comment? demanda l’alférez en se retournant vers
le curé, c’est peut-être la mère de vos deux
sacristains?
Le curé confirma d’un signe de tête.
—Ils ont disparu sans qu’on ait jamais recherché
ce qu’ils étaient devenus! ajouta sévèrement
D. Filipo en regardant le gobernadorcillo qui baissa les yeux.
—Cherchez cette femme! commanda Crisóstomo aux domestiques.
J’ai promis de m’informer de l’endroit où sont
ses fils...
—Ils ont disparu, dites-vous? demanda l’alférez.
Vos sacristains ont disparu, Père curé?
Celui-ci vida le verre de vin qu’il avait devant lui et fit un
signe de tête affirmatif.
—Caramba! Père curé, s’écria avec
un rire moqueur [172]l’alférez, qui se
réjouissait à la pensée d’une revanche,
quelques pesos de Votre Révérence sont perdus et vous
réveillez aussitôt mon sergent pour qu’il les fasse
chercher; vos deux sacristains disparaissent et Votre
Révérence ne dit rien, et vous, señor Capitan...
il est vrai aussi que vous...
Il n’acheva pas sa phrase mais éclata de rire en
enfonçant sa cuiller dans la chair rouge d’une papaya
sylvestre2.
Le curé, confus, troublé, répondit:
—C’est que je dois répondre de
l’argent...
—Bonne réponse, révérend pasteur
d’âmes! interrompit l’alférez, la bouche
pleine. Bonne réponse, saint homme!
Ibarra voulut intervenir mais, faisant un effort sur lui-même,
le P. Salvi reprit:
—Et savez-vous, señor alférez, ce que l’on
dit à propos de la disparition de ces enfants? Non? Eh bien!
demandez-le à vos soldats!
—Comment? s’écria l’interpellé,
abandonnant son ton joyeux et moqueur.
—On dit que la nuit où ils ont disparu on a entendu des
coups de feu!
—Des coups de feu? répéta l’alférez
en regardant les personnes présentes.
Celles-ci firent un mouvement de tête affirmatif.
Le P. Salvi reprit alors lentement avec un sourire cruel et
sarcastique:
—Allons, je vois que vous ne savez pas arrêter les
criminels, que vous ignorez ce que font les vôtres, mais que vous
voulez vous faire prédicateur et apprendre aux autres leur
devoir. Vous devez connaître le refrain:
«Le fou en sait plus chez lui...»
—Señores, interrompit Ibarra qui avait vu pâlir
l’alférez; à propos de tout cela je voudrais savoir
ce que vous pensez d’un projet que j’ai formé. Je
pense [173]confier cette folle aux soins d’un bon
médecin et, avec votre aide et vos conseils, rechercher ce que
sont devenus ses fils.
Le retour des domestiques, qui n’avaient pu retrouver la
folle, acheva de rétablir la paix entre les deux adversaires, en
donnant un nouveau tour à la conversation.
Le repas était terminé; tandis que l’on servait
le café et le thé, jeunes gens et vieillards se
dispersèrent en divers groupes. Les uns prirent les jeux
d’échecs, les autres les cartes, mais les jeunes filles,
curieuses de savoir leur destinée,
préférèrent poser des questions à la
Roue de la Fortune.
—Venez, señor Ibarra! criait Capitan Basilio, un peu
plus gai que d’ordinaire. Nous avons un litige qui dure depuis
quinze ans; il n’y a pas de juge à la cour qui le
résolve; nous allons voir si nous pourrons le terminer aux
échecs?
—A l’instant et avec grand plaisir! répondit le
jeune homme. Dans un moment, car l’alférez prend
congé de nous!
Aussitôt l’officier parti, tous les vieillards qui
comprenaient le jeu se réunirent autour des deux partenaires; la
partie était intéressante et attirait même les
profanes. Les vieilles dames cependant préférèrent
se grouper autour du curé pour converser avec lui des choses
spirituelles; mais le P. Salvi ne jugeait ni l’endroit ni
l’occasion convenables pour de tels entretiens, aussi ne
faisait-il que de vagues réponses et ses regards tristes et
quelque peu irrités se fixaient un peu partout excepté
sur ses interlocutrices.
Les deux joueurs commencèrent avec beaucoup de
solennité.
—Si la partie ne donne pas de résultats,
l’affaire est oubliée, c’est entendu! disait
Ibarra.
Au milieu de l’action, Ibarra reçut une
dépêche télégraphique; ses yeux
brillèrent, il devint pâle, mais il la mit intacte dans
son portefeuille, sans rien dire, [174]sans même regarder le groupe de la
jeunesse qui, entre des rires et des cris, continuait à
interroger le destin.
—Echec au Roi! dit le jeune homme.
Capitan Basilio n’eut d’autre ressource que de cacher
son Roi derrière la Reine.
—Echec à la Reine! redit encore Ibarra en la
menaçant avec sa tour alors qu’elle ne restait
défendue que par un pion.
Ne pouvant couvrir la Reine ni la retirer à cause du Roi qui
était derrière, Capitan Basilio demanda un moment pour
réfléchir.
—Très volontiers! répondit Ibarra; j’avais
précisément quelque chose à dire en ce moment
même à quelques-unes des personnes présentes.
Et il se leva en accordant un quart d’heure à son
adversaire.
Iday avait le disque de carton où étaient inscrites
les 48 demandes, Albino le livre des réponses.
—C’est un mensonge, ce n’est pas vrai! criait
Sinang à demi en larmes.
—Qu’as-tu? lui demandait Maria Clara.
—Figure-toi, je demande: «Quand aurais-je de la
raison?» et celui-là, ce curé manqué, lit
dans le livre:
«Quand les grenouilles auront du poil!» Qu’en
dis-tu?
Et Sinang faisait la moue à l’ancien séminariste
qui riait encore.
—Qui t’avait commandé de faire cette question?
lui dit sa cousine Victoria. Elle ne méritait pas une autre
réponse.
—Demandez quelque chose, vous! dirent-elles toutes à
Ibarra en lui présentant la Roue. Nous avons
décidé que celui qui aurait reçu la meilleure
réponse recevrait un cadeau des autres. Toutes nous avons
déjà demandé!
—Et qui a eu la meilleure réponse?
—Maria Clara, Maria Clara! répondit Sinang. Nous lui
avons fait demander bon gré mal gré: «Son [175]amoureux
est-il fidèle et constant?» et le livre a
répondu...
Mais toute rouge, Maria Clara lui ferma la bouche avec sa main et ne
la laissa pas continuer.
—Alors, donnez-moi la Roue! dit Crisóstomo
souriant.
Il demanda: «Sortirai-je bien de mon entreprise
actuelle?»
—Voilà une vilaine demande! s’écria
Sinang.
Ibarra retira le doigt et, suivant son numéro, on chercha la
page et la ligne.
—«Les songes sont des songes!» lut Albino.
Ibarra sortit le télégramme et l’ouvrit en
tremblant.
—Cette fois votre livre a menti! s’écria-t-il
plein de joie. Lisez:
«Projet d’école approuvé, autre
jugé en votre faveur.»
—Que signifie ceci? criait-on.
—Ne disiez-vous pas que vous deviez faire un cadeau pour la
meilleure réponse obtenue? demanda-t-il d’une voix
tremblante, tandis qu’il partageait soigneusement le papier en
deux morceaux.
—Oui! oui!
—Eh bien! ceci est mon cadeau, dit-il en donnant une
moitié à Maria Clara; je dois élever dans le
pueblo une école pour les garçons et pour les filles;
cette école sera mon offrande.
—Et cet autre morceau?
—Celui-ci je le donnerai à qui aura obtenu la plus
mauvaise réponse!
—Alors, à moi! cria Sinang.
Ibarra lui donna le papier et s’éloigna rapidement.
—Qu’est-ce que cela signifie? demanda-t-elle.
Mais l’heureux jeune homme était déjà
loin et retournait poursuivre la partie d’échecs.
Fr. Salvi s’approcha, comme distrait, du joyeux cercle de la
jeunesse. Maria Clara séchait une larme de joie.
Aussitôt le rire cessa, toutes et tous devinrent muets. [176]Le
curé regarda les jeunes filles sans se risquer à
prononcer une parole; elles de leur côté gardaient le
silence, attendant qu’il parlât.
—Qu’est-ce que ceci? demanda-t-il enfin en prenant le
petit livre qu’il feuilleta.
—La Roue de la Fortune, un livre de jeu,
répondit Léon.
—Ne savez-vous pas que c’est un péché de
croire à ces choses? dit-il, et avec colère il
déchira les feuillets.
Tous poussèrent des cris de surprise et de chagrin.
—C’est un péché plus grand encore de
disposer de ce qui n’est pas à soi contre la
volonté du propriétaire! lui répliqua Albino en se
levant. Père curé, cela s’appelle voler, et Dieu et
les hommes condamnent le vol.
Maria Clara joignit les mains et, les yeux humides, contempla les
restes de ce livre qui l’avait faite si heureuse.
On s’attendait à ce que Fr. Salvi répondît
à Albino. Il n’en fit rien, il regarda tourbillonner les
feuilles dispersées les unes dans le bois, les autres dans
l’eau, puis s’en alla chancelant, la tête dans les
mains. Il s’arrêta quelques secondes encore pour parler
avec Ibarra, puis celui-ci l’accompagna jusqu’à
l’une des voitures disposées pour amener ou reconduire les
invités.
—Il fait bien de s’en aller ce rabat-joie! murmurait
Sinang. Il a une figure qui semble dire: Ne ris pas, car je connais tes
péchés!
Depuis qu’il avait fait son cadeau à sa fiancée
Ibarra était si content qu’il commença à
jouer sans réfléchir, sans s’occuper de
l’état des pièces.
Il en résulta que, bien que le Capitan Basilio en fût
déjà réduit à se défendre
difficilement, la partie, grâce aux nombreuses fautes commises
par le jeune homme, devint égale; il n’y avait ni perdant
ni gagnant.
—Nous sommes quittes, nous sommes quittes! disait joyeusement
Capitan Basilio. [177]
—Nous sommes quittes, nous sommes quittes!
répéta le jeune homme, quel que soit l’arrêt
que les juges aient pu rendre.
Tous deux se donnèrent une poignée de mains avec
effusion.
Au moment où ils célébraient ainsi cet
arrangement qui mettait fin à un procès depuis longtemps
fastidieux pour les deux parties, l’arrivée soudaine de
quatre gardes civils et d’un sergent, en armes, baïonnette
au canon, troubla la joie et répandit l’effroi parmi les
femmes.
—Tout le monde tranquille! Feu sur qui bouge! commanda le
sergent.
Malgré cette brutale fanfaronnade, Ibarra s’approcha de
lui.
—Que voulez-vous? demanda-t-il.
—Nous cherchons un criminel nommé Elias, qui vous
servait de pilote ce matin, répondit le militaire
menaçant.
—Un criminel? le pilote! vous devez vous tromper!
—Non, señor, cet Elias est accusé d’avoir
levé la main sur un prêtre...
—Ah! et ce serait le pilote?
—Lui-même, selon ce qu’on nous a dit. Vous
admettez à vos fêtes des gens de bien mauvaise
renommée, señor Ibarra.
Celui-ci le regarda des pieds à la tête et lui
répondit avec un souverain mépris.
—Je n’ai pas de comptes à vous rendre de mes
actes! A nos fêtes, tout le monde est bien reçu et
vous-même, si vous étiez venu, vous auriez trouvé
un siège à notre table, comme votre alférez qui,
il y a deux heures, était encore avec nous.
Et ceci dit, il tourna les épaules.
Le sergent se mordit les lèvres et, voyant qu’il
n’était pas le plus fort, il ordonna à ses hommes
de rechercher de tous côtés, jusque dans les arbres, le
pilote [178]dont ils avaient le signalement sur un papier.
D. Filipo lui disait:
—Remarquez bien que ce signalement convient aux neuf
dixièmes des naturels; faites attention aux faux pas!
Les soldats revinrent enfin, disant qu’ils n’avaient
rien vu qui pût paraître suspect: le sergent balbutia
quelques paroles et s’en alla comme il était venu, en
garde civil.
La joie renaquit peu à peu, ce fut une pluie de questions,
une abondance de commentaires.
—C’est cet Elias qui a jeté
l’alférez dans une mare! disait Léon pensif.
—Comment cela? qu’était-il arrivé?
demandèrent quelques curieux.
—On dit qu’au mois de septembre, par une journée
très pluvieuse, l’alférez se rencontra avec un
homme qui portait du bois. La route était inondée, il ne
restait qu’un passage étroit, à peine suffisant
pour une personne. Il paraît que l’alférez, au lieu
de retenir son cheval, piqua des éperons, criant à
l’homme de retourner sur ses pas. Celui-ci qui ne voulait ni
marcher inutilement à cause de la charge qu’il avait sur
le dos ni s’enfoncer dans la mare, poursuivit sa route.
Irrité, l’alférez voulut le frapper, mais
l’homme prit un morceau de bois et le jeta à la tête
du cheval avec une telle force que la pauvre bête tomba,
déposant le cavalier au milieu de l’eau. On ajoute que
l’homme poursuivit tranquillement son chemin sans s’occuper
des cinq balles que, de la mare, l’alférez, aveuglé
par la colère autant que par la boue, lui envoya l’une
après l’autre. Comme l’homme était
entièrement inconnu de lui, on supposa que ce devait être
le célèbre Elias, arrivé dans la province depuis
quelques mois, venu on ne sait d’où et qui
s’était déjà fait connaître des gardes
civils de quelques pueblos par de pareils faits.
—C’est donc un tulisan? demanda Victoria tremblante.
[179]
—Je ne le crois pas, car on dit qu’il s’est battu
contre les tulisanes un jour qu’ils avaient attaqué une
maison.
—Il n’a pas la figure d’un malfaiteur! ajouta
Sinang.
—Non, mais son regard est très triste, je ne l’ai
pas vu sourire de la matinée, répondit pensive Maria
Clara.
L’après-midi se passa ainsi, l’heure était
venue de retourner au pueblo.
Aux derniers rayons du soleil mourant, tout le monde sortit du bois
en passant en silence près de la mystérieuse tombe de
l’ancêtre d’Ibarra. Puis les conversations
redevinrent gaies, vives, pleines de chaleur, sous ces branchages peu
accoutumés à tant de bruit. Les arbres paraissaient
tristes, les lianes se balançaient comme pour dire: Adieu,
jeunesse! Adieu, rêve d’un jour!
Et maintenant, à la lueur rouge de gigantesques torches de
roseaux, au son des guitares, laissons-les suivre leur chemin vers le
pueblo. Les groupes se font moins nombreux, les lumières
s’éteignent peu à peu, les chants
s’affaiblissent et cessent, les guitares deviennent muettes
à mesure qu’ils s’approchent des demeures des
hommes. Reprenons le masque que nous portons d’habitude, entre
frères!
[Table des matières]
XXV
Chez le philosophe
Le lendemain matin, Juan Crisóstomo Ibarra, après
avoir visité ses terres, se rendit chez le vieux Tasio.
Dans le jardin régnait une complète
tranquillité, les hirondelles qui voletaient autour du toit
faisaient à peine de bruit. La mousse recouvrait le vieux mur
[180]où grimpait une sorte de lierre qui
encadrait les fenêtres. Cette maison paraissait la maison du
silence.
Ibarra attacha soigneusement son cheval à un poteau et,
marchant presque sur la pointe du pied, il traversa le jardin,
proprement et scrupuleusement entretenu, monta les escaliers et, comme
la porte était ouverte, entra.
En premier lieu, il vit le vieillard penché sur un livre dans
lequel il paraissait écrire. Sur les murs, des collections
d’insectes et de feuilles, des cartes et de vieilles planches,
supportant des livres et des manuscrits.
Le vieillard était si absorbé par son travail
qu’il ne remarqua l’arrivée du jeune homme
qu’au moment où celui-ci, ne voulant pas le troubler,
allait se retirer.
—Comment? vous étiez là? demanda-t-il en
regardant Ibarra avec un certain étonnement.
—Ne vous dérangez pas, répondit celui-ci, je
vois que vous êtes très occupé...
—En effet, j’écrivais un peu, mais rien ne
presse, je suis satisfait de me reposer un instant. Puis-je vous
être utile en quelque chose?
—Très utile! répondit Ibarra en
s’approchant; mais...
Et il jeta un regard vers le livre qui était sur la
table.
—Comment! s’écria-t-il surpris, vous vous occupez
à déchiffrer des hiéroglyphes?
—Non! répondit le vieillard en lui offrant une chaise;
je n’entends rien à l’égyptien pas plus
qu’au copte, mais je comprends quelque peu le système
d’écriture et j’écris en
hiéroglyphes.
—Vous écrivez en hiéroglyphes! et pourquoi?
demanda le jeune homme qui doutait de ce qu’il voyait et
entendait.
—Pour qu’on ne puisse pas me lire en ce moment.
Ibarra le regarda fixement se demandant si, en effet, le vieillard
n’était pas un peu fou. Il examina
[181]rapidement le livre pour
s’assurer de la vérité et vit, très bien
dessinés, des animaux, des cercles, des demi-cercles, des
fleurs, des pieds, des mains, des bras, etc.
—Et pourquoi donc écrivez-vous si vous ne voulez pas
être lu?
—Parce que je n’écris pas pour cette
génération, j’écris pour les âges
futurs. Si les hommes d’aujourd’hui pouvaient me lire ils
brûleraient mes livres, le travail de toute ma vie; par contre,
la génération qui déchiffrera ces
caractères sera instruite, elle me comprendra, elle dira:
«Nos aïeux ne dormaient pas tous dans la nuit de leur
temps.» Le mystère de ces curieux caractères
sauvera mon œuvre de l’ignorance des hommes comme le
mystère et les rites étranges ont protégé
beaucoup de vérités contre les destructives classes
sacerdotales.
—Et, en quelle langue écrivez-vous?
—Dans la nôtre, en tagal.
—Les signes hiéroglyphiques peuvent servir?
—N’était la difficulté du dessin qui exige
du temps et de la patience, je dirais qu’ils servent mieux que
l’alphabet latin. L’antique égyptiaque a nos
voyelles, notre o qui n’est que final et n’a pas la
valeur de l’o espagnol, étant une voyelle
intermédiaire entre o et u; il a aussi le
véritable son de l’e; on y trouve notre ha
et notre kha qui n’existent pas dans l’alphabet
latin dont se sert l’espagnol. Par exemple, dans ce mot
mukhâ—ajouta-t-il en montrant le livre—je
transcris plus exactement la syllabe hâ avec cette figure
de poisson qu’avec la lettre h latine qui, en Europe, se
prononce de tant de façons diverses. Pour une autre aspiration
moins forte, par exemple dans ce mot hain, où la lettre
h est plus douce, je me sers de ce buste de lion ou de ces trois
fleurs de lotus, selon la quantité de la voyelle. Bien plus,
j’ai le son de la nasale, impossible à rendre par
l’alphabet latin espagnolisé. Je vous assure que si ce
n’était la difficulté du dessin qui doit être
parfait, il y aurait avantage à adopter les hiéroglyphes,
[182]mais
cette difficulté même m’oblige à être
concis et à ne rien dire de plus que ce qui est juste et
nécessaire; d’ailleurs ce travail me tient compagnie quand
s’en vont mes hôtes de la Chine et du Japon.
—Quels hôtes?
—Ne les entendez-vous pas? mes hôtes, ce sont les
hirondelles. Cette année il en manque une: elle doit avoir
été prise par quelque mauvais gamin chinois ou
japonais.
—Comment savez-vous qu’elles viennent de ces pays?
—Très simplement: il y a quelques années, avant
leur départ, je leur attachai à la patte un petit papier
avec le nom des Philippines en anglais, parce que je supposais
qu’elles ne devaient pas aller très loin et
l’anglais se parle dans toutes les régions environnantes.
Pendant plusieurs années, mon petit papier n’obtint pas de
réponse; dernièrement je le fis écrire en chinois;
lorsqu’elles revinrent ici, en novembre dernier, deux portaient
d’autres petits papiers que je fis déchiffrer; l’un
était en chinois et apportait un salut des rives du Hoang-ho; le
second, suivant l’avis du Chinois que je consultai, était
écrit en japonais. Mais je vous entretiens de choses
indifférentes et ne vous demande pas en quoi je puis vous
être utile.
—Je venais vous parler d’une affaire importante,
répondit le jeune homme; hier après-midi...
—A-t-on pris ce malheureux? interrompit le vieillard avec
intérêt.
—Vous parlez d’Elias? comment savez-vous qu’on le
recherchait?
—J’ai vu la Muse de la garde civile.
—La Muse de la garde civile? Quelle est cette Muse?
—La femme de l’alférez, que vous n’avez pas
invitée à votre fête. Hier matin on a appris dans
le pueblo l’histoire du caïman. La Muse de la garde civile,
qui a autant de pénétration que de
méchanceté, supposa que [183]le pilote devait être le
téméraire qui avait jeté son mari dans la mare et
frappé le P. Dámaso; et, comme elle lit les
dépêches que doit recevoir l’alférez,
à peine celui-ci fut-il rentré chez lui, ivre et sans
jugement, que, pour se venger de vous, elle envoya le sergent avec des
soldats, afin de troubler la joie de votre fête. Prenez garde!
Eve était bonne sortie des mains de Dieu... Da. Consolacion,
elle, est méchante et l’on ne sait de quelles mains elle
est venue. La femme, pour être bonne, doit avoir
été au moins une fois ou jeune fille ou mère.
Ibarra sourit légèrement et, tirant quelques papiers
de son portefeuille, répondit:
—Mon défunt père vous a parfois consulté
en quelques occasions et je me souviens qu’il n’a eu
qu’à se féliciter d’avoir suivi vos conseils.
J’ai commencé une entreprise dont il importe
d’assurer la réussite.
Et Ibarra le mit brièvement au courant du projet
d’école qu’il avait offert à sa
fiancée, déroulant à la vue du philosophe
stupéfait les plans qu’on lui avait renvoyés de
Manille.
—Pourriez-vous me dire quelles sont les personnes à qui
je dois m’adresser en premier dans le pueblo pour leur demander
leur appui et assurer le succès de l’œuvre? Vous
connaissez bien les habitants; moi, j’arrive et suis presque
étranger dans mon pays.
Le vieux Tasio examinait avec des yeux pleins de larmes les plans
exposés devant lui.
—Ce que vous allez réaliser était mon
rêve, le rêve d’un pauvre fou!
s’écria-t-il tout ému; et maintenant le premier
conseil que je vous donne est de ne jamais venir me consulter.
Surpris, le jeune homme le regarda.
—Parce que, continua-t-il avec une amère ironie, toutes
les personnes sensées ne tarderaient pas à vous prendre
aussi pour un fou. Ces gens-là croient que tous ceux qui ne
pensent pas comme eux sont des insensés, ils me tiennent pour
tel et je les en remercie, [184]car le jour où on voudrait bien voir en
moi un homme raisonnable, malheur à moi! on ne tarderait pas
à me priver de la petite liberté que j’ai
achetée au prix de ma réputation. Le gobernadorcillo
passe auprès d’eux pour un sage parce que, n’ayant
rien appris qu’à servir le chocolat et à souffrir
les mauvaises humeurs du P. Dámaso, il est maintenant riche, a
le droit de troubler la petite vie de ses concitoyens et parfois va
jusqu’à parler de justice. «Voilà un homme de
talent, pense le vulgaire; voyez, de rien il s’est fait
grand!» Pour moi, la fortune et la considération ont
été mon héritage, j’ai fait des
études; mais maintenant je suis pauvre, on ne m’a pas
confié le plus ridicule des emplois, et tout le monde de dire:
«C’est un fou; il n’entend rien à la
vie!» Le curé m’a donné le surnom de
philosophe et laisse entendre que je suis un charlatan faisant
étalage de ce qu’il a appris sur les bancs des
universités, quand précisément c’est
là ce qui me sert le moins. Peut-être ont-ils raison,
peut-être suis-je véritablement le fou, eux sont-ils les
sages? Qui pourrait le dire?
Et le vieillard secoua la tête comme pour éloigner une
pensée importune, puis il continua:
—La seconde chose que je puisse vous conseiller est de
consulter le curé, le gobernadorcillo, toutes les personnes qui
ont une position; ils vous donneront des conseils mauvais,
inintelligents, inutiles, mais consulter ne signifie pas obéir;
il suffit que vous ayez l’air de les suivre et que vous fassiez
constater que vous travaillez selon leurs indications.
Ibarra réfléchit un instant, puis répondit:
—Le conseil est bon mais difficile à suivre. Ne
pourrais-je apporter d’abord mon idée, sans que sur elle
se reflète une ombre? Le bon ne peut-il se faire un passage
à travers tout? La vérité a-t-elle besoin
d’emprunter des vêtements à l’erreur?
—Personne n’aime la vérité toute nue!
répliqua le vieillard. C’est bon en théorie, facile
dans le monde idéal que rêve la jeunesse. Voyez, le
maître d’école [185]s’est en vain agité dans le
vide; cœur d’enfant qui veut le bien et ne recueille que le
sarcasme et les éclats de rire. Vous me dites que vous
êtes étranger au pays; je le crois. Dès le premier
jour de votre arrivée, vous avez commencé par blesser
l’amour-propre d’un prêtre qui, parmi le peuple,
passe pour un saint, et parmi les siens pour un savant. Dieu veuille
que ce petit fait n’ait pas décidé de votre avenir!
Ne croyez pas que, parce que les dominicains et les augustins regardent
avec mépris l’habit de guingon1, le cordon et
l’indécente sandale, parce qu’un grand docteur de
Saint-Thomas a un jour rappelé que le pape Innocent III avait
qualifié les statuts de cet ordre de plus convenables pour des
porcs que pour des hommes, tous ne se donnent pas la main pour affirmer
ce que disait un procureur: «Le frère-lai le plus
insignifiant a plus de pouvoir que le gouvernement avec tous ses
soldats». Cave ne cadas2. L’or est très puissant. Le veau
d’or a plusieurs fois chassé Dieu de ses autels depuis le
temps de Moïse.
—Je ne suis pas aussi pessimiste et la vie dans mon pays ne me
semble pas présenter autant de périls, répondit
Ibarra en souriant. Je crois ces craintes un peu
exagérées et espère pouvoir réaliser tous
mes projets sans rencontrer de grande résistance de ce
côté.
—Oui, s’ils vous tendent la main; non, s’ils vous
la refusent. Tous vos efforts se briseront contre les murs du
presbytère sans que le moine s’en inquiète, sans
faire remuer son cordon ni secouer son habit; l’alcalde sous un
prétexte quelconque vous déniera demain ce qu’il
vous a concédé aujourd’hui; aucune mère ne
laissera son fils fréquenter votre école et le
résultat de tous vos efforts sera uniquement négatif;
vous n’aurez réussi qu’à décourager
ceux qui par la suite auraient voulu à leur tour se consacrer
à de généreuses entreprises. [186]
—Malgré tout, reprit le jeune homme, je ne puis croire
à ce pouvoir; et encore, en le supposant, en l’admettant
aussi considérable que vous le dites, j’aurai toujours de
mon côté le peuple intelligent, le gouvernement qui est
animé des meilleures intentions, qui regarde de haut et veut
franchement le bien des Philippines.
—Le gouvernement! le gouvernement! murmura le philosophe en
levant les yeux vers le plafond. Pour grand que soit son désir
d’élever le pays pour son bien propre et celui de la
Mère-Patrie, pour généreux qu’ait
été l’esprit des rois catholiques dont se
souviennent encore dans leurs méditations quelques
fonctionnaires, le gouvernement ne voit, n’écoute, ne juge
rien de plus que ce que le curé ou le provincial lui donne
à voir, à entendre ou à juger; il est convaincu
qu’il ne repose qu’en eux, que s’il se soutient,
c’est parce qu’ils le soutiennent, que s’il vit,
c’est parce qu’ils consentent à le laisser vivre et
que le jour où ils lui manqueraient, il tomberait comme un
mannequin qui a perdu son point d’appui. On effraye le
gouvernement avec la menace de soulever le peuple, le peuple en lui
montrant les forces du gouvernement; et tous deux font comme les
peureux qui prennent leurs ombres pour des fantômes et leurs voix
pour des échos. Tant que le gouvernement ne s’entendra pas
avec le pays, il ne se délivrera pas de cette tutelle; il vivra
comme ces jeunes imbéciles qui tremblent à la voix de
leur précepteur dont ils mendient la condescendance. Le
gouvernement ne songe à aucun avenir robuste, c’est un
bras, la tête est le couvent; par cette inertie il se laisse
traîner d’abîme en abîme, son existence propre
n’est plus qu’une ombre, elle disparaît, et
débile, incapable, il confie tout à des mains
mercenaires. Comparez donc notre système gouvernemental avec
ceux des pays que vous avez visités...
—Oh! interrompit Ibarra, c’est beaucoup dire;
contentons-nous de voir que notre peuple ne se plaint pas, [187]ne souffre pas
comme celui d’autres pays, et cela, grâce à la
religion et à la mansuétude de nos gouvernants.
—Le peuple ne se plaint pas parce qu’il n’a pas de
voix, il ne se meut pas parce qu’il est en léthargie, et
si vous dites qu’il ne souffre pas, c’est que vous
n’avez pas vu le sang de son cœur. Mais un jour vous le
verrez et vous l’entendrez; alors malheur à ceux qui
basent leur force sur l’ignorance et sur le fanatisme, malheur
à ceux qui ne règnent que par le mensonge et travaillent
dans la nuit, croyant que tous sommeillent! Quand la lumière du
soleil éclairera le néant de toutes ces ombres, il se
produira une réaction épouvantable: tant de forces
comprimées pendant des siècles, tant de venin
distillé goutte à goutte, tant de soupirs
étouffés, se feront jour et éclateront... Qui donc
alors les paiera ces comptes que, de temps en temps, présentent
les peuples et que nous conserve l’histoire en ses pages
ensanglantées?
—Dieu, le gouvernement et la religion ne permettront pas que
ce jour arrive jamais! répondit Ibarra, impressionné
malgré lui. Les Philippines sont religieuses et aiment
l’Espagne, les Philippines sauront ce que la nation espagnole a
fait pour elles. Il y a des abus, oui; il y a des défauts, je ne
les nie pas; mais l’Espagne travaille pour préparer des
réformes qui les corrigent, elle mûrit des projets, elle
n’est pas égoïste.
—Je le sais, et c’est là le pire. Les
réformes qui viennent d’en haut s’annulent dans les
sphères inférieures grâce aux vices de tous, au
désir avide des fonctionnaires de s’enrichir en peu de
temps et à l’ignorance du peuple qui consent à
tout. Les abus, ce n’est pas un décret royal qui peut les
corriger, lorsqu’une autorité jalouse ne veille pas
à leur exécution, lorsque la liberté de la parole
qui permettrait de dénoncer les excès de pouvoir des
petits tyrans n’existe pas; les projets restent des projets, les
abus des abus, et cependant le ministre, satisfait de son œuvre,
s’endort tranquille et content de lui. Bien plus, si par hasard
[188]un
personnage venant occuper un haut poste veut faire montre
d’idées grandes et généreuses,
immédiatement il s’entend dire—tandis que par
derrière on le traite de fou: Votre Excellence ne connaît
pas le pays, Votre Excellence ne connaît pas le caractère
des Indiens, Votre Excellence va les perdre, Votre Excellence fera bien
de se confier à Machin et à Chose, etc., etc. Et comme
effectivement Son Excellence ne connaît pas le pays que
jusqu’alors elle avait cru en Amérique, que de plus elle
a, comme tout homme, ses défauts et ses faiblesses, elle se
laisse convaincre. Son Excellence se souvient aussi que, pour obtenir
son poste, il lui a fallu peiner beaucoup et souffrir plus encore, que
ce poste elle le détient uniquement pour trois ans,
qu’elle se fait vieille et qu’il lui faut abandonner les
quichotteries pour ne penser qu’à son avenir; un petit
hôtel à Madrid, une petite maison de campagne et une bonne
pension pour faire figure à la cour, voilà ce
qu’elle est venue chercher aux Philippines. Ne demandons pas de
miracles, ne demandons pas que celui qui vient ici comme
étranger pour faire sa fortune et s’en aller ensuite,
s’intéresse au bien du pays. Que lui importent la
reconnaissance ou les malédictions d’un peuple qu’il
ne connaît pas, qui ne lui rappelle rien, où il n’a
ni espérances ni amours? Pour que la gloire nous soit
agréable, il faut que son bruit résonne aux oreilles de
ceux que nous aimons, dans l’atmosphère de notre foyer ou
de la patrie qui doit conserver nos cendres; nous voulons que cette
gloire s’asseye sur notre sépulcre pour réchauffer
de ses rayons le froid de la mort, pour que nous ne soyons pas
complètement réduits au néant, pour qu’il
reste quelque chose de nous. Celui qui vient ici pour diriger nos
destinées ne peut rien se promettre de tout cela et, pour
comble, il quitte le pays au moment où il commence à
connaître son devoir. Mais nous nous éloignons de la
question.
—Non pas, avant d’y revenir il est nécessaire
d’éclaircir certaines choses, interrompit vivement le
jeune [189]homme. Je puis admettre que le gouvernement ne
connaisse pas le peuple, mais je crois que le peuple connaît
encore moins le gouvernement. Il y a des fonctionnaires inutiles,
mauvais, si vous voulez, mais il y en a aussi de bons; si
ceux-là ne peuvent rien faire c’est parce qu’ils se
trouvent en présence d’une masse inerte, d’une
population qui ne s’intéresse que très peu à
ses affaires. Mais, je ne suis pas venu pour discuter avec vous sur ce
point; je venais vous demander un conseil et vous me dites de commencer
par courber la tête devant de grotesques idoles...
—Oui, je le répète: ici, il faut baisser la
tête ou la laisser tomber.
—Ou baisser la tête ou la laisser tomber?
répéta Ibarra pensif. Le dilemme est dur! Mais pourquoi?
Est-il donc impossible de concilier l’amour de mon pays et
l’amour de l’Espagne? est-il nécessaire de
s’abaisser pour être bon chrétien, de prostituer sa
conscience pour mener à bonne fin un projet utile? J’aime
ma patrie, les Philippines, parce que je leur dois la vie et mon
bonheur, parce que tout homme doit aimer sa patrie; j’aime
l’Espagne, la patrie de mes aïeux, parce que malgré
tout les Philippines lui doivent et lui devront leur bonheur et leur
avenir; je suis catholique, je conserve pure la foi de mes
pères, mais je ne vois pas pourquoi je devrais baisser la
tête quand je puis la lever et me livrer à mes ennemis
quand je puis les abattre.
—Parce que le champ où vous voulez semer est au pouvoir
de vos ennemis et que, contre eux, vous n’avez pas de force... Il
vous faut d’abord baiser cette main qui...
Mais le jeune homme ne le laissa pas achever et,
révolté, il s’écria:
—Baiser leur main! vous oubliez donc que parmi eux sont ceux
qui ont tué mon père, qui l’ont arraché de
son sépulcre... mais moi, son fils, je ne l’oublie pas et,
si je ne le venge pas, c’est que je veux respecter le prestige de
la Religion! [190]
Le vieux philosophe baissa la tête.
—Señor Ibarra, répondit-il lentement, si vous
conservez ces souvenirs, souvenirs dont je ne puis vous conseiller
l’oubli, abandonnez l’entreprise que vous commencez et
cherchez un autre moyen de travailler au bonheur de vos compatriotes.
Une telle œuvre demande un autre homme parce que, pour porter la
tête haute, il ne suffit pas d’avoir de l’argent et
de la volonté; dans notre pays il faut encore de
l’abnégation, de la ténacité et de la foi;
le terrain n’y est pas préparé: on n’y a
encore semé que de l’ivraie.
Ibarra comprit la valeur de ces paroles, mais il ne devait pas se
décourager; le souvenir de Maria Clara était dans son
cœur; il lui fallait réaliser son offrande.
—Votre expérience ne vous suggère-t-elle que ce
dur moyen? demanda-t-il à voix basse.
Le vieux Tasio lui prit le bras et le conduisit à la
fenêtre. Une fraîche brise soufflait,
avant-courrière du vent du Nord; devant eux
s’étendait le jardin, limité par le grand bois qui
servait de parc.
—Pourquoi devons-nous faire ce que fait cette tige
débile, chargée de boutons et de fleurs? dit le
philosophe, en montrant au jeune homme un superbe rosier. Le vent
souffle, il le secoue et lui s’incline, comme pour cacher sa
précieuse charge. Si la tige se maintenait rigide, elle se
romprait, le vent disperserait les fleurs et les boutons mourraient
avant d’éclore. Le coup de vent passé, la tige se
redresse orgueilleuse, portant son trésor. Qui l’accusera
pour avoir plié devant la nécessité? Voyez
là-bas ce gigantesque kupang3 qui balance majestueusement son
feuillage aérien où l’aigle fait son nid. Je
l’apportai du bois alors qu’il n’était encore
qu’une plante débile; avec des roseaux
dépouillés, je soutins sa tige pendant plusieurs mois. Si
je l’avais apporté grand, fort et plein de vie, il est
certain qu’il n’aurait pas vécu; le vent
l’aurait secoué avant que ses racines [191]eussent pu se
fixer dans le terrain, avant que celui-ci se fût affermi autour
de lui et ne lui eût assuré la subsistance
nécessaire à sa grandeur et à sa stature. Ainsi
finirez-vous, plante nouvellement transplantée d’Europe
dans ce sol pierreux, si vous ne cherchez un appui et ne consentez pas
à vous diminuer. Vous êtes dans de mauvaises conditions,
seul, élevé; le terrain tremble, le ciel annonce la
tempête et la coupe des arbres de votre famille a prouvé
qu’elle attire l’éclair. Combattre seul contre tout
ce qui existe, ce n’est pas du courage, c’est de la
témérité; personne ne blâme le pilote qui se
réfugie dans un port à la première rafale de la
tourmente. Se baisser quand siffle une balle n’est pas de la
couardise; ce qui est mauvais, c’est de la défier pour
tomber et ne plus se relever.
—Et ce sacrifice produirait-il les fruits que
j’espère? répondit Ibarra. Croirait-on en moi? Le
prêtre oublierait-il son offense? M’aiderait-on franchement
à répandre l’instruction qui dispute aux couvents
les richesses du pays? Ne peuvent-ils feindre l’amitié,
simuler la protection, et en dessous, dans l’ombre, combattre mon
projet, le ruiner, le blesser au talon pour le faire tomber plus
promptement encore qu’en l’attaquant de front? Etant
donnés les précédents que vous supposez, on peut
tout attendre!
Le vieillard resta silencieux, réfléchit quelque
temps, puis enfin répondit:
—Si cela arrive, si l’entreprise s’écroule,
vous vous consolerez en pensant que vous aurez fait tout ce qui
dépendait de vous; de plus, votre tentative n’aura
toujours pas été vaine; quelque chose aura
été gagné: vous aurez posé la
première pierre, lancé la première semence. Et
puis, si la tempête se déchaîne, il se peut que
quelque grain germe quand même, survive à la catastrophe,
sauve l’espèce de la destruction et serve ensuite de
semence aux fils du premier semeur mort à la tâche.
L’exemple donné peut en enhardir d’autres qui ne
craignent que de commencer. [192]
Ibarra pesa un instant toutes ces raisons, examina sa situation et
comprit qu’avec tout son pessimisme le vieillard avait
raison.
—Je vous crois! s’écria-t-il en lui serrant la
main. Ce n’était pas en vain que j’étais venu
chercher un bon conseil. Aujourd’hui même j’irai
m’en ouvrir au curé qui, après tout, peut
être un brave homme car tous ne sont pas comme le
persécuteur de mon père. Je dois de plus
l’intéresser en faveur de cette malheureuse folle et de
ses fils: je me confie à Dieu et aux hommes.
Il prit congé du vieillard et, montant à cheval,
partit, suivi du regard par le pessimiste philosophe qui murmurait:
—Attention! observons bien comment le destin va conduire le
drame commencé dans le cimetière.
Cette fois, le sage Tasio se trompait: le drame avait
commencé bien longtemps auparavant.
[Table des matières]
XXVI
La veille de la fête
Nous sommes le dix novembre, la veille de la fête.
Sortant de la monotonie habituelle de son existence, le pueblo se
livre à une activité incroyable; dans les maisons, dans
la rue, dans l’église, dans la gallera, aux champs,
c’est partout un mouvement inaccoutumé; les fenêtres
se pavoisent de drapeaux, de tapis de diverses couleurs; l’espace
retentit du bruit des détonations et du son de la musique;
l’air s’imprègne, se sature de
réjouissances.
Sur une petite table que recouvre une blanche nappe bordée,
la dalaga dispose diverses sortes de confitures de fruits du
pays dans des compotiers de cristal aux teintes joyeuses; dans le
patio, piaillent les poussins, caquètent les poules, grognent
les porcs épouvantés de [193]la gaieté des hommes. Les
domestiques montent et descendent portant des vaisselles dorées,
des couverts d’argent; ici on gronde pour un plat brisé,
là on se moque de la simplicité d’une paysanne;
partout on commande, on chuchote, on crie, on commente, on conjecture,
on s’anime; tout est confusion, bruit, ébullition. Et
toute cette ardeur, toute cette fatigue se dépensent pour
l’hôte connu ou inconnu; pour accueillir quelqu’un
que peut-être on n’a jamais vu, que probablement on ne
reverra jamais; l’étranger, l’ami, l’ennemi,
le philippin, l’espagnol, le pauvre, le riche semblent
également heureux, satisfaits; on ne leur demande aucune
gratitude, on n’attend même pas d’eux qu’ils ne
cherchent pas à nuire à la famille hospitalière
pendant ou après la digestion! Les riches, ceux qui sont
allés quelquefois à Manille, qui sont un peu plus
instruits que les autres, ont acheté de la bière, du
champagne, des liqueurs, des vins et des comestibles d’Europe,
à peine de quoi manger une bouchée ou boire un coup, mais
leur table est plus élégamment apprêtée.
Au milieu se dresse un grand piña artificiel, très
bien imité, dans lequel sont enfoncés des cure-dents de
bois artistiquement découpés par les forçats dans
leurs heures de loisir. En voici un qui représente un
éventail, cet autre un bouquet de fleurs, celui-ci un oiseau,
celui-là une rose, d’autres des palmes, des chaînes,
le tout taillé dans un seul morceau de bois: l’artiste est
un galérien, l’instrument un mauvais couteau,
l’inspiration la voix rauque du garde-chiourme. A
côté de ce piña que l’on appelle
palillera1
des coupes de cristal supportent des pyramides de fruits, oranges,
lanzones, ates, chicos, même mangas2, bien que l’on soit en
novembre. Puis, dans de larges plateaux, sur des papiers brodés
et peints des plus riches couleurs, des jambons d’Europe, [194]de Chine,
un pâté représentant l’Agnus Dei ou la
colombe de l’Esprit-Saint, des dindons farcis, etc. Enfin,
dispersées sur la table les appétissantes bouteilles
d’acharas3 recouvertes de capricieux dessins, faits de fleurs de
bonga, de légumes et de fruits artistiquement coupés et
collés avec de la confiture sur les parois des carafons.
On nettoie les globes de verre qui se transmettent de père en
fils, on fait briller les cercles de cuivre, on débarrasse les
lampes à pétrole des enveloppes rouges qui, pendant
l’année, les protègent contre les mouches et les
moustiques et les rendent inutiles; les prismes taillés et les
pendeloques de cristal se balancent, se choquent harmonieusement; on
dirait qu’ils chantent, qu’ils prennent part à la
fête par eux égayée de toutes les couleurs de
l’arc-en-ciel reflétées sur les murs blancs. Les
enfants jouent, courent, poursuivent les reflets tremblants des
couleurs, brisent la verrerie; ce qui en tout autre moment leur
coûterait des larmes ne sert qu’à accroître la
gaieté générale.
Ces lampes vénérées ne sont pas seules à
voir enfin la lumière du jour; on sort aussi de leur cachette
les petits travaux de la jeunesse: des voiles faits au crochet, de
petits tapis, des fleurs artificielles; on montre encore les petits
plateaux de cristal dont le fond représente un lac en miniature
avec ses minuscules poissons, ses caïmans, ses coquillages, ses
herbes aquatiques, ses coraux et ses rochers en verre de diverses
couleurs; dans ces plateaux vous trouverez des cigares, des cigarettes
et de mignons buyos, tordus par les doigts délicats des
jeunes filles. Le sol de la maison brille comme un miroir; des rideaux
de piña ou de jusi4, ornent les portes; aux fenêtres pendent
des lanternes de cristal ou de papier rose, bleu, vert ou rouge; la
[195]maison se remplit de fleurs et de vases,
placés sur des piédestaux de faïence de Chine; les
saints eux-mêmes s’embellissent, les images et les reliques
se mettent en fête, on les époussète, on nettoie
leurs vitres, des bouquets de fleurs pendent de leurs cadres.
Dans les rues, de distance en distance,
s’élèvent de capricieux arcs de roseaux,
travaillés de mille façons, que l’on appelle
sinkában; ils sont entourés de
kaluskús5 dont la seule vue réjouit le cœur des
gamins. Autour du parvis est la grande et coûteuse tenture,
soutenue par des troncs de bambous, sous laquelle doit passer la
procession. Là, les enfants courent, dansent, sautent et
déchirent les chemises neuves qui devaient briller le jour de la
fête.
Sur la place est élevé le plancher du
théâtre, scène de roseaux, de nipa et de bois; on y
dit merveille de la troupe de comédie de Tondo; elle luttera
avec les dieux de miracles invraisemblables; Marianito, Chananay,
Balbino, Ratia, Carvajal, Yeyeng, Liceria, etc., chanteront et
danseront. Le philippin aime le théâtre, il se passionne
pour les représentations dramatiques; il écoute en
silence le chant, admire la danse et la mimique, ne siffle jamais mais
n’applaudit pas plus. Le spectacle ne lui plaît-il pas? Il
mâche son buyo et s’en va sans troubler les autres qui
peuvent y trouver du plaisir. Parfois seulement, quand les acteurs
embrassent les actrices, le bas peuple hurle, mais rien de plus.
Autrefois, on ne représentait que des drames; le poète du
pueblo composait une pièce où nécessairement des
combats devaient se livrer toutes les deux minutes,
entremêlés des reparties d’un personnage comique et
de terrifiantes métamorphoses. Mais, depuis que les artistes de
Tondo se sont mis à batailler toutes les quinze secondes,
qu’ils ont eu deux comiques et ont encore reculé les
limites de l’invraisemblable, ils ont tué leurs
collègues provinciaux. Le gobernadorcillo était grand
amateur [196]de cette troupe et, d’accord avec le
curé, il avait choisi la comédie: Le prince Villardo
ou les clous arrachés de la cave infâme, pièce
avec magie et feux d’artifices.
De moment en moment retentissent joyeusement les cloches, ces
mêmes cloches qui si tristement tintaient il y a quelques jours.
Des roues de feu et des boîtes à pétards tonnent
dans l’air; le pyrotechnicien indigène, qui apprend son
art sans maître connu, va déployer son habileté: il
prépare des taureaux, des châteaux de feu avec feux de
Bengale, des ballons de papier gonflés par l’air chaud,
des roues étincelantes, des bombes, des fusées, etc.
Des accords lointains résonnent; tous les bambins du pueblo
courent aux environs pour recevoir les bandes de musiciens et leur
faire escorte. La musique de Pagsanghan, propriété du
notaire, ne doit pas manquer non plus que celle du pueblo de S. P. de
T., célèbre alors par son chef d’orchestre, le
maestro Austria, le vagabond cabo Mariano, qui, dit-on, porte la
renommée et l’harmonie à la pointe de son
bâton. Les dilettanti font l’éloge de sa marche
funèbre, El Sauce (le Saule), et déplorent
qu’il n’ait pu recevoir une véritable
éducation musicale, car son génie aurait
été la gloire de son pays.
La fanfare entre dans le pueblo en jouant des marches enlevantes;
elle est suivie de gamins loqueteux ou à moitié nus:
l’un a la chemise de son frère, l’autre le pantalon
de son père. Dès qu’un morceau a cessé, ils
le savent de mémoire, le fredonnent, le sifflent avec une rare
justesse et déjà donnent leur appréciation.
Pendant ce temps, en charrettes, en calèches, en voitures de
toutes sortes, arrivent les parents, les amis, les inconnus, les
joueurs décidés au besoin à violenter la chance,
amenant leurs meilleurs coqs, munis de sacs d’or, disposés
à risquer leur fortune sur le tapis vert ou dans
l’enceinte de la gallera.
—L’alférez a cinquante pesos chaque soir!
murmurait un homme petit et rondelet à l’oreille des
nouveaux arrivés. Capitan Tiago va venir et tiendra la banque,
Capitan Joaquin apporte dix-huit mille. Il y aura liam-pô:
[197]le
Chinois Carlo le fait avec un capital de dix mille. De gros joueurs
viennent de Tanauan, de Lipa et de Batangas comme aussi de Santa Cruz.
On va faire grand! on va faire grand! Mais prenez-vous le chocolat?...
Cette année Capitan Tiago ne nous plumera pas comme la
dernière fois: je n’ai dépensé que trois
messes d’actions de grâce et j’ai un
mutyâ6 de cacao. Et comment va la famille?
—Très bien, très bien! merci! répondaient
les étrangers; et le P. Dámaso?
—Le P. Dámaso prêchera le matin et sera au jeu le
soir avec nous.
—Tant mieux! il est hors de danger maintenant?
—Nous en sommes sûrs! De plus, c’est le Chinois
qui lâche...
Et le petit homme remua ses doigts comme s’il comptait de la
monnaie.
Hors du pueblo, les gens de la montagne, les kasamá,
mettent leurs plus beaux habits pour porter chez les riches du pays des
poules bien engraissées, des jambons, du gibier, des oiseaux;
les uns chargent sur de pesants chariots du bois, des fruits, des
plantes, les plus rares qui croissent dans le bois; d’autres
portent des bigâ7 à larges feuilles, des tikas-tikas8 avec des fleurs
couleur de feu pour orner les portes de leur maison.
Mais là où régnait la plus grande animation,
où déjà se limitait le tumulte,
c’était sur une sorte de plate-forme, à quelques
pas de la maison d’Ibarra. Des poulies grinçaient, des
cris retentissaient, on entendait le bruit métallique de la
pierre que l’on taille, du marteau qui enfonce un clou, de la
hache qui coupe les solives. Une foule d’ouvriers creusaient la
terre et ouvraient un long et profond fossé; d’autres
plaçaient en file des [198]pierres tirées des carrières du
pueblo, déchargeaient des chariots, empilaient du sable,
disposaient des tours et des cabestans...
—Ici! c’est cela! vivement! criait un petit vieillard
à physionomie animée et intelligente, tenant à la
main un mètre à bouts de cuivre, auquel était
enroulée la corde d’un fil à plomb.
C’était le contre-maître, le señor Juan,
architecte, maçon, charpentier, plafonneur, serrurier, peintre,
tailleur de pierre et, à l’occasion, sculpteur.
—Il faut finir aujourd’hui même! Demain on ne peut
travailler et après-demain c’est la
cérémonie! Allons, vivement!
—Faites le trou de façon qu’il s’adapte
exactement à ce cylindre! disait-il à l’un des
tailleurs de pierre qui polissaient un énorme bloc
quadrangulaire; c’est à l’intérieur que
l’on conservera nos noms.
A chaque étranger qui s’approchait, il
répétait ce qu’il avait déjà dit
mille fois:
—Savez-vous ce que nous allons construire? Eh bien!
c’est une école, un modèle d’école,
comme celles des Allemands, plus parfaite encore. Le plan a
été tracé par l’architecte, le señor
R. et moi, je dirige le travail! Oui, señor, voyez, ce sera un
palais à deux ailes, une pour les garçons, l’autre
pour les filles. Ici, au milieu, un grand jardin avec trois bassins;
là, sur les côtés, des allées, de petits
jardins où, pendant les récréations, les enfants
sèmeront et cultiveront des plantes, mettant ainsi le temps
à profit. Voyez comme les fondations sont profondes. Trois
mètres soixante-quinze centimètres!
L’édifice aura des caves, des souterrains, des cachots
pour les punis que l’on placera tout près des jeux et du
gymnase afin qu’ils entendent les amusements des bons
élèves. Voyez ce grand espace; ce sera l’esplanade
où ils pourront courir et sauter à l’air libre. Les
petites filles auront un jardin avec des bancs, des balançoires,
des allées pour le jeu de la comba9, des bassins, des volières,
etc. Ce sera magnifique! [199]
Et le señor Juan se frottait les mains en pensant à la
renommée qu’il allait acquérir. Les
étrangers viendraient pour voir la nouvelle école et
demanderaient:—Quel est le grand architecte qui a construit cet
édifice? Et tout le monde répondrait:—Ne le
savez-vous pas? Il est impossible que vous ne connaissiez pas le
señor Juan? Probablement vous devez venir de très
loin!
Bercé par ces pensées, il allait d’un bout
à l’autre, inspectant tout, passant tout en revue.
—C’est trop de bois pour une chèvre! disait-il
à un homme jaune qui dirigeait quelques travailleurs:
j’aurai assez de ces trois grands morceaux qui forment
trépied et de ces trois autres qui les réunissent.
—Abá! répondit l’homme jaune, avec un
sourire particulier; plus nous ornerons le travail, plus l’effet
produit sera grand. L’ensemble aura plus d’aspect, plus
d’importance et l’on dira: comme ils ont travaillé!
Vous verrez, vous verrez quelle chèvre je vais élever!
puis je l’ornerai de banderoles, de guirlandes de fleurs et de
feuilles... vous direz ensuite que vous avez eu raison de me prendre
parmi vos travailleurs et le señor Ibarra ne pourra rien
désirer de plus!
L’homme souriait, le señor Juan riait aussi et hochait
la tête.
A quelque distance, on voyait deux kiosques réunis entre eux
par une sorte de treillage couvert de feuilles de platane.
Une trentaine d’enfants, avec le maître
d’école, tressaient des couronnes, attachaient des
drapeaux à des piliers de roseaux secs, couverts de toile
blanche bouillonnée.
—Tâchez que les lettres soient bien écrites!
disait l’instituteur à ceux qui dessinaient les
inscriptions. L’alcalde va venir, beaucoup de curés seront
là et peut-être aussi aurons-nous le capitaine
général qui est dans la province. S’ils voient que
vous dessinez bien ils vous décerneront des éloges.
—Et l’on nous donnera un tableau noir...? [200]
—Qui sait! le señor Ibarra en a demandé un
à Manille. Demain arriveront divers objets que l’on
répartira entre vous comme prix... Mais, laissez ces fleurs dans
l’eau; demain nous ferons les bouquets, vous apporterez
d’autres fleurs, car il faut que la table en soit couverte; les
fleurs réjouissent la vue.
—Mon père apportera demain des fleurs de
bainô10 et ma mère un panier de jasmins.
—Le mien a apporté trois charrettes de sable et
n’a pas voulu recevoir de paiement.
—Mon oncle a promis de payer un maître! ajouta le neveu
du Capitan Basilio.
En effet, le projet avait trouvé de l’écho
presque chez tous. Le curé avait demandé à le
patronner et à bénir lui-même la première
pierre, cérémonie qui aurait lieu le dernier jour de la
fête et en serait une des principales solennités. Le
vicaire lui-même s’était approché timidement
d’Ibarra et lui avait offert toutes les messes que lui paieraient
les dévots jusqu’à l’achèvement de
l’édifice. Bien plus, la sœur Rufa, cette femme si
riche et si économe, disait que, au cas où l’argent
manquerait, elle parcourrait quelques pueblos pour demander
l’aumône à la seule condition qu’on lui
payât le voyage, la nourriture, etc. Ibarra l’avait
remerciée et lui avait répondu:
—Nous ne recueillerions pas grand’chose, d’abord
parce que je suis riche et ensuite parce qu’il ne s’agit
pas d’une église; et puis, je n’ai pas promis de
bâtir une école aux frais des autres.
Les jeunes gens, les étudiants qui venaient de Manille pour
prendre part à la fête, admiraient Ibarra et
s’efforçaient de le prendre pour modèle; mais,
comme presque toujours, quand nous voulons imiter un homme qui
dépasse la moyenne, nous singeons ses petits côtés
quand nous ne nous approprions pas ses défauts, beaucoup de ces
admirateurs s’en tenaient à la manière [201]dont Ibarra
faisait le nœud de sa cravate, d’autres à la forme
du col de sa chemise, presque tous au nombre des boutons de sa veste et
de son gilet.
Les pressentiments funestes du vieux Tasio semblaient
s’être dissipés pour toujours. Ibarra lui en avait
fait un jour la remarque, mais le vieux pessimiste lui avait
répondu:
—Rappelez-vous ce que dit notre poète Baltasar:
«’Kung ang isalúbong sa iyong
pagdating
Ay masayang mukhà’t may pakitang
giliu,
Lalong pag ingata’t kaauay na lihim11...
Baltasar était aussi bon penseur que bon poète.
Tout ceci se passait la veille de la fête, avant le coucher du
soleil.
[Table des matières]
XXVII
A la brume
De grands préparatifs se faisaient aussi chez Capitan Tiago.
Nous connaissons le maître de la maison; son affection pour le
faste et son orgueil de citadin de Manille devaient humilier les
provinciaux à force de splendeur. Une autre raison encore
l’obligeait à éclipser tous les autres: sa fille
Maria Clara était la fiancée de l’homme dont le nom
était dans toutes les bouches.
En effet, un des journaux les plus sérieux de Manille avait
déjà dédié à Ibarra un article de
première page intitulé: Imitez-le! qui le comblait
d’éloges et lui donnait quelques conseils. On
l’appelait le jeune et riche capitaliste déjà
illustre; deux lignes plus bas, le distingué [202]philanthrope;
au paragraphe suivant, l’élève de Minerve qui
est allé dans la Mère Patrie pour saluer le sol choisi
entre tous des arts et des sciences; un peu plus bas encore,
l’espagnol philippin, etc., etc. Capitan Tiago
brûlait d’une généreuse émulation et
se demandait s’il ne devrait pas, lui, élever à ses
frais un couvent.
Quelques jours auparavant une multitude de caisses étaient
arrivées à la maison où habitaient
déjà Maria Clara et la tante Isabel.
C’étaient des comestibles et des fruits d’Europe, de
colossaux miroirs, des tableaux et le piano de la jeune fille.
Capitan Tiago vint le jour même de la fête; quand sa
fille lui eut embrassé la main, il lui fit cadeau d’un
beau reliquaire d’or garni de brillants et
d’émeraudes, contenant une esquille de la barque de saint
Pierre où Notre Seigneur s’était assis pendant la
pêche.
Il fit à son futur gendre l’accueil le plus cordial;
naturellement on parla de l’école. Capitan Tiago voulait
qu’on l’appelât école de Saint
François.
—Croyez-moi, disait-il, saint François est un bon
patron! Si vous l’appelez école d’instruction
primaire vous ne gagnerez rien. Qu’est-ce que l’instruction
primaire?
Entrèrent quelques amies de Maria Clara venues pour
l’inviter à la promenade.
—Va, mais reviens vite, dit Capitan Tiago à sa fille;
tu sais que le P. Dámaso, qui vient d’arriver, dîne
avec nous ce soir.
Et, se retournant vers Ibarra qui était devenu pensif, il
ajouta:
—Vous aussi, vous dînez avec nous; vous seriez tout seul
chez vous.
—Je le ferais avec beaucoup de plaisir, balbutia le jeune
homme, en esquivant le regard de Maria Clara, mais je dois rester chez
moi car il peut survenir des visites.
Capitan Tiago lui répondit assez froidement: [203]
—Amenez vos amis; il y a toujours place à ma table...
Je voudrais que le P. Dámaso et vous, vous vous
entendissiez.
—Nous avons encore le temps! répondit Ibarra en
souriant d’un sourire forcé, et il se disposa à
accompagner les jeunes filles.
Tous et toutes descendirent l’escalier.
Maria Clara était au milieu entre Victoria et Iday; la tante
Isabel suivait.
Tout le monde s’écartait respectueusement pour leur
ouvrir le chemin. Maria Clara était surprenante de
beauté; sa pâleur avait disparu et, si ses yeux restaient
rêveurs, sa bouche paraissait ne connaître que le sourire.
Avec l’amabilité particulière aux jeunes filles
heureuses, elle saluait les personnes qu’elle avait connues
étant enfant et qui, aujourd’hui, admiraient sa jeunesse
et son bonheur. En moins de quinze jours, elle avait retrouvé
cette franche confiance, ce gracieux babil qui semblaient
s’être endormis d’un sommeil léthargique entre
les murs étroits du couvent; on aurait dit que le papillon,
brisant le cocon dans lequel il était enfermé,
reconnaissait toutes les fleurs; il lui suffisait de voler un instant
et de s’échauffer aux rayons dorés du soleil pour
perdre aussitôt la rigidité de la chrysalide. Une vie
nouvelle se reflétait dans tout l’être de la jeune
fille, tout lui semblait beau, tout lui paraissait bon; elle
manifestait son amour avec cette grâce virginale qui ne vient que
des pensées pures et ne connaît pas le pourquoi des
fausses rougeurs. Cependant, quand on lui disait quelque aimable
plaisanterie, elle se couvrait le visage de son éventail, tandis
que ses yeux souriaient et qu’une légère
émotion parcourait tout son être.
Les maisons commençaient à s’illuminer et, dans
les rues que parcourait la musique, s’allumaient les lustres de
bois et de roseaux, imitant ceux de l’église.
De la rue, par les fenêtres ouvertes, on voyait les habitants
des maisons et leurs invités se mouvoir dans une
atmosphère de lumière, dans le parfum des fleurs, [204]aux accords
du piano, de la harpe ou d’un orchestre. Dehors, en costumes
d’indigènes, en habits européens, Chinois,
Espagnols, Philippins allaient, venaient, se croisaient. Domestiques
chargés de viandes et de volailles, étudiants vêtus
de blanc, hommes, femmes, se coudoyaient, se bousculaient,
s’exposant à être renversés et
écrasés par les voitures et les calèches qui,
malgré le tabî1 des cochers s’ouvraient difficilement
passage.
Devant la maison du Capitan Basilio, quelques jeunes gens
saluèrent nos amis et les invitèrent à visiter la
maison. La voix joyeuse de Sinang qui descendait les escaliers en
courant mit fin à toute excuse.
—Montez un moment pour que je puisse sortir avec vous,
disait-elle. Je m’ennuie ici avec tous ces gens que je ne connais
pas et qui ne parlent que de coqs et de cartes.
Ils montèrent.
La salle était pleine de monde. Quelques personnes
s’avancèrent pour saluer Ibarra dont le nom était
connu de tous; ils contemplaient extasiés la beauté de
Maria Clara et quelques vieilles murmuraient tout en mâchant leur
buyo: «On dirait la Vierge!»
Là, ils durent prendre le chocolat.
Depuis le jour de la partie de campagne, Capitan Basilio
s’était fait l’ami intime d’Ibarra. Il avait
su par le télégramme donné à sa fille
Sinang que le jeune homme avait été informé du
jugement rendu en sa faveur, aussi, ne voulant pas se laisser vaincre
en générosité, il avait insisté pour que la
partie d’échecs fût annulée. Ibarra n’y
avait pas consenti, Capitan Basilio avait alors proposé que le
montant des frais du procès fût employé à
payer un maître pour la future école. Aussi,
l’orateur employait-il son éloquence à engager ceux
qui étaient en procès à se désister de
leurs prétentions:
—Croyez-moi! leur disait-il; dans les procès, celui qui
gagne reste sans chemise. [205]
Nous devons à la vérité de dire qu’il eut
beau de citer les Romains, il ne convainquit personne.
Après avoir pris le chocolat, nos jeunes gens durent entendre
le piano, touché par l’organiste du pueblo.
—Quand je l’entends à l’église,
disait Sinang en montrant l’artiste, il me donne envie de danser;
maintenant qu’il joue du piano il me donne envie de prier. Aussi
je m’en vais avec vous.
—Voulez-vous venir avec nous ce soir? demanda Capitan Basilio
à l’oreille d’Ibarra lorsqu’il prit
congé; le P. Dámaso va faire une petite banque.
Ibarra sourit et répondit d’un mouvement de tête
qui équivalait à un oui comme à un non.
—Qui est-ce? demanda Maria Clara à Victoria en lui
montrant un jeune homme qui les suivait.
—C’est... c’est un de mes cousins, répondit
celle-ci, un peu troublée.
—Et l’autre?
—Ce n’est pas mon cousin, répondit vivement
Sinang, c’est un fils de ma tante.
Ils passèrent devant le presbytère qui
n’était certes pas la maison la moins animée.
Sinang ne put contenir une exclamation de surprise en voyant
brûler les lampes d’une forme très ancienne que le
P. Salvi ne faisait jamais allumer pour ne pas dépenser de
pétrole. On y entendait des cris et de sonores éclats de
rire, on voyait les moines se promener lentement, remuant la tête
en mesure, un gros cigare ornant leurs lèvres. Avec eux quelques
laïques, qu’à leur costume européen on jugeait
être des fonctionnaires, s’efforçaient de leur mieux
d’imiter les bons religieux.
Maria Clara distingua la silhouette arrondie du P. Sibyla. Immobile
sur son siège, était le mystérieux et taciturne P.
Salvi.
—Il est triste! observa Sinang, il pense à ce que vont
lui coûter tant de visites. Mais il ne dépensera rien:
vous verrez qu’il s’arrangera pour faire payer [206]tout aux
sacristains. Et puis ses invités mangent toujours ailleurs que
chez lui.
—Sinang! gronda Victoria.
—Je ne puis plus le souffrir depuis qu’il a
déchiré la Roue de la Fortune; je ne me confesse
plus à lui.
Une maison se distinguait entre toutes; elle n’était
pas illuminée, les fenêtres en étaient
fermées; c’était celle de l’alférez.
Maria Clara s’en étonna.
—La sorcière! la Muse de la garde civile, comme dit le
vieux! s’écria la terrible Sinang. En quoi peut-elle
s’intéresser à nos plaisirs? Elle ne doit pas
cesser d’être en rage! Attends que vienne le choléra
et tu verras comme je l’invite.
—Mais, Sinang! reprit encore une fois sa cousine.
—Je n’ai jamais pu la souffrir, et moins encore depuis
qu’elle a troublé notre fête avec ses gardes civils.
Si j’étais archevêque, je la marierais avec le P.
Salvi... tu verrais les beaux petits! Pourquoi voulait-elle faire
arrêter ce pauvre pilote qui s’était jeté
à l’eau pour faire plaisir...?
Elle ne put achever sa phrase; à l’angle de la place,
où un aveugle chantait, au son d’une guitare, la romance
des Poissons, un spectacle peu commun vint s’offrir à
leurs yeux.
Un homme était là, couvert d’un large salakot de
feuilles de palme, vêtu misérablement d’une
lévite en haillons et de larges caleçons à la
chinoise, déchirés en différents endroits;
à ses pieds, de misérables sandales. Grâce au
salakot, sa figure restait entièrement dans l’ombre, mais
de ces ténèbres partaient par moment deux lueurs qui
s’éteignaient à l’instant. Il était
grand, à ses allures on pouvait le croire jeune. Il posa un
panier à terre et, après s’être
éloigné en prononçant quelques sons
étranges, incompréhensibles, il resta debout,
complètement isolé, comme si la foule et lui voulaient
s’éviter mutuellement. Alors, quelques femmes
s’approchèrent du panier et y déposèrent des
fruits, du poisson, du riz. Quand personne ne vint plus, on entendit
[207]sortir de l’ombre d’autres sons
plus tristes peut-être mais moins plaintifs, remerciements cette
fois; puis il reprit son panier et s’éloigna pour
recommencer ailleurs.
Maria Clara sentit qu’elle se trouvait devant une grande
souffrance et demanda quel était cet être singulier.
—C’est le lépreux, répondit Iday. Il y a
quatre ans qu’il a contracté cette maladie: en soignant sa
mère, d’après les uns, pour avoir été
enfermé dans une prison humide, suivant les autres. Il habite
hors du pueblo, près du cimetière chinois, et ne
communique avec personne; tous le fuient par crainte de la contagion.
Si tu voyais sa cabane! C’est la cabane de Giring-giring2, le vent, la pluie,
le soleil y entrent comme l’aiguille dans la toile et en sortent
de même. On lui a défendu de rien toucher qui
appartînt à quelqu’un. Un jour un enfant tomba dans
le canal, le canal n’était pas profond, mais lui, qui
passait tout près, aida le pauvre petit à sortir de
l’eau. Le père le sut et se plaignit au gobernadorcillo;
celui-ci fit donner au malheureux six coups de bâton au milieu de
la rue et l’on brûla le bâton ensuite.
C’était atroce! le lépreux s’enfuyait en
criant, l’exécuteur le poursuivait et le gobernadorcillo
lui criait: Apprends qu’il vaut mieux être noyé que
malade comme toi!
—C’est vrai! murmura Maria Clara.
Et, sans se rendre compte de ce qu’elle faisait, elle
s’approcha rapidement du panier du malheureux et y déposa
le reliquaire que son père venait de lui donner.
—Qu’as-tu fait? lui demandèrent ses amies.
—Je n’avais pas autre chose! répondit-elle en
dissimulant ses larmes.
—Et que va-t-il faire de ton reliquaire? lui dit Victoria. Un
jour on lui donna de l’argent, mais il l’éloigna de
lui avec une canne; pourquoi l’aurait-il pris [208]puisque personne
ne veut rien accepter qui vienne de lui? Si le reliquaire pouvait se
manger!
Maria Clara regarda avec envie les femmes qui vendaient des
comestibles et haussa les épaules.
Mais le lépreux s’approcha du panier, prit le bijou qui
brilla dans ses mains, s’agenouilla, l’embrassa, puis se
découvrit humblement, le front dans la poussière
où la jeune femme avait marché.
Maria Clara se cacha le visage dans son éventail et porta son
mouchoir à ses yeux.
Cependant une femme s’était approchée du
malheureux qui paraissait prier. A la lumière des lanternes
montrant sa longue chevelure éparse et flottante, à sa
mine amaigrie à l’extrême, on reconnut Sisa la
folle.
Le lépreux, sentant son contact, poussa un cri et se leva
d’un saut. Mais, au milieu des cris d’horreur de la foule,
elle s’accrocha à son bras:
—Prions, prions! disait-elle. C’est aujourd’hui le
jour des morts! Ces lumières sont les vies des hommes; prions
pour mes fils!
—Séparez-la, séparez-les! il va infecter la
folle! criait la multitude, mais personne n’osait
s’approcher.
—Vois-tu cette lumière dans la tour? C’est mon
fils Basilio qui tire une corde! Vois-tu celle-là, dans le
couvent? C’est mon fils Crispin; mais je ne puis pas les voir
parce que le curé est malade, qu’il a beaucoup
d’argent et que l’argent se perd. Prions, prions pour
l’âme du curé! Je lui apportais de l’amargoso
et des zarzalidas; mon jardin était plein de fleurs et
j’avais deux fils. J’avais un jardin, je soignais mes
fleurs et j’avais deux fils!
Et quittant le lépreux, elle s’éloigna en
chantant:
—J’avais un jardin et des fleurs; j’avais des
fils, un jardin et des fleurs!
—Qu’as-tu pu faire pour cette pauvre femme? demanda
Maria Clara à Ibarra.
—Rien encore; ces jours-ci, elle avait disparu du pueblo et on
n’a pas pu la trouver! répondit le jeune [209]homme un peu
confus. De plus, j’ai été très
occupé; mais ne t’afflige pas; le curé a promis de
m’aider, il m’a recommandé beaucoup de tact et de
discrétion, car il paraît que cette affaire met en cause
la garde civile. Le curé s’intéresse beaucoup
à cette malheureuse.
—L’alférez ne disait-il pas qu’il faisait
chercher les enfants?
—Oui, mais alors il était un peu... gris!
A peine venait-il de dire ceci qu’on vit la folle
traînée plutôt que conduite par un soldat: Sisa
résistait.
—Pourquoi l’emmenez-vous? qu’a-t-elle fait?
demanda Ibarra.
—Comment? n’avez-vous pas entendu le bruit qu’elle
faisait? répondit le gardien de la tranquillité
publique.
Le lépreux reprit en hâte son panier et
s’éloigna.
Maria Clara voulut se retirer, car elle avait perdu toute
gaieté et toute bonne humeur.
—Il y a donc aussi des gens qui ne sont pas heureux!
murmura-t-elle.
Sa tristesse s’augmenta lorsque, arrivée à sa
porte, son fiancé refusa de monter et prit congé
d’elle.
—Il le faut! lui dit le jeune homme.
Maria Clara monta les escaliers en pensant combien sont ennuyeux les
jours de fête où l’on doit recevoir les visites de
tant d’étrangers.
[Table des matières]
XXVIII
Correspondances
Chacun parle de la fête comme il y est allé.
Rien d’important n’étant arrivé à
nos personnages ni cette nuit-là, ni le lendemain, nous
passerions avec plaisir au dernier jour de la fête si nous ne
considérions que, peut-être, quelque lecteur
étranger voudrait [210]savoir comment on célèbre les
fêtes aux Philippines. Pour le renseigner nous copierons
textuellement diverses lettres; la première émane du
correspondant d’un journal de Manille sérieux et
distingué, vénérable par son ton et sa haute
sévérité. Nos lecteurs rectifieront quelques
légères inexactitudes bien excusables.
Le digne correspondant du noble journal écrivait ainsi:
«Señor directeur...
»Mon distingué ami: Jamais je n’avais
assisté ni espéré voir dans les provinces une
fête religieuse si solennelle, si splendide, si émouvante,
que celle de ce pueblo, célébrée par les
Très Révérends et vertueux Pères
Franciscains.
»L’affluence est très grande; j’ai eu le
bonheur de saluer presque tous les Espagnols résidant dans cette
province, trois R. R. P. P. Augustins de la province de Batangas, deux
R. R. P. P. Dominicains dont l’un est le T. R. P. Fr. Hernando de
la Sibyla qui est venu honorer ce pays de sa présence, ce que ne
devront jamais oublier ses dignes habitants. J’ai vu aussi un
grand nombre de notables de Cavite, Pampanga, beaucoup de troupes de
musiciens et une multitude de Chinois et d’indigènes qui,
avec la curiosité caractérisant les premiers et la
religiosité des seconds, attendent avec impatience le jour
où sera célébrée la fête solennelle,
pour assister au spectacle
comico-mimico-lyrico-choréographico-dramatique, en vue duquel on
a élevé une grande et spacieuse scène au milieu de
la place.
»Le 10, veille de la fête, à neuf heures du soir,
après le plantureux dîner que nous offrit le Frère
principal, l’attention de tous les Espagnols et des moines qui
étaient dans le couvent fut attirée par les accords de
deux musiques qui, accompagnées d’une foule
pressée, au bruit des fusées et des bombes et
précédées des notables du pueblo, venaient nous
chercher au couvent et nous conduire à l’endroit
préparé spécialement pour nous permettre
d’assister au spectacle. [211]
»Nous n’avons pu refuser une offre aussi gracieuse, bien
que nous eussions préféré nous endormir dans les
bras de Morphée et reposer nos membres endoloris par les
secousses du véhicule qu’avait mis à notre
disposition le gobernadorcillo du pueblo de R.
»Nous sommes donc descendus pour aller chercher nos
compatriotes qui dînaient dans la maison que possède ici
le pieux et opulent D. Santiago de los Santos. Le curé du
pueblo, le T. R. P. Fr. Bernardo Salvi et le T. R. P. Fr. Dámaso
Verdolagas qui était déjà, par une faveur
spéciale du Très-Haut, rétabli du coup
qu’une main impie lui a porté, le T. R. P. Fr. Hernando de
la Sibyla et le vertueux curé de Tanauan avec d’autres
Espagnols encore, étaient les invités du Crésus
philippin. Là, nous avons eu le bonheur d’admirer, non
seulement le luxe et le bon goût des maîtres de la maison
qui n’est pas commun parmi les naturels, mais aussi la
très belle, ravissante et riche héritière, qui
nous a prouvé qu’elle était une disciple
consommée de Sainte-Cécile en jouant sur son
élégant piano, avec une maestria qui me fit souvenir de
la Galvez, les meilleures compositions allemandes et italiennes. Quel
malheur qu’une demoiselle si parfaite soit aussi excessivement
modeste et cache ses mérites à la société
qui n’a d’admiration que pour elle seule. Je ne dois pas
laisser dans l’encrier que notre amphitryon nous fit prendre du
champagne et des liqueurs fines, avec la profusion et la splendeur qui
caractérisent ce capitaliste connu.
»Nous assistons au spectacle. Vous connaissez
déjà nos artistes Ratia, Carvajal et Fernandez; mais leur
talent ne fut compris que par nous, car le vulgaire n’en entendit
pas un seul mot. Chananay et Balbino, bien qu’un peu
enroués—ce dernier lâcha un petit
couac—n’en firent pas moins un ensemble d’une
bonne volonté admirable. La comédie tagale plut beaucoup
aux indiens, surtout au gobernadorcillo; ce dernier se frottait les
mains et nous disait que c’était un malheur [212]que l’on
n’eût pas fait battre la princesse avec le géant qui
l’avait enlevée, ce qui, dans son opinion, aurait
été bien plus merveilleux, surtout si le géant
n’avait été vulnérable qu’au nombril
comme le Ferragus dont parle l’histoire des Douze Pairs. Le T. R.
P. Fr. Dámaso, avec cette bonté de cœur qui le
distingue, partageait l’opinion du gobernadorcillo et ajoutait
que, dans ce cas, la princesse se serait arrangée pour
découvrir le nombril du géant et lui donner le coup de
grâce.
»Inutile de vous dire que, pendant le spectacle,
l’amabilité du Rothschild philippin ne permit pas que rien
manquât: sorbets, limonades gazeuses, rafraîchissements,
bonbons, vins, etc., etc., circulaient à profusion parmi nous.
On a beaucoup remarqué, et avec raison, l’absence du jeune
et déjà illustre D. Juan Crisóstomo Ibarra
qui, comme vous le savez, doit présider demain la
bénédiction de la première pierre du grand
monument qu’il fait si philanthropiquement élever. Ce
digne descendant des Pélages et des Elcanos (car,
d’après ce que j’ai appris, l’un de ses
aïeux paternels est de nos nobles et héroïques
provinces du Nord, peut-être un des premiers compagnons de
Magellan ou de Legaspisne s’est pas non plus laissé voir
le reste du jour à cause d’un petit malaise. Son nom court
de bouche en bouche, on ne le prononce qu’avec des louanges qui
ne peuvent manquer de concourir à la gloire de l’Espagne
et des véritables Espagnols comme nous qui ne démentons
jamais notre sang, quelque mêlé qu’il puisse
être.
»Aujourd’hui 11, le matin, nous avons assisté
à un spectacle hautement émouvant. Comme il est public et
notoire, c’est la fête de la Vierge de la Paix; elle est
célébrée par les frères du
Très-Saint Rosaire. Demain, sera la fête de San-Diego, le
patron du pueblo, et ceux qui y prennent la plus grande part sont les
frères du Vénérable Tiers Ordre. Entre ces deux
corporations, s’est établie une pieuse émulation
pour servir Dieu, et cette piété en arrive au point de
provoquer de saintes [213]querelles, comme il est arrivé
dernièrement lorsqu’elles se sont disputé le grand
prédicateur si renommé, le très souvent
cité T. R. P. Fr. Dámaso qui occupera demain la chaire du
Saint-Esprit, et prononcera un sermon qui sera, selon la croyance
générale, un événement religieux et
littéraire.
»Donc, comme nous le disions, nous avons assisté
à un spectacle hautement édifiant et émouvant. Six
jeunes religieux, dont trois devaient dire la messe et les trois autres
les assister comme servants, sortirent de la sacristie et se
prosternèrent devant l’autel; l’officiant qui
était le T. R. P. Fr. Hernando de la Sibyla entonna le Surge
Domine, qui devait commencer la procession autour de
l’église, avec cette magnifique voix et cette religieuse
onction que tout le monde lui reconnaît et qui le font si digne
de l’admiration générale. Le Surge Domine
terminé, le gobernadorcillo, en frac, avec la croix, suivi de
quatre servants munis d’encensoirs, se mit en tête de la
procession. Derrière eux venaient les candélabres
d’argent, la municipalité, les précieuses images
vêtues de satin et d’or, représentant saint
Dominique, saint Diego et la Vierge de la Paix portant un magnifique
manteau bleu avec des plaques d’argent doré, cadeau du
vertueux ex-gobernadorcillo, le très digne d’être
imité et jamais suffisamment nommé D. Santiago de los
Santos. Toutes ces images allaient dans des chars d’argent.
Après la Mère de Dieu venaient les Espagnols et les
autres religieux; l’officiant était protégé
par un dais que portaient les cabezas de barangay; le corps bien
méritant de la garde civile fermait la procession. Je crois
superflu de dire qu’une multitude d’indiens formaient les
deux files du cortège, portant avec grande piété
des cierges allumés. La musique jouait des marches religieuses
qu’accompagnaient les salves répétées des
bombes et des roues de feu. On ne pouvait qu’admirer la modestie
et la ferveur inspirées par ces actes dans le cœur des
croyants, la foi pure et grande qu’ils professent [214]pour la Vierge de
la Paix, la dévotion fervente et sincère avec laquelle
célèbrent ces solennités ceux qui ont eu le
bonheur de naître sous le pavillon sacro-saint et immaculé
de l’Espagne.
»La procession terminée commença la messe
exécutée par l’orchestre et les artistes du
théâtre. Après l’Evangile, monta au pupitre
le T. R. P. Fr. Manuel Martin, augustin de la province de Batangas, qui
a tenu absorbé et suspendu à ses lèvres tout
l’auditoire, et surtout les Espagnols, par un exorde en castillan
qu’il a prononcé avec tant d’énergie, avec
des phrases si facilement amenées, si bien appliquées
à leur objet, qu’elles remplissaient nos cœurs de
ferveur et d’enthousiasme. Ce mot est celui qui doit être
appliqué à ce qui touche le cœur et nous sommes
émus lorsqu’il s’agit de la Vierge et de notre
chère Espagne, et surtout quand on peut intercaler dans le
texte, lorsque le sujet s’y prête, les idées
d’un prince de l’Eglise, Mgr Monescillo1, qui sont assurément
celles de tous les Espagnols.
»La messe terminée nous sommes tous montés au
couvent avec les notables du pueblo et les autres personnes
d’importance; nous y avons été reçus avec la
délicatesse, la grâce et la
générosité qui caractérisent le T. R. P.
Fr. Salvi; on nous offrit d’abord des cigares, puis un
confortable lunch que le frère principal avait fait
préparer au rez-de-chaussée du couvent pour tous ceux qui
voudraient faire taire les nécessités de leur
estomac.
»Pendant le jour, rien ne manqua pour égayer la
fête et conserver l’animation caractéristique des
Espagnols, qui, en de telles occasions, ne peuvent se contenir,
démontrant soit par des chansons et des danses, soit par
d’autres simples distractions qu’ils ont le cœur
noble et fort, que le chagrin ne les abat pas et qu’il suffit que
trois Espagnols se réunissent n’importe où [215]pour en
chasser le malaise et la tristesse. On sacrifia donc au culte de
Terpsichore en beaucoup de maisons, mais principalement chez
l’illustre millionnaire philippin où nous avions tous
été invités à dîner. Je n’ai
pas besoin de vous dire que le banquet, somptueux et splendidement
servi, a été la seconde édition corrigée et
augmentée des noces de Cana ou de Gamache. Tandis que nous
jouissions des plaisirs de la table, préparés sous la
direction d’un cuisinier de la Campana, l’orchestre
jouait d’harmonieuses mélodies. La très belle fille
de la maison brillait dans un costume de métisse que rehaussait
encore une cascade de diamants; elle était la reine de la
fête. Tous nous déplorions dans le fond de notre âme
qu’une légère foulure de son joli pied l’ait
privée des plaisirs du bal car, si nous devons en juger par
toutes ses perfections, la señorita de los Santos doit danser
comme une sylphide.
»L’Alcalde de la province est arrivé cette
après-midi pour solenniser par sa présence la
cérémonie de demain. Il a déploré
l’indisposition du distingué propriétaire
señor Ibarra dont, grâce à Dieu,
l’état s’est déjà
amélioré, selon ce qui nous a été dit.
»Ce soir encore il y a eu grande procession, mais je vous en
parlerai dans ma lettre de demain car, en plus des bombes qui
m’étourdissent et me rendent quelque peu sourd, je suis
très fatigué et tombe de sommeil. Tandis donc que je vais
récupérer des forces dans les bras de Morphée,
c’est-à-dire dans le lit du couvent, je vous souhaite, mon
distingué ami, une bonne nuit jusqu’à demain qui
sera le grand jour.
»Votre affectionné ami
»Q. B. S. M2.
Le
Correspondant.
»S. Diego, 11 novembre.»
Ceci était la lettre officielle du correspondant. [216]Voyons
maintenant ce qu’écrivait le Capitan Martin à son
ami Luis Chiquito:
«Cher Choy: Viens en courant si tu peux car la fête est
très gaie, figure-toi que Capitan Joaquin qui tenait la banque a
presque sauté: Capitan Tiago l’a doublé trois fois,
trois fois il a gagné; aussi Cabezang Manuel, le maître de
la maison, en mourait presque de joie. Le P. Dámaso a
brisé une lampe d’un coup de poing parce que
jusqu’à présent il n’a pas gagné une
carte, le consul a perdu, avec ses coqs et à la banque presque
tout ce qu’il nous a gagné à la fête de
Binang et au Pilar de Santa Cruz.
»Nous attendons que Capitan Tiago nous amène son futur
gendre, le riche héritier de D. Rafael, mais il semble vouloir
imiter son père, car jusqu’ici on ne l’a pas vu.
Malheureusement il paraît ne devoir être d’aucun
profit.
»Le chinois Carlos fait une grande fortune avec le
liam-pô; je le soupçonne de porter quelque chose de
caché, peut-être un aimant; il se plaint continuellement
de douleurs à la tête qu’il porte bandée et,
quand le dé du liam-pô est pour
s’arrêter, il s’incline presque jusqu’à
le toucher comme s’il voulait bien l’observer de
près. Je me tiens sur mes gardes parce que je connais
d’autres histoires semblables.
»Adieu Choy; mes coqs vont bien, ma femme est joyeuse et se
divertit.
»Ton ami.
»Martin
Aristorenas.»
Ibarra, lui, avait reçu un petit billet parfumé,
qu’Andeng, la sœur de lait de Maria Clara, lui avait
apporté le soir du premier jour de la fête. Ce billet
disait:
»Crisóstomo, voici plus d’une journée que
l’on ne t’a pas vu; j’ai entendu dire que tu
étais malade; j’ai prié pour toi et allumé
deux cierges, bien que papa dise que ta maladie n’est pas grave.
Hier soir et aujourd’hui ils m’ont ennuyé tous en me
demandant de [217]jouer du piano et en m’invitant à
danser. Je ne savais pas qu’il y eût tant d’importuns
sur la terre! Si ce n’avait pas été pour le P.
Dámaso qui essayait de me distraire en me racontant beaucoup
d’histoires, je me serais enfermée dans mon alcôve
pour dormir. Ecris-moi ce que tu as, que je puisse dire à papa
qu’il aille te voir. Pour l’instant, je t’envoie
Andeng afin qu’elle te fasse du thé; elle le
réussit très bien et probablement mieux que tes
domestiques.
Maria
Clara.
P. S. Si tu ne viens pas demain, je n’irai pas à la
cérémonie. Au revoir.»
[Table des matières]
XXIX
La matinée
Les orchestres sonnèrent la diane aux premiers rayons du
soleil, réveillant de leurs airs joyeux les habitants
fatigués du pueblo.
C’était le dernier jour de la fête, mais en
vérité c’était la fête
elle-même. On s’attendait à voir beaucoup plus que
la veille. Les Frères du Tiers Ordre étaient plus
nombreux que ceux du Très-Saint Rosaire et leurs associés
souriaient pieusement, sûrs d’humilier leurs rivaux. Ils
avaient acheté la plus grande partie des cierges: les marchands
de cierges chinois avaient fait une riche moisson, aussi pensaient-ils
à se faire baptiser; beaucoup assuraient que ce
n’était pas par foi dans le catholicisme mais bien pour le
simple désir de prendre femme. A cela, les dévotes
répondaient:
—Et quand bien même il en serait ainsi, le mariage de
tant de Chinois à la fois n’en serait pas moins un miracle
et leurs épouses les convertiraient ensuite.
Chacun avait revêtu ses habits de fête; tous les bijoux
[218]étaient sortis de leurs coffrets, les
fripons et les joueurs étalaient des chemises bordées de
gros boutons en brillants, de pesantes chaînes d’or et de
blancs chapeaux de jipijapa1. Seul, le vieux philosophe avait gardé
son ordinaire costume: la chemise de sinamay2 à raies sombres,
boutonnée jusqu’au col, de grands souliers et un large
chapeau de feutre, couleur de cendre.
—Vous paraissez aujourd’hui plus triste que jamais? lui
dit le lieutenant principal. Faut-il donc, parce que nous avons tant de
sujets de pleurer, que nous ne nous amusions pas une fois de temps en
temps?
—S’amuser n’est pas faire des folies!
répondit le vieillard. C’est l’orgie insensée
de tous les ans! Et pourquoi dépenser l’argent si
inutilement quand il y a tant de besoins et tant de misères?
Mais, je comprends! c’est l’orgie, c’est la
bacchanale qui doit apaiser les lamentations de ceux qui souffrent.
—Vous savez que je partage votre opinion, reprit D. Filipo,
moitié sérieux, moitié riant. Je l’ai
défendue, mais que pouvais-je faire contre le gobernadorcillo et
contre le curé?
—Démissionner! répondit le vieillard et il
s’éloigna.
D. Filipo resta perplexe, suivant le philosophe du regard.
—Démissionner! murmura-t-il en se dirigeant vers
l’église. Démissionner! Oui, certainement, si mon
poste était une dignité et non une charge, je
démissionnerais!
Il y avait foule sur le parvis: hommes et femmes, enfants et
vieillards, en habits de fête, confondus, entraient et sortaient
par les étroites portes. L’odeur de la poudre se
mélangeait à celles des fleurs, de l’encens, des
parfums; les bombes, les fusées, les serpenteaux faisaient
courir et crier les femmes, amusaient les enfants. Un orchestre jouait
devant le couvent: d’autres, [219]accompagnant la municipalité,
parcouraient les rues où flottaient et ondoyaient une multitude
de drapeaux. La lumière et les couleurs distrayaient la vue, les
musiques et les détonations l’oreille. Les cloches ne
cessaient de tinter; les voitures, les calèches se croisaient et
les chevaux, qui parfois s’effrayaient, se cabraient, ruaient,
donnaient un spectacle gratuit qui, pour n’avoir pas
été prévu au programme de la fête,
n’en était moins des plus intéressants.
Le Frère principal avait envoyé des domestiques
chercher les convives dans la rue, comme pour ce festin dont nous parle
l’Evangile. On invitait les gens, presque par la force, à
venir prendre du café, du thé, des pâtisseries.
Parfois, l’invitation ressemblait à une querelle.
On allait célébrer la grand’messe, celle que
l’on appelle la dalmatique, de la même façon que la
veille; le rapport du digne correspondant nous l’a
déjà fait connaître; mais aujourd’hui, le
célébrant devait être le P. Salvi et, parmi les
assistants, on attendait l’Alcalde de la province avec beaucoup
d’autres Espagnols et de notables; enfin on allait entendre le P.
Dámaso qui, comme prédicateur, jouissait dans la province
de la plus grande renommée. L’alférez
lui-même, qui se méfiait des sermons du P. Salvi,
était venu, tant pour faire preuve de bonne volonté que
pour prendre sa revanche des mauvais moments que lui avait fait passer
le curé. La réputation du P. Dámaso était
telle que, d’avance, le correspondant avait écrit au
directeur du journal:
«Tout s’est passé comme je vous l’avais
annoncé dans ma lettre d’hier. Nous avons eu la
spéciale joie d’entendre le T. R. P. Fr. Dámaso
Verdolagas, ancien curé de ce pueblo, transféré
aujourd’hui dans un autre plus important en récompense de
ses bons services. L’insigne orateur sacré a occupé
la chaire du Saint-Esprit en prononçant un très
éloquent et très profond sermon qui édifia et
laissa pâmés d’admiration tous les [220]fidèles,
qui regardaient anxieux sortir de ses lèvres fécondes la
fontaine salutaire de la vie éternelle. Sublimité dans le
sujet, hardiesse dans les conceptions, nouveauté dans les
phrases, élégance dans le style, naturel dans le geste,
grâce dans la parole, élégance dans les
idées, tels sont les mérites du Bossuet espagnol qui lui
ont justement conquis sa haute réputation, non seulement parmi
les notables espagnols, mais encore chez les rudes indiens et chez les
fils astucieux du Céleste Empire.»
Le confiant correspondant se vit néanmoins obligé de
biffer une grande partie de ce qu’il avait écrit. Le P.
Dámaso se plaignait d’un léger rhume qui
l’avait pris la nuit précédente; après avoir
chanté quelques joyeuses peteneras3, il avait mangé trois
sorbets et assisté un moment au spectacle. Aussi voulait-il
renoncer à être l’interprète de Dieu
auprès des hommes; mais, comme il ne se trouva pas d’autre
prêtre qui connût la vie et les miracles de saint
Diego—le curé les savait, lui, mais officiant il ne
pouvait prêcher—les autres religieux furent unanimes
à trouver que le timbre de la voix du P. Dámaso
était parfait et que ce serait un grand malheur si un sermon
aussi éloquent que celui qu’il avait composé et
appris ne devait pas être prononcé. La vieille gouvernante
lui prépara donc des limonades, lui oignit le cou et la poitrine
d’onguents et d’huiles, l’enroula dans des draps
chauds, le massa, etc. Le P. Dámaso avala des œufs crus
battus dans du vin, puis il ne mangea ni ne parla de la matinée;
à peine prit-il un verre de lait, une tasse de chocolat et une
petite douzaine de biscuits, renonçant héroïquement
à son poulet frit et à son demi fromage de la Laguna
ordinaires, parce que, selon la gouvernante, le poulet et le fromage
ont du sel et de la graisse et peuvent provoquer la toux.
—Il fait tout pour gagner le ciel et nous convertir! se dirent
émues les sœurs du Tiers Ordre lorsqu’elles
apprirent tous ces sacrifices. [221]
—C’est la Vierge de la Paix qui le punit!
murmurèrent les sœurs du Très-Saint Rosaire qui ne
pouvaient lui pardonner d’avoir penché du
côté de leurs rivales.
A huit heures et demie la procession sortit à l’ombre
de la tenture de cotonnade. C’était exactement celle de la
veille avec, en plus, comme nouveauté, la Confrérie du
Vénérable Tiers Ordre. Des vieux, des vieilles et
quelques jeunes femmes à démarche de vieilles, se
montraient en longs habits de guingon; les pauvres les portaient en
toile, les riches en soie ou même en véritable guingon
franciscain; ils les choisissaient parmi ceux qu’avaient le plus
usés les Révérends Moines Franciscains. Tous ces
habits sacrés étaient authentiques; ils venaient du
couvent de Manille où le peuple les acquiert par charité,
en échange d’un prix fixe4, s’il est permis
d’employer ici le langage des boutiques. Ce prix fixe peut
augmenter mais ne peut jamais diminuer. Ce même couvent et celui
de Santa Clara vendent aussi d’autres habits qui
possèdent, en plus de la grâce toute spéciale de
procurer beaucoup d’indulgences aux morts qu’on y
ensevelit, la grâce plus spéciale encore de coûter
d’autant plus cher qu’ils sont plus vieux, plus
râpés, plus hors d’usage. Nous écrivons ceci
pour renseigner les lecteurs pieux qui voudraient faire usage de ces
reliques sacrées et aussi pour apprendre à quelque gueux
de drapier courant après la fortune, qu’en envoyant aux
Philippines un chargement d’habits mal cousus et crasseux, ils
s’y vendront encore seize pesos, et même plus, selon
qu’ils paraîtront plus ou moins en guenilles.
Saint Diego de Alcalá était traîné dans
un char orné de plaques d’argent repoussé. Le
saint, suffisamment sec avait un buste en marbre d’une expression
sévère et majestueuse, malgré son abondante
tignasse tonsurée, frisée comme celle des nègres.
Son vêtement était de satin brodé
d’or. [222]
Notre vénérable Père Saint François
suivait, puis la Vierge, dans le même équipage que la
veille; mais cette fois, sous le dais, marchait le P. Salvi et non plus
l’élégant P. Sibyla aux manières
distinguées. Toutefois, si le P. Salvi n’avait pas la
belle allure de son rival, il le surpassait en onction: les mains
jointes, les yeux baissés, le corps à demi courbé,
il édifiait la foule par son humble et mystique attitude. Le
dais était porté par les cabezas de
barangay eux-mêmes, suant de satisfaction en se voyant
à la fois demi-sacristains, recouvreurs d’impôts,
rédempteurs de l’humanité vagabonde et pauvre et,
par conséquent, Christs au petit pied, donnant leur sueur sinon
leur sang pour racheter les péchés des hommes. Le
vicaire, en surplis, allait d’un char à l’autre,
portant l’encensoir dont il envoyait par instant la fumée
vers les narines du curé qui se faisait alors plus
sérieux et plus grave encore.
Ainsi, lentement et posément, la procession
s’avançait au son des cloches, des cantiques et des
religieux accords éparpillés dans l’air par les
orchestres qui suivaient chaque char. Entre temps, le Frère
principal distribuait avec une louable sollicitude des cierges que
nombre de fidèles emportaient chez eux; c’était de
la lumière pour jouer aux cartes pendant quatre soirées.
Dévotement les curieux s’agenouillaient au passage du char
de la Mère de Dieu et récitaient avec ferveur des
Credo et des Salve.
Le char s’arrêta en face d’une maison aux
fenêtres ornées de riches tentures où se montraient
l’Alcalde, Capitan Tiago, Maria Clara, Ibarra, divers Espagnols
et des jeunes filles. Le P. Salvi leva les yeux, mais ne fit pas le
plus petit geste de salut, le moindre signe de reconnaissance; un
instant seulement il se redressa, et sa chape tomba sur ses
épaules avec plus de grâce et
d’élégance.
Dans la rue, sous la fenêtre, une jeune fille au visage
sympathique, vêtue avec beaucoup de luxe, portait dans son bras
un enfant en bas âge. Elle devait être [223]nourrice ou bonne
d’enfants, car le bébé était blanc et blond
et elle brune, avec des cheveux plus noirs que du jais.
En voyant le curé, le pauvre poupon tendit ses petites mains,
sourit de ce rire de l’enfance qui ne cause pas de douleurs et
n’est jamais causé par elles et, balbutiant, au milieu
d’un court silence, il cria: Pa...pa! papa! papa!
La jeune fille tressaillit, posa précipitamment sa main sur
la bouche du bébé, et, confuse, s’éloigna en
courant. L’enfant se mit à pleurer.
Les gens à l’esprit malin se regardèrent, les
Espagnols qui avaient vu cette courte scène sourirent. La
pâleur naturelle du P. Salvi se changea en un ton de
coquelicot.
Et cependant les rieurs avaient tort: cette femme était une
étrangère et le curé ne la connaissait pas.
[Table des matières]
XXX
A l’église
Le local exigu que les hommes assignent pour demeure au
Créateur de tout ce qui existe était comble.
On se bousculait, on s’écrasait, on se
piétinait; ceux qui sortaient en petit nombre comme ceux qui
entraient, beaucoup plus nombreux, poussaient des exclamations à
chaque bourrade. De loin, on tendait le bras pour mouiller les doigts
dans l’eau bénite, mais de plus près on en sentait
l’odeur et la main se retirait; on entendait alors un grognement,
une femme refoulée blasphémait un juron, mais les
bousculades n’en continuaient pas moins. Quelques vieillards qui
étaient arrivés à rafraîchir leurs doigts
dans cette eau couleur de fange où s’était
lavée toute la population, sans compter les étrangers,
s’en oignaient dévotement, non sans peine,
l’occiput, le [224]sommet du crâne, le front, le nez, la
barbe, la poitrine et le nombril, avec la conviction qu’ayant
ainsi sanctifié toutes ces parties de leur corps ils ne
souffriraient plus ni de torticolis, ni de douleurs de tête, ni
de phtisie, ni d’indigestion. Quant aux personnes jeunes,
peut-être moins sujettes aux maladies, peut-être ayant
moins de foi dans les vertus prophylactiques de ce bourbier, à
peine humectaient-elles l’extrémité de leur doigt,
pour ne pas donner prise aux bavardages de la gent dévote, et
faisaient-elles semblant de se signer le front, sans le toucher.
«Elle peut être bénite et tout ce que l’on
voudra! pensait plus d’une jeune fille, mais elle a une
couleur...!»
On respirait à peine; la chaleur, l’odeur de
l’animal humain étaient insupportables; mais le
prédicateur valait bien que l’on endurât toutes ces
misères et son sermon coûtait au pueblo deux cent
cinquante pesos. Le vieux Tasio avait dit à ce propos:
—Deux cent cinquante pesos pour un sermon! Un seul homme et
une seule fois! Le tiers de ce que l’on donne aux
comédiens qui travailleront pendant trois soirées!
Décidément vous êtes bien riches!
—Qu’est-ce que ceci a à voir avec le prix de la
comédie! répondit avec mauvaise humeur le nerveux
maître des Frères du Tiers Ordre; avec la comédie,
les âmes vont en enfer; elles vont au ciel avec le sermon!
S’il avait demandé mille pesos nous les aurions
payés et nous lui devrions encore des remerciements...
—Après tout, vous avez raison! répliqua le
philosophe; pour moi du moins le sermon m’amuse plus que la
comédie!
—Eh bien! moi, la comédie ne m’amuse pas plus que
le sermon! cria l’autre, furieux.
—Je le crois bien, vous comprenez autant l’un que
l’autre!
Et l’impie s’en alla sans faire cas des insultes et des
funestes prophéties sur sa vie future que lui lançait
l’irritable dévot. [225]
En attendant l’Alcalde, on suait, on bâillait: les
éventails, les chapeaux, les mouchoirs agitaient l’air;
les enfants pleuraient et criaient, donnant à travailler aux
sacristains qui devaient les chasser du temple, ce qui faisait dire au
consciencieux et flegmatique maître de la Confrérie du
Très-Saint Rosaire:
—N.S. Jésus-Christ disait: «Laissez venir
à moi les petits enfants», c’est vrai, mais il
devait entendre par là, les enfants qui ne pleurent pas!
Une vieille, habillée de guingon, la sœur Puté,
disait à sa petite fille, une gamine de six ans,
agenouillée près d’elle:
—Sois attentive, écoute bien, damnée! tu vas
entendre un sermon comme celui du Vendredi-Saint!
Et elle la gratifia d’un léger pinçon pour
réveiller la piété de la fillette; celle-ci fit la
moue, allongea le museau et fronça les sourcils.
Quelques hommes accroupis dormaient près des confessionnaux;
un vieillard à tête blanche enseignait à une
vieille, qui mâchait des prières et faisait rapidement
courir les doigts sur les grains de son chapelet, quelle était
la meilleure manière de se soumettre aux desseins du ciel et,
peu à peu, il se mettait à faire comme elle.
Ibarra était dans un coin; Maria Clara s’agenouillait
près du grand autel à une place que le curé avait
eu la galanterie de faire réserver par les sacristains. Capitan
Tiago, en frac, avait pris rang au banc des autorités; aussi les
enfants, qui ne le connaissaient pas, le prenaient pour un autre
gobernadorcillo et n’osaient l’approcher.
Enfin, le señor Alcalde arriva avec son État-Major; il
venait de la sacristie et s’assit dans un des magnifiques
fauteuils placés sur un tapis. L’Alcalde portait un
costume de grand gala, sur lequel reluisait le cordon de Charles III
accompagné de quatre ou cinq autres décorations.
Le peuple ne le reconnut pas. [226]
—Tiens! s’écria un paysan, un civil
habillé en comédien.
—Imbécile! lui répondit son voisin, en lui
donnant un coup de coude, c’est le prince Villardo que nous avons
vu hier soir au théâtre.
Aux yeux du peuple, l’Alcalde montait en grade; il en arrivait
à être prince enchanté, vainqueur de
géants.
La messe commença. Ceux qui étaient assis se
levèrent, ceux qui dormaient se réveillèrent au
bruit de la sonnette et de l’éclatante voix des chantres.
Le P. Salvi, en dépit de sa gravité, paraissait
très satisfait, car ce n’étaient rien moins que
deux Augustins qui lui servaient de diacre et de sous-diacre.
Chacun à leur tour, ils chantaient d’une voix plus ou
moins nasale, avec une prononciation plus ou moins claire, sauf
l’officiant dont l’organe était tremblant, assez
souvent faux même, au grand étonnement de ceux qui le
connaissaient. Il se mouvait cependant avec précision et
élégance, disait le Dominus vobiscum avec onction,
inclinant un peu la tête de côté et regardant la
voûte. En voyant de quel air il recevait la fumée de
l’encens, on aurait dit que Galien avait raison d’admettre
que la fumée passait des fosses nasales dans le crâne par
le crible des ethmoïdes. Il se redressait, rejetait la tête
en arrière et s’avançait ensuite vers le centre du
maître-autel, avec une telle emphase, une telle gravité,
que Capitan Tiago le trouva plus majestueux encore que le
comédien chinois qu’il avait vu la veille, revêtu
d’habits impériaux, barbouillé,
l’épée ornée d’un flot de rubans,
orné d’une barbe en crins de cheval et de babouches
à hautes semelles.
—Indubitablement, pensait-il, un seul de nos curés a
plus de majesté que tous les empereurs.
Enfin, le moment tant espéré arriva: on allait
entendre le P. Dámaso. Les trois prêtres s’assirent
dans leurs fauteuils et prirent une attitude édifiante, pour
parler le langage de l’honorable correspondant; l’Alcalde
[227]et
les autres gens à verge et à bâton les
imitèrent, la musique cessa.
Ce subit passage du bruit au silence réveilla la vieille
sœur Puté qui ronflait déjà, grâce
à la musique. Comme Sigismond ou comme le cuisinier du conte de
Dornröschen, la première chose qu’elle fit en se
réveillant fut de donner une tape sur la tête de sa
petite-fille qui, elle aussi, s’était endormie.
L’enfant commença à pleurer, mais de suite elle
s’arrêta, distraite, en regardant une femme qui se donnait
des coups sur la poitrine avec une conviction enthousiaste.
Tous s’efforçaient de se placer le plus
commodément possible; ceux qui n’avaient pas de banc
s’accroupirent, les femmes à même le sol ou sur
leurs propres jambes, à la façon des tailleurs.
Le P. Dámaso traversa la multitude,
précédé de deux sacristains et suivi d’un
autre moine qui portait un grand cahier. Il disparut dans
l’escalier en colimaçon, mais promptement on revit sa
grosse tête, puis son buste herculéen. Tout en
toussottant, il promena de tous côtés un regard
assuré; il vit Ibarra, et d’un clignement
d’œil particulier l’assura qu’il ne
l’oublierait pas dans ses prières, puis il lança un
regard de satisfaction au P. Salvi, un autre de dédain au P.
Manuel Martin, le prédicateur de la veille, et cette revue
terminée, se retourna en disant à son compagnon
dissimulé à ses pieds:
«Attention, frère!» Celui-ci ouvrit le
cahier.
Mais le sermon mérite un chapitre à part. Un jeune
homme, qui apprenait alors la tachygraphie et avait la passion des
grands orateurs, l’a sténographié; grâce
à lui, nous pouvons produire ici un échantillon de
l’éloquence sacrée dans ces régions. [228]
[Table des matières]
XXXI
Le sermon
Fr. Dámaso commença lentement à mi-voix:
—Et spiritum tuum bonum dedisti, qui doceret eos, et manna
tuum non prohibuisti ab ore eorum, et aquam dedisti eis in siti. Et
tu leur as donné ta sagesse pour les instruire, et tu n’as
pas retiré la manne de leur bouche, et tu leur as donné
de l’eau quand ils avaient soif! Paroles que dit le Seigneur par
la bouche d’Esdras, livre II, chap.
IX, vers. 20.
Le P. Sibyla regarda surpris le prédicateur, le P. Manuel
Martin pâlit et se mordit les lèvres; ce début
était meilleur que le sien.
Etait-ce un effet préparé ou bien l’enrouement
persistait-il encore, mais le P. Dámaso toussa à
plusieurs reprises, appuyant les deux mains sur l’appui de la
sainte tribune. L’Esprit-Saint était sur sa tête,
repeint à neuf, blanc, propre, le bout des pattes et le bec
couleur de rose.
—Excellentissime Señor (à l’Alcalde),
très vertueux prêtres, chrétiens, frères en
Jésus-Christ!
Ici une pose solennelle, un nouveau regard circulaire sur
l’auditoire, dont l’attention et le recueillement
donnèrent satisfaction à l’orateur.
La première partie du sermon devait être en castillan,
l’autre en tagal: loquebantur omnes linguas1.
Après le préambule et la pose, il étendit
majestueusement la main droite vers l’autel en regardant fixement
l’Alcalde, puis se croisa lentement les bras sans dire une parole
et, passant de ce calme à la mobilité, rejeta la
tête en arrière, montra l’entrée principale
en coupant l’air du bord de la main avec une telle [229]impétuosité que les sacristains
interprétèrent le geste comme un ordre et
fermèrent les portes: l’alférez devint inquiet, il
ne savait s’il devait sortir ou rester. Mais déjà
le prédicateur commençait à parler d’une
voix forte, pleine et sonore: décidément la vieille
gouvernante était un bon médecin.
—Éclatant et splendide est l’autel, large la
porte principale, l’air est le véhicule de la sainte
parole divine qui jaillira de ma bouche; écoutez donc, avec les
oreilles de l’âme et du cœur, pour que les paroles du
Seigneur ne tombent pas dans un terrain pierreux, où les
mangeront les oiseaux de l’Enfer, mais qu’elles croissent
et s’élèvent comme une sainte semence dans le champ
de notre vénérable et séraphique Père S.
François! Vous, grands pécheurs, captifs des Mores de
l’âme qui infestent les mers de la vie éternelle
dans les puissantes embarcations de la chair et du monde, vous qui
êtes chargés des chaînes de la lascivité et
de la concupiscence et ramez sur les galères du Satan infernal,
voyez ici, avec une révérente componction, celui qui
rachète les âmes de la captivité du Démon,
l’intrépide Gédéon, le courageux David, le
victorieux Roland du Christianisme, le garde civil céleste, plus
vaillant que tous les gardes civils réunis, du passé et
de l’avenir;—l’alférez fronça le
sourcil—oui, señor alférez, plus vaillant et plus
puissant que tous, qui, sans autre fusil qu’une croix de bois,
vainquit avec hardiesse l’éternel tulisan des
ténèbres, avec tous les partisans de Luzbel, et les
aurait pour toujours écrasés si les esprits
n’étaient pas immortels! Cette merveille de la
création divine, ce phénomène impossible est le
bienheureux Diego de Alcalá dont, en employant une
comparaison,—parce que, comme dit l’autre, les comparaisons
aident bien à la compréhension des choses
incompréhensibles—dont je dirai que ce grand saint est
seulement et uniquement un simple soldat, un vivandier, dans notre
très puissante compagnie, que commande du ciel notre
séraphique Père S. François et à laquelle
j’ai l’honneur d’appartenir [230]comme caporal ou sergent par la
grâce de Dieu.
Les rudes indiens, comme dit le correspondant, ne
pêchèrent dans ce paragraphe que les mots garde civil,
tulisan, S. Diego et S. François; ils avaient observé la
grimace de l’alférez, le geste belliqueux du
prédicateur et ils en déduisirent que celui-ci
était fâché après le garde civil parce
qu’il ne poursuivait pas les tulisanes, que S. Diego et S.
François s’en chargeraient, et y réussiraient
très bien, comme le prouve une peinture visible au couvent de
Manille, où l’on voit S. François, sans autre arme
que son cordon, arrêter l’invasion chinoise dans les
premières années de la découverte. Les
dévotes en furent enchantées, elles remercièrent
Dieu de ce secours, ne doutant pas qu’une fois les tulisanes
disparus, S. François détruirait aussi les gardes civils.
L’attention redoubla donc, tandis que le P. Dámaso
continuait:
—Excellentissime señor: Les grandes choses sont
toujours grandes, même à côté des petites, et
les petites toujours petites, même à côté des
grandes. L’Histoire le dit, mais comme l’Histoire frappe un
coup sur le clou et cent sur le fer, comme elle est faite par les
hommes et que les hommes se trompent: errarle es hominum2, comme dit
Cicéron, celui qui a une bouche se trompe, comme on dit dans mon
pays, il en résulte qu’il y a de très profondes
vérités que l’histoire passe sous silence. Ces
vérités, Excellentissime señor, l’esprit
divin l’a dit dans sa suprême sagesse, que
l’intelligence humaine n’a jamais comprise depuis les temps
de Sénèque et d’Aristote, ces savants religieux de
l’antiquité, jusqu’à nos jours
pécheurs. Ces vérités sont que les choses petites
ne sont pas toujours petites, mais sont parfois grandes, non pas
à côté des petites, mais à côté
des plus grandes de la terre, et du ciel, et des nuages, et des eaux,
et de l’espace, et de la vie et de la mort. [231]
—Amen! répondit le maître du Tiers Ordre, et il
se sanctifia.
Avec cette figure de rhétorique qu’il avait apprise
d’un prédicateur de Manille, le P. Dámaso voulait
surprendre son auditoire, et, en effet, il dut toucher du pied son
Esprit-Saint qui, hébété par tant de
vérités, avait complètement oublié sa
mission.
—Patente est à vos yeux!... souffla l’esprit
d’en bas.
—Patente est à vos yeux la preuve concluante et
frappante de cette éternelle vérité philosophique!
Patent ce soleil de vertus, et je dis soleil et non lune, parce
qu’il n’y a pas grand mérite à ce que la lune
brille pendant la nuit; dans le royaume des aveugles le borgne est roi,
la nuit une lumière quelconque, une toute petite étoile
peut briller; le plus grand mérite est de pouvoir, comme le
soleil, briller encore au milieu du jour: ainsi le frère Diego
brille encore au milieu des plus grands saints! Là, vous avez
patente à vos yeux, à votre incrédulité
impie, l’œuvre maîtresse du Très-Haut pour
confondre les grands de la terre, oui, mes frères, patente,
patente pour tous, patente!
Un homme se leva pâle et tremblant et se cacha dans un
confessionnal. C’était un vendeur d’alcools qui
sommeillait; il avait rêvé que les carabiniers lui
demandaient la patente qu’il n’avait pas! On assure
qu’il ne sortit pas de sa cachette tant que dura le sermon.
—Humble et rare saint! ta croix de bois—celle que
portait l’image était d’argent—, ton habit
modeste honorent le grand François dont nous sommes les fils et
les imitateurs! Nous propageons ta sainte race dans le monde entier,
dans tous les coins, dans les villes, dans les villages, sans
distinguer le blanc du noir—l’Alcalde ne respira
plus—souffrant le jeûne et le martyre, ta sainte race
armée de foi et de religion—Ah! respira
l’Alcalde—qui maintient le monde en équilibre et
l’empêche de tomber dans l’abîme de la
perdition! [232]
Les auditeurs, sans en excepter Capitan Tiago, bâillaient peu
à peu. Maria Clara n’entendait pas le sermon; elle savait
qu’Ibarra n’était pas loin et pensait à lui,
tandis qu’elle regardait en s’éventant l’un
des évangélistes dont le taureau avait toutes les allures
d’un petit carabao.
—Tous nous devrions connaître par cœur les Saintes
Écritures et, ainsi, je n’aurais pas à vous
prêcher, pécheurs; vous devriez savoir des choses aussi
importantes, aussi nécessaires que le Pater noster; mais,
pour beaucoup, vous l’avez déjà oublié, en
vivant comme des protestants ou des hérétiques qui ne
respectent pas les ministres de Dieu, comme les Chinois, mais je vais
vous condamner, je serai impitoyable pour vous, damnés!
—Qu’est-ce qu’il nous raconte là, ce
Palé Lámaso3, murmura le chinois Carlos, en regardant avec
colère le prédicateur, qui poursuivait en improvisant et
déchaînait une série d’apostrophes et
d’imprécations.
—Vous mourrez dans l’impénitence finale, race
d’hérétiques! Dieu vous châtie
déjà sur cette terre par les cachots et les prisons! Les
familles, les femmes doivent vous fuir, les gouvernants doivent vous
pendre tous, pour que la semence de Satan ne germe pas dans la vigne du
Seigneur! Jésus-Christ a dit: Si vous avez un membre mauvais qui
vous induise au péché, coupez-le, jetez-le au feu!...
Fr. Dámaso était nerveux, il avait oublié son
sermon et sa rhétorique.
—Entends-tu? demanda à son compagnon un jeune
étudiant de Manille, il faut couper?
—Bah! qu’il commence, lui! répondit l’autre
en montrant le prédicateur.
Ibarra s’inquiétait; il regarda derrière lui,
cherchant quelque coin, mais toute l’église était
pleine. Maria Clara ne voyait ni n’entendait rien, elle analysait
le tableau des âmes bénies du Purgatoire, âmes en
forme [233]d’hommes et de femmes nues avec des
mitres, des chapeaux, des toques, brûlant dans les flammes et
s’accrochant au cordon de S. François qui supportait tout
ce poids sans se rompre.
Dans toute cette improvisation, le moine qui jouait le rôle de
l’Esprit-Saint inférieur perdit le fil du sermon et sauta
trois longs paragraphes, manquant ainsi à son rôle de
souffleur auprès du P. Dámaso qui, haletant, se reposait
de son apostrophe.
—Lequel de vous, pécheurs qui m’écoutez,
lécherait les plaies d’un mendiant pauvre et
dépenaillé? Qui? que celui-là réponde et
lève la main! Personne! Je le savais déjà; seul
pouvait le faire un saint comme Diego de Alcalá; lui,
lécha toute la foule des pauvres, disant à un
frère qui s’étonnait: C’est ainsi que
l’on guérit ce malade! O charité chrétienne!
O piété sans exemple! O vertu des vertus! O modèle
inimitable! O talisman sans tache!...
Et il poursuivit lançant toute une longue série
d’exclamations, les bras en croix, les élevant, les
abaissant, comme s’il avait voulu s’envoler ou
épouvanter les oiseaux.
—Avant de mourir il parla en latin sans savoir le latin! Soyez
anéantis, pécheurs! Vous, malgré que vous
l’ayez étudié, que l’on vous ait donné
des coups pour vous le faire apprendre, vous ne parlez pas le latin,
vous mourrez sans le parler! Parler latin est une grâce de Dieu,
c’est pour cela que l’Église parle latin! Moi aussi
je parle latin! Comment? Dieu allait dénier cette consolation
à son cher Diego? Il pouvait mourir, il pouvait le laisser
mourir sans qu’il ait parlé latin? Impossible! Dieu
n’aurait pas été juste, il n’aurait pas
été Dieu! Diego parla donc latin, les auteurs de
l’époque nous en apportent le témoignage!—Et
il termina son exorde par le morceau qui lui avait coûté
le plus de travail et qu’il avait plagié d’un grand
écrivain, Sinibaldo de Mas.
—Je te salue donc, illustre Diego, honneur de notre [234]corporation! Tu fus l’exemple de toutes
les vertus, modeste avec honneur, humble avec noblesse, soumis avec
orgueil, sobre avec ambition, ennemi avec loyauté, compatissant
avec pardon, religieux avec scrupule, croyant avec dévotion,
crédule avec candeur, chaste avec amour, silencieux avec secret,
souffrant avec patience, vaillant avec crainte, continent avec
volupté, hardi avec résolution, obéissant avec
sujétion, honteux avec conscience du point d’honneur,
soigneux de tes intérêts avec détachement, adroit
avec capacité, cérémonieux avec urbanité,
astucieux avec sagacité, miséricordieux avec
piété, prudent avec honte, vindicatif avec courage,
pauvre par amour du travail avec résignation, prodigue avec
économie, actif avec négligence, économe avec
libéralité, simple avec pénétration,
réformateur avec suite, indifférent avec désir
d’apprendre: Dieu te créa pour goûter les
délices de l’amour platonique...! Aide-moi à
chanter tes grandeurs et ton nom plus haut que les étoiles et
plus pur que le soleil même qui tourne à tes pieds!
Aidez-moi, vous, demandez à Dieu l’inspiration suffisante
en récitant l’Ave Maria!
Tous s’agenouillèrent, un murmure s’éleva
comme le bourdonnement de mille moucherons. L’Alcalde plia
laborieusement un genou en remuant la tête avec ennui;
l’alférez était pâle et contrit:
—Au diable le curé! murmura un des deux jeunes gens qui
venaient de Manille.
—Silence! répondit l’autre, sa femme nous
écoute...
Pendant ce temps, au lieu de réciter l’Ave Maria, le P.
Dámaso, après avoir réprimandé son Esprit
Saint qui avait sauté trois des meilleurs paragraphes, prenait
deux meringues et un verre de Malaga, certain de trouver dans cette
légère collation plus d’inspiration que dans tous
les Esprits Saints possibles, qu’ils soient en bois, sous forme
de colombe, au dessus de sa tête, ou de chair et d’os, sous
la forme d’un moine distrait, à ses pieds. Il allait
commencer le sermon tagal. [235]
La vieille dévote donna une autre bourrade à sa petite
fille qui se réveilla de mauvaise humeur et demanda:
—Est-ce déjà le moment de pleurer?
—Pas encore; mais ne t’endors pas, petite damnée,
répondit la bonne grand’mère.
Sur cette deuxième partie du sermon, en langue tagale, nous
n’avons que des aperçus. Le P. Dámaso improvisait,
non pas qu’il sût mieux le tagal que le castillan, mais,
tenant les Philippins de la province pour fort ignorants en
rhétorique, il ne craignait pas de dire des sottises devant eux.
Avec les Espagnols, c’était autre chose: il avait entendu
parler des règles de l’éloquence et
peut-être, parmi ses auditeurs, pouvait-il s’en trouver,
comme l’Alcalde principal, par exemple, qui eussent fait leurs
classes: aussi écrivait-il ses sermons, les corrigeant, les
limant, puis les apprenant de mémoire et s’essayant
à les répéter deux ou trois jours avant de monter
en chaire.
Il est certain qu’aucun des assistants ne comprit
l’assemblage du sermon: ils avaient l’intelligence si
obtuse, le prédicateur était si profond, comme disait
sœur Rufa que c’est en vain qu’ils attendirent
l’occasion de pleurer et la petite fille damnée de la
vieille dévote se rendormit.
Mais cependant cette seconde partie eut des conséquences plus
graves que la première, au moins pour certains de nos
personnages.
Il commença avec un Maná capatir con
cristiano4, que suivit une avalanche de phrases intraduisibles;
il parla de l’âme, de l’enfer, du mahal na santo
pintacisi5, des pécheurs indiens et des vertueux
Pères Franciscains.
—Menche6! dit un des irrévérents
Manilènes à son compagnon; c’est du grec pour moi,
je m’en vais.
Et, voyant les portes fermées, il sortit par la sacristie
[236]au
grand scandale de l’assistance et du prédicateur qui
pâlit et s’arrêta au milieu de sa phrase.
Quelques-uns s’attendaient à une violente apostrophe, mais
le P. Dámaso se contenta de les suivre du regard et poursuivit
son sermon.
Des malédictions se déchaînèrent contre
le siècle, contre le manque de respect,
l’irréligiosité naissante. Ce point paraissait
être son fort, car il se montrait inspiré et
s’exprimait avec force et clarté. Il parla des
pécheurs qui ne se confessent pas, qui meurent en prison sans
sacrements, des familles maudites, des petits métis
orgueilleux et affectés, des jeunes savantasses,
philosophaillons7, avocaillons, étudiantillons,
etc. On connaît l’habitude de beaucoup lorsqu’ils
veulent ridiculiser leurs ennemis; ils ajoutent à chaque mot une
terminaison diminutive parce que leur cerveau ne leur fournit pas autre
chose; cela leur suffit, ils en sont très heureux.
Ibarra écouta tout et comprit les allusions. Conservant une
tranquillité apparente, ses yeux cherchaient Dieu et les
autorités, mais il n’y avait rien de plus que des images
de saints; quant à l’Alcalde il dormait.
Pendant ce temps, l’enthousiasme du prédicateur montait
par degrés. Il parlait des anciens temps où tout
philippin, rencontrant un prêtre, se découvrait, mettait
le genou en terre et lui baisait la main.—«Mais,
maintenant, ajouta-t-il, vous ne faites autre chose que quitter le
salakot ou le chapeau de castorillo8 que vous inclinez sur votre
tête pour ne pas déranger l’ordre de votre coiffure!
Vous vous contentez de dire: bonjour, among9, et il y a d’orgueilleux
étudiantillons, sachant quelque peu de latin qui, parce
qu’ils ont étudié à Manille et en Europe, se
croient le droit de nous [237]serrer la main au lieu de la baiser.... Ah! le
jour du jugement approche, le monde va finir, beaucoup de saints
l’ont prédit, il va pleuvoir du feu, des pierres et des
cendres pour châtier votre superbe!»
Et il exhortait le peuple à ne pas imiter ces
sauvages, mais à les fuir, à les détester,
parce qu’ils étaient excommuniés.
—Écoutez ce que disent les saints conciles: Quand
un indien rencontrera un curé dans la rue, il courbera la
tête et tendra le cou pour que l’among
s’appuie sur lui; si le curé et l’indien sont tous
deux à cheval, alors l’indien s’arrêtera et
retirera révérencieusement son salakot ou son
chapeau; enfin, si l’indien est à cheval et le curé
à pied, l’indien descendra de cheval et n’y
remontera pas jusqu’à ce que le curé lui ait dit:
sulung ou soit suffisamment éloigné. Voilà
ce que disent les saints conciles et qui ne leur obéira pas sera
excommunié!
—Et quand l’indien est monté sur un carabao?
demanda un paysan scrupuleux à son voisin.
—Alors.... il poursuit son chemin! répondit celui-ci
qui était un casuiste.
Mais, malgré les gestes et les cris du prédicateur,
beaucoup s’endormaient ou tout au moins n’écoutaient
plus, car ces sermons étaient de toujours et de partout; en vain
quelques dévotes essayèrent de soupirer et de pleurnicher
sur les péchés des impies, elles durent y renoncer,
personne ne faisant chœur avec elles... Même la sœur
Puté pensait à toute autre chose. Un homme assis à
son côté s’était si bien endormi qu’il
tomba sur elle en lui fripant son corsage: la bonne vieille prit son
sabot et, tapant sur l’homme pour le réveiller, lui
cria:
—Aïe! va-t’en, sauvage, animal, démon,
carabao, chien, damné!
Naturellement, un tumulte s’éleva. Le
prédicateur s’arrêta, leva les sourcils, surpris
d’un tel scandale. L’indignation étouffait la parole
dans sa gorge, il ne put que mugir en frappant la chaire de ses poings.
[238]L’effet voulu fut produit: la vieille
lâcha le sabot et, tout en grognant et en répétant
de multiples signes de croix, se mit très dévotement
à genoux.
—Ah! ah! ah! ah! put enfin s’écrier le
prêtre irrité, en croisant les bras et en remuant la
tête; c’est pour cela que je vous ai prêché
ici toute la matinée, sauvages! Ici, dans la maison de Dieu,
vous vous disputez, vous vous injuriez, polissons! Ah! ah! vous ne
respectez rien...! C’est l’œuvre de l’injure et
de l’incontinence du siècle! Je le disais bien, ah!
ah!..
Une fois lancé sur ce thème, il prêcha une
demi-heure encore! L’Alcalde ronflait, Maria Clara inclinait la
tête, la pauvrette ne pouvait résister au sommeil,
n’ayant plus de tableau à analyser pour se distraire.
Ibarra s’émotionnait peu de ce que disait le P.
Dámaso, ses allusions ne le touchaient pas; il voyait une petite
maison sur la cime d’une montagne avec Maria Clara dans le
jardin. Que lui importaient les hommes se traînant au fond de la
vallée dans leurs misérables pueblos.
Deux fois déjà le P. Salvi avait fait tinter la
sonnette; mais c’était verser de l’huile sur le feu:
le P. Dámaso était entêté, son sermon se
prolongeait toujours. Fr. Sibyla se mordait les lèvres;
plusieurs fois il mit et retira son lorgnon de cristal de roche
monté en or; Fr. Manuel Martin était le seul qui
paraissait écouter avec plaisir et souriait parfois.
Enfin, Dieu dit: Assez! L’orateur se lassa et descendit de la
chaire.
Tous s’agenouillèrent pour rendre grâce à
Dieu. L’Alcalde se frotta les yeux, étendit un bras comme
pour s’étirer, exhala un profond soupir et un
bâillement.
La messe continua.
Au moment où Balbino et Chananay chantant
l’Incarnatus est, tous s’étaient
agenouillés, où les curés inclinaient la
tête, un homme murmura à l’oreille d’Ibarra:
«A la cérémonie de la bénédiction de
la première [239]pierre, ne vous éloignez pas du
curé, ne descendez pas dans la fosse, ne vous approchez pas de
la pierre, il y va de votre vie!»
Ibarra reconnut Elias qui, ceci dit, se perdit aussitôt dans
la foule.
[Table des matières]
XXXII
La chèvre
L’homme jaune avait tenu parole: ce n’était pas
une simple chèvre qu’il avait construite sur la fosse
ouverte pour y descendre l’énorme masse de granit; ce
n’était pas le trépied que le señor Juan
avait édifié pour suspendre une poulie au sommet,
c’était quelque chose de plus; à la fois une
machine et un ornement, mais un ornement grandiose et une machine
impuissante.
L’échafaudage confus et compliqué
s’élevait à huit mètres de hauteur; quatre
gros madriers enfoncés dans le sol formaient les pièces
principales, reliés entre eux par de colossales solives
entrecroisées formant diagonales, réunies par de gros
clous enfoncés à moitié, sans doute afin de
pouvoir démonter plus facilement l’appareil.
D’énormes câbles, pendants de tous
côtés, donnaient un aspect de solidité et de
grandeur à l’ensemble, dont le sommet était
couronné de drapeaux aux couleurs bigarrées, de
banderoles flottantes et d’énormes guirlandes de fleurs et
de feuilles artistement tressées.
En haut, dans l’ombre des madriers, des guirlandes et des
drapeaux, pendait, assujettie par des cordes et des crocs de fer, une
extraordinaire poulie à trois roues, sur les bords brillants
desquelles passaient encastrés trois câbles encore plus
gros que les autres, portant suspendue l’énorme pierre de
taille creusée en son centre pour former, avec
l’excavation de l’autre pierre déjà descendue
dans la fosse, le petit espace destiné à conserver
l’historique [240]de la journée, journaux, écrits,
monnaies, médailles, etc., pour transmettre le tout aux plus
lointaines générations. Ces câbles descendaient de
bas en haut, retrouvaient une autre poulie non moins grosse
attachée au pied de l’appareil et allaient
s’enrouler autour du cylindre d’un treuil, supporté
par de gros madriers. Ce treuil, qui pouvait être mis en
mouvement par deux manivelles, centuplait l’effort
dépensé, grâce à un jeu de roues
dentées, dont le seul inconvénient était de faire
perdre en vitesse ce qu’il faisait gagner en force.
—Regardez, disait l’homme jaune en faisant tourner la
manivelle, regardez, señor Juan, comme avec mes seules forces,
je fais monter et descendre l’énorme pierre... Tout cela
est si bien disposé que je puis à volonté graduer,
pouce par pouce, l’ascension de façon que, du fond de la
fosse, un homme seul puisse en toute commodité ajuster les deux
pierres l’une sur l’autre, tandis que moi je dirigerai
d’ici la manœuvre.
Le señor Juan ne pouvait moins faire que d’admirer
l’homme qui se louait avec tant de complaisance. Les curieux
faisaient des commentaires et ne ménageaient pas leurs
compliments au constructeur.
—Qui vous a appris la mécanique? lui demanda le
señor Juan.
—Mon père, mon défunt père!
répondit-il avec son sourire particulier.
—Et à votre père?
—D. Saturnino, l’aïeul de D. Crisóstomo.
—Ne savez-vous pas que D. Saturnino...
—Oh! je sais beaucoup de choses! Non seulement il frappait ses
ouvriers et les exposait au soleil; mais il savait aussi
réveiller les endormis et faire dormir les
éveillés. Vous verrez par la suite ce que mon père
m’a enseigné, vous verrez!
Et l’homme jaune souriait toujours, de son étrange
sourire.
Sur une table couverte d’un tapis de Perse étaient
placés le cylindre de plomb et les objets qui devaient [241]être
conservés dans cette sorte de tombe; une boîte de cristal
à parois épaisses devait renfermer cette momie
d’une époque et garder pour l’avenir les souvenirs
d’un temps passé. Le philosophe Tasio, qui promenait par
là ses réflexions, murmurait:
—Peut-être quelque jour, quand l’œuvre qui
va naître aujourd’hui, vieillie après tant de
vicissitudes, tombera minée, soit par les secousses de la
nature, soit par la main de l’homme, sur ces ruines
croîtront le lierre et la mousse; puis, quand le temps aura
détruit la mousse, le lierre et les ruines, et dispersé
leur poussière au vent, biffant des pages de l’Histoire le
souvenir de l’œuvre et de ses constructeurs, depuis
longtemps déjà effacé de la mémoire des
hommes, peut-être, quand les habitants et le sol de ce pays
auront disparu, recouverts par de nouvelles couches géologiques,
le pic de quelque mineur, heurtant le granit d’où jaillit
l’étincelle, fera-t-il sortir de la roche des
mystères et des énigmes? Peut-être les savants de
la nation qui peuplera alors ces régions, travailleront-ils,
comme travaillent aujourd’hui les égyptologues, à
pénétrer les secrets des débris d’une
grandiose civilisation disparue, qui se croyait éternelle et ne
prévoyait pas que jamais une si longue et si profonde nuit
pût descendre sur elle? Peut-être alors quelque savant
professeur dira-t-il à ses élèves de cinq à
sept ans, dans un langage commun à tous les hommes de ce
temps-là: «Examinez, messieurs, et étudiez avec
soin les objets trouvés dans le sous-sol de notre terrain! nous
avons déchiffré quelques signes et traduit quelques mots,
et nous pouvons sans crainte présumer que ces objets
appartiennent à l’âge barbare de
l’humanité, à l’ère obscure que nous
sommes convenus d’appeler fabuleuse. En effet, messieurs, pour
que vous puissiez vous former une idée approximative de
l’état arriéré de nos ancêtres, il me
suffira de vous dire que ceux qui vivaient ici, non seulement
reconnaissaient encore des rois, mais que pour résoudre toutes
les questions de leur gouvernement intérieur ils devaient courir
à l’autre extrémité
[242]du monde; figurez-vous un
corps qui, pour se mouvoir, devrait consulter sa tête
située dans une autre partie du globe, peut-être dans une
région aujourd’hui recouverte par les vagues. Pour
invraisemblable que cela vous paraisse, il ne laissait pas, si nous
considérons leurs conditions d’existence, d’en
être ainsi pour ces êtres que j’ose à peine
appeler humains! En ces temps primitifs, ils étaient encore (ou
du moins croyaient être) en relations directes avec leur
Créateur, car ils avaient des ministres de celui-ci, êtres
différents des autres et toujours dénommés des
mystérieux caractères T. R. P. Fr., sur
l’interprétation desquels nos savants ne sont pas
d’accord. Suivant le professeur de langue que nous avons, et qui
ne parle guère plus d’une centaine des défectueux
idiomes du passé, T. R. P. signifierait Très Riche
Propriétaire, car ces ministres étaient des
espèces de demi-dieux, très vertueux, très
éloquents, très illustres, et qui, malgré leur
énorme pouvoir et leur grand prestige, ne commettaient jamais la
moindre faute, ce qui fortifierait ma croyance qu’ils
étaient d’une nature différente de celle du reste
du peuple. Et, si cela ne suffisait pas pour appuyer mon opinion, il me
resterait encore un argument: personne ne nie, et il se confirme de
plus en plus chaque jour, que ces êtres mystérieux
faisaient à leur volonté descendre Dieu sur la terre en
prononçant certaines paroles, que Dieu ne pouvait parler que par
leur bouche, qu’ils buvaient son sang, mangeaient sa chair et la
donnaient souvent à manger aussi aux hommes du
commun...»
Voilà le langage que, avec beaucoup d’autres
réflexions encore, l’incrédule philosophe mettait
dans la bouche des hommes corrompus de l’avenir...
Dans les kiosques qu’occupaient hier l’instituteur et
ses élèves, se prépare maintenant le repas
abondant et somptueux. Sur la table destinée aux enfants de
l’école, on ne voit pas une bouteille de vin, mais en
échange beaucoup de fruits. Dans l’allée
ombragée qui réunit les deux kiosques sont
disposés les sièges pour les musiciens [243]ainsi
qu’une table couverte de pâtisseries, de confitures et de
carafes d’eau, couronnées de feuilles et de fleurs pour le
public altéré.
Le maître d’école avait fait élever des
mâts de cocagne, des barrières, suspendre des
poêles, des marmites, pour d’allègres jeux.
La foule, en habits éclatants de couleurs joyeuses,
s’amoncelait, fuyant l’ardeur du soleil, soit à
l’ombre des arbres, soit sous les berceaux fleuris. Les enfants,
pour mieux voir la cérémonie, grimpaient aux branches,
escaladaient les pierres, suppléant ainsi à la petitesse
de leur taille; ils regardaient avec envie les élèves de
l’école qui, propres et bien vêtus, occupaient un
endroit spécialement réservé. Les parents
étaient enthousiasmés de voir, eux, simples paysans,
leurs fils manger sur une nappe blanche, presque aussi bien que le
curé ou l’alcalde. Il leur suffisait de penser à
cela pour se sentir rassasiés; le souvenir d’un tel
événement se transmettrait de père en fils.
On entendit bientôt les accords lointains de la musique: elle
s’avançait, précédée d’une
foule bigarrée où se mêlaient jeunes et vieux,
hommes et femmes, vêtus des couleurs les plus disparates.
L’homme jaune s’inquiéta, d’un regard il
examina toute sa construction. Un paysan curieux, qui observait avec
soin tous ses mouvements, suivit son regard; c’était
Elias. Lui aussi, était venu assister à la
cérémonie; son salakot et son rustique costume le
rendaient presque méconnaissable. Il était placé
au meilleur endroit, non loin du treuil, au bord de
l’excavation.
Derrière la musique venait l’Alcalde, la
municipalité, les moines, moins le P. Dámaso, et les
employés espagnols. Ibarra conversait avec l’Alcalde dont
il s’était fait un ami par quelques compliments bien
tournés sur ses cordons et ses décorations: les
fumées aristocratiques étaient le faible de Son
Excellence; Capitan Tiago, l’alférez, quelques riches
propriétaires accompagnaient la pléïade dorée
des jeunes filles dont brillaient [244]au soleil les ombrelles de soie. Le P.
Salvi suivait, toujours silencieux, toujours perdu dans ses
réflexions.
—Comptez sur mon appui chaque fois qu’il s’agira
d’une bonne action, disait l’Alcalde à Ibarra; je
vous en faciliterai toujours l’accomplissement, soit par
moi-même, soit indirectement.
A mesure qu’ils s’approchaient de l’endroit
désigné, le jeune homme sentait palpiter son cœur.
Instinctivement il jeta les yeux sur l’étrange
échafaudage qui y était élevé;
l’homme jaune, après l’avoir respectueusement
salué, fixa un instant son regard sur lui. La présence
d’Elias qu’il reconnut surprit
Ibarra; d’un coup d’œil significatif, le
mystérieux pilote lui rappela l’avertissement
déjà donné à l’église.
Le curé revêtit les vêtements sacerdotaux et
commença la cérémonie: le sacristain borgne tenait
le livre, un enfant de chœur était chargé du
goupillon et de l’eau bénite. Les assistants, debout et
découverts gardaient un si profond silence que, bien qu’il
lût à voix basse, on entendait la voix du P. Salvi
tremblant un peu.
Dans la boîte de cristal avaient été
placés les manuscrits, journaux, monnaies, médailles,
etc., qui devaient conserver le souvenir de cette journée; puis
la boîte elle-même fut enfermée dans le cylindre de
plomb scellé hermétiquement.
—Señor Ibarra, voulez-vous déposer la
boîte à sa place? Le curé vous attend! murmura
l’Alcalde à l’oreille du jeune homme.
—Ce serait avec grand plaisir, répondit celui-ci, mais
j’usurperais l’honneur d’accomplir ce devoir au
détriment du señor notaire qui doit dresser
procès-verbal de l’acte.
Le notaire prit gravement l’étui, descendit
l’escalier recouvert de tapis qui conduisait au fond de
l’excavation et, avec la solennité convenable,
déposa son fardeau dans le creux de la pierre. Le curé
saisit alors le goupillon et aspergea les pierres d’une
rosée d’eau bénite. [245]
Le moment était venu où chacun devait déposer
une cuillerée de ciment sur la superficie de la pierre
d’assise pour que l’autre s’y adaptât et
s’y fixât.
Ibarra présenta à l’Alcalde une truelle
d’argent sur laquelle était gravée la date de la
fête; mais, avant de s’en servir, S. E. prononça une
allocution en castillan:
«Habitants de S. Diego! dit-il d’une voix grave, nous
avons l’honneur de présider une cérémonie
dont, sans que nous ayons à vous l’expliquer, vous
comprenez toute l’importance. On fonde une école;
l’école est la base de la société,
l’école est le livre où est écrit
l’avenir des peuples! Montrez-nous l’école
d’un pueblo et nous vous dirons ce qu’il est.
»Habitants de S. Diego! Bénissez Dieu qui vous a
donné de vertueux prêtres et bénissez aussi le
Gouvernement de la Mère Patrie qui, inlassable, diffuse la
civilisation dans les îles fertiles que, pour les
protéger, elle recouvre de son glorieux manteau! Bénissez
Dieu qui a eu pitié de vous en vous envoyant ces humbles
prêtres pour vous éclairer et vous enseigner la parole
divine! Bénissez le Gouvernement qui a fait déjà,
qui fait et fera encore tant de sacrifices pour vous et pour vos
enfants!
»Et maintenant qu’a été bénite la
première pierre de cet important édifice, nous, Alcalde
Mayor de cette province, au nom de S. M. le Roi, que Dieu garde, Roi
des Espagnes, au nom de l’illustre Gouvernement espagnol et
à l’abri de son pavillon immaculé et toujours
victorieux, nous consacrons cet acte et commençons
l’édification de cette école!
»Habitants de S. Diego, vive le Roi! Vive l’Espagne!
vivent les Religieux! vive la religion catholique!»
—Vive! vive! répondirent de nombreuses voix, vive le
señor Alcalde!
Puis le haut fonctionnaire descendit majestueusement aux accords de
la musique qui commença à jouer, déposa quelques
cuillerées de plâtre sur la pierre et remonta aussi
majestueusement qu’il était descendu. [246]
Les employés applaudirent.
Ibarra offrit une autre cuiller d’argent au curé qui,
après avoir fixé un instant son regard sur lui, descendit
lentement à son tour. Arrivé au milieu de
l’escalier, le prêtre leva les yeux et examina
l’énorme pierre qui pendait maintenue par les câbles
puissants, mais il ne s’arrêta qu’une seconde et
continua sa descente. Il fit de même que l’Alcalde, mais
les applaudissements furent plus nombreux; aux employés
s’étaient joints quelques moines et Capitan Tiago.
Il semblait que le P. Salvi cherchât à qui offrir la
cuiller; il regarda avec hésitation Maria Clara, mais se
ravisant il la tendit au notaire. Celui-ci, par galanterie,
s’approcha de Maria Clara qui refusa en souriant. Les moines, les
employés, l’alférez descendirent tous l’un
après l’autre. Capitan Tiago n’avait pas
été oublié.
Restait Ibarra. Il allait ordonner que l’homme jaune fît
descendre la pierre, quand le curé se souvint du jeune homme,
lui disant d’un ton plaisant, affectant la
familiarité:
—Ne mettez-vous pas votre cuillerée, señor
Ibarra?
—Je serais un Juan Palomo, qui fit le ragoût et qui le
mangea! répondit celui-ci sur le même ton.
—Allez! dit l’Alcalde, en le prenant amicalement par le
bras, sinon je donne ordre qu’on ne descende pas la pierre et
nous resterons ici jusqu’au jour du jugement.
Une si terrible menace força Ibarra à obéir. Il
échangea la petite truelle d’argent contre une plus grande
en fer, ce qui fit sourire quelques personnes, et avança
tranquillement. Elias le regardait avec une expression
indéfinissable; il semblait que toute sa vie se fût
concentrée dans ses yeux. L’homme jaune examinait
l’abîme ouvert à ses pieds.
Ibarra après avoir jeté un rapide regard sur le bloc
suspendu au dessus de sa tête, puis un autre à Elias et
à l’homme jaune, dit au señor Juan d’une voix
tremblante: [247]
—Donnez-moi l’auge et cherchez-moi l’autre truelle
en haut.
Il restait seul. Elias ne le regardait plus. Ses yeux maintenant
étaient cloués sur la main de l’homme jaune qui,
penché sur la fosse, suivait anxieux les mouvements du jeune
homme.
On entendait le bruit de la truelle remuant la masse de sable et de
chaux, accompagnant le faible murmure des employés qui
félicitaient l’Alcalde pour son discours.
Tout à coup un bruit effroyable retentit; la poulie
attachée à la base de la chèvre sauta,
entraînant le treuil qui vint frapper l’appareil comme un
levier: les madriers vacillèrent, les cordes se rompirent et
tout l’appareil s’écroula au milieu d’un
fracas assourdissant. Un nuage de poussière
s’éleva; mille voix remplirent l’air d’un cri
d’horreur. Tous couraient, s’enfuyaient de tous
côtés; bien peu songeaient à descendre dans le
fossé. Seuls, Maria Clara et le P. Salvi restaient à leur
place, pâles, muets, incapables de se mouvoir.
Quand la poussière se fut quelque peu dissipée, on vit
Ibarra debout, parmi les solives, les poutres, les câbles, entre
le treuil et le bloc de pierre qui, dans sa chute, avait tout
défoncé, tout broyé. Le jeune homme avait encore
en main la truelle; avec des yeux épouvantés il regardait
un cadavre gisant à ses pieds, à demi enseveli sous les
pièces de bois.
—N’êtes-vous pas
blessé?—Vivez-vous?—Pour Dieu! parlez! lui criaient
quelques employés, avec autant d’intérêt que
de terreur.
—Miracle! miracle! s’exclamèrent quelques
assistants.
—Venez et dégagez le cadavre de ce malheureux! dit
Ibarra comme s’il se réveillait d’un songe.
Maria Clara, en entendant sa voix, sentit que les forces
l’abandonnaient; elle tomba presque sans connaissance dans les
bras de ses amies.
La plus grande confusion régnait; tous parlaient, [248]gesticulaient, couraient de côté
et d’autre, descendaient dans la fosse, remontaient,
consternés, ne sachant que faire.
—Qui est mort? respire-t-il encore? demanda
l’alférez.
On reconnut le cadavre: c’était celui de l’homme
jaune qui se trouvait debout à côté du treuil.
—Que l’on arrête le chef de chantier, fut la
première parole que l’Alcalde put prononcer.
On examina le cadavre, on lui mit la main sur la poitrine, le
cœur ne battait déjà plus. Le coup l’avait
frappé à la tête et le sang jaillissait par les
narines, la bouche et les yeux. Le cou portait des traces
étranges: quatre empreintes profondes d’un
côté et une quelque peu plus grande de l’autre: on
aurait dit qu’une main de fer l’avait serré comme
une tenaille.
Les prêtres serraient la main d’Ibarra et
chaleureusement le félicitaient d’avoir
échappé à la catastrophe. Le franciscain, humble
d’aspect, qui le matin avait servi d’Esprit-Saint au P.
Dámaso, disait avec des larmes dans les yeux:
—Dieu est juste! Dieu est bon!
—Quand je pense que quelques moments auparavant
j’étais là, disait un des employés à
Ibarra, dites! Si j’avais été le dernier!
Jésus!
—Cela me fait dresser les cheveux! reprenait un autre à
moitié chauve.
—Heureusement qu’on vous a donné la truelle
à vous, non à moi! murmurait un vieillard encore tout
tremblant.
—D. Pascal! s’écrièrent quelques
Espagnols.
—Señores, je disais ceci parce que le señor
Ibarra vit encore, tandis que moi, si je n’avais pas
été écrasé, je serais mort de peur.
Mais déjà Ibarra était parti s’informer
de Maria Clara.
Que cela n’empêche pas la fête de continuer,
señor de Ibarra! disait l’Alcalde; Dieu soit loué!
Le mort [249]n’est ni prêtre, ni espagnol! Il
n’y a qu’à fêter votre salut! Songez donc si
la pierre était tombée sur vous!
—Il avait des pressentiments! s’écriait le
notaire, je le disais; le señor Ibarra ne descendait pas avec
plaisir. Je le voyais bien!
—Ce n’est qu’un indien qui est mort!
—Que la fête continue! Allons, la musique! la tristesse
ne ressuscite pas les morts! Capitan, que l’on fasse
l’enquête...! Faites venir le directorcillo!...
Arrêtez le chef de chantier!
—Faut-il le mettre aux ceps?
—Oui, aux ceps! Eh! musique, musique! Aux ceps le chef de
chantier!
—Señor Alcalde, fit observer Ibarra avec
gravité, si la tristesse ne doit pas ressusciter le mort,
l’emprisonnement d’un homme dont la culpabilité ne
nous est pas prouvée fera moins encore. Je me porte garant de sa
personne et demande sa liberté, au moins pour ces
journées de fête.
—Bien! bien! mais qu’il ne recommence pas!
Des bruits de tous genres circulaient dans le peuple.
L’idée du miracle était admise par tous. Cependant
le P. Salvi paraissait peu satisfait de ce miracle que l’on
attribuait à un saint de sa paroisse et de son ordre.
Beaucoup ajoutèrent qu’ils avaient vu descendre dans la
fosse, au moment où tout s’écroulait, une figure
vêtue d’un costume obscur comme celui des franciscains.
Sans aucun doute, c’était S. Diego lui-même. On
supposa aussi qu’Ibarra avait entendu la messe à laquelle
l’homme jaune avait manqué: c’était clair
comme la lumière du soleil.
—Vois! tu ne voulais pas aller à la messe, disait une
mère à son fils; si je ne t’avais pas battu pour
t’y obliger, maintenant tu irais au tribunal dans la charrette,
comme celui-ci!
En effet, le cadavre de l’homme jaune, enveloppé
d’une natte, était conduit au tribunal.
Ibarra était parti chez lui pour changer de vêtements.
[250]
—Hein! c’est un mauvais commencement! disait en
s’éloignant le vieux Tasio.
[Table des matières]
XXXIII
Libre Pensée
Ibarra achevait de s’habiller quand un domestique lui
annonça qu’un paysan le demandait.
Supposant que c’était un de ses travailleurs, il
ordonna qu’on l’introduisît dans son bureau ou
cabinet de travail, en même temps bibliothèque et
laboratoire de chimie.
Mais, à sa grande surprise, il se trouva en face de la
sévère et mystérieuse figure d’Elias.
—Vous m’avez sauvé la vie, dit celui-ci en tagal,
comprenant le mouvement d’Ibarra; je vous ai payé à
moitié ma dette et vous n’avez pas à me remercier,
au contraire. Je suis venu pour vous demander une faveur...
—Parlez! répondit le jeune homme dans le même
idiome.
Elias fixa quelques secondes son regard dans les yeux d’Ibarra
et reprit:
—Quand la justice des hommes voudra éclaircir ce
mystère et vous demandera votre témoignage, je vous
supplie de ne parler à personne de l’avertissement que je
vous ai donné à l’église.
—Ne vous inquiétez pas, répondit
Crisóstomo avec un certain ennui, je sais que vous êtes
poursuivi, mais je ne suis pas un délateur.
—Oh! ce n’est pas pour moi! ce n’est pas pour moi!
s’écria vivement Elias, non sans quelque hauteur,
c’est pour vous: moi, je ne crains rien des hommes!
La surprise d’Ibarra s’augmenta encore; le ton dont lui
parlait ce paysan, cet ancien pilote, était nouveau [251]et semblait
n’être en rapport ni avec son état, ni avec sa
fortune.
—Que voulez-vous dire? demanda le jeune homme en interrogeant
du regard cet homme mystérieux.
—Je ne parle pas par énigmes; je veux m’expliquer
clairement. Pour assurer votre sécurité, il faut que vos
ennemis vous croient aveugle et confiant.
Ibarra recula.
—Mes ennemis? J’ai des ennemis?
—Nous en avons tous, señor, depuis le plus petit
insecte jusqu’à l’homme, depuis le plus pauvre et le
plus humble jusqu’au plus riche et au plus puissant! La haine est
la loi de la vie.
Ibarra silencieux regarda Elias.
—Vous n’êtes ni pilote ni paysan!..
murmura-t-il.
—Vous avez des ennemis dans les hautes comme dans les basses
sphères, continua Elias, sans paraître avoir entendu. Vous
méditez une grande entreprise; vous avez un passé: votre
père, votre grand-père ont eu des ennemis parce
qu’ils ont eu des passions; dans la vie ce ne sont pas les
criminels qui provoquent le plus de haine, ce sont les hommes
honorables.
—Vous connaissez mes ennemis?
Elias ne répondit pas immédiatement et
réfléchit.
—J’en connaissais un, celui qui est mort,
répondit-il. Hier soir, par quelques paroles
échangées entre lui et un inconnu qui se perdit dans la
foule, je découvris qu’il se tramait quelque chose contre
vous. «Celui-là, les poissons ne le mangeront pas comme
ils ont mangé son père, vous le verrez demain!»
avait-il dit. Ces mots attirèrent mon attention, aussi bien par
leur signification propre que par la personne de l’homme qui les
prononçait. Il y a quelques jours, cet individu
s’était présenté au chef de chantier en
s’offrant expressément pour diriger les travaux de pose de
la pierre, ne demandant pas un gros salaire, mais faisant
étalage de grandes connaissances. Je n’avais aucun motif
pour croire à de mauvais desseins de sa part, mais, en [252]moi,
quelque chose me disait que mes présomptions étaient
fondées. C’est pour cela que, voulant vous avertir,
j’ai choisi un moment et une occasion propices pour que vous ne
puissiez pas me questionner. Quant au reste, vous l’avez vu!
Elias s’était tu depuis un long moment, qu’Ibarra
ne lui avait pas encore répondu, n’avait pas
prononcé une seule parole.
—Je regrette que cet homme soit mort! dit-il enfin, par lui
j’aurais pu savoir quelque chose de plus!
—S’il avait vécu, il se serait
échappé de la tremblante main de l’aveugle justice
des hommes. Dieu l’a jugé! Dieu l’a tué! que
Dieu soit le seul Juge!
Crisóstomo regarda un instant l’homme qui lui parlait
ainsi et, découvrant ses bras musculeux, couverts de
meurtrissures et de contusions, il lui dit en souriant:
—Croyez-vous aussi au miracle? ce miracle dont parle le
peuple!
—Si je croyais aux miracles, je ne croirais pas en Dieu,
répondit Elias gravement; je croirais en un homme
déifié, je croirais qu’effectivement l’homme
a créé Dieu à son image et à sa
ressemblance; mais je crois en Lui, j’ai senti sa main plus
d’une fois. Au moment où l’échafaudage
s’écroulait, menaçant de destruction tout ce qui se
trouvait là, moi, je m’attachai au criminel, je me
plaçai à son côté; il fut frappé,
moi, je suis sain et sauf.
—Vous?... de sorte que vous..?
—Oui, quand son œuvre fatale commençant à
s’accomplir, il voulut s’échapper, je le maintins:
j’avais vu son crime. Je vous le dis: que Dieu soit
l’unique juge entre les hommes, qu’il soit le seul qui ait
droit sur la vie; que l’homme ne cherche jamais à se
substituer à lui!
—Et cependant, cette fois, vous...
—Non! interrompit Elias devinant l’objection, ce
n’est pas la même chose. Quand un homme en condamne [253]d’autres à mort ou brise pour
toujours leur avenir, il le fait à l’abri de la force des
autres hommes dont il dispose, tant pour se protéger que pour
exécuter des sentences qui, après tout, peuvent
être injustes et fausses. Mais moi, en exposant le criminel au
même péril qu’il avait préparé pour
les autres, je courais les mêmes risques. Je ne l’ai pas
frappé, j’ai laissé la main de Dieu le frapper!
—Vous ne croyez pas au hasard?
—Croire au hasard c’est croire au miracle; c’est
toujours supposer que Dieu ne connaît pas l’avenir.
Qu’est-ce que le hasard? Un événement que personne
n’avait prévu. Qu’est-ce que le miracle? Une
contradiction, un renversement des lois naturelles. Imprévision
et contradiction dans l’Intelligence qui dirige la machine du
monde, ce sont là deux grandes imperfections.
—Qui êtes-vous? demanda Ibarra avec une certaine
crainte; avez-vous fait des études?
—J’ai dû croire beaucoup en Dieu puisque
j’ai perdu la croyance dans les hommes, répondit le pilote
en éludant la question.
Ibarra crut qu’il comprenait la pensée de cet homme;
jeune et proscrit, il niait la justice humaine, il méconnaissait
le droit de l’homme à juger ses semblables, il protestait
contre la force et la supériorité de certaines classes
sur les autres.
—Mais il faut bien, reprit-il, que vous admettiez la justice
humaine, quelque imparfaite qu’elle puisse être.
Malgré tous les ministres qu’il a sur la terre. Dieu ne
peut exprimer, c’est-à-dire, n’exprime pas
clairement son jugement pour résoudre les millions de
contestations que suscitent nos passions. Il faut, il est
nécessaire, il est juste que l’homme juge quelquefois ses
semblables!
—Pour faire le bien, oui; non pour faire le mal; pour corriger
et améliorer, non pour détruire; parce que si ses
jugements sont erronés il n’a pas le pouvoir de
remédier au mal qu’il a fait. Mais, ajouta-t-il en [254]changeant
de ton, cette discussion est au-dessus de mes forces et je vous retiens
alors que l’on vous attend. N’oubliez pas ce que je viens
de vous dire: vous avez des ennemis, conservez-vous pour le bien de
votre pays.
Et il s’en alla.
—Quand vous reverrai-je? lui demanda Ibarra.
—Chaque fois que vous le voudrez et chaque fois que cela
pourra vous être utile. Je suis encore votre débiteur!
[Table des matières]
XXXIV
Le repas
Tous les grands personnages de la province sont réunis sous
le kiosque décoré et pavoisé.
L’Alcalde occupe une extrémité de la table;
Ibarra l’autre. A la droite du jeune homme est assise Maria
Clara, le notaire à sa gauche. Capitan Tiago,
l’alférez, les moines, les employés et les quelques
jeunes filles qui sont restées ont pris place au hasard, non
selon leur rang mais selon leurs affections.
Le repas était suffisamment animé et joyeux; on
était à la moitié environ du service
lorsqu’un employé des télégraphes entra et
remit une dépêche à Capitan Tiago qui,
naturellement, demanda la permission de la lire. Non moins
naturellement, tous l’en prièrent.
Le digne Capitan commença par froncer les sourcils, puis il
leva la tête: son visage pâlissait, s’illuminait,
puis il replia précipitamment la dépêche et se
levant:
—Señores, s’écria-t-il éperdu, Son
Excellence le capitaine général viendra tantôt
honorer ma maison de sa présence!
Et il se mit à courir, emportant la dépêche et
la serviette, mais oubliant son chapeau, poursuivi d’exclamations
et de questions. [255]
On lui aurait annoncé l’arrivée des tulisanes
qu’il eût certainement été moins
troublé.
—Mais écoutez!—Quand vient-il?—Dites-nous
donc?—Son Excellence!
Capitan Tiago était déjà loin.
—Son Excellence vient ici et c’est à Capitan
Tiago qu’elle demande l’hospitalité!
s’écrièrent quelques-uns, oubliant qu’ils
parlaient devant sa fille et son futur gendre.
—Le choix ne pouvait être meilleur! répondit
celui-ci.
Les moines se regardaient d’un œil qui voulait dire:
«Le capitaine général fait encore une des
siennes, il nous vexe; c’est au couvent qu’il devait
descendre». Mais tous se turent et personne n’exprima sa
pensée à ce sujet.
—On m’avait déjà parlé de ceci
hier, dit l’Alcalde, mais alors Son Excellence
n’était pas encore décidée.
—Savez-vous, señor Alcalde, combien de temps le
capitaine général pense rester ici? demanda
l’alférez inquiet.
—Avec certitude, non; Son Excellence aime faire des
surprises.
—Voici trois autres dépêches!
Elles étaient pour l’Alcalde, l’alférez et
le gobernadorcillo; identiques, elles annonçaient
l’arrivée du gouverneur; les moines remarquèrent
qu’aucune n’avait été adressée au
curé.
—Son Excellence arrivera à quatre heures du soir,
señores! dit solennellement l’Alcalde, nous pouvons
achever le repas tranquillement!
Léonidas ne peut certes avoir mieux dit: «Ce soir nous
souperons chez Pluton!»
La conversation reprit son cours ordinaire.
—Je remarque l’absence de notre grand
prédicateur! dit timidement l’un des employés,
brave homme d’aspect inoffensif, qui n’avait pas ouvert la
bouche de toute la journée et dont c’était le
premier mot. [256]
Ceux qui savaient l’histoire du père de
Crisóstomo firent un mouvement et eurent un clignement des
paupières significatif: «Allons, bon! pensaient-ils,
première parole, première sottise!» mais
quelques-uns, plus bienveillants répondirent:
—Il doit être quelque peu fatigué...
—Comment quelque peu, s’écria
l’alférez; il doit être rendu et, comme on dit ici,
malunqueado. Quel sermon!
—Un sermon superbe, gigantesque! opina le notaire.
—Magnifique, profond! ajouta le correspondant.
—Pour pouvoir tant parler, il faut avoir ses poumons! observa
le P. Manuel Martin.
L’augustin ne lui reconnaissait que de forts poumons.
—Et la facilité de s’exprimer, ajouta le P.
Salvi.
—Savez-vous que le señor Ibarra a le meilleur cuisinier
de la province? dit l’Alcalde coupant la conversation.
—Je me le disais, répondit un des employés, mais
sa belle voisine ne veut pas faire honneur à sa table, car
c’est à peine si elle a touché aux plats.
Maria Clara rougit et timidement balbutia:
—Je vous remercie, señor... vous vous occupez trop de
ma personne, mais...
—Mais votre seule présence est déjà un
suffisant honneur! conclut galamment l’Alcalde qui se retourna
vers le P. Salvi.
—Père curé, ajouta-t-il à haute voix, je
remarquai que toute la journée, Votre Révérence a
été muette et pensive...
—Le señor Alcalde est un terrible observateur!
s’écria le P. Sibyla d’un ton particulier.
—C’est mon habitude, balbutia le franciscain, je
préfère écouter que parler.
—Votre Révérence espère toujours gagner
et ne rien perdre! dit l’alférez un peu moqueur.
Le P. Salvi n’accepta pas la plaisanterie; son œil
brilla un moment puis il répliqua: [257]
—Le señor alférez sait bien, en ces jours-ci,
que ce n’est pas moi qui gagne ou qui perds le plus.
L’alférez dissimula le coup sous un éclat de
rire forcé et ne répondit rien, affectant
l’indifférence.
—Mais, señores, je ne comprends pas comment on peut
parler de gains ou de pertes, intervint l’Alcalde; que
penseraient de nous ces aimables et discrètes demoiselles qui
embellissent notre fête? Pour moi, les jeunes filles sont comme
les harpes éoliennes au milieu de la nuit; il n’y a
qu’à les écouter, à leur prêter
attentivement l’oreille, parce que leurs ineffables harmonies
élèvent l’âme vers les célestes
sphères de l’infini et de l’idéal.
—Votre Excellence est poète! dit gaiement le notaire;
et tous deux vidèrent leur verre.
—Je ne puis moins faire, dit l’Alcalde en
s’essuyant les lèvres; l’occasion, si elle ne fait
pas toujours le larron, fait le poète. En ma jeunesse j’ai
composé des vers, qui certainement n’étaient pas
mauvais.
—De telle sorte que, pour suivre Thémis, Votre
Excellence a été infidèle aux Muses! dit
emphatiquement notre mythique et sympathique correspondant.
—Psh! que voulez-vous dire? Parcourir toute
l’échelle sociale a toujours été mon
rêve. Hier je cueillais des fleurs et j’entonnais des
chansons, aujourd’hui j’ai pris la verge de la justice et
je sers l’humanité, demain...
—Demain, Votre Excellence jettera la verge au feu pour se
réchauffer dans l’hiver de la vie et prendra un
portefeuille de ministre, ajouta le P. Sibyla.
—Psh! oui... non... être ministre n’est pas
précisément mon idéal: le premier venu arrive
à l’être. Une villa dans le Nord pour passer
l’été, un hôtel à Madrid, quelques
propriétés en Andalousie pour l’hiver... Nous
vivrons en paix, nous souvenant de nos chères Philippines... De
moi, Voltaire n’aurait pas dit: Nous n’avons
été chez ces peuples que pour nous y enrichir et pour les
calomnier1. [258]
Les employés crurent que Son Excellence avait fait un bon mot
et se mirent à rire pour le célébrer; les moines
les imitèrent, car ils ne savaient pas que Voltaire était
le Voltaïré2 qu’ils avaient tant de fois
maudit et voué à l’enfer. P. Sibyla, lui, le
savait, et supposant que l’Alcalde avait soutenu quelque
hérésie ou proféré quelque
impiété, il affecta un air sérieux et
réservé.
Dans l’autre kiosque étaient les enfants. Ils
étaient plus bruyants que ne le sont d’ordinaire les
enfants philippins qui, à table ou devant des étrangers,
pèchent plutôt par timidité que par hardiesse. Si
l’un se servait mal de son couvert son voisin le corrigeait; de
là une discussion, tous deux avaient leurs partisans: pour les
uns tel ou tel objet était une cuiller, pour les autres une
fourchette ou un couteau, et, comme personne ne faisait
autorité, c’était un vacarme épouvantable;
on aurait cru assister à une discussion de
théologiens.
—Oui, disait une paysanne à un vieillard qui triturait
du buyo dans son kalikut3; bien que mon mari ne le veuille pas, mon Andoy
sera prêtre. Il est vrai que nous sommes pauvres, mais nous
travaillerons; s’il le faut nous demanderons
l’aumône. Beaucoup donnent de l’argent pour permettre
aux pauvres de se faire ordonner. Le frère Mateo, qui ne ment
jamais, n’a-t-il pas dit que le pape Sixte avait
été pasteur de carabaos à Batangas? Tiens!
regarde-le mon Andoy, regarde s’il n’a pas
déjà la figure de saint Vincent!
Et l’eau en venait à la bouche de la bonne mère
de voir son fils prendre sa fourchette à deux mains!
—Dieu nous aide! ajoutait le vieillard en mâchant le
sapâ; si Andoy arrive à être pape, nous irons
à Rome. Hé! hé! je peux encore bien marcher. Et si
je meurs... hé! hé! [259]
—N’ayez crainte, grand-père! Andoy
n’oubliera pas que vous lui avez enseigné à tresser
des paniers de roseaux et de dikines4.
—Tu as raison, Petra; moi aussi je crois que ton fils sera
quelque chose de grand..... au moins patriarche! Je n’en ai pas
vu d’autres qui ait appris l’office en moins de temps! Oui,
oui, il se rappellera de moi quand il sera Pape ou évêque
et qu’il s’amusera à faire des paniers pour sa
cuisinière. Il dira des messes pour mon âme, hé!
hé!
Et le bon vieillard, dans cette espérance, remplit son
kalikut de buyo.
—Si Dieu écoute mes prières et si mes
espérances s’accomplissent, je dirai à Andoy: Fils,
enlève-nous nos péchés et envoie-nous au Ciel.
Nous n’aurons plus besoin de prier, de jeûner ni
d’acheter des bulles. Quand on a un saint Pape pour fils, on peut
commettre des péchés!
—Envoie-le demain chez moi, Petra, dit enthousiasmé le
vieillard; je vais lui montrer à labourer le nitô5!
—Hem! bah! que croyez-vous donc, grand-père?
Pensez-vous que les Papes travaillent des mains? Le curé, bien
qu’il ne soit qu’un curé, ne travaille
qu’à la messe... quand il se retourne!
L’archevêque, lui, ne se retourne pas; il dit la messe
assis; et le Pape... le Pape doit la dire dans le lit, avec un
éventail! Que vous imaginiez-vous donc!
—Rien de plus, Petra, seulement j’aimerais qu’il
sût comment se prépare le nitô. Il est bon
qu’il puisse vendre des salakots et des bourses à tabac
pour n’avoir pas besoin de demander l’aumône comme le
curé le fait ici tous les ans au nom du Pape. Cela me fait peine
de voir si pauvre ce saint homme et je donne toujours tout ce que
j’ai économisé.
Un autre paysan s’approcha en disant:
[260]
—C’est décidé, cumare6, mon fils doit
être docteur; il n’y a rien de tel que d’être
docteur!
—Docteur! taisez-vous, cumpare, répondit la
Petra; il n’y a rien de tel que d’être
curé!
—Curé? prr! curé? Le docteur gagne beaucoup
d’argent; les malades le vénèrent, cumare!
—Merci bien! Le curé, pour faire deux ou trois tours et
dire déminos pabiscum, mange le bon Dieu et reçoit
de l’argent. Tous, même les femmes, lui racontent leurs
secrets.
—Et le docteur! que croyez-vous donc qu’est le docteur?
Le docteur voit tout ce qu’ont les femmes, il tâte le pouls
des filles... Je voudrais bien être docteur seulement une
semaine!
—Et le curé? peut-être que le curé
n’en voit pas autant que votre docteur? Et encore mieux! Vous
savez le refrain: poule grasse et jambe ronde sont pour le
curé!
—Quoi? est-ce que les médecins mangent des sardines
sèches? est-ce qu’ils s’abîment les doigts
à manger du sel?
—Est-ce que le curé se salit les mains comme vos
médecins? C’est pour cela qu’il a de grandes fermes
et, quand il travaille, il travaille avec de la musique et les
sacristains l’aident.
—Et confesser, cumare, n’est-ce pas un travail!
—En voilà un ouvrage! Je voudrais confesser tout le
monde. Nous nous donnons beaucoup de mal pour arriver à savoir
ce que font les hommes et les femmes et les affaires de nos voisins! Le
curé n’a qu’à s’asseoir; on lui raconte
tout. Parfois il s’endort, mais il murmure deux ou trois
bénédictions et nous sommes de nouveau fils de Dieu! Je
voudrais bien être curé pendant une seule
après-midi de carême!
—Et le... le prêcher? vous ne me direz pas que ce
n’est pas un travail. Voyez donc, comme le grand curé
[261]suait
ce matin! objecta l’homme, qui ne voulait pas battre en
retraite.
—Le prêcher? Un travail? Où avez-vous la
tête? Je voudrais parler pendant une demi-journée du haut
de la chaire en grondant tout le monde, en me moquant de tous, sans que
personne ne se risque à répliquer et encore être
payé, par dessus le marché! Oui, je voudrais être
curé seulement une matinée quand ceux qui me doivent sont
à la messe! Voyez, voyez le P. Dámaso comme il engraisse
à toujours crier et frapper!
En effet, le P. Dámaso arrivait, de cette marche
particulière à l’homme gras, à moitié
souriant, mais d’une manière si maligne qu’en le
voyant Ibarra, qui était en train de parler, perdit le fil de
son discours.
On fut étonné de voir le P. Dámaso, mais tout
le monde, excepté Ibarra, le salua avec des marques de plaisir.
On en était au dessert et le Champagne moussait dans les
coupes.
Le sourire du P. Dámaso devint nerveux quand il vit Maria
Clara assise à la droite de Crisóstomo; mais, prenant une
chaise à côté de l’Alcalde, il demanda au
milieu d’un silence significatif:
—Vous parliez de quelque chose, señores, continuez!
—Nous en étions aux toasts, répondit
l’Alcalde. Le señor de Ibarra mentionnait ceux qui
l’avaient aidé dans sa philanthropique entreprise et il
parlait de l’architecte, quand Votre
Révérence...
—Eh bien! moi je n’entends rien à
l’architecture, interrompit le P. Dámaso, mais je me moque
des architectes et des nigauds qui s’en servent. Ainsi,
j’ai tracé le plan d’une église et elle a
été parfaitement construite; c’est un bijoutier
anglais qui logea un jour au couvent qui me l’a dit. Pour tracer
un plan, il suffit d’avoir deux doigts d’intelligence!
—Cependant, répondit l’Alcalde, en voyant
qu’Ibarra se taisait, quand il s’agit de certains
édifices, comme d’une école par exemple, il faut un
homme expert... [262]
—Quel expert, quelles expertes! s’écria avec
ironie le P. Dámaso. Celui qui a besoin d’experts est un
petit chien7!
Il faut être plus brute que les Indiens qui bâtissent
eux-mêmes leurs propres maisons, pour ne pas savoir construire
quatre murs et placer une charpente dessus; c’est tout ce
qu’il faut pour une école!
Tous regardèrent Ibarra, mais celui-ci, bien qu’il ait
un peu pâli, poursuivait sa conversation avec Maria Clara.
—Mais Votre Révérence
considère-t-elle?...
—Voyez, continua le franciscain sans laisser causer
l’Alcalde, voyez comment un de nos frères lais, le plus
bête que nous ayons, a construit un bon hôpital, beau et
à bon marché. Il faisait beaucoup travailler et ne payait
pas plus de huit cuartos par jour les ouvriers, qui, de plus devaient
venir d’autres pueblos. Celui-là savait s’y prendre,
il ne faisait pas comme beaucoup de ces jeunes écervelés,
de ces petits métis, qui perdent les ouvriers en leur payant
trois ou quatre réaux.
—Votre Révérence dit que l’on ne donnait
que huit cuartos? c’est impossible! dit l’Alcalde pour
changer le cours de la conversation.
—Si, señor, et c’est ce que devraient faire aussi
ceux qui se targuent d’être bons Espagnols. On voit bien
que, depuis l’ouverture du canal de Suez, la corruption est venue
jusqu’ici. Autrefois, quand on devait doubler le Cap, il ne
venait pas tant d’hommes perdus et il n’y en avait pas tant
qui allassent se perdre là-bas!
—Mais, P. Dámaso...!
—Vous connaissez bien l’indien; aussitôt
qu’il a appris quelque chose, il se donne du docteur. Tous ces
blancs-becs qui s’en vont en Europe...
—Mais! que Votre Révérence écoute...!
interrompit l’Alcalde qui s’inquiétait de la
dureté de ces paroles.
—Tous finissent comme ils le méritent, continua-t-il,
[263]la
main de Dieu est là, il faut être aveugle pour ne pas la
voir. Déjà, dans cette vie, les pères de tous ces
serpents reçoivent leur châtiment... ils meurent en
prison! hé!...
Il n’acheva pas. Ibarra, livide, l’avait suivi du
regard; en entendant l’allusion à la mort de son
père, il se leva, sauta d’un seul bond, et sa robuste main
s’abattit sur la tête du moine qui,
hébété, tomba à la renverse.
La surprise, la terreur clouèrent à leur place tous
les assistants; aucun n’osait intervenir.
—N’approchez pas! cria le jeune homme d’une voix
terrible, en tirant un couteau effilé, tandis qu’il
maintenait du pied le cou du prêtre revenu de son
étourdissement. Que celui qui ne veut pas mourir ne
s’approche pas!
Ibarra était hors de lui, son corps tremblait, ses yeux
menaçants sortaient de leurs orbites. Fr. Dámaso,
d’un effort, se souleva mais le jeune homme, lui prenant le cou,
le secoua jusqu’à ce qu’il l’eût
plié à genoux.
—Señor de Ibarra! Señor de Ibarra!
balbutièrent quelques assistants.
Mais personne, même l’alférez, ne se risquait
à s’approcher; ils voyaient le couteau briller, ils
calculaient la force de Crisóstomo, décuplée par
la colère. Tous se sentaient paralysés.
—Vous tous, ici, vous n’avez rien dit! maintenant, cela
me regarde! Je l’ai évité, Dieu me l’apporte!
que Dieu juge!
Le jeune homme respirait avec effort; mais son bras de fer
maintenait durement le franciscain qui luttait en vain pour se
dégager.
—Mon cœur bat tranquille, ma main est sûre...
Et il regarda autour de lui.
—Avant tout, je vous le demande, y a-t-il parmi vous
quelqu’un qui n’ait pas aimé son père, qui
ait haï sa mémoire, quelqu’un né dans la honte
et dans l’humiliation?... Vois, écoute ce silence!
Prêtre d’un Dieu [264]de paix, dont la bouche est pleine de
sainteté et de religion et le cœur de misères, tu
ne dois pas savoir ce que c’est qu’un père... tu
aurais pensé au tien! Vois! dans toute cette foule que tu
méprises il n’y en a pas un comme toi! Tu es
jugé!
Ceux qui l’entouraient, croyant qu’il allait frapper,
firent un mouvement.
—N’approchez pas! cria-t-il de nouveau d’une voix
menaçante. Quoi? Vous craignez que je ne tache ma main
d’un sang impur? Ne vous ai-je pas dit que mon cœur battait
tranquille? Loin de nous, tous! Écoutez, prêtres, juges,
qui vous croyez différents des autres hommes et vous attribuez
d’autres droits! Mon père était un homme honorable,
demandez-le à ce pays qui vénère sa
mémoire. Mon père était un bon citoyen; il
s’est sacrifié pour moi et pour le bien de sa patrie. Sa
maison était ouverte, sa table mise pour recevoir
l’étranger ou l’exilé qui recourait à
lui dans sa misère! Il était bon chrétien,
toujours il a fait le bien, jamais il n’a opprimé le
faible ni fait pleurer le misérable... Quant à celui-ci,
il lui a ouvert la porte de sa maison, l’a fait asseoir à
sa table et l’a appelé son ami. Comment cet homme lui
a-t-il répondu? Il l’a calomnié, il l’a
poursuivi, il a armé contre lui l’ignorance; se
prévalant de la sainteté de son emploi, il a
outragé sa tombe, déshonoré sa mémoire, sa
haine a troublé même le repos de la mort. Et non satisfait
encore, il poursuit le fils maintenant! Je l’ai fui, j’ai
évité sa présence... Vous l’entendiez ce
matin profaner la chaire, me signaler au fanatisme populaire, et moi,
je n’ai rien dit. A l’instant, il vient ici me chercher
querelle; à votre surprise, j’ai souffert en silence; mais
voici que, de nouveau, il insulte une mémoire sacrée pour
tous les fils... Vous tous qui êtes ici, prêtres, juges,
avez-vous vu votre vieux père s’épuiser en
travaillant pour vous, se séparer de vous pour votre bien,
mourir de tristesse dans une prison, soupirant après le moment
où il pourrait vous embrasser, cherchant un être qui lui
apporte [265]une consolation, seul, malade, tandis que vous
à l’étranger...? Avez-vous ensuite entendu
déshonorer son nom, avez-vous trouvé sa tombe vide quand
vous avez voulu prier sur elle? Non? Vous vous taisez, donc vous le
condamnez!
Il leva le bras. Mais une jeune fille, rapide comme la
lumière, se jeta entre le prêtre et lui et, de ses mains
délicates, arrêta le bras vengeur: c’était
Maria Clara.
Ibarra la regarda d’un œil qui semblait refléter
la folie. Peu à peu ses doigts crispés
s’étendirent, il laissa tomber le corps du franciscain,
abandonna le couteau, puis se couvrant la figure de ses deux mains,
s’enfuit à travers la multitude.
[Table des matières]
XXXV
Commentaires
Le bruit de l’événement se répandit bien
vite dans le pueblo. D’abord personne ne voulait y croire, mais
quand il n’y eut plus moyen de douter, ce furent des exclamations
de surprise.
Chacun, selon le degré de son élévation morale,
faisait ses commentaires.
—Le P. Dámaso est mort! disaient quelques-uns; quand on
l’a emporté, il avait déjà la figure
inondée de sang et ne respirait plus.
—Qu’il repose en paix, mais il n’a que payé
sa dette! s’écriait un jeune homme. Ce qu’il a fait
ce matin au couvent n’a pas de nom.
—Qu’a-t-il fait? Il a voulu battre le vicaire?
—Qu’a-t-il fait? Voyons! Racontez-nous cela.
—Vous avez vu ce matin un métis espagnol sortir par la
sacristie pendant le sermon?
—Oui, nous l’avons vu! Le P. Dámaso l’a
bien regardé. [266]
—Eh bien! après le sermon, il l’a fait appeler et
lui a demandé pourquoi il était sorti. «Je ne
comprends pas le tagal, Père», répondit le jeune
homme.
«Et pourquoi t’es-tu moqué de moi en disant que
c’était du grec?» lui cria le P. Dámaso en
lui donnant un soufflet. L’autre riposta, ce fut une bataille
à coups de poings jusqu’à ce qu’on fût
venu les séparer.
—Si cela m’arrivait.., murmura un étudiant entre
ses dents.
—Je n’approuve pas ce qu’a fait le franciscain,
répondit un autre, car la Religion n’est ni un
châtiment ni une pénitence et ne doit s’imposer
à personne; mais je le louerais presque, parce que je connais ce
jeune homme, je sais qu’il est de S. Pedro Macati et qu’il
parle bien le tagal. Maintenant, il veut qu’on le croie
nouvellement arrivé de Russie, et il s’honore
d’ignorer en apparence la langue de ses parents.
—Alors, Dieu les a créés et ils se battent!
—Cependant, nous devons protester contre le fait,
s’écria un autre étudiant: se taire, serait
consentir à ce qu’il se renouvelât avec
quelqu’un de nous. Sommes-nous revenus au temps de
Néron?
—Tu te trompes! lui répliqua l’autre.
Néron était un grand artiste et le P. Dámaso est
un bien mauvais prédicateur!
Les commentaires des personnes d’âge étaient tout
autres.
Tandis que l’on attendait l’arrivée du capitaine
général, dans une petite maison, hors du pueblo, le
gobernadorcillo disait:
—Dire qui a tort et qui a raison n’est pas facile: mais
cependant, si le señor Ibarra avait été plus
prudent...
—Vous voulez dire, probablement: si le P. Dámaso avait
eu la moitié de la prudence du señor Ibarra, interrompit
D. Filipo. Le malheur est que les rôles ont été
intervertis; le jeune homme s’est conduit comme un vieillard et
le vieillard comme un jeune homme. [267]
—Et vous dites que personne n’a bougé, que
personne n’est venu les séparer, si ce n’est la
fille du Capitan Tiago? demanda le Capitan Martin. Ni un moine, ni
l’Alcalde? Hein! C’est bien pis! Je ne voudrais pas
être dans la peau du jeune homme. Personne de ceux qui ont eu
peur de lui ne le lui pardonnera! C’est bien pis! Hein!
—Croyez-vous? demanda avec intérêt le Capitan
Basilio.
—J’espère, dit D. Filipo, échangeant un
regard avec ce dernier, que le pueblo ne va pas l’abandonner.
Nous devons penser à ce qu’a fait sa famille, à ce
que lui-même faisait en ce moment. Et si, par hasard, la crainte
faisait taire tout le monde, ses amis...
—Mais, señores, interrompit le gobernadorcillo, que
pouvons-nous faire? que peut le pueblo? Quoi qu’il arrive, les
moines ont toujours raison!
—Ils ont toujours raison parce que nous leur donnons
toujours raison, répondit D. Filipo avec impatience, en
appuyant sur le mot «toujours»; donnons-nous donc raison
à nous-mêmes, une bonne fois, puis ensuite nous
causerons!
Le gobernadorcillo secoua la tête et répondit
d’une voix aigre:
—Ah! la chaleur du sang! il semble que vous ne sachiez pas
dans quel pays nous sommes; vous ne connaissez pas nos compatriotes.
Les moines sont riches, ils sont unis; nous sommes pauvres et
divisés. Oui! essayez de le défendre et vous verrez comme
on vous laissera vous compromettre tout seul!
—Oui, s’écria amèrement D. Filipo, cela
sera tant que l’on pensera ainsi, tant que l’on croira que
crainte et prudence sont synonymes. On s’attend plutôt au
mal possible qu’au bien nécessaire; on a peur et non
confiance; chacun ne songe qu’à lui, personne aux autres
et c’est pourquoi nous sommes si faibles!
—Eh bien! pensez aux autres plus qu’à
vous-même et vous verrez comme les autres nous laisseront pendre.
[268]Ne
connaissez-vous pas le proverbe espagnol: Charité bien
ordonnée commence par soi-même?
—Il serait mieux de dire, répondit le lieutenant
exaspéré, que la couardise bien entendue commence par
l’égoïsme et finit par la honte! Aujourd’hui
même je donne ma démision à l’Alcalde:
j’en ai assez de passer pour ridicule sans être utile
à personne... Adieu!
Les femmes pensaient autrement.
—Aïe! soupirait une d’elles dont la figure
était plutôt bienveillante, les jeunes gens seront
toujours les mêmes! Si sa bonne mère vivait encore, que
dirait-elle? Ah, mon Dieu! quand je pense que mon fils, qui a aussi la
tête brûlée, pourrait faire de même... Ah,
Jésus! j’envie presque sa défunte mère....
j’en mourrais de chagrin!
—Eh bien, moi, non! répondit une autre femme, je
n’en voudrais pas à mes deux fils s’ils faisaient de
même.
—Que dites-vous, Capitana Maria? s’écria la
première en joignant les mains.
—J’aime les fils qui défendent la mémoire
de leurs parents. Capitana Tinay, que diriez-vous si, plus tard, veuve,
on parlait mal de votre mari en votre présence et que votre fils
Antonio baissât la tête et se tût?
—Je lui refuserais ma bénédiction!
s’écria une troisième, la sœur Rufa,
mais...
—Lui refuser la bénédiction, jamais! interrompit
la bonne Capitana Tinay, une mère ne doit pas dire cela... mais,
je ne sais pas ce que je ferais... je ne sais pas...; je crois que
j’en mourrais... lui... non! mon Dieu! mais je ne voudrais plus
le voir... mais, à quoi pensez-vous, Capitana Maria?
—Malgré tout, ajouta sœur Rufa, on ne doit pas
oublier que c’est un grand péché de mettre la main
sur une personne sacrée.
—L’honneur des parents est plus sacré encore!
répliqua la Capitana Maria. Personne, même le Pape, et
moins encore le P. Dámaso, ne peut profaner une si sainte
mémoire. [269]
—C’est vrai! murmura la Capitana Tinay admirant la
science de toutes deux; d’où tirez-vous tant de bonnes
raisons?
—Mais, et l’excommunication, et la damnation?
répliqua la Rufa. Que sont les honneurs et le bon renom dans
cette vie si nous nous damnons dans l’autre? Tout passe vite...
mais l’excommunication... outrager un ministre de
Jésus-Christ... il n’y a que le Pape qui puisse
l’absoudre!
—Dieu l’absoudra, lui qui a commandé
d’honorer son père et sa mère; Dieu ne
l’excommuniera pas! Et je vous le dis: si ce jeune homme vient
chez moi, je le recevrai et je lui parlerai; si j’avais une
fille, je le voudrais pour gendre. Celui qui est bon fils sera bon mari
et bon père, croyez-le, sœur Rufa!
—Eh bien! je ne pense pas comme vous; dites ce que vous
voudrez, bien qu’il me semble que vous ayez raison, je croirai
toujours le curé plutôt que vous. Avant tout, je sauve mon
âme! Que dites-vous, Capitana Tinay?
—Ah! que voulez-vous que je dise! Vous avez toutes deux
raison; le curé aussi, et Dieu doit de même avoir raison!
Je ne sais pas, je ne suis rien qu’une bête... Ce que je
vais faire, c’est de dire à mon fils qu’il
n’étudie plus! On dit que les savants meurent tous pendus!
Très Sainte Marie! mon fils qui voulait aller en Europe!
—Que pensez-vous faire?
—Lui dire qu’il reste près de moi; pourquoi en
savoir plus long? Demain ou après nous mourrons; le savant meurt
comme l’ignorant... la question est de vivre en paix.
Et la bonne femme soupirait et levait les yeux au ciel.
—Eh bien! moi, dit gravement la Capitana Maria, si
j’étais riche comme vous, je laisserais mes enfants
voyager; ils sont jeunes, ils doivent être hommes un jour... moi
je n’ai plus longtemps à vivre... Nous nous [270]reverrions dans
l’autre vie... les fils doivent aspirer à être
quelque chose de plus que leurs pères et s’ils restent
auprès de nous, nous ne leur enseignons qu’à
être des enfants.
—Quelles idées avez-vous! s’écria
épouvantée la Capitana Tinay, en joignant les mains; il
semble que vous n’ayez pas souffert pour enfanter vos deux
jumeaux!
—C’est justement parce que j’ai souffert pour les
mettre au monde, parce que je les ai élevés et instruits,
malgré notre pauvreté, que je ne veux pas, après
tout ce qu’ils m’ont coûté, les voir rester
à moitié hommes...
—Il me semble que vous n’aimez pas vos fils comme Dieu
le commande! dit d’un ton quelque peu aigre la sœur
Rufa.
—Pardonnez! chaque mère aime ses fils à sa
manière: les unes les aiment pour ceci, les autres pour cela et
quelques-unes pour elles-mêmes. Je suis de ces dernières,
mon mari m’a appris à être ainsi.
—Toutes vos idées, Capitana Maria, sont peu
religieuses, dit la sœur Rufa, comme si elle prêchait.
Faites-vous sœur du Très Saint Rosaire, de S.
François, de sainte Rita ou de sainte Clara!
—Sœur Rufa, quand je serai la digne sœur des
hommes, je tâcherai d’être la sœur des saints!
répondit la Maria en souriant.
Pour achever ce chapitre de commentaires, et pour que les lecteurs
voient immédiatement ce que pensaient du fait les simples
paysans, nous irons à la place où, sous la tente,
conversent quelques-uns d’entre eux, parmi lesquels celui qui
rêvait des docteurs en médecine.
—Ce qui m’ennuie le plus, disait-il, c’est que
l’école ne sera pas terminée.
—Comment? comment? lui demandèrent les autres avec
intérêt.
—Mon fils ne sera pas docteur, mais charretier! Il n’y a
plus rien, il n’y aura pas d’école!
—Qui vous dit qu’il n’y aura pas
d’école? fit un [271]rude et robuste paysan aux larges
mâchoires, au crâne étroit.
—Moi! Les Pères blancs ont appelé D.
Crisóstomo plibastiero1. Il n’y a plus d’école!
Tous s’interrogèrent du regard. Le nom était
nouveau pour eux.
—Et, c’est mauvais ce nom? se risqua enfin à
demander le rude paysan.
—C’est le pire qu’un chrétien puisse donner
à un autre!
—Pire que tarantado et saragate2?
—Si ce n’était pire que cela, ce ne serait pas
grand’chose! On m’a appelé plusieurs fois ainsi et
cela ne m’a pas coupé l’appétit.
—Allons donc, ce ne serait pas pire que indio3, comme dit
l’alférez?
Celui dont le fils devait être charretier s’assombrit,
l’autre secoua la tête et réfléchit.
—Alors ce serait aussi mauvais que betelapora4, comme dit la vieille
de l’alférez? C’est pire que de cracher sur
l’hostie?
—Oui, pire que de cracher sur l’hostie le Vendredi
Saint, répondit l’autre gravement. Vous vous souvenez du
mot ispichoso5, qu’il suffisait d’appliquer à un
homme pour que les gardes civils de Villa-Abrille l’emmenassent
en exil ou en prison; eh bien! plebestiero est pire encore!
Selon ce que disent le télégraphiste et le
sous-directeur, plibestiro, dit par un chrétien, un
curé ou un Espagnol à un autre chrétien comme
nous, ressemble à un sanstudeus avec
requimiternam6; [272]si on t’appelle une seule fois
plibustiero, tu peux te confesser et payer tes dettes car il ne te
reste rien à faire que de te laisser pendre. Tu sais si le
sous-directeur et le télégraphiste doivent être
renseignés: l’un parle avec des fils de fer et
l’autre sait l’espagnol et ne manie que la plume.
Tous étaient atterrés.
—Qu’on m’oblige à mettre des souliers et
à ne plus boire de ma vie que cette urine de cheval qu’on
appelle de la bière, si je me laisse jamais dire
pelbistero! jura le paysan en serrant les poings. Quoi! si
j’étais riche comme D. Crisóstomo, sachant
l’espagnol comme lui et pouvant manger vite avec un couteau et
une cuiller, je me moquerais bien de cinq curés!
—Le premier garde civil que je verrai en train de voler une
poule, je l’appelerai palabisterio... et je me confesserai
ensuite! murmura à voix basse un des paysans, en
s’éloignant du groupe.
[Table des matières]
XXXVI
Le premier nuage
La maison de Capitan Tiago n’était pas moins
troublée que l’imagination des gens. Maria Clara, se
refusant à écouter les consolations de sa tante et de sa
sœur de lait, Andeng, ne faisait que pleurer. Son père lui
avait défendu de causer avec Ibarra, tant que les prêtres
n’auraient pas levé l’excommunication.
Capitan Tiago, très occupé à tout
préparer pour recevoir dignement le capitaine
général avait été appelé au
couvent.
—Ne pleure pas, ma fille, disait tante Isabel en passant une
peau de chamois sur les miroirs, on lèvera son excommunication,
on écrira au Saint-Pape... nous [273]ferons une grande aumône...
le P. Dámaso n’a eu qu’un évanouissement...
il n’est pas mort!
—Ne pleure pas, lui disait Andeng à voix basse, je
m’arrangerai pour que tu lui parles; pourquoi sont faits les
confessionnaux sinon pour que l’on puisse pécher? Tout est
pardonné quand on l’a dit au curé!
Enfin, Capitan Tiago revint! Elles cherchèrent sur sa figure
une réponse à beaucoup de questions; mais la figure de
Capitan Tiago annonçait le découragement. Le pauvre homme
suait, se passait la main sur le front et semblait ne pouvoir articuler
une parole.
—Qu’y a-t-il, Santiago? demanda anxieuse la tante
Isabel.
Il répondit par un soupir en essuyant une larme.
—Pour Dieu, parle! qu’y a-t-il?
—Ce que je craignais déjà! dit-il enfin en
retenant ses larmes. Tout est perdu! Le P. Dámaso
m’ordonne de rompre la promesse de mariage, sinon il me condamne
dans cette vie et dans l’autre! Tous me disent la même
chose, même le P. Sibyla! Je dois lui fermer les portes de ma
maison et... je lui dois plus de cinquante mille pesos! Je l’ai
dit aux Pères, mais ils n’ont pas voulu en faire cas: que
préfères-tu perdre, m’ont-ils dit, cinquante mille
pesos ou ta vie et ton âme? Ah! S. Antonio! si j’avais su,
si j’avais su!
Maria Clara sanglotait.
—Ne pleure pas, ma fille, ajouta-t-il en se tournant vers
elle; tu n’es pas comme ta mère qui ne pleurait jamais...
elle ne faisait que semblant... Le P. Dámaso m’a dit
qu’un de ses parents est arrivé d’Espagne... il te
le destine pour fiancé...
Maria Clara se boucha les oreilles.
—Mais, Santiago, tu es fou? lui cria tante Isabel. Lui parler
d’un autre fiancé en ce moment! Crois-tu que ta fille en
change comme de chemise?
—J’y pensais bien, Isabel; D. Crisóstomo est
riche... les Espagnols ne se marient que par amour de l’argent...
mais, que veux-tu que je fasse? Ils m’ont
[274]menacé d’une
autre excommunication... ils disent que je cours grand péril,
non seulement dans mon âme, mais aussi dans mon corps... mon
corps, entends-tu? mon corps!
—Mais tu ne fais que chagriner ta fille! N’es-tu pas
l’ami de l’archevêque? Pourquoi ne lui
écris-tu pas?
—L’archevêque est aussi un moine,
l’archevêque ne fait que ce que lui disent les moines.
Mais, ne pleure pas, Maria; le capitaine général va
venir, il voudra te voir, tu auras les yeux rouges... Ah! moi qui
croyais passer une bonne après-midi... sans ce grand malheur je
serais le plus heureux des hommes et tous me porteraient envie...
Calme-toi, ma fille! je suis plus malheureux que toi et je ne pleure
pas. Tu peux trouver un autre fiancé meilleur, mais moi, je
perds cinquante mille pesos! Ah! Vierge d’Antipolo, si ce soir au
moins j’avais de la chance!
Des détonations, le roulement, des voitures, le galop des
chevaux, la musique jouant la Marche royale, annoncèrent
l’arrivée de Son Excellence le Gouverneur
Général des Iles Philippines. Maria Clara courut se
cacher dans son alcôve... pauvre jeune fille! ton cœur est
le jouet de mains grossières qui n’en connaissent pas les
délicates fibres!
Tandis que la maison se remplissait de monde, que des pas lourds,
des voix de commandement, des bruits de sabres et
d’éperons résonnaient de tous côtés,
la pauvrette bouleversée gisait à demi agenouillée
devant une gravure représentant la Vierge, dans la douloureuse
solitude où Delaroche l’a placée, comme s’il
l’avait surprise au retour du sépulcre de son fils. Maria
Clara oubliait la douleur de cette mère pour ne songer
qu’à la sienne propre. La tête courbée sur la
poitrine, les mains appuyées contre le sol, on aurait dit un lys
brisé par la tempête. Un avenir rêvé et
caressé pendant des années, des illusions nées
dans son enfance, grandies avec sa jeunesse, qui faisaient partie de
son être, on voulait maintenant d’un seul mot briser tout
[275]cela,
chasser tout cela de son esprit et de son cœur!
Bonne et pieuse chrétienne, fille aimante,
l’excommunication la terrifiait; la tranquillité de son
père, plus encore que ses ordres exigeaient d’elle le
sacrifice de son amour. Elle ressentait seulement en ce moment toute la
force de cette affection! Une rivière glisse paisible;
d’odorantes fleurs ombragent ses rives, le sable le plus fin
forme son lit, le vent ride à peine son courant, on croirait
qu’elle dort. Mais voici que les rives se resserrent, que
d’âpres roches ferment le passage, que des troncs noueux
s’entassent formant une digue; alors la rivière mugit,
elle se révolte, les vagues bouillonnent, des panaches
d’écume se dressent, les eaux furieuses battent les
rochers et s’élancent à l’abîme. Ainsi
cet amour si tranquille se transformait devant l’obstacle et
déchaînait tous les orages de la passion.
Elle voulait prier, mais qui pourrait prier sans espérance?
Le cœur qui s’adresse à Dieu, alors qu’il
n’espère plus, ne peut exhaler que des plaintes:
«Mon Dieu! soupirait le sien, pourquoi rejeter ainsi un homme,
pourquoi lui refuser l’amour des autres? tu lui laisses ton
soleil, ton air, tu ne lui caches pas la vue de ton ciel, pourquoi lui
retirer l’amour sans lequel on ne saurait vivre?»
Ces soupirs, que n’entendaient pas les hommes, arrivaient-ils
au trône de Dieu? La Mère des malheureux les
entendait-elle?
Ah! la pauvre jeune fille, qui n’avait jamais connu de
mère, s’enhardissait à confier les chagrins que lui
causaient les amours de la terre à ce cœur très pur
qui n’a jamais ressenti que l’amour filial et l’amour
maternel; dans sa tristesse, elle avait recours à cette image
divinisée de la femme, l’idéalisation la plus belle
de la plus idéale des créatures, à cette
poétique conception du Christianisme qui réunit en elle
les deux états les plus parfaits de la femme, vierge et
mère, sans rien ressentir de leurs douleurs ni de leurs
misères, à cet être de rêve et de
bonté que nous appelons Marie. [276]
—Mère! mère! gémissait-elle.
La tante Isabel vint la tirer de ses larmes. Quelques-unes de ses
amies étaient là et le capitaine général
désirait lui parler.
—Tante, dites que je suis malade! supplia-t-elle,
terrifiée; ils vont vouloir me faire chanter et jouer du
piano!
—Ton père l’a promis, vas-tu faire mentir ton
père?
Maria Clara se leva, regarda sa tante, tordit ses beaux bras en
balbutiant.
—Oh! si j’étais...
Puis sans achever sa phrase, elle sécha ses larmes et se mit
à sa toilette.
[Table des matières]
XXXVII
Son Excellence
—Je désire parler à ce jeune homme! disait le
général à un aide-de-camp; il éveille tout
mon intérêt.
—On est allé le chercher, mon général!
Mais il y a ici un autre jeune homme de Manille qui demande avec
insistance à être introduit. Nous lui avons dit que Votre
Excellence n’avait pas le temps et qu’elle
n’était pas venue pour donner des audiences, mais pour
voir le pueblo et la procession; il a répondu que Votre
Excellence avait toujours le temps quand il s’agissait de faire
justice...
Le général émerveillé, se retourna vers
l’Alcalde.
—Si je ne me trompe pas, répondit celui-ci avec une
légère inclinaison de tête, c’est le jeune
homme qui ce matin a eu des démêlés avec le P.
Dámaso au sujet du sermon.
—Encore un autre? Ce moine s’est-il donc proposé
d’ameuter toute la province ou croit-il commander ici? Faites
entrer! [277]
Le gouverneur se promenait nerveusement d’un bout à
l’autre de la salle.
Dans l’antichambre, quelques Espagnols, des militaires et les
fonctionnaires du pueblo de S. Diego et des environs, formés en
groupes, conversaient ou discutaient. Tous les moines s’y
trouvaient aussi, excepté le P. Dámaso; ils voulaient
entrer pour présenter leurs respects à Son
Excellence.
—Son Excellence le Capitaine Général supplie Vos
Révérences d’attendre un moment, dit
l’aide-de-camp. Passez, jeune homme!
Ce Manilène, qui confondait le tagal avec le grec, entra dans
le salon, pâle et tremblant.
Tous étaient surpris au dernier point: Son Excellence devait
être très irritée pour oser ainsi faire attendre
les moines. Le P. Sibyla disait:
—Je n’ai rien à lui dire... je perds mon temps
ici!
—Moi de même, ajouta un augustin; partons-nous?
—Ne vaudrait-il pas mieux chercher à savoir ce
qu’il pense? demanda le P. Salví; nous éviterions
un scandale... et... nous pourrions lui rappeler... ses devoirs
envers... la Religion...
—Vos Révérences peuvent entrer si elles le
désirent! dit l’aide-de-camp en reconduisant le jeune
homme qui sortait radieux.
F. Sibyla entra le premier, puis venaient le P. Salví, le P.
Manuel Martin et les autres religieux. Tous saluèrent
humblement, sauf le P. Sibyla qui, même en s’inclinant,
conservait toujours un certain air de supériorité; le P.
Salví, au contraire, courba la tête presque
jusqu’à terre.
—Qui, parmi Vos Révérences, est le P.
Dámaso? demanda immédiatement Son Excellence, sans les
inviter à s’asseoir, sans s’intéresser
à leur santé, sans aucune de ces phrases louangeuses qui
font partie intégrante du répertoire des hauts
personnages.
—Señor, le P. Dámaso n’est pas parmi nous!
répondit, presque avec la même sécheresse, le P.
Sibyla. [278]
—Le serviteur de Votre Excellence est au lit, malade, ajouta
le P. Salvi toujours humble; après avoir eu le plaisir de saluer
Votre Excellence et de nous informer de sa santé, comme
c’est le devoir de tous les fidèles sujets du Roi et de
toute personne d’éducation, nous venions aussi au nom du
respectueux serviteur de Votre Excellence, qui a eu le malheur...
—Oh! interrompit avec un nerveux sourire le capitaine
général, tandis qu’il faisait tourner une chaise
sur un pied, si tous les serviteurs de Mon Excellence étaient
comme Sa Révérence le P. Dámaso, je
préférerais servir moi-même Mon Excellence!
La paresse habituelle au corps des Révérences gagna
cette fois leur esprit; elles ne surent que répondre à
cette interruption.
—Que Vos Révérences prennent des sièges!
ajouta le Gouverneur sur un ton plus doux.
Capitan Tiago, en frac, marchant sur la pointe des pieds, entrait
conduisant par la main Maria Clara, toute hésitante, toute
timide. La jeune fille, surmontant son trouble, fit un salut gracieux
et cérémonieux à la fois.
—Cette señorita est votre fille? demanda surpris le
gouverneur.
—Et celle de Votre Excellence, mon général!
répondit sérieusement Capitan Tiago.
Les aides-de-camp, l’Alcalde, se regardèrent et
sourirent mais, sans rien perdre de sa gravité, le
général tendit la main à la jeune fille et lui dit
avec affabilité:
—Heureux les pères qui ont des filles comme vous,
señorita! on m’a parlé de vous avec respect et
admiration... j’ai désiré vous voir pour vous
remercier du bel acte que vous avez accompli aujourd’hui. Je suis
informé de tout et, quand j’écrirai au
Gouvernement de Sa Majesté je n’oublierai pas votre
généreuse conduite. En attendant, permettez-moi,
señorita, au nom de S. M. le Roi, que je représente ici,
et qui aime la paix et la tranquillité de ses
fidèles sujets, comme au mien, en celui d’un père
qui, lui aussi, a des filles de [279]votre âge, de vous adresser les plus
chaleureux remerciements et de vous proposer pour une
récompense.
—Señor...! répondit Maria Clara tremblante.
Le général devina ce qu’elle voulait dire et
reprit:
—C’est très bien, señorita, de vous
contenter du témoignage de votre conscience et de l’estime
de vos concitoyens; par ma foi! c’est la meilleure
récompense et nous ne devrions point en demander d’autre.
Mais ne me privez pas d’une belle occasion de faire voir que, si
la Justice sait punir, elle sait aussi récompenser et surtout
qu’elle n’est pas toujours aveugle.
Tous les mots soulignés avaient été
prononcés d’une voix plus ferme.
—Le señor Don Juan Crisóstomo Ibarra attend les
ordres de Votre Excellence, dit à voix haute un
aide-de-camp.
Maria Clara frémit.
—Ah! s’écria le général,
permettez-moi, señorita, de vous exprimer le désir de
vous revoir avant de quitter ce pueblo, j’ai encore à vous
dire des choses très importantes. Señor Alcade, Votre
Seigneurie m’accompagnera durant la promenade que je
désire faire à pied après la conférence que
j’aurai seul avec le señor Ibarra.
—Votre Excellence, dit humblement le P. Salvi, nous permettra
de l’avertir que le señor Ibarra est
excommunié...
Le général l’interrompit.
—Je suis heureux de n’avoir à déplorer que
l’état du P. Dámaso à qui je souhaite
sincèrement une guérison complète, car,
à son âge, un voyage en Espagne pour des motifs de
santé ne doit pas être très agréable. Mais
ceci dépend de lui... en attendant, que Dieu conserve la
santé à Vos Révérences!
Tous se retirèrent.
—Pour lui aussi, cela dépendra de lui! murmura en
sortant le P. Salvi.
—Nous verrons qui fera plus promptement le voyage en Espagne!
ajouta un autre franciscain. [280]
—Je m’en vais dès aujourd’hui, dit avec
dépit le P. Sibyla.
—Nous repartons aussi! grondèrent à leur tour
les augustins.
Les uns et les autres ne pouvaient supporter que, par la faute
d’un franciscain, Son Excellence les ait reçus aussi
froidement.
Dans l’antichambre, ils se rencontrèrent avec Ibarra
qui, quelques heures auparavant, avait été leur
amphitryon. Pas un salut ne fut échangé, mais les regards
étaient éloquents.
L’Alcalde au contraire, quand les moines furent partis, salua
le jeune homme et lui tendit familièrement la main, mais
l’arrivée de l’adjudant qui cherchait
Crisóstomo ne permit aucune conversation.
Sur la porte, il se rencontra avec Maria Clara: des regards
significatifs se croisèrent encore, bien différents de
ceux échangés avec les moines.
Ibarra était vêtu de deuil. Bien que la vue des moines
lui ait semblé de mauvais augure, il se présenta,
l’air assuré et salua profondément.
Le capitaine général fit quelques pas au devant de
lui.
—J’éprouve la plus grande satisfaction,
señor Ibarra, à serrer votre main. Permettez-moi de vous
demander toute votre confiance!
Et en effet, il examinait le jeune homme avec une visible
satisfaction.
—Señor... tant de bonté...
—Votre surprise m’offense; elle me montre que vous
n’attendiez pas de moi un bon accueil; c’était
douter de ma justice!
—Une réception amicale, señor, pour un
insignifiant sujet de Sa Majesté comme moi, n’est pas de
la justice, c’est de la faveur.
—Bien, bien! dit le général en s’asseyant
et en lui montrant un siège, laissez-nous jouir d’un
moment d’expansion: je suis très satisfait de votre
conduite et je vous ai proposé au gouvernement de Sa
Majesté pour [281]une décoration afin de
récompenser votre philanthropique projet d’érection
d’une école... Si vous m’aviez invité, je me
serais fait un plaisir d’assister à la
cérémonie et, peut-être, je vous aurais
évité un ennui.
—Mon idée me paraissait si ordinaire, répondit
le jeune homme, que je ne la croyais pas suffisante pour distraire
l’attention de Votre Excellence de ses nombreuses occupations; de
plus mon devoir était de m’adresser d’abord à
la première autorité de ma province.
Le gouverneur fit un signe de satisfaction et, prenant un air plus
familier encore, elle continua:
—Quant à ce qui est arrivé entre vous et le P.
Dámaso, n’en gardez ni crainte ni regrets; on ne
touchera pas un cheveu de votre tête tant que je gouvernerai les
Iles et, pour ce qui est de l’excommunication j’en parlerai
à l’Archevêque, parce qu’il faut nous
conformer aux circonstances; ici nous ne pourrions en rire comme dans
la Péninsule ou dans l’Europe cultivée.
Malgré tout, soyez à l’avenir plus prudent; vous
vous êtes mis à dos les corporations religieuses qui, par
leur rôle et leurs richesses doivent être
respectées. Mais je vous protégerai parce que
j’aime les bons fils, parce qu’il me plaît que
l’on honore la mémoire de ses parents; moi aussi
j’ai aimé les miens et, vive Dieu! je ne sais pas ce que
j’aurais fait à votre place!...
Puis, changeant rapidement de conversation, il demanda:
—On m’a dit que vous veniez d’Europe;
êtes-vous allé à Madrid?
—Oui, señor, quelques mois.
—Avez-vous par hasard entendu parler de ma famille?
—Votre Excellence venait de partir quand j’ai eu
l’honneur de lui-être présenté.
—Et alors, comment êtes-vous revenu sans
m’apporter aucune recommandation?
—Señor, répondit Ibarra en s’inclinant,
parce que je ne viens pas directement d’Espagne, et parce que,
[282]ayant
entendu parler du caractère de Votre Excellence, j’ai cru
qu’une lettre de recommandation, non seulement serait inutile,
mais même vous offenserait: les Philippins vous sont tous
recommandés.
Un sourire se dessina sur les lèvres du vieux soldat qui
répondit lentement comme méditant et pesant ses
paroles:
—Je suis flatté que vous pensiez ainsi et... cela
devrait être! Cependant, jeune homme, vous devez savoir quelles
charges pèsent sur nos épaules aux Philippines. Ici, nous
autres, anciens militaires, nous devons faire tout, être tout:
Roi, Ministre d’Etat, de la Guerre, de l’Intérieur,
de Fomento1, de Grâce et Justice, etc., et le pire encore
est que, pour chaque affaire, nous devons consulter la lointaine
Mère-Patrie qui, selon les circonstances et parfois à
l’aveuglette, approuve ou rejette nos propositions. Et vous
connaissez notre proverbe: qui trop embrasse mal étreint. De
plus, lorsque nous arrivons, nous connaissons
généralement peu le pays et nous le quittons au moment
où nous commençons à le connaître... Avec
vous, je puis m’exprimer franchement, il me serait inutile de
feindre. Si déjà, en Espagne, où chaque branche a
son ministre, né et grandi dans le pays, où il y a une
presse et une opinion, où une opposition franche ouvre les yeux
au gouvernement et l’éclaire, tout est imparfait et
défectueux, c’est un miracle qu’ici, où tous
ces avantages manquent, où se développe et machine dans
l’ombre la plus puissante des oppositions, tout ne soit pas en
révolution. Ce n’est pas la bonne volonté qui
manque aux gouvernants, mais nous sommes obligés de nous servir
d’yeux et de bras étrangers que, pour la plupart, nous ne
connaissons pas, et qui, au lieu peut-être de servir leur pays,
ne servent que leurs propres intérêts. Ce n’est pas
notre faute, c’est celle des circonstances; les moines [283]nous sont
d’un puissant secours mais ils ne suffisent pas... Vous
m’inspirez un grand intérêt et je voudrais que
l’imperfection de notre système gouvernemental actuel ne
vous portât en rien préjudice... je ne puis veiller sur
tous, tous ne peuvent venir jusqu’à moi. Puis-je vous
être utile en quelque chose, avez-vous une demande à
m’adresser?
Ibarra réfléchit:
—Señor, répondit-il, mon plus grand désir
est le bonheur de mon pays, bonheur que je voudrais qu’il
dût à la Mère-Patrie et aux efforts de mes
concitoyens, unis à elle et entre eux par les éternels
liens de vues communes et de communs intérêts. Ce que je
demande, seul le gouvernement peut le donner après de nombreuses
années de continuel travail et de réformes bien
conçues.
Le général fixa sur lui pendant quelques secondes un
regard qu’Ibarra soutint naturellement, sans timidité,
sans hardiesse.
—Vous êtes le premier homme avec qui j’aie
parlé dans ce pays! s’écria le
général en lui tendant la main.
—Votre Excellence n’a vu que ceux qui se traînent
dans les villes, elle n’a pas visité les cabanes
calomniées de nos pueblos. Là, Votre Excellence aurait pu
voir de véritables hommes si, pour être un homme, il
suffit d’un cœur généreux et de mœurs
simples.
Le capitaine général se leva et se promena d’un
côté à l’autre du salon.
—Señor Ibarra, s’écria-t-il en
s’arrêtant de nouveau,—le jeune homme
s’était levé;—peut-être partirai-je
dans un mois: votre éducation,votre façon de penser ne
sont pas pour ce pays. Vendez ce que vous possédez,
préparez votre valise et venez avec moi en Europe, le climat
vous y sera meilleur.
—Je conserverai toute ma vie le souvenir de la bonté de
Votre Excellence! répondit Ibarra, quelque peu ému; mais
je dois vivre dans le pays où ont vécu mes parents...
[284]
—Où ils sont morts, diriez-vous plus exactement!
Croyez-moi, je connais peut-être votre pays mieux que
vous-même... Ah! je me rappelle maintenant, dit-il en changeant
de ton, vous vous mariez avec une adorable jeune fille et je vous
retiens ici! Allez, allez auprès d’elle et, pour que vous
ayez plus de liberté, envoyez-moi le père, ajouta-t-il en
souriant. N’oubliez pas cependant que je désire que vous
m’accompagniez à la promenade.
Ibarra salua et s’éloigna.
Le général appela son aide-de-camp.
—Je suis content! dit-il en lui donnant un léger coup
sur l’épaule; j’ai vu aujourd’hui, pour la
première fois comment on peut être bon Espagnol sans
cesser d’être bon Philippin et d’aimer son pays;
aujourd’hui je leur ai enfin démontré aux
Révérences que nous ne sommes pas tous leur jouet; ce
jeune homme m’en a fourni l’occasion et j’aurai
promptement réglé tous mes comptes avec le moine! Quel
malheur que cet Ibarra un jour ou l’autre... Mais, appelez-moi
l’Alcalde!
Celui-ci se présenta immédiatement.
—Señor Alcalde, lui dit-il aussitôt, afin
d’éviter que se répètent des
scènes comme celle à laquelle Votre Seigneurie a
assisté, scènes que je déplore parce
qu’elles portent atteinte au prestige du gouvernement et
de tous les Espagnols, je me permets de vous recommander
efficacement le señor Ibarra pour que, non seulement vous
lui facilitiez les moyens de terminer sa patriotique entreprise, mais
aussi pour que vous évitiez qu’à l’avenir il
soit molesté par qui que ce soit, de n’importe quelle
classe et sous n’importe quel prétexte.
L’Alcalde comprit la réprimande et baissa la tête
pour cacher son trouble.
—Votre Seigneurie fera transmettre cette recommandation
à l’alférez qui commande ici la section, et vous
rechercherez si cet officier a des façons de faire qui ne soient
point d’accord avec les règlements; j’ai entendu
à ce sujet plus d’une plainte. [285]
Capitan Tiago se présenta raide et empesé.
—D. Santiago, lui dit le général d’un ton
affectueux, il y a un moment je vous félicitais du bonheur que
vous aviez d’avoir une fille comme la señorita de los
Santos, maintenant je vous fais mes compliments de votre futur gendre;
la plus vertueuse des filles est assurément digne du meilleur
citoyen des Philippines. Puis-je savoir la date de la noce?
—Señor... balbutia Capitan Tiago en essuyant la sueur
qui perlait à son front.
—Allons, je vois qu’il n’y a rien encore de
définitif! Si l’on manque de témoins, j’aurai
le plus grand plaisir à être l’un d’entre eux.
Cela m’enlèvera le mauvais souvenir que m’ont
laissé tant de noces auxquelles j’ai assisté
jusqu’ici! ajouta-t-il en se dirigeant vers l’Alcalde.
—Oui, señor! répondit Capitan Tiago, avec un
sourire qui inspirait la compassion.
Ibarra était parti presque en courant à la recherche
de Maria Clara; il avait tant de choses à lui dire, à lui
raconter. A travers la porte d’un appartement, il entendit un
murmure de voix de jeunes filles; il frappa.
—Qui est là? demanda Maria Clara.
—Moi!
Les voix se turent... et la porte ne s’ouvrit pas.
—C’est moi... puis-je entrer? demanda le jeune homme
dont le cœur battait violemment.
Le silence continua. Quelques secondes après, des pas
légers s’approchèrent de la porte et la voix
légère de Sinang murmura à travers le trou de la
serrure:
—Crisóstomo, nous allons au théâtre ce
soir; écris ce que tu as à dire à Maria Clara.
Et les pas s’éloignèrent rapides comme ils
étaient venus.
—Qu’est-ce que cela veut dire? murmura Ibarra pensif, en
quittant cette porte. [286]
[Table des matières]
XXXVIII
La procession
Le soir, à la lumière de toutes les lanternes
suspendues aux fenêtres, au son des cloches et des habituelles
détonations, la procession sortit pour la quatrième
fois.
Le capitaine général, qui s’était
promené à pied accompagné de ses deux
aides-de-camp, de Capitan Tiago, de l’Alcalde, de
l’Alférez et d’Ibarra, précédés
par des gardes civils et des autorités qui ouvraient le passage
et déblayaient le chemin, fut invité à voir passer
la procession de la maison du gobernadorcillo. Ce pieux fonctionnaire
avait fait élever une estrade pour que fût
récitée une loa1 en l’honneur du Saint Patron.
Ibarra aurait renoncé avec plaisir à l’audition
de cette composition poétique; il aurait
préféré voir la procession des fenêtres de
la maison de Capitan Tiago où Maria Clara était
restée avec ses amies, mais Son Excellence voulait entendre la
loa et il dut se consoler en pensant qu’il verrait sa
fiancée au théâtre.
La procession commençait par la marche des chandeliers
d’argent, portés par trois sacristains gantés;
suivaient les enfants de l’école avec leur maître;
puis venaient d’autres enfants, munis de lanternes en papier de
formes et de couleurs variées, placées au bout de bambous
plus ou moins longs, ornés suivant le goût du petit
porteur, car cette décoration était payée par
l’enfance de tous les quartiers. C’est avec plaisir
qu’ils accomplissent ce devoir qui leur est imposé par la
mantandâ sa náyon2; chacun imagine et compose sa
lanterne, la décore à sa fantaisie, et suivant
l’état de sa bourse, de plus ou moins de pendeloques et de
petites bannières, puis l’éclaire avec un bout de
cierge, s’il a [287]un parent ou un ami sacristain, ou bien
achète une de ces petites chandelles rouges dont usent les
Chinois devant leurs autels.
Au milieu allaient et venaient des alguazils, des lieutenants de
justice, veillant à ce que les files ne se rompissent pas,
à ce que le peuple ne se portât pas tout entier au
même endroit; pour cela, ils se servaient de leurs verges dont
quelques coups, donnés convenablement, avec une certaine force,
contribuaient à l’éclat et à la gloire des
processions, pour l’édification des âmes et le
lustre des pompes religieuses.
En même temps que les alguazils répartissaient gratis
ces coups de canne sanctificateurs, d’autres, pour consoler les
battus, leur distribuaient, gratis également, des cierges et des
bougies de différentes grandeurs.
—Señor Alcalde, dit Ibarra à voix basse, ces
coups sont-ils donnés en châtiment des
péchés ou seulement pour le plaisir?
—Vous avez raison, señor Ibarra! répondit le
capitaine général, qui avait entendu la question; ce
spectacle... barbare étonne tous ceux qui viennent
d’autres pays. Il faudrait l’interdire.
Sans qu’il puisse être expliqué pourquoi, le
premier saint qui apparut fut S. Jean-Baptiste. A le voir, on aurait
dit que la renommée du cousin de Notre Seigneur
n’était pas des meilleures parmi le peuple que ne
séduisaient ni ses pieds, ni ses jambes minces, ni sa figure
d’anachorète; il s’avançait sur un vieux
brancard de bois caché par quelques gamins, armés de
leurs lanternes de papier non allumées et se battant en
cachette.
—Malheureux! murmura le philosophe Tasio qui, de la rue,
assistait à la procession. A quoi te sert-il d’avoir
été le précurseur de la Bonne Nouvelle et
d’avoir vu Jésus incliné devant toi? Que te valent
ta grande foi, ton austérité, ta mort pour la
vérité et pour tes convictions? Tout cela les hommes
l’oublient! Mieux vaut mal prêcher dans les églises
que d’être l’éloquente voix qui clama dans le
désert; voilà ce que te prouvent les Philippines. [288]Si tu avais
mangé de la dinde au lieu de sauterelles, si tu
t’étais vêtu de soie au lieu de peaux de
bêtes, si tu t’étais affilié à une
Congrégation...
Mais le vieillard suspendit son apostrophe car S. François
était là.
—Ne le disais-je pas? continua-t-il avec un sourire
sarcastique; celui-ci monte dans un char et, Saint Dieu! quel char! que
de lumières, que de lanternes de cristal! Jamais tu ne
t’es vu entouré de tant de lumières, Giovanni
Bernardone! Et quelle musique! C’étaient d’autres
mélodies dont tes fils faisaient retentir les airs après
ta mort! Mais, vénérable et humble fondateur, si tu
ressuscitais maintenant, tu ne verrais que des Elias de Cortona
dégénérés; si tes fils te reconnaissaient,
ils t’emprisonneraient et peut-être même te feraient
partager le sort de Cesario de Speyer!
Après la musique venait un étendard
représentant le même saint, muni de sept ailes,
porté par les frères du Tiers Ordre, vêtus de
guingon, priant d’une voix haute et lamentable.—Sans que
l’on sût pourquoi encore, saint François
était suivi de sainte Marie-Madeleine, très belle image
ornée d’une abondante chevelure, portant un costume de
soie orné de lames d’or, tenant un mouchoir de piña
brodé entre ses doigts couverts de bagues. Les lumières
et l’encens l’entouraient, on voyait ses larmes de verre
refléter les couleurs des feux de Bengale qui donnaient à
la procession un aspect fantastique, de telle sorte que la sainte
pécheresse pleurait vert, bleu, rouge, etc. Les habitants ne
commençaient à allumer ces lumières qu’au
passage de S. François; S. Jean-Baptiste ne jouissait pas de ces
honneurs, il allait vite comme honteux de son vêtement de peau
entre tous ces gens couverts d’or et de pierres
précieuses.
—Voici notre sainte! dit la fille du gobernadorcillo à
ses invités; je lui ai prêté mes bagues, mais
c’est pour gagner le ciel!
Les porteurs de cierges s’arrêtaient autour de
l’estrade [289]pour entendre la loa, les saints
faisaient de même; eux et leurs pasteurs voulaient entendre les
vers. Ceux qui portaient Saint Jean, las d’attendre,
s’accroupirent et posèrent la malheureuse statue à
terre.
—L’alguazil peut se fâcher! objecta
l’un.
—Bah! à la sacristie ils le laissent bien dans un coin
parmi les toiles d’araignées!...
Et saint Jean, une fois à terre, rien ne le distinguait plus
des gens du peuple.
Après la Madeleine, s’avancent les femmes. Au contraire
des hommes, ce ne sont pas les fillettes qui viennent en premier, mais
les vieilles: les jeunes filles entourent le char de la Vierge
derrière lequel marche le curé sous son dais. Cette
coutume provenait du P. Dámaso qui disait: «La Vierge aime
les jeunes et non les vieilles.» Beaucoup de dévotes
avaient fait la grimace, mais cela ne changeait rien aux
préférences de la Vierge.
Saint Diego suit la Madeleine, ce qui ne paraît pas le
réjouir beaucoup, car il marche avec autant de componction que
ce matin, alors qu’il se promenait derrière saint
François. Six frères du Tiers Ordre tirent son char, je
ne sais par suite de quel vœu ou de quelle maladie: le fait est
qu’ils tirent, et semblent assez fatigués. Saint Diego
s’arrête devant l’estrade et attend qu’on le
salue.
On n’attend plus que le char de la Vierge. Le voici,
précédé de gens habillés en fantômes,
au grand effroi des enfants; aussi entend-on pleurer et crier la foule
des bébés imprudents. Cependant, au milieu de cette masse
obscure d’habits, de capuchons, de cordons et de toques, au son
de cette prière monotone et nasillarde, on voit, comme de blancs
jasmins, comme de fraîches sampagas parmi de vieux chiffons,
douze petites filles, vêtues de blanc, couronnées de
fleurs, les cheveux frisés; leurs regards sont brillants comme
leurs colliers, on aurait dit de petits génies de la
lumière prisonniers des spectres. Elles étaient
attachées par deux [290]larges rubans bleus au char de la Vierge,
rappelant les colombes qui traînent celui du Printemps.
Déjà toutes les images sont réunies,
attentives, pour écouter les vers; tout le monde a les yeux
fixés sur le rideau entr’ouvert; enfin un ah!
d’admiration s’échappe de toutes les
lèvres.
L’exclamation est méritée; un tout jeune homme
apparaît, ailé, botté en cavalier, avec
écharpe, ceinturon et chapeau à plumes.
—Le señor Alcalde-Mayor! crie quelqu’un. Mais le
prodige de la création commence à réciter une
poésie aussi extraordinaire que sa personne et ne paraît
pas offensé de la comparaison.
Pourquoi transcrire ici ce que dit en latin, en tagal et en
castillan, le tout versifié, la pauvre victime du
gobernadorcillo? Nos lecteurs ont déjà savouré le
sermon prononcé ce matin par le P. Dámaso et nous ne
voulons pas les gâter par tant de merveilles; sans compter que le
franciscain pourrait nous en vouloir de lui chercher un
compétiteur et, en gens pacifiques que nous sommes, nous
n’aurions garde de nous en faire un ennemi.
La pièce de vers terminée, saint Jean poursuit son
chemin d’amertume.
Au moment où la Vierge passe devant la maison de Capitan
Tiago, un chant céleste la salue des paroles de
l’archange. C’est une voix tendre, mélodieuse,
suppliante, pleurant l’Ave Maria de Gounod,
s’accompagnant du piano qui prie avec elle. La musique de la
procession s’émeut, la prière cesse, le P. Salvi
lui-même s’arrête. La voix tremble, elle fait jaillir
les larmes; c’est plus qu’une salutation, c’est une
supplication, c’est une plainte.
De la fenêtre où il se trouve, Ibarra entend cette voix
et la crainte et la mélancolie descendent dans son cœur.
Il comprend ce que cette âme souffre, ce qu’elle exprime
dans ce chant, il a peur de s’interroger sur la cause de cette
douleur. [291]
Il est sombre, pensif, quand le capitaine général lui
parle:
—Vous voudrez bien me tenir compagnie à table, nous
causerons de ces enfants qui ont disparu, lui dit-il.
Et le jeune homme regardant sans le voir le Général
murmure: «En serais-je la cause?» et le suit
machinalement.
[Table des matières]
XXXIX
Doña Consolacion
Pourquoi étaient fermées les fenêtres de la
maison de l’alférez? Où étaient, tandis que
passait la procession, la figure masculine et la chemise de flanelle de
la Méduse ou de la Muse de la Garde civique? Da. Consolacion
aurait-elle compris combien désagréables étaient
son front marqué de grosses veines, conductrices en apparence,
non de sang, mais de vinaigre et de fiel, le gros cigare, digne
ornement de ses lèvres violettes, et son envieux regard?
Cédant à une impulsion généreuse,
n’aurait-elle pas voulu troubler les plaisirs de la foule par son
apparition sinistre?
Ah! pour elle les impulsions généreuses
n’existent plus depuis l’Age d’or!
La maison est triste, comme disait Sinang, parce que le peuple est
gai. Ni lanternes, ni drapeaux; si la sentinelle ne se promenait pas
comme à l’ordinaire devant la porte, on croirait cette
demeure inhabitée.
Une faible lumière éclaire le désordre de la
salle et perce à travers les conchas1 sales où
l’araignée accroche sa toile, où s’incruste
la poussière. La dame, selon [292]son habitude
d’oisiveté, dort dans un large fauteuil. Vêtue comme
tous les jours, c’est-à-dire horriblement mal, elle
n’a pour toute coiffure qu’un mouchoir attaché
autour de la tête, laissant échapper de minces et courtes
mèches de cheveux emmêlés; pour toute toilette
qu’une chemise de flanelle bleue passée sur une autre qui
a dû être blanche, et une basque déteinte qui moule
les jambes minces et plates, croisées l’une sur
l’autre et s’agitant fébrilement. De sa bouche
s’échappent des bouffées de fumée
qu’elle rejette avec ennui vers l’espace où elle
regarde quand elle ouvre les yeux. Si en ce moment, D. Francisco de
Cañamaque2 l’avait vue, il l’aurait prise pour un
cacique du pueblo ou pour le mankukúlam3, ornant ensuite sa
découverte de commentaires en une langue de boutiquier, par lui
créée pour son usage personnel.
Ce matin, la Dame n’avait pas entendu la messe, non parce
qu’elle ne l’avait pas voulu; au contraire, elle aurait
aimé se montrer à la multitude et entendre le sermon,
mais son mari ne le lui avait pas permis, et la prohibition avait
été, comme toujours, accompagnée de deux ou trois
séries d’insultes, de jurons et de menaces de coups de
pied. L’alférez comprenait que sa femelle
s’habillait de façon ridicule, qu’elle avait
l’air de ce qu’on appelle une femme à soldats
et il ne lui convenait pas de l’exposer aux regards des
personnages du chef-lieu et des étrangers.
Mais elle ne l’entendait pas de cette façon. Elle
savait qu’elle était belle, attrayante, qu’elle
avait des airs de reine et que sa toilette était beaucoup plus
belle et plus luxueuse que celle de Maria Clara elle-même. Aussi
l’alférez avait-il dû la menacer: «Ou tu vas
te taire ou je t’envoie un coup de pied dans ton
p—pueblo,» lui avait-il répondu. [293]
Da. Consolacion n’avait pas voulu risquer de recevoir des
coups de pied dans son pueblo, mais elle songeait à la
vengeance.
Jamais l’obscur visage de la dame n’avait
été propre à inspirer confiance à personne,
même quand il était peint, mais ce matin-là il
devint inquiétant, surtout lorsqu’on la vit parcourir la
maison d’une extrémité à l’autre,
silencieuse, comme méditant quelque chose de terrible ou de
malicieux; son regard avait le reflet qui jaillit de la pupille
d’un serpent au moment où, pris, il va être
écrasé; il était froid, lumineux,
pénétrant à la fois, avec quelque chose de
visqueux, de repoussant, de cruel.
La plus petite faute, le bruit le plus insignifiant, lui arrachaient
une infâme et obscène injure qui souffletait
l’âme, mais personne ne lui répondait:
s’excuser eût été commettre un autre
crime.
Le jour se passa ainsi. Ne trouvant pas un obstacle qui
s’opposât à ses vues—son mari ayant
été invité—elle se saturait de bile; on
aurait cru que les cellules de son organisme se chargeaient
d’électricité et menaçaient
d’éclater en une effroyable tourmente. Dans son entourage,
tous pliaient, comme les épis au premier souffle de
l’ouragan; point de résistance, nulle pointe, nulle
hauteur sur qui décharger sa mauvaise humeur: soldats et
domestiques rampaient devant elle.
Pour ne pas voir les réjouissances au dehors, elle fit fermer
les fenêtres et donna pour consigne à la sentinelle de ne
laisser passer personne. Elle s’entoura ensuite la tête
d’un mouchoir comme pour en éviter l’explosion puis,
bien que le soleil brillât encore, fit allumer les
lumières.
Sisa avait été arrêtée comme
perturbatrice de l’ordre et conduite au quartier où, en
l’absence de l’alférez, elle dut passer la nuit sur
un banc, indifférente et inconsciente. Le lendemain,
l’alférez la vit et, craignant que la malheureuse ne
devînt le jouet de la foule en fête et ne fût
l’objet de scènes regrettables, il chargea [294]les soldats
d’en prendre soin, leur ordonnant de la traiter avec pitié
et de lui donner à manger. La pauvre folle passa ainsi deux
jours.
Ce soir-là, soit que la proximité de la maison de
Capitan Tiago lui ait permis d’entendre le triste chant de Maria
Clara, soit que d’autres accords aient réveillé le
souvenir de ses propres refrains, soit pour toute autre cause, Sisa
commença à chanter de sa voix douce et
mélancolique les kundiman4 de sa jeunesse. Les soldats
l’écoutaient et se taisaient; ces airs ils les
connaissaient, ils les chantaient eux-mêmes au temps où,
libres encore, ils n’étaient pas corrompus.
Da. Consolacion, dans son ennui, l’entendait aussi: elle
s’informa de la chanteuse.
—Qu’elle monte de suite! ordonna-t-elle après
quelques secondes de méditation. Quelque chose qui pouvait
ressembler à un sourire errait sur ses lèvres
desséchées.
Les soldats amenèrent Sisa qui se présenta sans se
troubler, sans crainte comme sans étonnement: elle semblait ne
voir personne. La vanité de la Muse qui prétendait
imposer le respect et la terreur en fut blessée.
Elle toussa, fit signe aux soldats de se retirer et,
détachant la cravache de son mari, dit à la folle
d’un ton sinistre.
—Vamos, magcantar icau!5
Sisa naturellement ne la comprit pas et cette ignorance redoubla la
colère de la mégère dont une des affectations
était d’ignorer le tagal, ou tout au moins de
paraître l’ignorer en l’estropiant le plus possible:
elle pensait se donner ainsi des airs de véritable
Orofea6,
comme elle se plaisait à dire. Heureusement! car si elle
martyrisait le tagal, elle ne traitait guère mieux le castillan,
se faisant une idée tout à fait particulière de sa
grammaire comme de sa prononciation. Et cependant [295]son mari, les
chaises et les souliers, chacun pour sa part avait contribué
à lui donner des leçons. Un des mots qui lui avaient
coûté plus de travail encore qu’à Champollion
les hiéroglyphes était celui de Filipinas7.
On raconte que le lendemain même de son mariage, causant avec
son mari, qui alors était caporal, elle avait dit
Pilipinas; il crut devoir la corriger et, accompagnant sa
remontrance d’une gifle: «Dis, Felipinas, femme! Ne fais
pas l’ignorante! ne sais-tu pas que l’on appelle ainsi ton
p—8 pays
dont le nom vient de Felipe9?» La femme, qui rêvait à sa
lune de miel, voulut obéir et dit Felepinas. Il sembla au
caporal qu’elle approchait de la bonne prononciation il redoubla
les gifles et la réprimanda plus sévèrement:
«Mais, femme, ne peux-tu prononcer: Felipe? Ne l’oublie
pas, c’est le nom du roi Don Felipe... cinq... Dis Felipe, et
ajoute nas, qui, en latin, signifie îles d’Indiens,
et tu as le nom de ton rep—pays!»
La Consolacion, blanchisseuse à cette époque, tout en
frottant ses joues où les soufflets laissaient leurs traces,
recommença à répéter, perdant un peu de
patience:
—Fe... lipe, Felipe... nas, Felipenas, c’est bien comme
cela, n’est-ce pas?
Le caporal n’y voyait plus: il se demandait s’il ne
rêvait pas. Comment de sa règle résultait-il
Felipenas et non Felipinas? De deux choses l’une: ou
l’on doit dire Felipenas, ou l’on doit dire
Felipi?
Ce jour-là il crut prudent de se taire; il laissa sa femme et
s’en fut soigneusement consulter les imprimés. Son
étonnement fut au comble, il n’en pouvait croire ses
yeux:—Comment... doucement!—Filipinas, disaient tous
les imprimés en caractères bien moulés,
irréprochables; ni lui ni sa femme n’étaient dans
le vrai.
—Comment l’Histoire peut-elle mentir ainsi?
murmurait-il. [296]Ce livre ne dit-il pas que Alonso Saavedra a
donné ce nom au pays en l’honneur de l’infant D.
Felipe. Comment ce nom s’est-il corrompu? Ce Saavedra serait-il
un indien?
Il confia ses doutes au sergent Gomez qui, dans son enfance, avait
voulu être curé. Celui-ci, sans daigner le regarder, lui
répondit avec la plus grande emphase, tout en lâchant une
bouffée de fumée:
—Autrefois on disait Filipi au lieu de Felipe;
nous, les modernes, comme nous devenons Franchutes10, nous ne pouvons
tolérer deux i de suite. C’est pour cela que les
gens instruits, à Madrid surtout,—tu n’es pas
allé à Madrid?—les gens instruits, dis-je,
commencent déjà à prononcer: menistro,
enritacion, embitacion, endino11, etc.; c’est ce qui
s’appelle suivre la mode.
Le pauvre caporal n’avait pas été à
Madrid; voilà pourquoi il ignorait la difficulté. Que de
choses on apprend à Madrid!
—De sorte que l’on doit aujourd’hui dire?
—A l’ancienne mode, homme! ce pays n’est pas
encore cultivé; à l’ancienne mode, Filipinas!
répondit Gomez, non sans quelque mépris.
Le caporal, s’il était mauvais philologue, en
échange était un bon mari; ce qu’il venait
d’apprendre, sa femme devait le savoir aussi: il continua son
éducation.
—Consola, comment appelles-tu ton p—pays?
—Comment je dois l’appeler? comme tu me l’as
appris: Felifenas!
—Je te jette la chaise à la tête, p—! hier
déjà tu le prononçais un peu mieux, à la
moderne; mais maintenant il faut le prononcer à la vieille mode!
Feli, je dis, Filipinas!
—Mais je ne suis pas vieille! qu’est-ce qui te
prend?
—Cela m’est égal! dis: Filipinas!
—Ne m’ennuie pas! Je ne suis pas un vieux meuble...
[297]j’ai à peine trente petites
années! répondit-elle en retroussant ses manches comme
pour se préparer au combat.
—Dis-le, rep—ou je te jette la chaise!
Consolacion vit le mouvement, réfléchit et balbutia
tout oppressée:
—Feli... Fele... File...
Poum! crracc! la chaise s’abattit avec le mot.
Et la leçon se termina par des coups de poing, des gifles,
des coups de griffes, etc. Le caporal l’empoigna par les cheveux,
elle le prit par la barbiche, puis par n’importe
où—elle ne pouvait mordre, ses dents n’étant
pas solides—; il poussa un cri, la lâcha, lui demanda
pardon, le sang coula, il y eut un œil plus rouge que
l’autre, une chemise en morceaux, elle cracha beaucoup de choses,
mais Filipinas ne sortit point.
Chaque fois qu’il s’agissait du langage, de pareilles
scènes se renouvelaient. Le caporal, en jugeant les
progrès linguistiques de sa femme, calcula avec douleur
qu’avant dix ans elle aurait perdu complètement
l’usage de la parole. C’est ce qui arriva. Quand ils se
marièrent elle connaissait encore le tagal et se faisait
comprendre en espagnol; maintenant, elle ne parlait aucun idiome; elle
s’était attachée au langage des gestes, choisissant
toujours les plus bruyants et les plus contondants.
Sisa, donc, avait eu la chance de ne point la comprendre. Les plis
de son front se desserrèrent un peu, un sourire de satisfaction
anima sa figure; du moment qu’on ne l’entendait pas,
c’est qu’elle ne savait pas le tagal, elle était
donc véritablement orofea.
—Dis à cette femme qu’elle chante!
commanda-t-elle à l’ordonnance, elle ne me comprend pas,
elle ne connaît pas l’espagnol!
La folle comprit l’ordonnance et commença la Chanson
de la Nuit.
D’abord Da. Consolacion écoutait avec un rire moqueur,
mais peu à peu le rire s’effaça de ses
lèvres, elle devint attentive, puis sérieuse et quelque
peu réfléchie. [298]La voix, le sens des vers, la musique du chant,
tout l’impressionnait: ce cœur aride et sec était
cette fois altéré de pluie. Elle comprenait bien:
«La tristesse, le froid et l’humidité qui descendent
du ciel enveloppés dans le manteau de la nuit», lui
paraissaient descendre sur son cœur, «la fleur fanée
et flétrie qui durant le jour, avait étalé ses
splendeurs et cherché l’admiration, pleine de
vanités, à la chute du jour, repentie et
détrompée, fait un effort pour élever ses
pétales desséchés vers le ciel, demandant un peu
d’ombre pour s’y cacher et mourir, dans la raillerie de la
lumière qui l’a vue dans sa pompe, qui rirait de la
vanité de son orgueil, mendiant aussi une goutte de rosée
qui pleurait sur elle. L’oiseau des nuits laisse sa solitaire
retraite, le creux du tronc noueux, il trouble la mélancolie des
forêts...»
—Non, ne chante pas! s’écria, en parfait tagal,
l’alféreza qui se leva agitée; ne chante pas; ces
vers m’ennuient!
La folle se tut; l’ordonnance murmura: «Aba! elle sait
paler tagal!» et il regarda sa patronne plein
d’admiration.
Celle-ci comprit qu’elle s’était trahie: elle
devint honteuse et, comme sa nature n’était pas
d’une femme, la honte chez elle se transforma en rage et en
haine. Elle montra la porte à l’imprudent et d’un
coup de pied la ferma derrière lui, puis elle fit quelques tours
dans la chambre, tordant la cravache entre ses mains nerveuses et, se
plantant de nouveau devant la folle, elle lui dit en
espagnol:—Danse!
Sisa ne remua pas.
—Danse, danse! répéta-t-elle d’une voix
sinistre; la folle la regardait avec des yeux vagues, sans expression:
la mégère lui leva un bras, puis l’autre, en les
secouant: inutile, Sisa ne comprenait pas.
En vain Da. Consolacion se mit à sauter, à
s’agiter, faisant signe à la malheureuse de
l’imiter. On entendait de loin la musique de la procession jouer
une marche [299]grave et majestueuse; mais la dame sautait
furieusement, suivant une autre mesure, une autre musique, celle qui
résonnait en elle-même. Sisa immobile la regardait;
quelque chose qui ressemblait à de la curiosité se
peignait dans ses yeux, un faible sourire remua ses lèvres
pâles: c’était une joie pour elle que la danse de
l’alféreza.
La danseuse s’arrêta enfin, comme ayant honte, mais elle
leva le fouet, ce terrible fouet connu des voleurs et des soldats, fait
à Ulangô et perfectionné par l’alférez
au moyen de fils de fer tordus.
—Maintenant, dit-elle, c’est à toi de danser...
danse!
Et elle commença à frapper lentement les pieds nus de
la folle dont la figure se contracta de douleur; la malheureuse chercha
à se défendre avec les mains.
—Ah! tu commences! s’écria-t-elle avec une joie
sauvage, et du lente elle passa à un allegro vivace.
Sisa poussa un cri et leva vivement le pied.
—Veux-tu danser, p—indienne? et le fouet vibrait et
sifflait.
La folle se laissa tomber à terre, les deux mains cachant ses
jambes et regardant son bourreau avec des yeux hagards. Deux forts
coups sur l’épaule la forcèrent à se
relever: ce ne fut plus une plainte, ce furent deux hurlements! La fine
chemise fut déchirée, la peau ouverte, le sang
jaillissait.
La vue du sang fait la joie du tigre; celui de sa victime exalta
encore Da. Consolacion.
—Danse, danse, maudite damnée! Malheur à celle
qui t’a engendrée! danse ou je te tue à coups de
fouet.
Et elle-même, la saisissant d’une main tandis
qu’elle, la frappait de l’autre, recommença à
sauter et à danser.
La folle l’avait enfin comprise et la suivait en remuant les
bras, sans rythme ni mesure. Un sourire de satisfaction contracta les
lèvres de l’horrible femme, sourire d’un
Méphistophelès femelle qui vient de faire un bon
élève: il y avait de la haine, du mépris, de la
moquerie, de la cruauté; un éclat de rire n’aurait
rien dit de plus. [300]
Absorbée par la joie de ce spectacle, elle n’avait pas
entendu arriver son mari, jusqu’à ce que, d’un coup
de pied, la porte se fût précipitamment ouverte.
L’alférez était pâle et sombre; il vit ce
qui se passait et lança à sa femme un regard terrible.
Celle-ci ne bougea pas et garda son sourire cynique.
Aussi doucement que possible, il posa la main sur
l’épaule de l’étrange ballerine et
l’arrêta. La folle respira et s’assit sur le sol
taché de son sang.
Le silence continuait; l’alférez respirait avec force;
la mégère qui l’observait d’un œil
inquiet reprit le fouet et lui demanda d’une voix tranquille et
lente:
—Qu’as-tu donc? tu ne m’as pas encore dit
bonsoir!
L’alférez ne répondit pas; il appela
l’ordonnance.
—Emmène cette femme, dit-il, que la Marta lui donne une
autre chemise et la soigne! Tu la feras bien manger, tu lui donneras un
bon lit... Fais attention qu’elle soit bien traitée!
Demain on la conduira chez le señor Ibarra!
Puis il ferma soigneusement la porte, poussa le verrou et
s’approcha de sa femme.
—Tu veux que je te brise? lui dit-il en serrant les
poings.
—Qu’est-ce qui te prend? demanda-t-elle en se levant et
reculant un peu.
—Ce qui me prend? cria-t-il d’une voix de tonnerre, avec
un blasphème, voilà ce qui me prend.
Et il lui montra un papier rempli de pattes de mouche plus ou moins
mal alignées.
—N’as-tu pas écrit cette lettre à
l’Alcalde en lui disant que l’on me payait pour que je
permette le jeu, p—? je ne sais comment je ne
t’écrase pas!
—Voyons, voyons, si tu l’oses! lui dit-elle avec un rire
moqueur, celui qui m’écrasera sera un autre mâle que
toi!
Il entendit l’insulte, mais il vit le fouet. Il prit une
assiette sur une table et lui lança à la tête; mais
la femme accoutumée à ces luttes se baissa rapidement,
[301]l’assiette vola en éclats contre
le mur; une tasse, puis un couteau la suivirent.
—Lâche! lui cria-t-elle, tu n’oses pas
t’approcher.
Et pour mettre le comble à son exaspération, elle
cracha à terre. Aveugle, hurlant de rage, il
s’élança mais avec une rapidité surprenante
elle lui fit une croix sur la figure avec deux coups de fouet puis, se
sauvant brusquement, s’enferma dans sa chambre dont elle tira
violemment la porte. Rugissant de colère et de douleur
l’alférez la poursuivit, mais il se heurta contre la porte
qu’il frappa du poing et du pied, proférant
d’épouvantables jurons.
—Maudite soit ta descendance, truie! Ouvre, p— p—,
ouvre ou je te brise le crâne! hurlait-il.
Da. Consolacion ne répondait pas. On entendait un remuement
de chaises et de coffres comme si elle avait voulu élever une
barricade de meubles. La maison tremblait sous les coups de pied et les
cris de son mari.
—N’entre pas, n’entre pas! disait la voix aigre de
la mégère, si tu te montres, je fais feu.
Lui, peu à peu, paraissait se calmer; il se promenait en long
et en large comme un fauve en cage.
—Sors, va te rafraîchir la tête! continua moqueuse
la femme qui semblait avoir terminé ses préparatifs de
défense.
—Je te jure que si je t’attrape, personne, même
Dieu, ne te reverra plus!
Et ce fut une bordée d’injures.
—Va! tu peux dire ce que tu voudras...! Tu n’as pas
voulu que j’aille à la messe? tu ne m’as pas
laissée accomplir mes devoirs envers Dieu! disait-elle de ce ton
sarcastique où elle excellait.
L’alférez prit son casque, répara un peu le
désordre de sa toilette et sortit à grands pas, mais, au
bout de quelques minutes, il revint sans faire le moindre bruit, ayant
retiré ses bottes. Les domestiques, accoutumés à
ce spectacle, ne s’émouvaient guère, mais les
bottes retirées constituaient une nouveauté qui appela
leur attention; ils se regardèrent en clignant de
l’œil. [302]
L’officier s’assit sur une chaise, près de la
sublime porte et, patiemment, attendit plus d’une demi-heure.
—Es-tu sorti pour de bon ou es-tu ici, bouc? demandait la voix
de temps en temps, changeant d’épithètes mais
criant toujours plus fort.
Enfin, elle commença à retirer peu à peu les
meubles; il écoutait et souriait. Elle appela
l’ordonnance:
—Le señor est-il sorti?
Sur un signe de l’alférez, celui-ci
répondit:
—Oui, señora, il est sorti.
Elle se mit à rire joyeusement et tira le verrou.
Très doucement, l’alférez se leva; la porte
s’entr’ouvrit...
On entendit un cri, le bruit d’un corps qui tombait, des
jurons, des hurlements, des malédictions, des coups, des voix
étranglées... Qui pourrait décrire ce qui se passa
là dans l’obscurité?
L’ordonnance, revenu à la cuisine, fit un signe
très significatif au cuisinier.
—C’est toi qui vas le payer! lui dit celui-ci.
—Moi? Peut-être; en tout cas le pueblo! Elle m’a
bien demandé s’il était sorti, mais non s’il
était revenu.
[Table des matières]
XL
Le droit et la force
Il était dix heures du soir. Les premières
fusées montent paresseusement dans le ciel obscur où
brillent, tels de nouveaux astres, quelques globes de papier
gonflés de fumée et d’air chaud, qui viennent de
s’enlever. Quelques-uns, ornés de feux, s’allument,
menaçant d’incendier toutes les maisons; aussi, sur les
poutres des toits, voit-on des hommes munis d’un long bambou
portant un torchon à l’extrémité, avec
à leur [303]portée un seau plein d’eau. Leurs
noires silhouettes se détachent sur la vague clarté de
l’air et semblent des fantômes descendus des espaces pour
assister aux réjouissances des hommes.—On a
brûlé également une multitude de roues, de
châteaux, de taureaux et de carabaos de feu ainsi qu’un
grand volcan surpassant en beauté et en grandeur tout ce
qu’avaient vu jusqu’alors les habitants de S. Diego.
Maintenant la foule se dirige en masse vers la place pour assister
à la dernière représentation du
théâtre. Ici et là brûlent des feux de
Bengale, éclairant fantastiquement les groupes joyeux; les
enfants se munissent de torches pour chercher dans l’herbe les
bombes tombées et d’autres restes qu’ils puissent
utiliser, mais la musique donne le signal et tous abandonnent la
prairie.
La grande estrade est splendidement illuminée; des milliers
de lumières entourent les piliers, pendent du toit et
parsèment le sol en groupes entassés. Un alguazil est
là pour y veiller et, quand il s’approche pour les
arranger, le public le siffle et lui crie: «Il est là, le
voilà!»
Devant la scène, l’orchestre accorde les instruments,
prélude aux airs qu’il doit jouer; derrière est
l’endroit dont parlait le correspondant dans sa lettre. Les
principaux du pueblo, les Espagnols et les riches étrangers
occupent les sièges alignés. Le peuple, ceux qui
n’ont ni titres ni traitements, occupe le reste de la place;
quelques-uns ont apporté un banc, bien plus pour monter dessus
que pour s’y asseoir; les autres protestent bruyamment; ceux qui
sont juchés sur le banc en descendent mais pour y remonter
immédiatement, comme si rien n’était.
Les allées, les venues, les cris, les exclamations, les
éclats de rires, un quolibet, un sifflet augmentent le tumulte.
Ici, le pied d’un banc se brise et ceux qui l’occupaient
tombent au milieu des rires de la multitude, là on se dispute
pour une place, un peu plus loin on entend un fracas de verres et de
bouteilles qui se brisent; [304]c’est Andeng qui apporte des
rafraîchissements et des boissons; de ses deux mains elle
soutient le large plateau, mais par malheur elle se rencontre avec son
fiancé qui veut profiter de la situation...
Le lieutenant principal, D. Filipo, préside le spectacle, car
le gobernadorcillo est un fervent du monte1. D. Filipo converse avec le vieux
Tasio:
—Que dois-je faire? disait-il, l’Alcalde n’a pas
voulu accepter ma démission. «Ne vous sentez-vous pas
suffisamment de force pour accomplir votre devoir?»
m’a-t-il demandé.
—Et que lui avez-vous répondu?
—Señor Alcalde, lui ai-je dit; les forces d’un
lieutenant principal, pour insignifiantes qu’elles puissent
être, sont comme celles de toute autorité: elles viennent
de ce qui leur est supérieur. Le Roi lui-même
reçoit les siennes du peuple qui les tient de Dieu. Cette force
supérieure me manque, señor Alcalde! Mais l’Alcalde
n’a pas voulu m’écouter, il m’a dit que nous
en parlerions après les fêtes!
—Alors que Dieu vous aide! dit le vieillard, et il se disposa
à se retirer.
—Ne voulez-vous pas voir la représentation?
—Merci! pour rêver et divaguer, je me suffis à
moi-même, répondit en riant le philosophe; mais je me
souviens d’une question que je voulais vous soumettre. Le
caractère de notre peuple n’a-t-il jamais appelé
votre attention? Pacifique, il aime les spectacles belliqueux;
démocrate, il adore les empereurs, les rois et les princes;
irréligieux, il se ruine pour les pompes du culte; nos femmes
ont un caractère doux, elles délirent quand une princesse
brandit une lance... en savez-vous la cause? Eh bien!...
L’arrivée de Maria Clara et de ses amies coupa la
conversation. D. Filipo les reçut et les accompagna à
leurs places. Puis venaient le curé avec un autre franciscain
[305]et
quelques Espagnols, sans compter un certain nombre de ceux dont
l’office est de former l’escorte des moines.
—Dieu les récompense aussi dans l’autre vie! dit
le vieux Tasio en s’éloignant.
La séance commença avec Chananay et Marianito dans
Crispino et la Commère. L’attention de tous
était accaparée par la scène; seul le P. Salvi
restait indifférent au spectacle; il semblait n’être
venu que pour surveiller Maria Clara dont la tristesse donnait à
sa beauté un caractère si idéal, si particulier,
que l’on aurait compris qu’il s’absorbât avec
ravissement dans sa contemplation. Mais ce n’était pas le
ravissement qu’exprimaient les yeux du prêtre,
profondément enfoncés dans leurs creuses orbites; en ce
regard sombre se lisait quelque chose de
désespérément triste: c’est avec de tels
yeux que Caïn aurait contemplé de loin le Paradis dont sa
mère lui avait dépeint les délices.
L’acte se terminait quand Ibarra entra; sa présence
occasionna un murmure; les regards se concentrèrent sur lui et
sur le curé.
Mais le jeune homme ne parut s’apercevoir de rien; il salua
gracieusement Maria Clara et ses amies, et prit place à
côté de sa fiancée. La seule qui lui parla fut
Sinang.
—Tu as été voir le volcan? lui
demanda-t-elle.
—Non, petite amie, j’ai dû accompagner le
capitaine général.
—Quel malheur! Le curé est venu avec nous et nous a
raconté des histoires de damnés; qu’en dis-tu? pour
nous faire peur et nous empêcher de nous amuser, n’est-ce
pas?
Le P. Salvi s’était levé, il s’approcha de
D. Filipo et parut avoir avec lui une vive discussion. Il parlait avec
vivacité, le lieutenant avec mesure et à voix basse.
—Je regrette de ne pouvoir satisfaire Votre
Révérence, disait-il, le señor Ibarra est un des
principaux [306]contribuables et a le droit d’être
ici tant qu’il ne trouble pas l’ordre.
—Mais n’est-ce pas troubler l’ordre que de
scandaliser les bons chrétiens? C’est laisser entrer un
loup dans la bergerie! Tu répondras de ceci devant Dieu et
devant les autorités!
—Je réponds toujours des actes qui émanent de ma
propre volonté, Père, répondit D. Filipo en
s’inclinant légèrement; mais ma petite
autorité ne me permet pas de me mêler des choses
religieuses; que ceux qui veulent éviter son contact ne lui
parlent pas; le señor Ibarra n’y force personne.
—Mais c’est faciliter le péril et qui aime le
péril périt par lui!
—Je ne vois là aucun péril, Père; le
señor Alcalde et le capitaine général, mes
supérieurs, ont accepté sa compagnie toute
l’après-midi; il ne m’appartient pas de leur donner
une leçon.
—Si tu ne le chasses pas d’ici, c’est nous qui
sortirons.
—J’en serai très fâché, mais je ne
puis chasser d’ici qui que ce soit.
Le curé se repentit de sa démarche, mais il n’y
avait plus de remède. Il fit un signe à son compagnon qui
se leva avec ennui et tous deux sortirent. Leur petite escorte les
imita, non sans lancer à Ibarra un regard chargé de
haine.
Les murmures et les chuchotements recommencèrent; quelques
personnes s’approchèrent de Crisóstomo, le
saluèrent et lui dirent:
—Nous sommes avec vous; ne faites pas cas de
ceux-là!
—Quels sont ceux-là? demanda-t-il avec
étonnement.
—Ceux qui sont sortis pour éviter votre contact?
—Pour éviter mon contact? mon contact?
—Oui! ils disent que vous êtes excommunié.
Ibarra, surpris, ne sut que dire et regarda autour de lui. Il vit
Maria Clara qui se cachait derrière son éventail. [307]
—Mais, est-ce possible? s’écria-t-il enfin;
sommes-nous encore en plein Moyen-Age? De sorte que...
Et s’approchant des jeunes filles, il changea de ton.
—Excusez-moi, dit-il; j’avais oublié un
rendez-vous; je reviendrai pour vous accompagner.
—Reste donc! lui dit Sinang; Yeyeng va danser dans la
Calandria; elle danse divinement.
—Je ne puis pas, petite amie, mais je reviendrai.
Les murmures redoublèrent.
Pendant que Yeyeng sortait, habillée en femme du peuple avec
le: Da Usté su permiso? et que Carvajal lui
répondait: Pase usté adelante2, etc., deux soldats de la Garde
Civile s’approchèrent de D. Filipo, lui demandant de
suspendre la représentation.
—Et pourquoi? demanda-t-il surpris.
—Parce que l’alférez et sa dame se sont battus et
ne peuvent dormir.
—Dites à l’alférez que nous avons la
permission de l’Alcalde Mayor et que, contre ce permis,
personne ne peut rien dans le pueblo, même le
gobernadorcillo, qui est mon u-ni-que su-pé-rieur.
—Mais il faut suspendre la séance!
répétèrent les soldats.
D. Filipo haussa les épaules et leur tourna le dos. Les
gardes s’en allèrent.
Pour ne pas troubler la tranquillité, D. Filipo ne dit rien
à personne de cet incident.
Après un vaudeville qui fut très applaudi, le Prince
Villardo se présenta défiant tous les Mores qui
retenaient son père prisonnier; le héros les
menaçait de leur couper à tous la tête d’une
seule estafilade et de les envoyer dans la lune. Heureusement pour les
Mores, qui se disposaient à combattre au son de l’hymne de
Riego, un tumulte se produisit. L’orchestre s’arrêta,
les musiciens assaillirent le théâtre en jetant leurs
instruments. Le vaillant Villardo, qui ne les attendait [308]pas, les prenant
pour des alliés des Mores, jeta aussi son épée et
son bouclier et prit la fuite; les Mores, en voyant fuir un si terrible
chrétien s’enhardirent, à l’imiter; on
entendait des cris, des interjections, des imprécations, des
blasphèmes; tout le monde courait, se heurtait, les
lumières s’éteignaient, on lançait en
l’air les verres lumineux, etc.
—Les tulisanes, les tulisanes, criaient les uns.—Au feu,
au feu! aux voleurs! criaient les autres; les femmes et les enfants
pleuraient, les bancs et les spectateurs roulaient à terre au
milieu de la confusion, du brouhaha et du tumulte.
Que s’était-il passé?
Les deux gardes civils, bâton en main, avaient poursuivi les
musiciens pour arrêter le spectacle, le lieutenant principal et
les cuadrilleros armés de leurs vieux sabres, essayant vainement
de les retenir.
—Conduisez ces hommes au tribunal! criait D. Filipo; faites
attention de ne pas les laisser échapper!
Ibarra était revenu et cherchait Maria Clara. Les craintives
jeunes filles s’accrochaient à lui tremblantes et
pâles; la tante Isabel récitait les litanies en latin.
Lorsque la foule fut revenue de son effroi et se rendit compte de ce
qui s’était passé, l’indignation
éclata. Les pierres plurent sur le groupe des cuadrilleros
conduisant au tribunal les deux gardes civils; on proposa de mettre le
feu au quartier et d’y rôtir Da. Consolacion avec
l’alférez.
—C’est à cela qu’ils servent! criait une
femme en retroussant ses bras; à troubler le pueblo! Ils ne
poursuivent que les honnêtes gens. C’est là que sont
les tulisanes et les joueurs! Le feu au quartier!
L’un, se tâtant le bras, demandait à être
confessé; des accents plaintifs sortaient de dessous les bancs
renversés: c’était un pauvre musicien. La
scène était pleine d’artistes et d’habitants
du pueblo qui parlaient tous à la fois. Là, Chananay,
dans son costume de Léonor du [309]Trouvère causait en
jargon de tienda3 avec Ratia, vêtu en maître
d’école; Yeyeng, enveloppée dans un châle de
soie, conversait avec le prince Villardo; Balbino et les Maures
s’efforçaient de consoler les musiciens chagrinés.
Quelques Espagnols allaient de côté et d’autre,
haranguant tous ceux qu’ils rencontraient.
Mais déjà s’était formé un
rassemblement. D. Filipo avait appris les intentions de la foule et
courait la contenir.
—Ne troublez pas l’ordre! criait-il; demain nous
demanderons satisfaction, on nous fera justice; je vous réponds
qu’on nous fera justice!
—Non! répondirent quelques-uns; ils ont fait de
même à Calamba4, on leur a également promis justice et
l’Alcalde n’a rien fait! Nous nous ferons justice
nous-mêmes! Au quartier!
En vain s’efforçait le lieutenant; la foule ne
s’apaisait pas. D. Filipo cherchant autour de lui quelqu’un
qui pût le seconder aperçut Ibarra.
—Señor Ibarra, par grâce! maintenez-les tandis
que je vais chercher les cuadrilleros.
—Que puis-je faire? demanda le jeune homme perplexe; mais
déjà le lieutenant était loin.
A son tour, Ibarra regarda autour de lui, cherchant quelqu’un
sans savoir qui. Par bonheur, il crut distinguer Elias qui, impassible,
assistait au mouvement. Ibarra courut à lui, le prit par le bras
et lui dit en espagnol:
—Pour Dieu! faites quelque chose si vous le pouvez, moi je ne
puis rien.
Le pilote devait l’avoir compris, car il se perdit dans la
foule.
On entendit de vives discussions, de rapides interjections, puis,
peu à peu le groupe commença à se dissoudre,
prenant une attitude moins hostile. [310]
Il était temps, les soldats arrivaient armés,
baïonnette au canon.
Pendant ce temps, que faisait le curé?
Le P. Salvi ne s’était point couché. Debout, le
front appuyé contre les persiennes, il regardait vers la place,
immobile, laissant échapper parfois un soupir comprimé.
Si la lumière de sa lampe avait été moins basse,
peut-être aurait-on pu voir ses yeux se remplir de larmes. Il
passa ainsi une heure.
Le tumulte le surprit dans cette position. Etonné, il suivit
des yeux les allées et les venues du peuple; les cris arrivaient
confusément jusqu’à lui. Un domestique qui
accourait à perdre haleine l’informa de ce qui se
passait.
Une pensée traversa son imagination. Au milieu de la
confusion et du tumulte, le moment est propice aux libertins pour
profiter de l’effroi et de la faiblesse des femmes: toutes
fuient, chacun ne pense qu’à soi, un cri ne s’entend
pas, les pauvrettes s’évanouissent, se renversent,
tombent, la terreur fait taire la pudeur et, au milieu de la nuit...
quand on s’aime! Il s’imagina voir Crisóstomo
emportant dans ses bras Maria Clara défaillante et disparaissant
avec elle dans l’obscurité.
Il bondit dans les escaliers, sans chapeau, sans canne et, comme un
fou, courut vers la place.
Là, il rencontra les Espagnols qui réprimandaient les
soldats; il regarda vers les sièges qu’occupaient Maria
Clara et ses amies: ils étaient vides.
—Père Curé! Père Curé! lui
criaient les Espagnols. Mais il ne s’arrêta pas, il courait
vers la demeure de Capitan Tiago. Là, il respira; il vit
à travers le rideau transparent la silhouette adorable,
gracieuse, aux suaves contours de Maria Clara et celle de la tante qui
apportait des tasses et des verres.
—Allons! murmura-t-il, il semble qu’elle est seulement
malade.
Tante Isabel ferma ensuite les conchas des fenêtres et
l’ombre charmante disparut. [311]
Le curé s’éloigna sans voir la foule. Il avait
devant les yeux le superbe buste d’une belle jeune fille
endormie, respirant doucement; les paupières sont
ombragées par de longs cils, formant des courbes gracieuses
comme aux Vierges peintes par Raphaël; la petite bouche sourit;
tout le visage respire la virginité, la pureté,
l’innocence; c’est une douce vision au milieu des draperies
blanches de son lit; c’est une tête de chérubin
parmi les nuages.
Son imagination emportée achevait le tableau, lui montrait
encore... mais qui donc pourrait décrire tous les rêves de
ce cerveau ardent?
Peut-être en aurait été capable
l’infatigable correspondant du journal de Manille qui terminait
la description de la fête et de tous les événements
qui l’avaient accompagnée par ces lignes:
«Merci mille fois, infiniment merci pour l’opportune et
active intervention du T. R. P. Fr. Salvi qui, défiant tout
péril, parmi ce peuple furieux, au milieu de la tourbe
effrénée, sans chapeau, sans canne, apaisa les fureurs de
la multitude, ne faisant usage que de sa persuasive parole, de la
majesté et de l’autorité qui jamais ne manquent au
prêtre d’une Religion de paix. Le vertueux religieux, avec
une abnégation sans exemple, a abandonné les
délices du tranquille sommeil dont jouit toute bonne conscience,
comme la sienne, pour éviter que le plus petit malheur ne
vînt
frapper son troupeau. Les habitants de San Diego
n’oublieront sans doute pas ce sublime acte de leur
héroïque pasteur et sauront lui en être
éternellement reconnaissants».
[Table des matières]
XLI
Deux visites
Dans l’état d’esprit où se trouvait Ibarra
dormir lui était impossible; aussi, pour distraire son esprit et
éloigner [312]les tristes idées que la nuit rend plus
tristes encore, il se mit à travailler dans son cabinet
solitaire. Le jour le surprit faisant des combinaisons et des
mélanges, à l’action desquels il soumettait de
petits morceaux de canne à sucre ou d’autres substances,
qu’il enfermait ensuite dans des flacons numérotés
et cachetés.
Un domestique entra annonçant l’arrivée
d’un paysan.
—Qu’il entre! dit Crisóstomo sans se
retourner.
C’était Elias qui, debout, attendait sans rien
dire.
—Ah! c’est vous? s’écria Ibarra en le
reconnaissant. Excusez-moi si je vous ai fait attendre un moment, je ne
m’étais pas aperçu de votre entrée, je
faisais une expérience importante.
—Je ne veux pas vous déranger! répondit le jeune
pilote; je suis venu d’abord pour vous demander si vous aviez une
commission pour la province de Batangas où je pars, et ensuite
pour vous donner une mauvaise nouvelle...
Du regard Ibarra l’interrogea.
—La fille de Capitan Tiago est malade, ajouta tranquillement
Elias, mais non gravement.
—Je le craignais, répondit Ibarra d’une voix
débile. Savez-vous quelle est sa maladie?
—Une fièvre? Maintenant si vous n’avez rien
à me demander...
—Merci, mon ami, je vous souhaite un bon voyage... mais, avant
de partir, permettez-moi une question; si elle est indiscrète,
ne répondez pas.
Elias s’inclina.
—Comment avez-vous pu conjurer l’émeute
d’hier soir? demanda Ibarra en fixant ses yeux sur lui.
—Très simplement! répondit Elias avec le plus
grand naturel; ceux qui dirigeaient le mouvement étaient deux
frères dont le père est mort sous les bâtons de la
garde civile; j’eus un jour le bonheur de les sauver des
mêmes mains qui avaient tué leur père et tous deux
m’en sont restés reconnaissants. C’est à
[313]eux
que je me suis adressé, ils se sont chargés de dissuader
les autres.
—Et ces deux frères?...
—Finiront comme leur père, répondit Elias
à voix basse; quand une fois le malheur a marqué une
famille, tous les membres doivent périr; quand la foudre a
frappé un arbre, elle ne tarde pas à le réduire en
cendres.
Puis, voyant qu’Ibarra se taisait, il partit.
Resté seul, Crisóstomo perdit l’attitude sereine
qu’il avait conservée en présence du pilote et la
douleur se manifesta sur sa figure.
—C’est moi, c’est moi qui la fais souffrir!
murmura-t-il.
Il s’habilla rapidement et descendit les escaliers.
Un petit homme en deuil, portant une grande cicatrice à la
joue gauche, le salua humblement, l’arrêtant dans son
chemin.
—Que voulez-vous? lui demanda Ibarra.
—Señor, je m’appelle José, je suis le
frère de celui qui a été tué hier.
—Ah! je vous assure que je ne suis pas insensible à
votre chagrin... que désirez-vous?
—Señor, je veux savoir combien vous allez payer
à la famille de mon frère.
—Payer? répéta le jeune homme sans pouvoir
réprimer un mouvement d’ennui, nous reparlerons de ceci.
Venez cette après-midi, car je suis pressé.
—Dites-moi seulement ce que vous voulez donner? insista
José.
—Je vous dis que nous en parlerons un autre jour;
aujourd’hui je n’ai pas le temps! dit Ibarra avec
impatience.
—Vous n’avez pas le temps maintenant, señor?
demanda José avec amertume en se plaçant devant lui. Vous
n’avez pas le temps de vous occuper des morts?
—Venez cette après-midi, bonhomme! répéta
Ibarra en se contenant; je dois à l’instant voir une
personne malade. [314]
—Ah! et pour un malade vous oubliez les morts? Vous croyez que
parce que nous sommes pauvres...?
Ibarra le regarda et lui coupa la parole.
—Ne mettez pas ma patience à l’épreuve!
dit-il, et il poursuivit son chemin. José le suivit des yeux
avec un sourire plein de haine.
—On voit bien que c’est le petit-fils de celui qui
exposait mon père au soleil! murmura-t-il entre ses dents; il
est du même sang!
Et changeant de ton, il ajouta:
—Mais, si tu payes bien... amis!
[Table des matières]
XLII
Les époux de Espadaña
La fête est terminée; les habitants du pueblo
s’aperçoivent maintenant, comme tous les ans, que leur
bourse est vide, qu’il ont travaillé, sué et
veillé beaucoup sans s’amuser guère, sans
s’être même acquis de nouveaux amis, en un mot,
qu’ils ont acheté très cher du bruit et des maux de
tête. Mais, qu’importe! l’année prochaine on
recommencera, le siècle prochain il en sera encore de
même, car, jusqu’à présent on l’a fait
et il n’y a rien qui puisse faire renoncer à une habitude,
même coûteuse et nuisible.
Chez Capitan Tiago, la maison est triste. Toutes les fenêtres
sont fermées, à peine si l’on ose faire quelque
bruit et c’est à la cuisine seulement que l’on se
risque à parler à voix haute. Maria Clara,
l’âme de la maison, est clouée au lit;
l’état de sa santé se lit sur tous les visages
comme se lisent dans nos gestes les chagrins de notre âme.
—Qu’en dis-tu, Isabel? dois-je faire un don à la
croix de Tunasan ou à celle de Matahong? demande à voix
basse le père tout troublé. La croix de Tunasan [315]grandit,
mais celle de Matahong sue; quelle est selon toi la plus
miraculeuse?
La tante Isabel réfléchit, hoche la tête et
murmure:
—Grandir... grandir est plus miraculeux que suer; tous nous
suons, mais nous ne grandissons pas tous.
—C’est vrai, oui, Isabel, mais songe bien que suer...
pour du bois semblable à celui des pieds de banc, ce n’est
pas un petit miracle... Allons, le mieux sera de faire un don aux deux
croix, comme cela aucune ne sera fâchée et Maria Clara
guérira plus vite...
—Les appartements sont prêts? Tu sais qu’avec le
docteur vient un jeune homme nouvellement arrivé, parent par
alliance du P. Dámaso; il faut que rien ne manque.
A l’autre bout de la salle à manger sont les deux
cousines, Sinang et Victoria, qui viennent de tenir compagnie à
la malade. Andeng les aide à nettoyer un service d’argent
pour prendre le thé.
—Connaissez-vous le docteur Españada? demanda avec
intérêt à Victoria la sœur de lait de Maria
Clara.
—Non! tout ce que j’en sais, c’est qu’il
coûte très cher, d’après Capitan Tiago.
—Alors il doit être très bon! dit Andeng; celui
qui a percé le ventre de Da. Maria a pris très cher,
aussi était-il très savant.
—Sotte! s’écria Sinang; celui qui prend cher
n’est pas savant pour cela. Regarde le docteur Guevara; il
n’a pas su aider à l’accouchement, il a coupé
la tête de l’enfant et cependant a pris cinquante pesos au
veuf... tout ce qu’il savait c’était toucher!
—Qu’en sais-tu? lui demanda sa cousine en lui poussant
le coude.
—Ne dois-je pas le savoir? Le mari qui est un scieur de bois,
après avoir perdu sa femme, perdit aussi sa maison, parce que
l’Alcalde qui était l’ami du docteur l’obligea
à payer... ne dois-je pas le savoir? [316]mon père lui a
prêté l’argent pour faire le voyage à Santa
Cruz1.
Une voiture s’arrêtant devant la maison coupa court
à toutes les conversations.
Capitan Tiago, suivi de la tante Isabel, descendit en courant les
escaliers pour recevoir les nouveaux
arrivés.—C’étaient le docteur D. Tiburcio de
Espadaña, sa dame, la doctora Da. Victorina de los Reyes
de de Espadaña et un jeune Espagnol de physionomie
sympathique et d’aspect agréable.
Elle portait une robe de soie, bordée de fleurs et un chapeau
avec un grand perroquet, à demi aplati entre des rubans bleus et
rouges; la poussière du chemin, se mêlant sur ses joues
à la poudre de riz, accentuait plus fortement ses rides; comme
lorsque nous l’avons vue à Manille, aujourd’hui
encore elle donnait le bras à son mari boiteux...
—J’ai le plaisir de vous présenter notre cousin
D. Alfonso Linares de Espadaña! dit Da. Victorina en
désignant le jeune homme; le señor est fils adoptif
d’un parent du P. Dámaso, et secrétaire particulier
de tous les ministres...
Le jeune homme salua gracieusement; un peu plus, Capitan Tiago lui
aurait baisé la main.
Tandis que l’on monte les nombreuses malles, valises et sacs
de voyage des nouveaux arrivés et que Capitan Tiago les conduit
à leurs appartements, faisons plus ample connaissance avec ce
couple que nous avons seulement entrevu dans les premiers
chapitres.
Da. Victorina est une dame âgée de quarante-cinq
étés qui, selon ses calculs arithmétiques, sont
équivalents à trente-deux printemps. Elle avait
été très belle dans sa jeunesse, avait eu de
bonnes chairs—ainsi disait-elle d’habitude,—mais
extasiée, dans sa propre contemplation, elle avait
regardé avec le plus parfait dédain ses nombreux
adorateurs philippins; ses aspirations [317]la portaient vers une autre race.
Aussi n’avait-elle voulu accorder à personne sa main
blanche et fine, bien que souvent elle ait livré à divers
passagers étrangers ou compatriotes des joyaux et des bijoux de
valeur inestimable.
Depuis six mois elle avait réalisé son plus beau
rêve, celui de toute son existence, pour lequel elle avait
dédaigné les hommages de la jeunesse et même les
serments d’amour jadis murmurés à ses oreilles ou
chantés en quelque sérénade par Capitan Tiago.
Bien tard, il est vrai, s’accomplissait ce songe mais, bien
qu’elle ne parlât qu’un fort mauvais castillan, Da.
Victorina était plus espagnole que la Agustina de Zaragoza2, elle
connaissait le proverbe: Mieux vaut tard que jamais, et se
consolait en se le redisant sans cesse.—Sur la terre il
n’est point de bonheur complet, était son autre
maxime, mais ses lèvres ne prononçaient jamais devant qui
que ce soit ni l’un ni l’autre de ces deux dictons.
Sa première jeunesse, puis sa seconde, puis sa
troisième, s’étant passées à tendre
les filets pour pêcher dans l’océan du monde
l’objet de ses insomnies, Da. Victorina dut à la fin se
contenter de ce que le sort lui voulut bien départir. Si, au
lieu d’avoir trente-deux avrils, la pauvrette n’en avait
eu que
trente et un—la différence était
considérable pour son arithmétique—elle aurait
abandonné au Destin la prise qu’il lui offrait et en
eût attendu une autre plus conforme à ses désirs.
Mais la femme propose et la nécessité dispose; ayant
absolument besoin d’un mari, elle se vit obligée de se
contenter d’un pauvre homme qui, arraché de son
Estremadure, après avoir, moderne Ulysse, quelque six ou sept
ans erré de par le monde, trouva enfin dans l’île de
Luzon l’hospitalité, de l’argent et une Calypso
fanée... Le malheureux avait nom Tiburcio Espadaña et,
bien qu’il eût trente-cinq ans et parût vieux, il
était cependant plus jeune que Da. Victorina [318]qui n’en
avait que trente-deux: le pourquoi en est facile à comprendre
mais difficile à dire.
Il était parti pour les Philippines comme petit
employé des Douanes, mais sa mauvaise chance voulut
qu’après avoir beaucoup navigué et
s’être fracturé une jambe pendant ses voyages il
fût forcé de donner sa démission.
Se défiant de la mer, il ne voulait pas retourner en Espagne
sans avoir fait fortune et chercha une occupation. L’orgueil
espagnol ne lui permettait aucun travail corporel; ce
n’était pas que le pauvre homme, désireux de vivre
honorablement, n’eût accepté de faire
n’importe quoi avec plaisir, mais les nécessités du
prestige des Péninsulaires lui interdisaient certains
métiers et le prestige ne le nourrissait point.
D’abord il vécut aux dépens de quelques-uns de
ses compatriotes mais, ayant du cœur, ce pain lui semblait amer
et loin d’engraisser, il maigrissait. Comme il n’avait ni
science, ni argent, ni recommandations, ses protecteurs,
désireux de se débarrasser de lui, conseillèrent
donc à notre ami Tiburcio de s’en aller dans les provinces
et de s’y faire passer pour docteur en médecine. Cet
expédient ne lui convenait guère, il se refusa
d’abord à l’adopter; son service comme garçon
à l’Hôpital de San Carlos ne lui avait rien appris
de la science de guérir: il se bornait à
épousseter les bancs et à allumer le feu; encore
n’y était-il resté que peu de temps. Cependant, la
nécessité le pressant, ses amis lui démontrant la
vanité de ses scrupules, il fit ce qu’on lui disait,
parcourut la province et se mit à visiter quelques malades, ne
demandant qu’un prix modique que fixait sa conscience. Mais, de
même que le jeune philosophe dont parle Samaniego3, ses
prétentions devinrent très hautes et il finit par
attacher un tel prix à ses visites que promptement on le prit
pour un grand médecin. Il était en voie de faire fortune
et y aurait [319]probablement réussi si le
Protomedicato4 de Manille n’avait pas été
informé des honoraires exorbitants qu’il exigeait et de la
concurrence qu’il faisait aux autres médecins.
Des particuliers, des professeurs intercédèrent pour
lui.—Laissez-le donc! disaient-ils au jaloux Dr. C., laissez-le
faire sa petite pelote et, quand il aura ramassé six ou sept
mille pesos, il s’en retournera dans son pays et y vivra en paix.
En quoi cela vous gêne-t-il qu’il trompe ces bonnes dupes
d’Indiens? que ne sont-ils plus malins? C’est un pauvre
diable, ne lui retirez pas le pain de la bouche, montrez-vous bon
Espagnol!
Le docteur était bon Espagnol et consentit à fermer
les yeux, mais le bruit de l’affaire était arrivé
aux oreilles du public, la confiance disparut peu à peu et avec
elle la clientèle; la misère revint et D. Tiburcio
Espadaña se retrouva devoir presque mendier le pain de chaque
jour. C’est alors que, par un de ses amis qui avait
été l’intime de Da. Victorina, il apprit dans
quelle affliction se trouvait cette dame et quels étaient son
patriotisme et son bon cœur. D. Tiburcio vit là un coin de
ciel bleu et demanda à être présenté.
Da. Victorina et D. Tiburcio se virent. Tarde venientibus
ossa5, se
serait-il écrié s’il avait su le latin! Elle
n’était plus passable, elle était passée; sa
chevelure abondante s’était réduite à un
chignon qui, au dire de sa domestique, ne dépassait guère
la grosseur d’une tête d’ail; des rides
zébraient son visage et ses dents abandonnaient leur poste; les
yeux avaient également souffert et beaucoup; seul, son
caractère n’avait pas changé.
Après une demi-heure de conversation, ils
s’étaient compris, ils s’étaient
acceptés. Sans doute, elle aurait préféré
un Espagnol moins boiteux, moins bègue, moins chauve, moins
brèche-dents, mais ceux-là ne [320]lui avaient jamais
demandé sa main. Souvent elle avait entendu dire que
l’occasion était chauve et, très fermement, elle
crut que D. Tiburcio était l’occasion en personne, lui qui
devait à ses nuits blanches une calvitie
prématurée. A trente-deux ans quelle femme n’est
pas prudente?
Pour sa part, D. Tiburcio ne pouvait songer sans une vague
mélancolie à ce que serait sa lune de miel. Il se
résigna cependant, surtout lorsqu’il vit se dresser le
spectre de la faim. Ce n’est pas qu’il eût jamais eu
ni grandes prétentions ni grandes ambitions: ses goûts
étaient simples, ses désirs limités; mais son
cœur, jusqu’alors vierge, avait rêvé
d’une divinité bien
différente.—Là-bas, dans sa jeunesse, lorsque
lassé par le travail, il allait, après un frugal repas,
se coucher dans un mauvais lit pour digérer le gazpacho6, il
s’endormait en pensant à une image souriante et
caressante. Ensuite, quand les privations et les ennuis se furent
accrus, que les années écoulées n’eurent
point amené la poétique figure, il rêva d’une
bonne femme, économe, travailleuse, qui lui apporterait une
petite dot, le consolerait des fatigues du travail et se disputerait
avec lui de temps en temps!—oui, il songeait aux disputes comme
à une joie! Mais, quand obligé de vaguer de pays en pays
à la recherche, non pas de la fortune mais du pain quotidien,
lorsque illusionné par les récits de ses compatriotes qui
revenaient des colonies il se fut embarqué pour les Philippines,
le réalisme de la femme de ménage céda la place
à une métisse arrogante, à une belle indienne aux
grands yeux noirs, drapée dans la soie et les tissus
transparents, chargée d’or et de diamants, qui lui
apporterait son amour, ses voitures, etc. Il arriva aux Philippines et
crut son rêve réalisé, car les jeunes filles qui,
en des calèches argentées, roulaient à la Luneta
et au Malecon l’avaient d’abord regardé avec une
certaine [321]curiosité. Mais bientôt la
métisse disparut ainsi que l’indienne et, après un
long travail, le malheureux en fut réduit à se forger la
vision d’une veuve, mais d’une veuve agréable. Quand
il vit son rêve prendre corps en partie, la tristesse
l’envahit, mais, comme il avait une certaine dose de philosophie
naturelle, il se dit: «C’était un rêve; dans
le monde on ne vit pas en rêvant!» Et il raisonnait ainsi:
«Elle use beaucoup de poudre de riz, bah! quand on se marie! et
puis je ferai qu’elle s’en déshabitue; elle a
beaucoup de rides, mais mon habit a beaucoup de pièces et de
déchirures; c’est une vieille prétentieuse et
impérieuse, mais la faim est plus impérieuse et plus
prétentieuse encore, d’ailleurs je suis né avec un
caractère très doux et puis, qui sait? l’amour
modifie bien des choses et bien des esprits; elle parle très mal
le castillan, moi non plus je ne le parle pas très bien, le chef
de Division me l’a dit en me notifiant ma démission; de
plus qu’importe ceci? C’est une vieille laide et ridicule?
je suis boiteux, édenté, chauve!» D. Tiburcio
préférait soigner les autres que d’être
soigné lui-même pour maladie d’inanition. Quand
quelques amis se moquaient de lui: «Donne-moi du pain,
répondait-il, et appelle-moi niais.»
Il était de ceux dont on dit vulgairement qu’ils ne
feraient pas de mal à une mouche; modeste, incapable d’une
mauvaise pensée, aux temps anciens il se fût fait
missionnaire. Son séjour dans le pays n’avait pu lui
donner cette conviction de haute supériorité,
d’extraordinaire valeur et de grande importance qu’y
acquièrent en peu de semaines la plupart de ses compatriotes.
Son cœur n’avait jamais connu la haine, il n’avait
encore pu trouver un seul flibustier; il ne voyait que des malheureux
qu’il lui fallait plumer s’il ne voulait pas être
plus malheureux qu’eux. Quand on parla de le poursuivre pour
exercice illégal de la médecine, il n’en eut de
ressentiment contre personne, il ne se plaignit pas; il reconnaissait
le bien fondé [322]de l’accusation et se contentait de
répondre: Il me faut pourtant vivre.
Ils se marièrent donc7 et s’en allèrent à Santa
Anna passer leur lune de miel; la nuit même des noces, Da.
Victorina eut une terrible indigestion, D. Tiburcio rendit grâces
à Dieu et se montra dévoué et empressé. La
seconde nuit cependant il se comporta en homme honorable mais, lorsque
le lendemain il se regarda dans un miroir, il sourit avec
mélancolie, découvrant ses gencives dégarnies: il
avait vieilli d’au moins dix ans.
Enchantée de son mari, Da. Victorina le fit doter d’une
bonne denture postiche, habiller et équiper par les meilleurs
tailleurs de la ville, commanda des lustres et des voitures, et alla
jusqu’à l’obliger à avoir deux chevaux pour
les courses prochaines.
Tandis qu’elle transformait ainsi son époux, elle ne
s’oubliait pas elle-même: elle abandonna la jupe de soie et
la chemise de piña pour le costume européen; elle
substitua les fausses nattes à la simple coiffure des
Philippines, et par ses atours qui lui allaient divinement mal, troubla
la paix de tout son oisif et tranquille voisinage.
Son mari, qui jamais ne sortait à pied,—elle ne voulait
pas qu’il affichât son infirmité—la promenait
toujours là où il n’y avait personne; elle, qui
aurait voulu faire briller son mari aux yeux de tous, en souffrait
beaucoup, mais elle se taisait, ne voulant pas troubler la lune de
miel.
L’éclat de cet astre commença à
pâlir lorsqu’il voulut lui faire des observations sur
l’abus qu’elle faisait des poudres de riz.
Comme il lui faisait remarquer que rien n’était plus
laid que le faux ni mieux que le naturel, Da. Victorina fronça
les sourcils et regarda sa denture postiche. Il comprit et se tut.
[323]
Au bout de peu de temps elle se crut mère et annonça
l’heureux événement à tous ses amis:
—Le mois prochain, moi et de Espadaña nous irons
à la Pegninsule; je ne veux pas que notre fils naisse ici
et qu’on l’appelle révolutionnaire.
Elle mit un de avant le nom de son mari; le de ne
coûtait rien et donnait un genre. Elle signait: Victorina de los
Reyes de de Espadaña; ce de de Espadaña
était sa manie; ni le graveur de ses cartes de visite ni son
mari n’avaient pu l’y faire renoncer.
—Si je ne mets qu’un seul de, on peut croire que
tu ne l’as pas, imbécile! disait-elle à D.
Tiburcio.
Continuellement elle parlait de ses préparatifs de voyage,
apprenant par cœur les noms des points d’escale et
c’était un plaisir de l’entendre dire:—Je vais
voir l’isme du canal de Suez; De Espadaña croit que
c’est le plus joli et De Espadaña a parcouru le monde
entier.—Il est probable que je ne reviendrai jamais dans ce pays
de sauvages.—Je ne suis pas née pour vivre ici; Aden ou
Port-Saïd me conviendraient mieux; toute enfant je le croyais,
etc. Dans sa géographie particulière, Da. Victorina
divisait le monde en deux parties, l’Espagne et les
Philippines.
Le mari sentait le ridicule de ces barbarismes mais il ne disait
rien, craignant qu’elle ne se moquât de lui et ne lui
fît honte de son bégaiement. Elle fit la fantasque pour
augmenter ses illusions de maternité et affecta de se
vêtir de couleurs chatoyantes, de s’orner de fleurs et de
rubans, de se promener en robe de chambre sur l’Escolta, mais,
ô désillusion! trois mois se passèrent et le
rêve s’évanouit. Aucune raison ne subsistant plus
pour que l’enfant devînt un révolutionnaire, elle
renonça au voyage. Elle eut beau consulter les médecins,
les matrones, les vieilles femmes, tout fut inutile, et, comme au grand
mécontentement de Capitan Tiago elle s’était
moquée de S. Pascual Bailon, elle ne voulut recourir à
aucun saint ni à aucune sainte. Aussi, un ami de son mari lui
dit-il un jour: [324]
—Croyez-moi, señora, vous êtes le seul esprit
fort qu’il y ait dans ce pays.
Elle sourit sans comprendre, mais le soir, avant de
s’endormir, elle demanda à son mari ce que
c’était que de l’esprit fort.
—Ma chère, lui répondit-il, l’es...
l’esprit le plus fort que je connaisse, c’est
l’ammoniaque; mon ami aura fait une figure de rhé...
rhétorique.
Depuis lors, chaque fois qu’elle en trouvait l’occasion,
elle ne manquait pas de dire:
—Je suis le seul ammoniaque de ce pays abruti, soit dit par
rhétorique, c’est l’avis du señor N. de N.
péninsulaire de très grande catégorie.
Quand elle parlait, on devait obéir; elle avait réussi
à dominer complètement son mari qui, sans
résistance, en était arrivé à
n’être plus que son petit toutou d’appartement.
S’il la gênait, elle ne le laissait pas sortir et, dans ses
moments de grande colère, elle lui arrachait sa fausse
mâchoire, le laissant un ou plusieurs jours, selon le cas,
horriblement défiguré.
Elle s’avisa que son mari devait être docteur en
médecine et chirurgie.
—Tu veux donc que l’on me mette en prison? demanda-t-il
épouvanté.
—Ne fais pas la bête et laisse-moi arranger cela!
répondit-elle; tu ne soigneras personne, mais je veux que
l’on t’appelle docteur et moi doctoresse, voilà!
Le lendemain, Rodoreda recevait l’ordre de graver sur une
plaque de marbre noir:
Dr de
Espadaña,
Spécialiste En Toutes Sortes de Maladies.
Toute la valetaille dut leur donner les nouveaux titres; le nombre
de fanfreluches s’augmenta, l’enduit de poudres de riz
s’épaissit, les rubans et les dentelles
s’entassèrent, Da. Victorina regarda avec plus de
dédain que jamais ses pauvres compatriotes qui n’avaient
pas eu le bonheur d’avoir un mari d’aussi haute [325]catégorie que le sien. Chaque jour elle
se sentait s’élever, se dignifier plus; en continuant
ainsi, au bout d’un an, elle se serait persuadée
qu’elle était d’origine divine.
Toute cette gloire, tous ces sublimes pensers
n’empêchaient pas cependant que chaque jour elle ne
fût plus vieille et plus ridicule. Chaque fois que Capitan Tiago
se trouvait avec elle et se rappelait lui avoir vraiment causé
d’amour, il envoyait aussitôt un peso à
l’église pour une messe d’actions de grâces;
cependant il avait beaucoup de respect pour D. Tiburcio, à cause
de son titre de spécialiste en toutes sortes de maladies, et
écoutait avec attention les rares phrases que son
bégayement lui permettait de prononcer. C’est pour cela,
et aussi parce que ce docteur ne prodiguait pas ses visites à
tout le monde comme les autres médecins, que Capitan Tiago
l’avait choisi pour soigner sa fille.
Quant au jeune Linarès, son histoire était
différente. Au moment où elle se disposait à
partir en Espagne, Da. Victorina, peu confiante dans les Philippins,
chercha à prendre un intendant péninsulaire; son mari se
souvint d’un de ses cousins qui étudiait le droit à
Madrid et qui était considéré comme le plus malin
de la famille; ils lui écrivirent donc, lui envoyant
d’avance le prix du passage et, quand le rêve se fût
évanoui, le jeune homme était déjà en
route.
Tels étaient les trois personnages qui arrivaient chez
Capitan Tiago.
Le père Salvi entra tandis qu’ils prenaient le second
déjeuner et les époux qui le connaissaient
déjà lui présentèrent, avec tous ses
titres, le jeune Linarès qui rougit quelque peu.
Naturellement on parla de Maria Clara; la jeune fille reposait et
dormait. On parla aussi du voyage; Da. Victorina fit briller sa
loquacité en critiquant les coutumes des provinciaux, leurs
maisons de nipa, leurs [326]ponts de bambou, elle n’oublia pas de
faire savoir au curé ses relations amicales avec le Segundo
Cabo8, avec
l’Alcalde un tel, avec le Conseiller ceci, avec l’Intendant
cela, toutes personnes de catégorie qui avaient pour elle la
plus grande considération.
—Si vous étiez venue deux jours plus tôt, Da.
Victorina, reprit Capitan Tiago, profitant d’une petite pause de
la dame, vous vous seriez rencontré avec Son Excellence le
Capitaine Général: il était assis à cette
place.
—Quoi? Comment? Son Excellence était ici? Et chez vous?
Ce n’est pas possible!
—Je vous dis qu’il s’est assis là! Si vous
étiez venue il y a deux jours...
—Ah! quel malheur que Clarita ne soit pas tombée malade
plus tôt, s’écria-t-elle, véritablement
ennuyée; et s’adressant à Linares:
—Ecoute, cousin? Son Excellence était ici! Vois-tu
comme De Espadaña avait raison quand il te disait de ne pas
aller chez un misérable Indien? Parce que vous saurez, D.
Santiago, que notre cousin, à Madrid, était l’ami
des ministres et des ducs et qu’il dînait chez le comte du
Campanario.
—Chez le duc de la Torre9, Victorina, corrigea son mari.
—C’est la même chose; si tu me disais...?
—Trouverai-je aujourd’hui le P. Dámaso à
son pueblo? interrompit Linares en s’adressant au P. Salvi; on
m’a dit qu’il était tout près
d’ici.
—Le P. Dámaso est justement ici même et va venir
d’un moment à l’autre, répondit le
curé.
—J’en suis bien content! j’ai une lettre pour lui,
s’écria le jeune homme, et si une heureuse chance ne [327]m’avait pas amené ici, je serais
venu exprès pour lui rendre visite.
Entre temps, l’heureuse chance,
c’est-à-dire Maria Clara, s’était
réveillée.
—De Espadaña? dit Da. Victorina, quand le
déjeuner fut terminé, allons-nous voir Clarita?
Et, se tournant vers Capitan Tiago, elle ajouta:
—C’est pour vous qu’il le fait, D. Santiago, pour
vous seul! Mon mari ne soigne que les personnes de catégorie, et
encore! Mon mari n’est pas comme ceux d’ici... à
Madrid, il ne visitait que les personnages de catégorie.
Ils passèrent dans la chambre de la malade.
L’appartement était presque dans
l’obscurité, les fenêtres closes par crainte des
courants d’air; seuls, deux cierges brûlant devant une
image de la Vierge d’Antipolo projetaient quelque
lumière.
La tête ceinte d’un mouchoir imbibé d’eau
de Cologne, le corps soigneusement enveloppé dans des draps
blancs dont les multiples plis voilaient ses formes virginales, la
jeune fille était étendue dans son lit de
Kamagon10
entre des rideaux de jusi et de piña. Ses cheveux, encadrant son
visage, augmentaient cette pâleur transparente qu’animaient
seulement ses deux grands yeux pleins de tristesse. Près
d’elle étaient ses deux amies et Andeng tenant une branche
de lis.
De Espadaña lui prit le pouls, examina la langue, fit
quelques questions et hochant la tête:
—E... elle est malade, mais cela peut se guérir!
Da. Victorina regarda l’assistance avec orgueil, mais le
praticien ordonnait:
—Du lichen avec du lait pour le matin, du sirop de guimauve,
deux pilules de cynoglosse!
—Prends courage, Clarita, dit Da. Victorina en
s’approchant; nous sommes venus pour te guérir... Je vais
te présenter notre cousin! [328]
Linares contemplait, absorbé, ces yeux éloquents qui
semblaient chercher quelqu’un; il n’entendit pas Da.
Victorina.
—Señor Linares, lui dit le curé en
l’arrachant à son extase; voici le P. Dámaso.
C’était lui, en effet, pâle et quelque peu
triste; aussitôt relevé, sa première visite
était pour Maria Clara. Mais ce n’était plus le P.
Dámaso d’antan, si robuste, si décidé;
maintenant il s’en allait silencieux, d’une marche
indécise.
[Table des matières]
XLIII
Projets
Sans se soucier de personne, le P. Dámaso vint droit au lit
de la malade et, lui prenant la main:
—Maria! dit-il avec une indicible tristesse, et ses larmes
jaillirent, Maria, ma fille, tu ne dois pas mourir!
Maria Clara ouvrit les yeux et le regarda avec un certain
étonnement.
Personne de ceux qui connaissaient le franciscain ne le supposait
capable de tendres sentiments; sous cette rude et grossière
enveloppe personne ne croyait que battît un cœur.
Le P. Dámaso ne put en dire plus et, s’éloignant
de la jeune fille en pleurant comme un enfant, il s’en fut
derrière la tapisserie pour donner libre cours à sa
douleur, sous les plantes grimpantes favorites du balcon de Maria
Clara.
—Comme il aime sa filleule! pensaient-ils tous.
Fr. Salvi le contemplait immobile et silencieux, se mordant
légèrement les lèvres.
Lorsque son chagrin fut un peu apaisé, Da. Victorina lui
présenta le jeune Linares qui s’approcha de lui avec
respect. [329]
Fr. Dámaso, sans rien dire, le contempla, des pieds à
la tête, prit la lettre qu’il lui tendait et la lut sans
paraître y rien comprendre, puis lui demanda:
—Eh bien! qui êtes-vous?
—Alfonso Linares, le filleul de votre beau-frère...
balbutia le jeune homme.
Le P. Dámaso rejeta la tête en arrière, examina
de nouveau le jeune homme et son visage s’éclairant, se
leva:
—Comment, c’est toi le filleul de Carlicos1!
s’écria-t-il en le serrant dans ses bras; viens que je
t’embrasse... Il y a quelques jours j’ai reçu une
lettre de lui...! Comment c’est toi! Je ne t’ai pas
connu... tu n’étais pas encore né quand j’ai
quitté le pays, je ne te connaissais pas!
Et le P. Dámaso serrait dans ses bras robustes le jeune homme
qui devenait rouge, peut-être par timidité,
peut-être aussi parce qu’il étouffait. Le P.
Dámaso paraissait avoir complètement oublié son
chagrin.
Les premiers moments d’effusion passés, les
premières questions touchant Carlicos et la Pepa faites, le P.
Dámaso l’interrogea:
—Voyons, qu’est-ce que Carlicos veut que je fasse pour
toi?
—Je crois qu’il dit quelque chose dans la lettre...
balbutia de nouveau Linares.
—Dans la lettre? Voyons? C’est vrai. Il veut que je te
trouve un emploi et une femme! Hein! L’emploi... l’emploi,
c’est facile. Tu sais lire et écrire?
—J’ai fait mes études à
l’Université Centrale et y ai été
reçu avocat!
—Carambas! serais-tu par hasard un menteur? Tu n’en as
pas la touche... on dirait une mademoiselle; mais tant mieux! Quant
à te donner une femme... hem! hem! une femme... [330]
—Père, cela n’est pas si pressé, dit
Linares confus.
Mais le P. Dámaso se promenait de long en large en murmurant:
Une femme! une femme!
Son visage n’était plus ni triste ni réjoui; il
était du plus grand sérieux, on y voyait la
préoccupation de son esprit. De loin, le P. Salvi regardait
toute cette scène.
—Je ne croyais pas que la chose pût me faire tant de
peine! murmura le P. Dámaso d’une voix plaintive; mais de
deux maux il faut choisir le moindre.
Et levant la voix, il s’approcha de Linares.
—Viens par ici, garçon, dit-il; nous allons causer
à Santiago.
Linares pâlit et se laissa entraîner par le prêtre
qui marchait pensif.
Ce fut alors au tour du P. Salvi de se promener en méditant
comme toujours.
Une voix qui lui souhaitait le bonjour le tira de sa rêverie;
il leva la tête et aperçut José qui le saluait
humblement.
—Que veux-tu? demandèrent les yeux du curé.
—Père, je suis le frère de celui qui est mort le
jour de la fête! répondit José d’un ton
larmoyant.
Le P. Salvi se recula.
—Eh bien! quoi? murmura-t-il d’une voix
imperceptible.
L’homme fit un effort pour pleurer, il s’essuyait les
yeux avec son mouchoir.
—Père, dit-il en pleurnichant, je suis allé chez
D. Crisóstomo pour lui demander l’indemnité... il
m’a d’abord reçu à coups de pied, me disant
qu’il ne voulait rien payer, car lui-même avait failli
être tué par la faute de mon cher et malheureux
frère. Hier, je suis retourné pour lui parler, mais il
était parti à Manille, me laissant, comme par
charité, cinq cents pesos et me faisant dire de ne jamais
revenir. Ah, Père, cinq cents pesos pour mon pauvre
frère, cinq cents pesos... ah! Père...
Le curé surpris l’écoutait d’abord avec
beaucoup [331]d’attention; puis lentement, sur ses
lèvres, se refléta un sourire empreint d’un
mépris si sarcastique que José s’il l’avait
vu, se serait sauvé à toutes jambes.
—Et que veux-tu maintenant? lui demanda le prêtre en
haussant les épaules.
—Ah! Père, dites-moi pour l’amour de Dieu, ce que
je dois faire; le Père a toujours donné de bons
conseils.
—Qui te l’a dit? Tu n’es pas d’ici...
—Le Père est connu de toute la province!
Le P. Salvi, le regard irrité, s’approcha de
José épouvanté et, lui montrant la rue:
—Va-t’en chez toi et rends grâce à D.
Crisóstomo qu’il ne t’ait pas fait envoyer en
prison. Va-t’en d’ici!
Oubliant de jouer son rôle, José murmura:
—Mais je croyais...
—Va-t’en d’ici! cria le P. Salvi avec un accent
nerveux.
—Je voudrais voir le P. Dámaso....
—Le P. Dámaso est occupé... va-t’en!
commanda encore une fois impérieusement le curé.
José descendit les escaliers en murmurant:
—Celui-ci est comme l’autre... comme il ne paye pas
bien!... Celui qui paye le mieux...
A la voix du curé tous étaient accourus, même le
P. Dámaso, Santiago et Linares.
—C’est un insolent vagabond qui vient demander
l’aumône et ne veut pas travailler! leur dit le P. Salvi en
prenant son chapeau et sa canne pour retourner au couvent.
[Table des matières]
XLIV
Examen de conscience
De longs jours suivis de tristes nuits ont été
passés au chevet de la malade; quelques moments après
s’être [332]confessée, Maria Clara avait eu une
rechute et, pendant son délire, elle ne prononçait que le
nom de sa mère qu’elle n’avait jamais connue. Ses
amies, son père, sa tante, la veillaient, comblant
d’aumônes et d’argent pour des messes, toutes les
images miraculeuses; Capitan Tiago avait promis un bâton
d’or à la Vierge d’Antipolo. Enfin lentement et
régulièrement la fièvre commença à
décroître.
Le Dr. De Espadaña était stupéfait des vertus
du sirop de guimauve et de la décoction de lichen, prescriptions
qu’il n’avait pas variées. Da. Victorina
était si contente de son mari que, celui-ci ayant un jour
marché sur la queue de sa robe, elle ne lui appliqua pas son
code pénal ordinaire en lui arrachant la denture, mais se
contenta de lui dire:
—Si tu n’étais pas boiteux tu
m’écraserais jusqu’à mon corset.
Cette modération n’était guère dans ses
habitudes.
Une après-midi, tandis que Sinang et Victorina étaient
allées voir leur amie, le curé, Capitan Tiago et la
famille de Espadaña causaient dans la salle à manger.
—J’en suis désolé, disait le docteur, et
le P. Dámaso en sera aussi bien frappé.
—Et, où dites-vous qu’on l’envoie? demanda
Linares au curé.
—Dans la province de Tabayas! répondit
négligemment celui-ci.
—Maria Clara également le regrettera beaucoup, ajouta
Capitan Tiago, elle l’aimait comme un père.
Fr. Salvi le regarda du coin de l’œil.
—Je crois, Père, continua Capitan Tiago, que sa maladie
ne provient que du chagrin qu’elle a eu le jour de la
fête.
—Je suis du même avis que vous; aussi avez-vous bien
fait en ne permettant pas au Sr. Ibarra de lui parler, cela
n’aurait pu qu’aggraver son état.
—Et c’est seulement grâce à nous,
interrompit Da. [333]Victorina, que Clarita n’est pas
déjà au ciel à chanter les louanges de Dieu.
—Amen Jésus! crut devoir dire Capitan Tiago.
—Il est heureux pour vous que mon mari n’ait pas eu un
malade de plus haute catégorie, car vous auriez dû appeler
un autre médecin et ici tous sont ignorants; mon mari...
—Je crois et je sais pourquoi je le dis, interrompit à
son tour le curé, que la confession de Maria Clara a
provoqué cette crise favorable qui lui a sauvé la vie.
Une conscience pure vaut mieux que beaucoup de médicaments; ne
croyez pas que je nie le pouvoir de la science, surtout celui de la
chirurgie! mais une conscience pure... Lisez les livres pieux et vous
verrez combien de guérisons ont été
opérées sans autre médecine qu’une bonne
confession!
—Pardonnez, objecta Da. Victorina piquée, quant au
pouvoir de la confession... guérissez donc la femme de
l’alférez avec une confession!
—Une blessure, señora, n’est pas une maladie sur
laquelle puisse influer la conscience! répliqua
sévèrement le P. Salvi. Cependant une bonne confession la
préserverait de recevoir désormais des coups comme ceux
qu’elle a reçus ce matin.
—Elle les mérite! continua Da. Victorina, comme si elle
n’avait pas entendu ce qu’avait dit le P. Salvi. Cette
femme est très insolente! A l’église, elle
n’a fait que me regarder; on voit bien ce qu’elle est;
j’avais envie de lui demander ce que j’avais de curieux sur
la figure, mais qui donc se salirait à parler avec ces gens qui
ne sont pas de catégorie?
Le curé, de son côté, comme s’il
n’avait pas entendu toute cette tirade, continua:
—Croyez-moi, D. Santiago; pour achever de guérir votre
fille, il est nécessaire qu’elle communie demain; je lui
apporterai le viatique... je crois qu’elle n’a pas besoin
de se confesser, mais cependant... si elle veut recommencer une seconde
fois ce soir... [334]
—Je ne sais pas, reprit immédiatement Da. Victorina
profitant d’une pause, je ne comprends pas qu’il puisse
exister des hommes capables de se marier avec de tels
épouvantails, on voit de loin d’où elle vient,
cette femme; elle se meurt d’envie, cela saute aux yeux; que peut
gagner un alférez?
—Ainsi donc, D. Santiago, dites à votre économe
de prévenir la malade qu’elle communiera demain; je
viendrai ce soir l’absoudre de ses peccadilles...
Et voyant que la tante Isabel sortait, le curé lui dit en
tagal:
—Préparez votre nièce à se confesser ce
soir; demain je lui apporterai le viatique; comme cela elle
guérira plus vite.
—Mais, Père, se risqua à objecter timidement
Linares, ne va-t-elle pas se croire en danger de mort?
—Ne vous inquiétez pas! lui répondit le
prêtre sans le regarder, je sais ce que je fais; j’ai
déjà assisté de nombreux malades; de plus elle
dira si oui ou non elle veut recevoir la sainte communion et vous
verrez comme elle dira oui à tout.
Capitan Tiago dut lui aussi dire promptement oui à tout.
La tante Isabel entra dans l’alcôve de la malade.
Maria Clara était toujours couchée, pâle,
très pâle; à côté d’elle
étaient ses deux amies.
—Prends encore une pilule, disait Sinang à voix basse,
en lui présentant un granule blanc qu’elle tira d’un
petit tube de cristal; il a dit que tu suspendes le traitement quand tu
entendras du bruit ou un bourdonnement dans les oreilles.
—Il ne t’a pas récrit? demanda tout bas la
malade.
—Non, il doit être très occupé!
—Il ne te demande pas de me rien dire?
—Non, il me dit seulement qu’il va faire ses efforts
pour se faire absoudre par l’Archevêque de son
excommunication afin que...
L’arrivée de la tante suspendit la conversation. [335]
—Le Père a dit que tu te disposes à te
confesser, ma fille, dit-elle; laissez-la faire son examen de
conscience.
—Mais il n’y a pas une semaine qu’elle s’est
déjà confessée! protesta Sinang. Je ne suis pas
malade et je ne pèche pas si vite!
—Pourquoi pas? Ne savez-vous pas ce que dit le curé: le
juste pèche sept fois par jour? Allons, veux-tu que je
t’apporte l’Ancre, le Bouquet ou le Droit
chemin pour aller au ciel?
Maria Clara ne répondit pas.
—Allons, il ne faut pas te fatiguer, ajouta la bonne tante
pour la consoler; je lirai moi-même l’examen de conscience
et tu n’auras qu’à te souvenir de tes
péchés.
—Ecris-lui qu’il ne pense plus à moi! murmura la
malade à l’oreille de Sinang quand celle-ci prit
congé d’elle.
—Comment?
Mais la tante était revenue et Sinang dut
s’éloigner sans comprendre ce que son amie lui avait
dit.
La bonne tante approcha une chaise près de la lumière,
assura ses lunettes sur la pointe de son nez et, ouvrant un petit
livre, dit:
—Fais bien attention, ma fille; je vais commencer par les
Commandements de Dieu; j’irai lentement pour que tu puisses
méditer; si tu ne m’entends pas bien, tu me le diras pour
que je répète; tu sais que pour ton bien je ne me lasse
jamais.
Et, d’une voix monotone et nasillarde, elle commença
à lire les considérations relatives aux occasions de
pécher. A la fin de chaque paragraphe elle
s’arrêtait longuement pour donner le temps à la
jeune fille de se souvenir de ses péchés et de s’en
repentir.
Vaguement, Maria Clara regardait l’espace. Le premier
commandement d’aimer Dieu par dessus toutes choses
terminé, la tante Isabel l’observa par dessus ses lunettes
et parut satisfaite de son air triste et méditatif. [336]Elle toussa
pieusement et, après une longue pause, commença le second
commandement. La bonne vieille lut avec onction et, les
considérations terminées, regarda de nouveau sa
nièce qui lentement tourna la tête de l’autre
côté.
—Bah! dit en elle-même la tante Isabel; pour ce qui est
de jurer son saint nom, la pauvre petite n’a rien à y
voir. Passons au troisième.
Et le troisième commandement épluché et
commenté, lues toutes les causes de pécher contre lui,
elle regarda de nouveau vers le lit; maintenant la tante levait ses
lunettes et se frottait les yeux; elle avait vu sa nièce porter
son mouchoir à ses yeux comme pour essuyer des larmes.
—Hum! dit-elle, hem! la pauvre enfant s’est endormie
pendant le sermon.
Et, replaçant ses lunettes sur le bout de son nez, elle
ajouta:
—Nous allons voir si, de même qu’elle n’a
pas sanctifié les fêtes, elle n’a pas honoré
son père et sa mère.
Et, d’une voix plus lente, plus nasillarde encore, elle lut le
quatrième commandement, croyant donner ainsi plus de
solennité à son acte, comme elle l’avait vu faire
à beaucoup de moines; la tante Isabel n’avait jamais
entendu prêcher un quaker, sans quoi elle se serait mise aussi
à trembler.
La jeune fille, en ce moment, s’essuyait de nouveau les yeux,
sa respiration devenait plus forte.
—Quelle âme pure! pensait la vieille dame; elle qui est
si obéissante, si soumise avec tous? J’ai
péché beaucoup plus que cela et n’ai jamais pu
pleurer pour de bon!
Et elle commença le cinquième commandement, avec des
pauses plus longues, une voix plus parfaitement nasillarde encore, et
un tel enthousiasme qu’elle n’entendait pas les sanglots
étouffés de sa nièce. Ce ne fut qu’en
s’arrêtant après les considérations sur
l’homicide à main armée qu’elle perçut
les gémissements [337]de la pécheresse. Alors, d’un ton
qui surpassait le sublime, d’une voix qu’elle
s’efforçait de rendre menaçante, elle lut la suite
du commandement et voyant que Maria Clara n’avait pas
cessé de pleurer.
—Pleure, ma fille, pleure! lui dit-elle en s’approchant
du lit; plus tu pleureras, plus promptement te pardonnera Dieu. Que ta
douleur de contrition soit meilleure que celle d’attrition.
Pleure, ma fille, pleure, tu ne sais pas quelle joie te vient de
pleurer! Frappe-toi aussi la poitrine, pas trop fort, car tu es encore
malade.
Mais, comme si la douleur avait besoin de mystère et de
solitude, Maria Clara, se voyant surprise, cessa peu à peu de
soupirer, sécha ses yeux sans dire un mot, sans rien
répondre à sa tante.
Celle-ci poursuivit sa lecture mais, comme la plainte de son public
avait cessé, elle perdit son enthousiasme; les derniers
commandements lui donnèrent sommeil et la firent bâiller,
ce qui interrompit le monotone nasillement.
—Il faut l’avoir vu pour le croire! pensait la bonne
vieille; cette enfant pèche comme un soldat contre les cinq
premiers commandements et du sixième au dixième, pas un
péché véniel; c’est le contraire de nous
toutes! On voit de drôles de choses maintenant.
Et elle alluma un grand cierge à la Vierge d’Antipolo
et deux autres plus petits à Notre-Dame du Rosaire et à
Notre-Dame del Pilar, prenant bien soin de décrocher et de
mettre dans un coin un crucifix d’ivoire pour lui donner à
entendre que les cierges ne brûlaient pas pour lui. La Vierge de
Delaroche fut également exclue de cette illumination;
c’était une étrangère inconnue et la tante
Isabel n’avait pas encore entendu dire qu’elle eût
fait aucun miracle.
Nous ignorons ce qui se passa pendant la confession qui se fit le
soir; nous respectons ces secrets. Elle fut longue et la tante, qui de
loin veillait sur sa nièce, put remarquer que, au lieu de tendre
l’oreille aux [338]paroles de la malade, le curé au
contraire avait la figure tournée vers elle; on aurait dit
qu’il voulait deviner les pensées de la jeune fille ou les
lire dans ses beaux yeux.
Pâle, les lèvres serrées, le P. Salvi sortit de
l’appartement. A voir son front obscurci et couvert de sueur on
aurait dit que c’était lui qui s’était
confessé et que l’absolution lui avait été
refusée.
—Jésus, Marie, Joseph! dit la tante en se signant pour
chasser une mauvaise pensée; qui peut comprendre les jeunes
filles d’à présent?
[Table des matières]
XLV
Les persécutés
A la faveur de la faible clarté que diffuse la lune à
travers les épaisses frondaisons des grands arbres, un homme
vague par le bois; son pas est lent mais assuré. De temps en
temps, comme pour s’orienter, il siffle un air particulier
auquel, de loin, un autre sifflement répond par le même
air. L’homme attentif écoute, puis poursuit sa route vers
le côté d’où partent ces sons lointains.
Enfin, après avoir lutté contre les multiples
obstacles qu’oppose une forêt vierge à la marche de
l’homme, surtout la nuit, il arrive à une petite
clairière baignée par la lumière de la lune en son
premier quartier. Des roches élevées, couronnées
d’arbres, s’érigent à l’entour formant
comme un amphithéâtre en ruines; d’autres arbres
récemment coupés, des troncs encore carbonisés
gisent au milieu, confondus avec d’énormes rocs que la
nature recouvre à demi de son vert manteau.
A peine l’inconnu entrait-il dans la clairière
qu’une autre forme humaine, sortant prudemment de derrière
un grand rocher, s’avança un revolver à la main.
[339]
—Qui es-tu? demanda-t-elle en tagal, d’une voix
impérieuse en armant le chien de son arme.
—Le vieux Pablo est-il parmi vous? répondit
l’arrivant d’une voix tranquille, sans
déférer à la question qui lui était
posée, sans paraître intimidé.
—Tu parles du capitaine? Oui, il est là.
—Dis-lui alors qu’Elias le cherche.
—Vous êtes Elias? demanda l’autre avec un certain
respect; et il s’approcha, sans pour cela cesser de tenir son
revolver prêt à faire feu; eh bien!... venez.
Elias le suivit.
Ils pénétrèrent dans une sorte de caverne qui
se creusait dans les profondeurs de la terre. Le guide, qui connaissait
le chemin, avertissait le pilote quand il fallait descendre,
s’incliner ou se traîner couché; cependant le trajet
ne dura pas longtemps; ils arrivèrent à une espèce
de salle, éclairée misérablement par des torches
de goudron où, les uns assis, les autres couchés, douze
ou quinze individus armés, sales, déchirés,
sinistres, causaient tout bas entre eux. Les coudes appuyés sur
une pierre faisant l’office de table, un vieillard, la
physionomie triste, la tête enveloppée d’un bandeau
sanglant, contemplait cette lumière qui répandait tant de
fumée pour si peu de clarté; si nous ne reconnaissions
pas l’endroit pour une caverne de tulisanes, le désespoir
qui se peignait sur la figure du vieillard nous aurait fait croire que
c’était la Tour de la Faim, la veille du jour où
Ugolin dévora ses enfants.
Lorsque Elias arriva avec son guide, les hommes furent pour se
lever, mais un signe de leur camarade les tranquillisa, ils se
contentèrent d’examiner le pilote qui était
complètement désarmé.
Le vieillard tourna lentement la tête et aperçut Elias
qui restait debout, grave, la tête découverte, plein de
tristesse, le cœur ému.
—C’était donc toi? demanda le vieux chef, dont le
[340]regard, en reconnaissant le jeune homme
s’anima quelque peu.
—En quel état vous trouvai-je? murmura Elias à
mi-voix et remuant la tête.
Le vieillard baissa la tête en silence, fît un signe aux
hommes qui se levèrent et s’éloignèrent, non
sans mesurer des yeux la taille et les muscles du pilote.
—Oui! dit le vieillard à Elias lorsqu’ils se
trouvèrent seuls; il y a six mois lorsque je te donnai
l’hospitalité chez moi, c’était moi qui avais
pitié de toi; maintenant le sort a changé, c’est
à toi de me plaindre. Mais assieds-toi et dis-moi comment tu as
fait pour arriver jusqu’ici.
—Il y a quinze jours qu’on m’a parlé de
votre malheur, répondit le jeune homme lentement et à
voix basse, regardant vers la lumière; je me suis mis
aussitôt en route, vous cherchant de montagne en montagne;
j’ai parcouru presque deux provinces.
—Pour ne pas verser le sang innocent, j’ai dû
fuir; mes ennemis craignaient de se présenter et je ne voyais
jamais devant moi que quelques malheureux ne m’ayant pas fait le
moindre mal.
Après une courte pause, pendant laquelle il
s’efforça de lire sur le visage sombre du vieillard les
pensées qui s’y peignaient, Elias reprit:
—Je suis venu vous soumettre une proposition. Après
avoir inutilement recherché quelque reste de la famille qui a
causé le malheur de la mienne, je me suis décidé
à quitter la province où je vivais pour émigrer
vers le Nord et me fixer là, parmi les tribus infidèles
et indépendantes. Voulez-vous abandonner la vie que vous
commencez et venir avec moi? Je serai votre fils, puisque vous avez
perdu vos enfants et que je n’ai plus de famille, je retrouverai
en vous un père à aimer et à servir.
Le vieillard remua la tête en signe de refus.
—A mon âge, dit-il, quand on a pris une
résolution désespérée c’est
qu’on n’en peut plus prendre d’autre. [341]Quand un homme
comme moi, qui a passé sa jeunesse et son âge mûr
à travailler pour assurer son avenir et celui de ses enfants,
qui s’est toujours soumis à toutes les volontés de
ses supérieurs, dont la conscience est nette, qui a tout subi
pour vivre en paix, pour s’assurer toute la tranquillité
possible, quand cet homme, arrivé à un âge
où le temps a refroidi l’ardeur de son sang, presque sur
le bord de la tombe, renonce à tout son passé, à
tout ce qu’il croyait devoir être le bonheur de ses
derniers jours, c’est parce qu’après mûre
réflexion il a jugé que la paix n’existe pas,
qu’elle n’est pas le suprême bien! Pourquoi
traîner sur une terre étrangère de
misérables jours? J’avais deux fils, une fille, un foyer,
une fortune; je jouissais de la considération, du respect de
tous; maintenant je suis comme un arbre dépouillé de ses
branches nu et désolé, comme un fauve dans la
forêt, j’erre fugitif sentant derrière moi la meute
et le chasseur, et tout cela, pourquoi? Parce qu’un homme a
déshonoré ma fille, parce que mes fils ont voulu demander
raison de son infamie à cet homme, placé au dessus des
autres par le titre de ministre de Dieu. Eh bien! moi, père,
moi, déshonoré dans ma vieillesse, j’ai
pardonné l’injure, je me suis montré indulgent pour
les passions de la jeunesse et les faiblesses de la chair; et puis, le
mal était irréparable, que pouvais-je, que devais-je
faire, sinon me taire et sauver tout ce qui pouvait être
sauvé? Mais lui, le criminel, a eu peur d’une vengeance
plus ou moins prochaine, il a cherché la perte de mes fils.
Savez-vous ce qu’il a fait? Non? Savez-vous que l’on a
simulé un vol au couvent et que l’on impliqua un de mes
fils dans le procès? L’autre étant absent ne put
être inquiété. Vous imaginez-vous les tortures
auxquelles il fut soumis? Oui, n’est-ce pas, elles sont en usage
dans tous les pueblos. Eh bien! j’ai vu mon fils pendu par les
cheveux, j’ai entendu ses cris, ses appels, mon nom, et moi,
lâche, ne voulant point compromettre la paix de mon existence, je
n’ai su ni tuer ni mourir! Le vol [342]ne put être prouvé,
la calomnie se révéla, le curé fut puni,
changé de pueblo, mais mon pauvre enfant mourut de ses
blessures.
Alors ils eurent peur de mon autre fils qu’ils savaient moins
couard que moi; ils craignirent en lui le bourreau qui vengerait la
mort de son frère! comme il avait oublié de se munir
d’une cédule de domicile, on saisit ce prétexte
pour le faire arrêter par la garde civile, il fut
maltraité, excité, et à force d’injures et
de mauvais traitements, acculé au suicide! Et moi j’ai
survécu à tant de honte! mais si le courage du
père m’a manqué pour défendre mes fils, il
me reste un cœur pour me venger et je me vengerai! Les
mécontents se sont réunis sous mon commandement, mes
ennemis par leurs exactions renforcent ma troupe chaque jour, le jour
où je me trouverai assez fort je descendrai dans la plaine et
j’éteindrai dans le feu ma vengeance et ma vie! Oui, ce
jour viendra ou il n’y a pas de Dieu1!
Le vieillard se leva nerveux, et le regard scintillant, la voix
caverneuse, il ajouta en arrachant ses longs cheveux:
—Malédiction, malédiction sur moi qui ai contenu
la main vengeresse de mes fils; c’est moi qui les ai
assassinés! Si j’avais laissé mourir le coupable,
j’aurais au moins pu croire à la justice de Dieu et
à celle des hommes et mes fils seraient encore là,
à mes côtés, fugitifs sans doute, mais je les
aurais et ils ne seraient pas morts dans les supplices! Je
n’étais pas né pour être père,
c’est pour cela que je ne les ai plus! Malédiction sur moi
qui malgré mon âge n’avais pas, avec les
années, appris à connaître le milieu dans lequel je
vivais! Mais par le feu, par le sang et par ma propre mort je saurai
les venger!
Dans l’excès de sa douleur le malheureux père
avait arraché son bandage et rouvert la blessure de son front,
d’où jaillit un filet de sang. [343]
—Je respecte votre douleur, reprit Elias, et comprends votre
vengeance; moi aussi, comme vous, j’ai une haine à
assouvir et cependant, par crainte de frapper un innocent, je
préfère oublier la cause de mes malheurs.
—Tu peux oublier, toi, tu es jeune, tu n’as perdu ni un
fils ni l’espérance dernière! Moi non plus, je te
le jure, je ne frapperai pas un innocent. Vois-tu cette blessure? Je me
la suis laissé faire pour ne pas blesser un pauvre cuadrillero
qui accomplissait son devoir.
—Mais, dit Elias après un moment de silence, voyez quel
épouvantable incendie vous allez allumer dans notre malheureux
pays. Si, de votre propre main, vous satisfaites votre vengeance, vos
ennemis prendront de terribles représailles, non contre vous,
non contre ceux qui ont des armes, mais contre le peuple qui, selon
l’habitude, restera le seul accusé. Que d’injustices
s’en suivront!
—Que chacun, que le peuple apprenne à se
défendre!
—Vous savez bien que ce n’est pas possible! Ecoutez, je
vous ai connu autrefois, quand vous étiez heureux, alors vous me
donniez de sages conseils; me permettrez-vous...
Le vieillard se croisa les bras et parut attendre.
—Señor, continua Elias en pesant chacune de ses
paroles, j’ai eu le bonheur de rendre un grand service à
un jeune homme riche, au cœur bon, noble, voulant le bien de son
pays. Qu’il ait des relations à Madrid, on le dit, mais je
l’ignore; ce que je puis vous assurer, c’est qu’il
est des amis du capitaine général. Que diriez-vous si
nous l’intéressions à la cause des malheureux, si
nous en faisions le porte-voix des plaintes du peuple?
Le vieillard secoua la tête:
—Il est riche, dites-vous? Les riches ne pensent
qu’à accroître leurs richesses; l’orgueil, le
désir de paraître les aveugle, et, comme d’ordinaire
leur vie est facile, surtout lorsqu’ils ont des amis puissants,
il n’en [344]est pas un qui veuille risquer de compromettre
son repos pour venir en aide à ceux qui souffrent. Je le sais
moi qui fus riche!
—Celui dont je vous parle ne ressemble point aux autres;
c’est un fils qui a été insulté dans la
mémoire de son père, c’est un jeune homme qui,
devant se marier avant peu, songe à l’avenir, à un
avenir qu’il veut beau pour ses enfants.
—Alors c’est un homme qui va être heureux; notre
cause n’est pas celle des gens heureux.
—Non, mais c’est celle des hommes de cœur!
—Soit, reprit le vieillard en s’asseyant; je suppose
qu’il consente à être notre porte-parole même
auprès du capitaine général, je suppose
qu’il trouve à Madrid des députés qui
plaident pour nous, croyez-vous qu’on nous fera justice?
—Essayons, avant de recourir aux mesures sanglantes,
répondit Elias. Cela doit vous surprendre que moi, autre
persécuté, jeune et robuste, je vous propose, à
vous, vieux et faible, des moyens pacifiques! C’est que je les ai
vues si nombreuses les misères dont nous sommes la cause aussi
bien que nos tyrans; ce sont toujours les désarmés qui
paient.
—Et si nos démarches n’aboutissent à aucun
résultat!
—Il y aura toujours un résultat, croyez-moi; tous les
gouvernants ne sont pas injustes. Mais si l’on ne nous
écoutait pas, si l’on dédaignait notre plainte, si
les puissants restaient sourds à la douleur de leurs semblables,
je serais le premier à me tenir à vos ordres!
Rempli d’enthousiasme, le vieillard embrassa le jeune
homme.
—J’accepte ta proposition, Elias; je sais que tu
tiendras ta parole. Tu viendras à moi et je t’aiderai
à venger tes parents comme tu m’aideras à venger
mes fils, mes fils qui étaient jeunes, fiers et braves comme
toi! [345]
—En attendant, señor, vous éviterez, toute
action violente.
—Tu exprimeras les plaintes du peuple, tu les connais. Quand
saurai-je la réponse?
—Dans quatre jours, envoyez-moi un homme à la plage de
San Diego, je lui dirai la décision de la personne sur qui je
compte... Si elle accepte, on nous fera justice; sinon, je serai le
premier qui tombera dans la lutte que nous entreprendrons.
—Elias ne mourra pas, Elias sera le chef, quand le Capitan
Pablo sera tombé satisfait dans sa vengeance, dit le
vieillard.
Et lui-même accompagna le pilote jusqu’à ce
qu’il fût sorti de la caverne.
[Table des matières]
XLVI
La gallera
Pour sanctifier l’après-midi du dimanche, en Espagne,
on va d’ordinaire à la plaza de toros; aux
Philippines, on se rend à la gallera. Les combats de coqs,
introduits dans le pays il y a environ un siècle, sont
aujourd’hui un des vices du peuple; les Chinois se passeraient
plus facilement d’opium que les Philippins de ce jeu
sanglant.
Le pauvre, désireux de gagner de l’argent sans
travailler, y va risquer le peu qu’il a, le riche y recherche une
distraction au prix de l’argent que lui laissent les festins et
les messes d’actions de grâce; l’éducation de
son coq lui coûte d’ailleurs beaucoup de soins, plus
peut-être que celle de son fils.
Puisque le gouvernement le permet et même le recommande
presque, en ordonnant que le spectacle ne se donnera que sur les
places publiques, aux jours de fête (afin que tout le
monde puisse le voir et que [346]l’exemple entraîne les
hésitants), après la grand’messe jusqu’au
crépuscule (pendant huit heures!) nous allons nous aussi
assister à ce jeu, certains d’y retrouver quelques
personnes de connaissance.
La gallera de San Diego ne se différencie de celles que
l’on voit dans les autres pueblos que par quelques
détails. Elle est divisée en trois compartiments.
D’abord l’entrée: c’est un rectangle
d’environ vingt mètres de long sur quatorze de large; sur
un côté s’ouvre une porte d’ordinaire
gardée par une femme chargée de recouvrer le sa
pintû, c’est-à-dire le droit
d’entrée. De ce droit que chacun verse le Gouvernement
prend une part qui lui rapporte en tout quelques centaines de milliers
de pesos par an: on dit que cet argent, dont le vice paye sa
liberté, sert à élever de magnifiques
écoles, à jeter des ponts, à tracer des routes,
à instituer des prix pour encourager l’agriculture et
l’industrie... béni soit le vice qui produit de si heureux
résultats!—Dans cette première enceinte se tiennent
les vendeuses de buyo, de cigares, de pâtisseries et de
comestibles, etc.; y pullulent également les enfants
amenés par leurs pères ou par leurs oncles et par eux
soigneusement initiés à tous les secrets de la vie.
Ce compartiment communique avec un autre, de proportions
légèrement plus grandes, une sorte de foyer où se
réunit le public avant les soltadas1. Là se trouve la plus
grande partie des coqs, retenus au sol par une corde attachée
à un piquet fait d’un os ou d’une branche de palma
brava2,
là se réunissent les brelandiers, les
aficionados3, l’homme expert à attacher la navaja,
là se passent les contrats, se méditent les coups
à faire, se sollicitent les emprunts, on y maudit, on y jure, on
y rit aux éclats; celui-ci caresse son coq, passant la main sur
le brillant plumage, celui-là examine et compte les
écailles des pattes; dans ce groupe [347]on rappelle les hauts faits des
héros; voyez celui-ci qui, la colère au front, la rage au
cœur, emporte suspendu par les pieds un cadavre
déplumé: l’animal qui pendant des mois a
été le favori, choyé, soigné nuit et jour,
sur qui se fondaient tant de brillants espoirs n’est plus
qu’un cadavre et va, pour une peseta, être vendu à
quelque ménagère qui l’assaisonnera de gingembre et
en fera ce soir même la pièce capitale de quelque
succulent ragoût: Sic transit gloria mundi. Le
décavé s’en retourne chez lui où
l’attendent la femme inquiète et les enfants
déguenillés; il a perdu à la fois son coq et son
pécule. De tout ce rêve doré, de tous ces soins
prodigués pendant de longs mois depuis l’aube du jour
jusqu’à l’heure où le soleil se cache, de
toutes ces fatigues, de tous ces travaux, il lui reste une peseta:
toute cette fumée n’a laissé que cette
pincée de cendres.—Là, dans ce foyer, le moins
intelligent discute, le plus irréfléchi examine
consciencieusement la matière, pèse, retourne,
étend les ailes, palpe les muscles. Les uns sont vêtus
avec élégance, suivis et entourés de tous les
partisans de leurs coqs; les autres, sales, le stigmate du vice
marqué sur leur face-flétrie, suivent anxieux les
mouvements des riches et attendent aux aguets, car la bourse peut se
vider, la passion reste; là, pas de visage qui ne soit
animé; là, le Philippin n’est ni indolent, ni
apathique, ni silencieux; tout y est mouvement, passion,
activité; on dirait que tous sont dévorés
d’une soif qu’avive encore une eau fangeuse.
De cette enceinte on passe dans l’arène que l’on
nomme Rueda4. Le plancher, entouré de bambous, est plus
élevé que celui des deux autres compartiments. A la
partie supérieure, touchant presque au toit, sont les gradins
sur lesquels prennent place les spectateurs qui sont en même
temps les joueurs. Pendant le combat ces gradins se remplissent
d’hommes et d’enfants [348]qui crient, hurlent, jurent, se disputent:
presque aucune femme ne se risque jusque-là. Dans la
Rueda même se tiennent les gros messieurs, les riches, les
joueurs fameux, le contratista, le sentenciador. Sur le
sol, parfaitement damé, luttent les volatiles; c’est de
là que le Destin distribue aux familles le rire ou les larmes,
la faim ou les joyeux repas.
En entrant, nous pouvons reconnaître aussitôt le
gobernadorcillo, Capitan Pablo, Capitan Basilio et aussi José,
l’homme à la cicatrice, que nous avons vu si
désolé de la mort de son frère.
Capitan Basilio s’approche d’un habitant du pueblo et
lui demande:
—Sais-tu quel coq apporte Capitan Tiago?
—Je ne le sais pas, señor, ce matin on lui en a
apporté deux, l’un est le lásak qui a
gagné le talisain du consul.
—Crois-tu que mon búlik5 puisse lutter avec lui?
—Certainement; j’y mets ma maison et ma chemise!
Mais voici Capitan Tiago. Il est vêtu, comme les grands
joueurs, d’une chemise de toile de Canton, d’un pantalon de
laine et d’un chapeau de jipijapa6; il est suivi de deux domestiques
dont l’un porte le fameux lásak et l’autre un coq
blanc de taille colossale.
—Sinang m’a dit que Maria va de mieux en mieux, lui dit
Capitan Basilio.
—Elle n’a plus de fièvre, mais elle est encore
faible.
—Vous avez perdu hier soir?
—Un peu; je sais que vous avez gagné... je vais essayer
de me rattraper.
—Voulez-vous jouer le lásak? demanda Capitan
Basilio en regardant le coq qu’il demanda au domestique. [349]
—Cela dépend, s’il y a pari.
—Combien mettez-vous?
—A moins de deux, je ne le joue pas.
—Avez-vous vu mon búlik? demanda Capitan Basilio, et il
appela un homme qui apporta un petit coq.
Le Capitan Tiago l’examina et, après l’avoir
pesé et analysé les écailles, le rendit.
—Combien mettez-vous? demanda-t-il.
—Ce que vous voudrez.
—Deux cinq cents?
—Trois?
—Trois.
—Pour la suivante.
Le chœur de curieux et de joueurs répandit la nouvelle
du combat des deux célèbres coqs dont chacun avait son
histoire et sa renommée conquérante. Tous veulent voir,
examiner les deux célébrités; on émet des
opinions, on prophétise...
Cependant les voix se font plus hautes, la confusion augmente, la
Rueda est envahie, on se bouscule sur les gradins. Les
soltadores apportent sur l’arène deux coqs, un blanc
et un rouge, armés déjà, mais leurs navajas sont
encore enfermées dans les gaînes. On entend de nombreux
cris: le blanc! le blanc! par ci, par là quelque voix
crie: le rouge! Le blanc était le llamado, le
rouge le dejado7.
Parmi la multitude circulent des gardes civils; ils ne portent pas
l’uniforme de ce corps émérite, mais cependant ils
ne sont pas mis comme les paysans. Pantalon de guingon à frange
rouge, chemise tachée de bleu par la blouse déteinte,
bonnet de quartier, leur déguisement est ici en rapport avec
leur conduite: ils parient tout en surveillant et troublent la paix
qu’ils parlent de maintenir.
Tandis que l’on crie, que les mains s’agitent, remuant
de la monnaie, faisant tinter les pièces; tandis [350]que l’on
cherche au fond des poches le dernier cuarto ou que, à son
défaut, l’on veut engager sa parole, promettant de vendre
le carabao, la prochaine récolte, etc., deux jeunes gens,
paraissant être les deux frères, suivent les joueurs
d’un œil envieux, s’approchent, murmurent de timides
paroles que personne n’écoute, et de plus en plus sombres
se regardent par instants avec colère et dépit.
José les observe à la dérobée, sourit
malignement, fait sonner des pesos d’argent, passe près
des deux frères et regarde vers la Rueda en criant:
—Je paie cinquante, cinquante contre vingt pour le blanc!
Les deux frères échangent un regard.
—Je te l’avais dit, murmura le plus grand, je te
l’avais dit de ne pas risquer tout l’argent; si tu
m’avais écouté nous aurions maintenant pour mettre
sur le rouge!
Le plus petit s’approcha timidement de José et lui
toucha le bras:
—C’est toi? s’écria celui-ci en se
retournant et feignant la surprise! ton frère accepte-t-il ma
proposition ou viens-tu parier?
—Comment voulez-vous que nous puissions parier puisque nous
avons tout perdu.
—Alors vous acceptez?
—Il ne veut pas! Si vous pouviez nous prêter quelque
chose, puisque vous dites que vous nous connaissez...
José secoua la tête, tira sa chemise et reprit:
—Oui, je vous connais; vous êtes Társilo et
Bruno, tous deux jeunes et forts. Je sais que votre vaillant
père est mort des cent coups de bâton que lui ont
donnés ces soldats; je sais que vous ne pensez pas à le
venger...
—Ne vous mêlez pas de notre histoire, interrompit
Társilo, l’aîné; cela porte malheur. Si nous
n’avions pas une sœur, il y a longtemps que nous serions
pendus! [351]
—Pendus? On ne pend que les lâches, ceux qui n’ont
ni argent ni protection. Et d’ailleurs, la montagne n’est
pas si loin.
—Cent contre vingt, pour le blanc! cria quelqu’un en
passant.
—Prêtez-nous quatre pesos ... trois ... deux, supplia le
plus jeune; nous vous en rendrons le double; l’assaut va
commencer.
José secoua de nouveau la tête.
—Tst! Cet argent n’est pas à moi, D.
Crisóstomo me l’a donné pour ceux qui veulent le
servir. Mais je vois que vous n’êtes pas comme votre
père, il était courageux lui; que celui qui ne
l’est pas ne cherche pas de diversions.
Et il s’éloigna d’eux, mais n’alla pas
très loin.
—Acceptons, dit Bruno. Autant vaut être pendu que
fusillé; nous autres pauvres ne servons guère à
autre chose.
—Tu as raison, mais je pense à notre sœur.
Cependant le cercle est évacué par la foule, le combat
va commencer. Le silence s’établit peu à peu, les
deux soltadores et l’expert attacheur de navajas restent seuls au
milieu du cercle. A un signal du sentenciador celui-ci sort les
éperons d’acier de leurs gaînes et les fines lames
brillent, menaçantes.
Les deux frères, tristes, silencieux, s’approchent du
cercle et regardent, le front appuyé contre la barrière.
Un homme s’approche et leur souffle à l’oreille:
—Pare8! cent contre dix, je suis pour le blanc!
Társilo le regarde, l’air hébété.
Bruno lui donne un coup de coude auquel il répond par un
grognement.
Les soltadores tiennent les deux coqs avec une magistrale
délicatesse, prenant garde de ne pas se blesser. Un silence
solennel règne; on croirait que les assistants ne sont que
d’horribles figures de cire. On approche les deux coqs l’un
de l’autre, maintenant la [352]tête du blanc pour qu’il soit
piqué et s’excite, puis on recommence en faisant de
même pour le rouge; dans tout duel les chances doivent être
égales, qu’il se livre entre deux élégants
de Paris ou entre deux coqs philippins9. Après les avoir
placés face à face, on les rapproche encore l’un de
l’autre afin que les pauvres volatiles sachent qui leur a
arraché une petite plume et contre qui ils doivent lutter. Le
plumage de leur cou se hérisse, ils se regardent fixement, des
éclairs de colère s’échappent de leurs
petits yeux ronds. Le moment est venu: on les dépose à
terre à une certaine distance et le champ leur est laissé
libre.
Lentement ils s’avancent. Leurs pas résonnent sur le
sol; personne ne parle, personne ne respire. Baissant la tête
puis la relevant comme se mesurant du regard, les deux coqs laissent
entendre des gloussements, peut-être de menace, peut-être
de mépris. Ils écartent leurs griffes, séparant la
brillante lame qui lance des reflets froids et bleus; le péril
les anime, ils marchent décidés l’un vers
l’autre; mais à un pas de distance ils
s’arrêtent, hérissent de nouveau leurs plumes. Leur
petit cerveau est inondé de sang, l’éclair jaillit
de leurs yeux, courageusement ils s’élancent, se choquent,
bec contre bec, poitrine contre poitrine, aile contre aile, acier
contre acier: les coups ont été parés avec
maestria, seules quelques plumes sont tombées. De nouveau ils se
mesurent; de nouveau le blanc vole, s’élève,
agitant la meurtrière navaja, mais le rouge a plié les
jambes, baissé la tête, le blanc n’a frappé
que l’air, mais au moment où il revient à terre,
évitant d’être blessé aux épaules, il
se retourne rapidement et fait front. Le rouge l’attaque avec
furie, il se défend avec calme, s’affirmant le digne
favori du public. Tous émus, anxieux, suivent les
péripéties du combat, le silence n’est
troublé que par quelque rare cri, poussé [353]involontairement.
Le sol se couvre de plumes rouges et blanches, teintes de sang; mais ce
n’est pas au premier sang qu’est le duel; le Philippin
suivant en cela les règles édictées par le
gouvernement veut qu’il ne cesse que par la mort ou la fuite de
l’un des combattants. Le sang arrose donc le sol, les coups
diminuent de force, mais la victoire reste encore indécise.
Enfin, tentant un suprême effort, le blanc s’élance
pour donner le dernier coup, sa navaja s’enfonce dans
l’aile du rouge et s’engage entre les os; mais
lui-même a été blessé à la poitrine
et tous deux, sanglants, exténués, haletants,
cloués l’un à l’autre, restent immobiles
jusqu’à ce que le blanc tombe, rendant le sang par le bec,
remuant les pattes un instant et meure; le rouge, maintenu par
l’aile, reste à son côté, s’affaisse
peu à peu et ferme lentement les yeux.
Le sentenciador, d’accord avec ce que prescrit le
gouvernement, proclame vainqueur le rouge; un hurlement sauvage salue
la sentence, hurlement prolongé, uniforme, qui s’entend
par tout le pueblo. Qui l’entend de loin comprend alors que
c’est le dejado (outsider) qui a gagné, sans
quoi le tumulte durerait moins longtemps. Il en est de même parmi
les nations; lorsqu’une petite a réussi à remporter
une victoire sur une grande, elle la chante et la raconte pendant des
siècles et des siècles.
—Vois-tu? dit Bruno à son frère avec
dépit, si tu m’avais écouté, nous aurions
maintenant cent pesos, par ta faute nous sommes sans un cuarto.
Társilo ne répondit pas, mais regarda autour de lui
comme s’il cherchait quelqu’un.
—Il est là, il parle avec Pedro, ajouta Bruno; il lui
donne de l’argent, beaucoup d’argent!
En effet, José comptait des pièces d’argent dans
la main du mari de Sisa. Ils échangèrent encore quelques
mots en secret puis se séparèrent, paraissant tous deux
satisfaits. [354]
—Pedro aura accepté ses conditions; c’est
à cela que tu es aussi décidé! soupira Bruno.
Társilo restait sombre et pensif; avec la manche de sa
chemise il essuyait la sueur qui perlait à son front.
—Frère, dit Bruno, j’y vais si tu ne te
décides pas; la ley10 continue, le lásak doit gagner et
nous ne devons laisser perdre aucune occasion. Je veux parier à
la prochaine soltada; qui donne le plus? C’est dit, nous
vengerons le père.
—Attends! lui dit Társilo qui le regarda fixement dans
les yeux—tous deux étaient pâles;—je vais avec
toi, tu as raison: nous vengerons le père.
Il s’arrêta cependant et de nouveau s’essuya le
front.
—Qu’attends-tu? demanda Bruno impatient.
—Sais-tu quelle est la soltada qui suit? vaut-elle la
peine?...
—Comment! tu n’as pas entendu? Le búlik de
Capitan Basilio contre le lásak dé Capitan Tiago; selon
la loi du jeu c’est le lásak qui doit gagner.
—Ah, le lásak! moi aussi je parierais... mais
assurons-nous en d’abord.
Bruno fit un geste d’impatience, mais suivit son frère;
celui-ci examina bien le coq, l’analysa, réfléchit,
posa quelques questions; le malheureux avait des doutes; Bruno nerveux
le regardait avec colère.
—Mais, ne vois-tu pas cette large écaille ici,
près de l’éperon? et ces pattes? que veux-tu de
plus? Regarde ces jambes, étends ces ailes! Et cette
écaille qui prend sur cette large là, vois, elle est
double!
Társilio ne l’entendait pas, il continuait son examen
de l’animal; le bruit de l’or et de l’argent arrivait
à ses oreilles.
—Voyons maintenant le búlik, dit-il d’une voix
étouffée.
Bruno tapa du pied d’impatience et grinça des dents,
mais obéit à son frère.
Ils s’approchèrent de l’autre groupe. Là,
on armait [355]le coq, on choisissait les navajas,
l’attacheur préparait la soie rouge, l’enduisait de
cire et la frottait à diverses reprises.
Társilo enveloppa l’animal d’un regard sombre; il
lui semblait qu’il ne voyait pas le coq, mais autre chose dans
l’avenir. Il se passa la main sur le front et, d’une voix
sourde, interrogea son frère.
—Es-tu disposé?
—Moi? il y a longtemps; sans avoir besoin de les voir!
—Est-ce que... notre pauvre sœur...
—Bah! Ne t’a-t-on pas dit que le chef est D.
Crisóstomo? ne l’as-tu pas vu passer avec le capitaine
général? Quel péril courons-nous?
—Et si nous mourons?
—Notre pauvre père n’est-il pas mort
d’avoir reçu des coups de bâton?
—Tu as raison.
Les deux frères cherchèrent José parmi les
groupes.
Mais aussitôt l’hésitation reprit
Társilo.
—Non! allons-nous en d’ici, nous allons nous perdre!
s’écria-t-il.
—Va-t’en si tu veux, j’accepte!
—Bruno!
Malheureusement un homme s’approcha et leur dit:
—Vous pariez? Je suis pour le búlik.
Les deux frères ne répondirent point.
—Je paye!
—Combien? demanda Bruno.
L’homme compta ses pièces de quatre pesos. Bruno le
regardait sans respirer.
—J’en ai deux cents; cinquante contre quarante!
—Non! dit Bruno résolu; mettez...
—Bon! cinquante contre trente!
—Doublez si vous voulez!
—Bien! le búlik est à mon patron et je viens de
gagner; cent contre soixante.
—Entendu! Attendez que j’aille chercher l’argent.
[356]
—Mais je serai dépositaire, dit l’autre à
qui la mine de Bruno n’inspirait guère confiance.
—Cela m’est égal, répondit celui-ci se
fiant à la force de ses poings.
Et se retournant vers son frère, il lui dit:
—Va-t’en si tu veux, moi je reste.
Társilo réfléchit: il aimait Bruno et le jeu;
il ne pouvait laisser seul son cadet.—Soit! murmura-t-il.
Ils vinrent vers José: celui-ci sourit en les voyant.
—Oncle! dit Társilo.
—Qu’y a-t-il?
—Combien donnes-tu?
—Je vous l’ai déjà dit: si vous vous
chargez d’en chercher d’autres pour surprendre le quartier,
je vous donne trente pesos à chacun et dix à chaque
compagnon. Si tout réussit bien, chacun en recevra cent et vous
le double: D. Crisóstomo est riche!
—Accepté! s’écria Bruno; donne
l’argent.
—Je savais bien que vous étiez vaillants comme votre
père! Venez par ici, que ceux qui l’ont tué ne nous
entendent pas! dit José en leur montrant les gardes civils.
Et, les emmenant dans un coin, il ajouta en leur comptant
l’argent:
—Demain D. Crisóstomo arrive; il apporte des armes.
Après-demain soir, vers huit heures, allez au cimetière
et là je vous transmettrai ses dernières instructions.
Vous avez le temps de chercher des compagnons.
Il s’en alla. Les deux frères paraissaient avoir
changé de rôle: Társilo était tranquille,
Bruno pâle.
[Table des matières]
XLVII
Les deux dames
Tandis que Capitan Tiago jouait son lásak, Da. Victorina se
promenait à travers le pueblo pour voir ce [357]qu’étaient les maisons et les
cultures des indolents Indiens. Elle s’était
habillée le plus élégamment qu’elle avait
pu, ornant sa robe de soie de tous ses rubans et de toutes ses fleurs
afin d’en imposer aux provinciaux et de leur montrer quelle
distance les séparait de sa personne sacrée; donnant le
bras à son mari boiteux elle se pavanait par les rues du pueblo
à la grande stupéfaction des habitants. Le cousin Linares
était resté à la maison.
—Quelles vilaines maisons ont donc ces Indiens!
commença Da. Victorina en faisant la moue; je ne sais comment on
peut y habiter, il faut être indien! Qu’ils sont donc mal
élevés et orgueilleux! Ils passent à
côté de nous sans se découvrir! Frappe sur leur
chapeau comme font les curés et les lieutenants de la garde
civile; enseigne-leur la politesse.
—Et, s’ils me battent? demanda le Dr. de
Espadaña.
—N’es-tu pas un homme?
—Oui, mais... mais je suis boiteux!
Da. Victorina devenait de mauvaise humeur; les rues n’avaient
pas de trottoir, la poussière salissait la queue de sa robe. Des
jeunes filles passaient près d’elle qui baissaient les
yeux et n’admiraient point comme elles le devaient sa luxueuse
toilette. Le cocher de Sinang qui la conduisait avec sa cousine dans un
élégant tres-por-ciento1! eut l’audace de lui
crier: tabi2! d’une voix si imposante qu’elle dut
se ranger:—Regarde cette brute de cocher, protesta-t-elle. Je
vais dire à son maître qu’il ait à mieux
éduquer ses domestiques.
Puis elle ordonna.
—Allons-nous en!
Son mari, craignant un orage, tourna sur ses talons et obéit
au commandement.
Ils se rencontrèrent avec l’alférez; on se
salua. Le [358]mécontentement de Da. Victorina
s’en accrut encore car, non seulement le militaire ne lui avait
adressé aucun compliment sur son costume, mais elle avait cru
remarquer qu’il l’avait regardée presque avec
moquerie.
—Tu ne devais pas donner la main à un simple
alférez, dit-elle à son mari, lorsque l’officier se
fut éloigné; à peine s’il a touché
son casque et toi tu as retiré ton chapeau; tu ne sais pas
garder ton rang!
—I... ici, c’est lui le chef!
—Que nous importe? sommes-nous indiens par hasard?
—Tu as raison! répondit D. Tiburcio qui ne voulait pas
se disputer.
Ils passèrent devant le quartier. Da. Consolacion
était à la fenêtre, comme d’ordinaire,
vêtue de flanelle et fumant son puro. Comme la maison
était basse les deux dames se regardèrent et Da.
Victorina la distingua très bien; la Muse de la Garde Civile
l’examina de pied en cap, puis avançant la lèvre
inférieure, elle cracha en tournant la tête d’un
autre côté. Cette affectation de mépris mit
à bout la patience de la doctoresse qui, laissant son mari sans
appui, vint, tremblante de colère, impuissante à
articuler une parole, se placer devant la fenêtre de
l’alféreza. Da. Consolacion retourna lentement la
tête, regarda son antagoniste avec le plus grand calme et, de
nouveau, cracha à terre avec le plus grand dédain.
—Qu’avez-vous, Doña? demanda-t-elle.
—Pourriez-vous me dire, señora, pourquoi vous me
dévisagez de cette façon? Etes-vous jalouse? put enfin
dire Da. Victorina.
—Moi, jalouse, et de vous? répondit nonchalamment la
Méduse; oui, je suis jalouse de vos frisures!
—Allons, vous! intervint le docteur; ne fais pas c... cas de
ces sot... sottises!
—Laisse-moi, il faut que je lui donne une leçon
à cette éhontée! répondit la doctoresse en
bousculant son mari qui manqua d’embrasser la terre. [359]
—Faites attention à qui vous parlez! dit-elle en se
retournant vers Da. Consolacion. Ne croyez pas que je sois une
provinciale ni une femme à soldats! Chez moi, à Manille,
les alféreces n’entrent pas; ils attendent à la
porte.
—Holà, Excellentissime Señora Puput! les
alféreces n’entrent pas, mais vous recevez les invalides,
comme celui-ci! ah! ah! ah!
Si elle avait été moins fardée on aurait vu
rougir Da. Victorina; elle voulut se précipiter vers son
ennemie, mais la sentinelle l’arrêta. La rue se remplissait
de curieux.
—Sachez que je m’abaisse en parlant avec vous; les
personnes de catégorie comme moi ne doivent pas... Voulez-vous
laver mon linge, je vous paierai bien! Croyez-vous que je ne sache pas
que vous êtes une blanchisseuse!
Da. Consolacion se redressa furieuse; être appelée
blanchisseuse l’avait blessée:
—Croyez-vous que nous ne sachions pas qui vous êtes?
Allez, mon mari me l’a dit! Señora, moi au moins je
n’ai jamais appartenu qu’à un seul homme, mais vous?
Il faut mourir de faim pour s’embarrasser du reste, du rebut de
tout le monde.
Le coup atteignit Da. Victorina en pleine poitrine; elle se
retroussa, ferma les poings et hurla:
—Descendez donc, vieille truie, que je casse cette figure
malpropre! Maîtresse de tout un bataillon, prostituée de
naissance!
Rapidement la Méduse disparut de la fenêtre; plus
rapidement encore on la vit descendre en courant, agitant le terrible
fouet de son mari.
D. Tiburcio, suppliant, s’interposa, mais il n’aurait
pas empêché le combat si l’alférez
n’était arrivé.
—Eh bien, señoras... D. Tiburcio!
—Donnez un peu plus d’éducation à votre
femme, achetez-lui de plus beaux costumes et, si vous n’avez
[360]pas
d’argent, volez-en à ceux du pueblo, vous avez des soldats
pour cela! criait Da. Victorina.
—Je suis là, señora! pourquoi ne me cassez-vous
pas la figure? Vous n’avez donc que de la langue et de la salive,
Doña Excelencias!
—Señora! s’écria l’alférez
furieux! vous êtes heureuse que je me souvienne que vous
êtes une femme, car sinon je vous crèverais à coups
de pied avec toutes vos boucles et tous vos rubans!
—Se... señor alférez!
—Allez, charlatan! Vous ne portez pas de pantalons, Juan
Lanas3!
S’armant l’une de paroles et de gestes, l’autre de
cris, d’insultes et d’injures, elles se jetèrent
à la tête tout ce qu’il y avait en elles de sale et
de honteux, ce fut un fleuve d’ordures qui les inonda toutes
deux. Tous quatre parlaient à la fois; dans cette multitude de
mots, de nombreuses vérités se
révélèrent au grand jour, mais en de tels termes
que nous renonçons à les reproduire. S’ils
n’entendaient pas tout, les curieux ne laissaient pas de se
divertir beaucoup; ils attendaient la bataille. Malheureusement pour
les amateurs de spectacle, le curé vint à passer qui
rétablit la paix.
—Señores, señoras! quelle honte! Señor
alférez!
—Que venez-vous faire ici, hypocrite, carliston?
—D. Tiburcio, emmenez votre femme! Señora, contenez
votre langue!
—C’est à ces voleurs de pauvres que je
parlais!
Peu à peu le dictionnaire d’épithètes
sonores s’épuisa, les deux mégères
éhontées ne trouvèrent plus rien à se dire
et tout en se menaçant, en s’injuriant encore, les deux
couples se séparèrent peu à peu. Fr. Salvi allait
de l’un à l’autre, se prodiguant; si notre ami le
correspondant avait été là!...
—Nous repartons aujourd’hui même pour Manille et
nous nous présenterons au capitaine général!
disait [361]Da. Victorina furieuse à son mari. Tu
n’es pas un homme!
—Mais... mais, femme, et les gardes? je suis boiteux!
—Tu dois le provoquer au sabre ou au pistolet, ou sinon...
sinon...
Et elle regarda sa denture.
—Fille, je n’ai jamais manié...
Da. Victorina ne le laissa pas terminer. D’un mouvement
sublime elle lui arracha son dentier, le jeta au milieu de la rue et
l’écrasa sous ses pieds. Lui pleurant presque, elle le
criblant de sarcasmes, ils arrivèrent à la maison de
Capitan Tiago. En ce moment Linares causait avec Maria Clara, Sinang et
Victoria et, comme il ne savait rien de la dispute,
l’arrivée si brusque de ses cousins
l’inquiéta. Maria Clara, qui était couchée
sur un fauteuil garni d’oreillers et de couvertures, ne fut pas
peu surprise de la nouvelle physionomie de son docteur.
—Cousin, dit Da. Victorina, tu vas aller provoquer
l’alférez à l’instant même ou
sinon...
—Pourquoi? demanda Linares étonné.
—Tu vas le provoquer immédiatement ou sinon je dis ici
et à tout le monde qui tu es.
—Mais, Da. Victorina!
Les trois amies se regardèrent.
—Qu’en dis-tu? L’alférez nous a
insultés, il a dit que tu étais ce que tu es! La vieille
sorcière est descendue avec un fouet pour nous frapper et
celui-ci, celui-ci s’est laissé insulter... un homme!
—Tiens! dit Sinang, on s’est battu et nous n’avons
rien vu!
—L’alférez a brisé les dents du docteur!
ajouta Victorina.
—Aujourd’hui même nous partons pour Manille; toi,
tu vas rester ici pour le provoquer; sinon je dis à D. Santiago
que ce que tu lui as raconté n’est qu’un mensonge,
je lui dis... [362]
—Mais, Da. Victorina, Da. Victorina! interrompit Linares tout
pâle. Et, s’approchant d’elle, il ajouta à
voix basse:
—Ne me faites pas souvenir... Ne soyez pas imprudente, surtout
en ce moment.
Capitan Tiago entra; il revenait de la gallera, triste, soupirant:
il avait perdu son lásak.
Il n’eut pas le temps de souffler; en peu de mots,
mélangés de beaucoup d’insultes, Da. Victorina lui
raconta ce qui s’était passé en
s’efforçant, naturellement, de se mettre en bonne
posture.
—Linares va le défier, entendez-vous? ou bien ne le
laissez pas se marier avec votre fille, ne le permettez pas! S’il
n’est pas courageux, il ne mérite pas Clarita.
—Comment, tu te maries avec ce señor? lui demanda
Sinang dont les yeux rieurs se remplirent de larmes; je savais que tu
étais discrète, mais je ne te croyais pas
inconstante.
Maria Clara, pâle comme la cire, se mit sur son séant,
ses grands yeux effarés regardèrent son père, Da.
Victorina et Linares. Celui-ci rougit, Capitan Tiago baissa la
tête, mais la doctoresse ajouta:
—Rappelle-toi bien ce que je te dis, Clarita, ne te marie
jamais à un homme qui ne porte pas de pantalons; ce serait
t’exposer à ce que tout le monde t’insulte,
même les chiens.
La jeune fille ne lui répondit pas.
—Conduisez-moi à ma chambre, dit-elle à ses
amies, je ne puis pas encore y aller seule.
Elles l’aidèrent à se lever, leurs bras ronds
entourèrent sa ceinture et, sa tête marmoréenne
appuyée sur l’épaule de la belle Victoria, la jeune
fille regagna son alcôve.
Le soir même, les deux époux firent leurs paquets,
présentèrent à Capitan Tiago leur compte, qui se
montait à quelques milliers de pesetas, et le lendemain matin,
à la première heure, ils partaient pour Manille [363]dans la
voiture de leur hôte. Quant au timide Linares, ils lui confiaient
le rôle de vengeur.
[Table des matières]
XLVIII
L’énigme
Elles reviendront les noires hirondelles...
Gustavo A.
Becquer.
Ainsi que José l’avait annoncé, Ibarra arriva le
lendemain. Sa première visite fut pour la famille de Capitan
Tiago; il espérait voir Maria Clara et lui annoncer que Son
Illustrissime Grandeur l’avait réconcilié avec la
Religion; il apportait pour le curé une lettre de
recommandation, écrite de la main même de
l’archevêque. La tante Isabelle, qui avait beaucoup
d’affection pour le jeune homme et voyait avec plaisir son
mariage avec sa nièce, en fut toute réjouie. Gapitan
Tiago était sorti.
—Entrez, lui dit la tante en son mauvais castillan; Maria, D.
Crisóstomo est rentré en grâce avec Dieu,
l’archevêque l’a
désexcommunié!
Mais le jeune homme ne put avancer, le sourire se gela sur ses
lèvres, la parole s’enfuit de sa mémoire.
Appuyé au balcon, debout, à côté de Maria
Clara, était Linares; il faisait des bouquets avec les fleurs et
les feuilles des plantes grimpantes; sur le sol gisaient des roses
effeuillées et des sampagas; Maria Clara, couchée dans
son fauteuil, pâle, pensive, le regard triste, jouait avec un
éventail d’ivoire moins blanc que ses doigts
effilés.
A la vue d’Ibarra, Linares blêmit et les joues de Maria
Clara se teintèrent de carmin. Elle essaya de se lever mais, les
forces lui manquant, elle baissa les yeux et laissa tomber son
éventail.
Pendant quelques secondes régna un silence embarrassant.
[364]Enfin
Ibarra put s’avancer et, tremblant, il murmura:
—J’arrive à l’instant, je suis accouru pour
te voir... Je te trouve mieux que je ne le croyais.
On aurait dit que Maria Clara était devenue muette; les yeux
toujours baissés elle ne répondit pas un mot.
Ibarra toisa Linares d’un regard que le timide jeune homme
soutint avec hauteur.
—Allons, je vois que mon arrivée n’était
pas attendue, reprit-il lentement. Pardonne-moi, Maria, de ne pas
m’être fait annoncer, un autre jour je pourrai te donner
des explications sur ma conduite... car nous nous verrons encore...
sûrement!
Ces derniers mots furent accompagnés d’un regard
à l’adresse de Linares. La jeune fille leva vers son
fiancé ses beaux yeux, pleins de pureté et de
mélancolie, si suppliants et si doux qu’Ibarra
s’arrêta confus.
—Pourrai-je venir demain?
—Tu sais que pour moi tu es toujours le bienvenu,
répondit-elle d’une voix faible.
Ibarra s’éloigna tranquille en apparence, mais une
tempête agitait son cerveau, un froid intense glaçait son
cœur. Ce qu’il venait de voir et de comprendre lui semblait
incompréhensible: était-ce du doute, de l’oubli,
une trahison?
—Oh, femme! murmura-t-il.
Sans s’en apercevoir, il était arrivé au terrain
où se construisait l’école. Les travaux
étaient très avancés; son mètre et son fil
à plomb à la main, Nor Juan allait et venait au milieu
des nombreux ouvriers. En voyant Ibarra, il courut à sa
rencontre.
—D. Crisóstomo, lui dit-il, enfin vous voici! nous vous
attendions tous; voyez où en sont les murs, ils ont
déjà un mètre dix de haut; dans deux jours ils
auront la hauteur d’un homme. Je ne me suis servi que de molave,
de dungon, d’ipil, de langil; j’ai demandé du
tindalo, du malatapay, du pino et du narra1 [365]pour les œuvres mortes.
Voulez-vous visiter les fondations?
Les travailleurs saluaient respectueux.
—Voici la canalisation que je me suis permis d’ajouter,
disait señor Juan; ces canaux souterrains conduisent à
une espèce de réservoir situé à trente pas.
Ce réservoir donnera de quoi fumer le jardin; ceci n’avait
pas été prévu par le plan. Vous n’approuvez
pas...?
—Bien au contraire, je vous approuve et je vous
félicite de votre idée. Vous êtes un
véritable architecte; qui vous a appris?
—Moi-même, señor, répondit modestement le
vieillard.
—Ah! que je n’oublie pas une chose assez importante: que
ceux qui auraient des scrupules et qui craindraient de me parler
sachent que je ne suis pas excommunié; l’Archevêque
m’a invité à dîner.
—Ahl señor, nous ne faisons guère cas des
excommunications! Excommuniés, mais nous le sommes tous, le P.
Dámaso lui-même l’est aussi et cependant cela ne le
fait pas maigrir.
—Que voulez-vous dire?
—Sans doute; l’an dernier il a donné un coup de
bâton à un vicaire et les vicaires sont aussi
prêtres que lui. Qui donc fait cas des excommunications?
Ibarra remarqua Elias parmi les travailleurs; celui-ci le salua
comme les autres mais, d’un regard, lui fît comprendre
qu’il avait à lui parler.
—Señor Juan, dit Ibarra, voulez-vous m’apporter
la liste des travailleurs? [366]
Le señor Juan disparut et Ibarra s’approcha
d’Elias qui, seul, soulevait une grosse pierre et la chargeait
sur un chariot.
—Si vous pouvez, señor, m’accorder quelques
heures de conversation, nous nous promènerons ce soir, de bonne
heure, sur les rives du lac et nous prendrons ma barque, car nous
aurons à parler de choses graves.
Ibarra consentit d’un signe, Elias s’éloigna.
Le señor Juan apportait la liste; vainement D.
Crisóstomo la parcourut: le nom d’Elias n’y figurait
point.
[Table des matières]
XLIX
La voix des persécutés
Le soleil n’était pas encore couché lorsque, sur
le bord du lac, Ibarra mit le pied dans la barque d’Elias. Le
jeune homme paraissait contrarié.
—Pardonnez-moi, señor, dit Elias avec une certaine
tristesse; pardonnez-moi de m’être permis de vous donner ce
rendez-vous; je voulais vous parler librement et, ici, aucun
témoin n’est à craindre; dans une heure nous
pourrons être de retour.
—Vous vous trompez, ami Elias, répondit Ibarra
s’efforçant de sourire; il vous faudra me conduire
à ce pueblo dont nous voyons d’ici le clocher. La
fatalité m’y oblige, je suis forcé de m’y
rendre.
—La fatalité?
—Oui; figurez-vous qu’en venant je me suis
rencontré avec l’alférez qui voulait absolument
m’imposer sa compagnie; pensant à vous et sachant
qu’il vous connaissait j’ai dû, pour
l’éloigner, lui dire que je me rendais à ce pueblo
où je devais rester toute la journée; il tient à
venir m’y chercher demain soir.
—Je vous remercie de cette attention, répondit Elias du
ton le plus naturel, mais vous auriez pu simplement lui dire que je
vous accompagnerais. [367]
—Comment? vous?
—Il ne m’aurait pas reconnu. Il ne m’a vu
qu’une seule fois et je ne crois pas qu’il ait pensé
à prendre mon signalement.
—C’est jouer de malheur! soupira Ibarra en pensant
à Maria Clara. Qu’aviez-vous à me dire?
Elias regarda autour de lui. Déjà ils étaient
loin de la rive; le soleil maintenant avait disparu derrière la
crête des montagnes et comme, sous ces latitudes, le
crépuscule dure peu, la nuit descendait rapidement,
éclairée par le disque de la lune en son plein.
—Señor, répondit le pilote d’une voix
grave; je suis le porte-parole de beaucoup de malheureux.
—Des malheureux? que voulez-vous dire?
En peu de mots, Elias le mit au courant de la conversation
qu’il avait eue avec le chef des tulisanes, en omettant les
doutes que le vieillard avait émis et les menaces qu’il
avait proférées. Ibarra l’écouta avec
attention mais, quand Elias eut terminé son rapport, il garda
encore quelques instants le silence avant d’interroger.
—De sorte que l’on voudrait?...
—Des réformes radicales dans la force armée,
dans le clergé, dans l’administration de la justice; en un
mot on demande que le Gouvernement jette sur nous un regard
paternel.
—Des réformes? dans quel sens?
—Par exemple: plus de respect pour la dignité humaine,
plus de sécurité pour l’individu, moins de force
à la force armée, moins de privilèges pour ce
corps qui facilement en abuse.
—Elias, répondit le jeune homme, je ne sais rien de
vous, mais je devine que vous n’êtes pas un homme vulgaire;
vous pensez, vous travaillez autrement que personne en ce pays. Vous me
comprendrez quand je vous dirai que, si défectueux que soit
l’état actuel des choses, il le deviendrait plus encore si
on le changeait. Je pourrais, en les payant, faire agir les amis
que j’ai [368]à Madrid, je pourrais causer au
Capitaine général, mais ni les uns n’obtiendraient,
ni l’autre n’aurait le pouvoir d’introduire tant de
nouveautés; d’ailleurs, je ne ferai jamais un pas dans ce
sens parce que je comprends très bien que, si les
Congrégations ont leurs défauts, elles sont utiles en ce
moment; elles sont ce que l’on appelle un mal
nécessaire.
Surpris à l’extrême, Elias leva la tête et
stupéfait le regarda.
—Vous aussi, señor, vous croyez au mal
nécessaire? demanda-t-il d’une voix
légèrement tremblante; vous croyez qu’il faut
passer par le mal pour arriver au bien?
—Non; j’y crois comme à un violent remède
dont nous nous servons quand nous voulons nous guérir
d’une maladie. A l’heure actuelle, le pays souffre
d’une affection chronique et, pour sa guérison, le
Gouvernement se voit contraint d’user de moyens, durs et
violents, si vous voulez, mais efficaces, indispensables
même!
—C’est un mauvais médecin, señor, celui
qui ne cherche qu’à faire disparaître les
symptômes et à les étouffer sans chercher à
découvrir l’origine de la maladie, ou bien qui, la
connaissant, craint de l’attaquer dans son germe. La Garde civile
n’a d’autre raison d’existence que la
répression du crime par la force et la terreur, et ce but elle
ne l’atteint guère que par hasard. Encore faudrait-il
remarquer que la société n’a le droit
d’être sévère avec les individus que
lorsqu’elle a mis à leur disposition tous les moyens de
développer leur perfectibilité morale. Dans notre pays,
comme il n’y a pas de société puisque le peuple et
le gouvernement ne forment pas une unité, un tout parfait, les
détenteurs du pouvoir devraient être indulgents, non
seulement parce qu’ils ont eux-mêmes besoin
d’indulgence, mais parce que, négligé et
abandonné par eux, l’individu n’a qu’une
responsabilité moindre ayant été moins
éclairé. De plus, en poursuivant
[369]votre comparaison, le
traitement que l’on applique aux maux dont souffre le pays est si
destructeur que ses effets se font sentir uniquement dans la partie de
l’organisme encore saine, dont il affaiblit la vitalité et
qu’il prédispose à la maladie. Ne serait-il pas
plus raisonnable de fortifier les organes malades et de modérer
un peu la violence du médicament?
—Affaiblir la Garde civile serait mettre en péril la
sécurité des pueblos.
—La sécurité des pueblos! s’écria
Elias avec amertume. Il y aura bientôt quinze ans que ces pueblos
ont leur Garde civile, et voyez: nous avons encore des tulisanes, nous
entendons encore dire que l’on pille des maisons, que l’on
attaque sur les chemins; les vols continuent et les auteurs n’en
sont jamais découverts; le crime subsiste mais le
véritable criminel se promène librement, tandis que le
pacifique habitant des pueblos est inquiété. Demandez
à tous les gens honorables de ce pays s’ils
considèrent cette institution comme un bien, comme une
protection du Gouvernement ou bien comme une charge, un despotisme dont
les abus font plus de ravages que les violences des brigands. Ces
violences, pour grandes qu’elles soient, sont rares et de plus on
peut s’en défendre; contre les vexations de la force
légale la protestation n’est pas permise et, si elles sont
moins retentissantes, elles sont continues et sanctionnées par
les autorités supérieures. Aussi, quel rôle joue
cette institution dans la vie de nos pueblos? Elle paralyse les
communications, tous craignant d’être maltraités
sous de futiles prétextes; elle s’attache plus aux
formalités qu’au fond même des choses, ce qui est un
premier symptôme d’incapacité; parce qu’un
pauvre diable, fût-il honnête et bien
considéré, aura oublié sa cédule, doit-on
lui mettre les menottes et le maltraiter? Les chefs considèrent
comme étant leur premier devoir de se faire saluer de gré
ou de force, fût-ce par les nuits les plus obscures et leurs
inférieurs les imitent; quand il s’agit de battre ou de
[370]dépouiller le malheureux paysan, tout
prétexte leur est bon; le respect du foyer n’existe pas
pour eux: il y a peu de temps, à Calamba, ils ont, en passant
par la fenêtre, envahi la maison d’un pacifique habitant du
pays à qui leur chef devait et argent et assistance; nulle
sécurité personnelle: quand ils veulent nettoyer leur
quartier ou leur habitation ils sortent et arrêtent le premier
venu qui ne résiste pas pour le faire travailler tout le jour.
Plus encore: pendant ces dernières fêtes les jeux
prohibés n’ont pas été entravés, mais
vous les avez vus brutalement troubler les réjouissances
permises par l’autorité; vous avez vu ce que le peuple
pensait d’eux. Que lui a-t-il servi de refréner ses
colères et d’attendre satisfaction de la justice des
hommes? Ah! señor, si c’est là ce que vous appelez
conserver l’ordre...
—Je conviens qu’il y a des abus, répliqua Ibarra,
mais nous acceptons ces abus pour les biens qu’ils accompagnent.
L’institution peut être imparfaite, mais, croyez-le, la
terreur qu’elle inspire empêche de s’accroître
le nombre des criminels.
—Dites plutôt que cette terreur en crée chaque
jour de nouveaux, rectifia Elias. Avant la création de ce corps,
presque tous les malfaiteurs—à de rares exceptions
près—étaient des affamés; ils pillaient, ils
volaient pour manger; la disette passée, les chemins
redevenaient libres; il suffisait, pour mettre en fuite ces malheureux,
des pauvres mais vaillants cuadrilleros, si mal armés, si
calomniés par tous ceux qui ont écrit sur notre pays, qui
n’ont d’autre droit que de mourir, d’autre devoir que
de combattre, d’autre récompense que l’insultante
moquerie. Aujourd’hui, il y a des tulisanes qui le sont pour
toute leur vie. Une faute, un premier délit châtié
inhumainement, la résistance aux excès de pouvoir, la
crainte de supplices atroces, les arrachent pour toujours de la
société et les condamnent à tuer ou à
être tués. Le terrorisme de la Garde civile leur ferme les
portes du repentir et comme, dans la [371]montagne où il s’est
réfugié, un tulisan pour se défendre, guerroie
beaucoup mieux que le soldat dont il se rit, nous ne pouvons
remédier au mal que nous avons créé. Souvenez-vous
des résultats obtenus par la prudente conduite du capitaine
général de La Torre: l’amnistie, accordée
par lui à ces malheureux, a prouvé que dans ces montagnes
le cœur de l’homme bat encore pour le bien et
démontré toute la puissance du pardon. Le terrorisme peut
servir quand le peuple est esclave, que la montagne n’a pas de
cavernes, que le pouvoir peut aposter une sentinelle derrière
chaque arbre et que, dans le corps de l’opprimé, il
n’y a qu’un estomac et un ventre; mais quand le
désespéré luttant pour sa vie se sent un bras
fort, un cœur vivant, que la rage l’anime, le terrorisme
pourra-t-il éteindre l’incendie allumé par
lui-même, dont il a lui-même entassé les
combustibles?
—Je suis confondu, Elias, en vous entendant parler ainsi; je
croirais que vous avez raison si mes propres convictions
n’étaient déjà formées.
Mais,—et je ne le dis pas pour vous offenser, car je vous
considère comme une exception,—remarquez ceci: quels sont
ceux qui demandent cette réforme? Presque tous sont des
criminels ou des gens prêts à le devenir.
—Des criminels ou de futurs criminels! sans doute, mais
pourquoi sont-ils devenus tels? Parce qu’on a troublé leur
paix, détruit leur bonheur, blessé leurs plus
chères affections et, qu’à demander protection
à la justice ils ont appris qu’ils ne la pouvaient
espérer que d’eux-mêmes! Mais vous vous trompez,
señor, si vous croyez que les réformes ne sont
réclamées que par ces infortunés; allez de pueblo
en pueblo, de maison en maison, écoutez les secrets soupirs des
familles, et vous vous convaincrez que les maux dont la Garde civile
est continuellement l’auteur sont égaux, sinon
supérieurs, à ceux auxquels elle remédie. Ou bien
en conclurez-vous que tous les citoyens sont des criminels? Alors
pourquoi les défendre contre les autres? Pourquoi ne pas les
détruire tous? [372]
—Quelque défaut existe ici qui maintenant
m’échappe, quelque erreur dans la théorie qui vicie
la pratique, car en Espagne, dans la Mère Patrie, la Garde
civile a rendu et rend encore les plus grands services.
—Je n’en doute pas; peut-être là-bas,
est-elle mieux organisée, le personnel est-il mieux choisi;
peut-être aussi l’Espagne en a-t-elle un besoin qui
n’existe pas aux Philippines? Nos mœurs, nos coutumes, que
l’on invoque toujours chaque fois qu’il s’agit de
nous dénier un droit, sont totalement oubliées quand on
veut nous imposer quelque charge nouvelle. Dites-moi, señor,
pourquoi les autres nations qui, par leur voisinage de l’Espagne
doivent lui ressembler plus que les Philippines, n’ont-elles pas
adopté cette institution? Serait-ce parce que les vols y sont
moins nombreux, que les trains y sont moins souvent
arrêtés sur les chemins de fer, que les insurrections y
sont moins fréquentes, qu’on y assassine moins, que les
rues de leurs capitales sont plus sûres?
Ibarra baissait la tête, il méditait les paroles
d’Elias.
—Cette question, mon ami, répondit-il, mérite
une sérieuse étude; si mes recherches me prouvent que ces
plaintes sont fondées, j’écrirai à mes amis
de Madrid puisque nous n’avons pas de députés.
Cependant, croyez bien que le Gouvernement a besoin d’un corps
dont la force soit illimitée, pour se faire respecter et dont
l’autorité s’impose.
—Vous avez raison, señor, quand le Gouvernement est en
guerre avec le pays; mais pour le bien même du Pouvoir nous ne
devons pas faire croire au peuple qu’il est en opposition avec
ses gouvernants. D’ailleurs, s’il en est ainsi, si nous
préférons la force au prestige, encore devons-nous bien
regarder à qui nous confions cette force illimitée, cette
autorité toute-puissante. Une telle force dans la main
d’hommes et d’hommes ignorants, pleins de passions, sans
éducation morale, sans honorabilité prouvée, est
une arme remise à un insensé au milieu d’une foule
désarmée. J’accorde, je veux bien [373]croire
qu’il faille un bras au Gouvernement, mais qu’il choisisse
bien ce bras, qu’il ne confie sa force qu’aux plus dignes
et, puisqu’il préfère l’autorité
qu’il se donne lui-même à celle que le peuple
pourrait concéder, qu’au moins il fasse voir qu’il
sait se la donner!
Elias parlait avec passion, avec enthousiasme; ses yeux brillaient
et le timbre de sa voix résonnait vibrant. Un silence suivit ses
derniers mots; la barque que la rame ne dirigeait plus semblait se
maintenir immobile à la surface des eaux; la lune resplendissait
majestueuse dans un ciel de saphir; au loin, vers la rive, brillaient
quelques étoiles.
—Et, que demande-t-on encore? interrogea Ibarra.
—La réforme de l’organisation religieuse,
répondit Elias d’une voix triste et
découragée; les malheureux demandent à être
mieux protégés...
—Contre les Ordres religieux?
—Contre leurs oppresseurs, señor.
—Les Philippines auraient-elles oublié ce
qu’elles doivent à ces ordres? Renieraient-elles la dette
de gratitude qu’elles ont contractée envers ceux qui les
ont tirées de l’erreur pour leur donner la foi, qui les
ont protégées contre la tyrannie du pouvoir civil? Le mal
est que l’on n’enseigne pas l’histoire de la
patrie!
Elias, surpris, semblait à peine certain de ce qu’il
entendait.
—Señor, répondit-il d’une voix grave, vous
accusez le peuple d’ingratitude; permettez que moi, qui suis de
ce peuple qui souffre, je le défende. Les bienfaits, pour
mériter la reconnaissance, doivent être
désintéressés. Laissons de côté la
mission divine, la charité chrétienne dont on a tant
usé; faisons abstraction de l’Histoire, ne demandons pas
ce qu’a fait l’Espagne du peuple juif qui a donné
à toute l’Europe un livre, une religion et un Dieu; ce
qu’elle a fait du peuple arabe qui lui avait donné sa
civilisation, qui s’est montré tolérant pour sa
religion, qui a réveillé son amour-propre national,
tombé en léthargie, anéanti presque pendant [374]la
domination des Romains et des Goths. Vous dites que les Ordres nous ont
donné la foi, qu’ils nous ont retirés de
l’erreur; appelez-vous foi ces pratiques extérieures;
religion, ce commerce de courroies et de scapulaires;
vérité, ces miracles et ces contes que nous entendons
tous les jours? Est-ce la loi de Jésus-Christ? Il
n’était point nécessaire qu’un Dieu se
laissât crucifier, que nous nous obligeassions à une
gratitude éternelle: la superstition existait depuis longtemps,
il suffisait de la perfectionner et de hausser le prix des
marchandises. Vous me direz que, si imparfaite que soit notre religion
actuelle, celle qu’elle a remplacée était pire
encore; je le crois, j’en conviens, mais ne l’avons-nous
pas payée trop cher par la perte de notre nationalité, de
notre indépendance? Pour elle nous avons donné à
ses prêtres nos meilleurs pueblos, nos champs les plus fertiles,
et nous leur donnons encore nos économies pour l’achat
d’objets religieux. On a importé pour notre usage un
article d’industrie étrangère, nous l’avons
largement payé, nous sommes en paix. Si vous me parlez de la
protection accordée contre les encomenderos1, je pourrais vous
répondre que c’est grâce aux religieux que nous
sommes tombés sous le pouvoir des encomenderos; mais non,
je reconnais qu’une foi sincère, qu’un
véritable amour de l’humanité guidaient les
premiers ministres qui abordèrent sur nos plages, je reconnais
la dette de gratitude contractée envers ces nobles cœurs,
je sais que l’Espagne d’alors abondait en héros de
toutes classes, dans la religion comme dans la politique, dans
l’ordre civil comme dans l’ordre militaire. Mais parce que
les ancêtres furent vertueux, devons-nous consentir à tous
les excès de leurs descendants
dégénérés? Parce que l’on nous a fait
un grand bien, sommes-nous si coupables de demander que l’on ne
nous fasse pas de mal? Le pays n’exige pas l’abolition des
Ordres, il demande seulement [375]des réformes en rapport avec des
circonstances nouvelles, avec des nécessités
nouvelles.
—J’aime notre Patrie comme vous pouvez l’aimer,
Elias; je comprends quelque peu ce que vous désirez, j’ai
écouté avec attention ce que vous avez dit et surtout,
mon ami, je crois que nous voyons un peu avec les yeux de la passion:
en cette question, moins qu’en toute autre, je ne vois la
nécessité de réformes.
—Serait-il possible, señor? demanda Elias. Mais vos
propres malheurs de famille...
—Ah! je m’oublie, j’oublie mes propres malheurs
lorsqu’il s’agit de la sécurité des
Philippines, de la sécurité de l’Espagne!
interrompit vivement Ibarra. Pour conserver les Philippines à la
Mère Patrie, il faut que les moines restent ce qu’ils sont
et, dans l’union avec l’Espagne, est le bien de notre
pays.
Ibarra avait cessé de parler qu’Elias
l’écoutait encore; sa physionomie s’était
attristée, ses yeux avaient perdu leur éclat.
—Les missionnaires ont conquis le pays, c’est vrai,
reprit-il, mais croyez-vous que ce soit par les moines que
l’Espagne puisse garder les Philippines?
—Oui, et seulement par eux; cette opinion est celle de tous
ceux qui ont écrit sur les Philippines.
—Oh! s’écria Elias en rejetant avec
découragement la rame dans la barque; je ne croyais pas que vous
eussiez une si pauvre idée du gouvernement et du pays. Pourquoi
ne méprisez-vous ni l’un ni l’autre? Que diriez-vous
d’une famille qui ne vivrait en paix que par l’intervention
d’un étranger? Un pays qui n’obéit que parce
qu’on le trompe, un gouvernement qui ne commande que parce
qu’il se sert du mensonge, qui ne sait pas se faire aimer ni
respecter par lui-même! Pardonnez-moi, señor, mais je
crois que votre gouvernement se déshonore et se suicide
lorsqu’il se réjouit de la croyance aveugle d’un
peuple trompé! Je vous remercie de votre amabilité et
vous prie de me dire où vous voulez que je vous conduise
maintenant? [376]
—Non, répondit Ibarra; discutons, il faut savoir qui a
raison lorsque le sujet de la conversation est si important.
—Vous m’excuserez, señor, reprit Elias en
secouant la tête; je ne suis pas assez éloquent pour vous
convaincre; si j’ai reçu quelque éducation, je suis
un Indien, mon existence est pour vous douteuse, et mes paroles vous
sembleront toujours suspectes. Ceux qui ont exprimé des opinions
contraires aux miennes sont Espagnols et, comme tels, quelque
frivolité, quelque niaiserie qu’ils débitent, leur
ton, leurs titres, leur origine les consacrent, leur donnent une telle
autorité qu’ils désarment d’avance toute
contradiction. De plus, quand je vois que vous qui aimez votre pays,
vous dont le père repose sous ces tranquilles flots, vous qui
avez été provoqué, insulté, poursuivi, vous
conservez ces opinions malgré tout, quand je considère ce
que vous valez, je commence à douter de mes convictions et
j’admets qu’il soit possible que le peuple se trompe. Je
dois dire à ces malheureux qui ont mis leur confiance dans les
hommes qu’ils la placent en Dieu ou dans leurs propres bras. Je
vous remercie de nouveau et vous prie de m’indiquer où je
dois vous conduire.
—Elias, vos amères paroles pénètrent
jusqu’à mon cœur et me font douter, moi aussi. Que
voulez-vous? Je n’ai pas été élevé au
milieu du peuple, je ne connais pas ses besoins; j’ai
passé mon enfance au Collège des Jésuites,
j’ai grandi en Europe, je ne me suis formé que par les
livres et je n’ai pu lire que ce que les hommes ont
apporté à la lumière; ce qui est resté dans
l’ombre, ce que n’ont pas révélé les
écrivains, je l’ignore. Et cependant, comme vous,
j’aime notre patrie, non seulement parce que c’est le
devoir de tout homme d’aimer le pays à qui il doit
l’existence et à qui, peut-être, il devra son
dernier asile; non seulement parce que mon père me l’a
enseigné, parce que ma mère était indienne et que
mes plus chers souvenirs vivent en lui, je l’aime de plus parce
que je lui dois et lui devrai mon bonheur! [377]
—Et moi, parce que je lui dois mon malheur, murmura Elias.
—Oui, ami, je sais que vous souffrez, que vous êtes
malheureux; votre situation vous obscurcit la vision de l’avenir
et influe sur votre manière de penser; c’est pour cela que
j’écoute vos plaintes avec une certaine prévention.
Si je pouvais apprécier les motifs, une partie de ce
passé...
—Mes malheurs ont une autre origine; si je supposais que cela
puisse être de quelque utilité, je vous les raconterais,
car non seulement je n’en fais aucun mystère mais ils sont
connus de beaucoup.
—Peut-être que les connaître rectifierait mes
jugements; vous savez que je me méfie beaucoup des
théories, je me guide surtout d’après les
faits.
Elias resta quelques instants pensif:
—S’il en est ainsi, señor, je vous raconterai
brièvement mon histoire.
[Table des matières]
L
La famille d’Elias
—Il y a environ soixante ans, mon grand-père vivait
à Manille; il était employé comme comptable chez
un commerçant espagnol. Bien qu’il fût alors
très jeune, il était marié et avait un fils. Une
nuit, sans que l’on sût comment, le magasin prit feu et
l’incendie se communiqua à toute la maison et aux
habitations environnantes. Les pertes furent innombrables, on chercha
un coupable et le commerçant accusa mon grand-père. En
vain protesta-t-il de son innocence, il était pauvre, il ne
pouvait payer les avocats célèbres, on le condamna
à être bâtonné publiquement et promené
par les rues de Manille. Il y a peu de temps qu’a
été supprimé ce châtiment infamant, que le
peuple appelle caballo y [378]vaca1, pire mille fois que la mort elle-même.
Mon aïeul, abandonné de tous, excepté de sa jeune
épouse, se vit attaché à un cheval, suivi
d’une foule cruelle, frappé à chaque carrefour,
à la face des hommes, ses frères, dans le voisinage des
nombreux temples d’un Dieu de paix. Quand le malheureux,
marqué à jamais d’infamie, eut satisfait de son
sang, de ses tortures et de ses cris, la vengeance des hommes, on le
détacha, mais il eût mieux valu pour lui être mort!
Par une de ces cruautés raffinées que savent parfois
inventer les bourreaux, la liberté lui fût rendue; sa
femme, alors enceinte, s’en alla vainement de porte en porte
mendier du travail ou quelque aumône pour soigner son mari malade
et son pauvre enfant; qui pouvait avoir confiance ou pitié?
N’était-ce pas la femme d’un incendiaire et
d’un infâme? L’épouse, donc, dut
s’adonner à la prostitution!
Ibarra se leva de son siège.
—Oh! ne vous inquiétez pas! La prostitution
n’était un déshonneur ni pour elle ni pour son
mari; honneur et honte, n’existaient plus pour eux. Le mari
guérit de ses blessures et, avec sa femme et son fils, il vint
se cacher dans les montagnes de cette province. La femme y mit au jour
un fœtus estropié et malade qui eut la chance de ne point
vivre. Eux y restèrent quelques mois encore, misérables,
isolés, détestés, repoussés de tout le
monde. Mon grand-père, moins courageux que sa femme, ne put
supporter une telle existence: il se pendit,
désespéré de voir celle qu’il aimait malade,
enceinte de nouveau, privée de tout secours et de tout soin. Le
fils, qui pouvait à peine soigner sa mère, dut laisser se
pourrir le cadavre que la mauvaise odeur signala bientôt à
la justice. Mon aïeule fut accusée à son tour et
condamnée pour n’avoir point révélé
la mort de son mari; on lui attribua le crime, on prouva qu’elle
l’avait commis: de quoi n’était point capable la
femme d’un tel [379]misérable qui, elle-même, avait
été une prostituée? Si elle prêtait serment
on l’appelait parjure, si elle pleurait on lui reprochait de
jouer une comédie, on répondait blasphème si elle
invoquait Dieu. Cependant, en considération de son état,
on résolut d’attendre sa délivrance pour la
bâtonner: vous savez que les moines ont répandu cette
croyance que les Indiens ne doivent se traiter qu’à coups
de bâtons: lisez ce qu’en dit le P. Gaspar de S.
Augustin.
Une femme ainsi condamnée doit maudire le jour où son
enfant verra la lumière; c’était donc à la
fois prolonger son supplice et violer ses sentiments maternels. Par
malheur sa délivrance s’opéra bien, par malheur
aussi l’enfant naquit vivant et robuste. Deux mois après,
la sentence s’accomplissait à la grande satisfaction des
hommes qui croyaient ainsi remplir un devoir. Ayant perdu la
tranquillité dans ces montagnes, elle s’enfuit avec ses
deux enfants dans la province voisine et, là, ils
vécurent comme des fauves, haïssant et haïs.
L’aîné des deux fils qui, au milieu de tant de
misères, se rappelait les joies de son enfance se fit tulisan
dès qu’il en eut la force, et le nom sanguinaire de
Bâlat s’étendit de province en province, terreur des
pueblos, car dans sa soif de vengeance il mettait tout à feu et
à sang. Le plus jeune, à qui la Nature avait donné
un cœur bon, s’était résigné à
son sort et à son infamie; il vivait à côté
de sa mère, se nourrissant tous deux des fruits de la
forêt, s’habillant des guenilles que leur jetaient les
passants; elle avait perdu son nom; on ne la connaissait que par les
sobriquets de delincuente, prostituta, apaleada2; lui,
n’était connu que comme fils de sa mère, parce que
la douceur de son caractère ne permettait pas de le croire
né de l’incendiaire et qu’il est toujours permis de
douter de la moralité des Indiens. Enfin, le fameux Bâlat
tomba un jour entre les mains de la Justice qui
[380]lui demanda
sévèrement compte de ses crimes, elle qui jamais
n’avait rien fait pour lui enseigner le bien; un matin, le jeune
garçon cherchant sa mère qui était allée au
bois pour y cueillir des champignons et n’était pas encore
revenue, la trouva étendue à terre, sur le bord du
chemin, sous un cotonnier, la figure vers le ciel, les yeux fixes, hors
des orbites, les doigts crispés, enfoncés dans le sol
taché de sang. Quand le malheureux leva la tête et tourna
sa vue vers où regardait le cadavre il aperçut un panier
suspendu à une branche et, dans ce panier, la tête
ensanglantée de son frère!
—Mon Dieu! s’écria Ibarra.
—C’est le cri qui échappa à mon
père, continua froidement Elias. Les hommes avaient
dépecé le brigand et enterré le tronc, mais les
membres dispersés furent exposés en différents
pueblos. Si parfois vous allez de Calamba à Santo Tomas vous
trouverez encore un misérable arbre de lomboy3 où une jambe de mon
oncle fut suspendue et se putréfia: la Nature l’a maudit,
l’arbre n’a plus ni grandi ni donné de fruits. Il en
fut de même des autres membres, mais la tête, comme
étant le meilleur de l’individu, ce qui s’en
reconnaît le plus facilement, on l’avait pendue devant la
cabane de la mère!
Ibarra baissa la tête.
—Le jeune homme s’enfuit comme un maudit, de pueblo en
pueblo, à travers les monts et les vallées, et quand il
se crut assez loin pour ne plus être reconnu, il entra, comme
travailleur, chez un riche de la province de Tayabas. Son
activité, la douceur de son caractère lui
assurèrent l’estime de tous, car on ignorait son
passé. A force de travail et d’économie il arriva
à se créer un petit capital, et comme la misère
était passée, qu’il était jeune, il pensa
à être heureux. Sa bonne prestance, sa jeunesse et sa
situation quelque peu indépendante lui [381]captèrent l’amour
d’une jeune fille du pueblo dont il n’osait point demander
la main de peur que son origine se découvrît. Mais
l’amour fut le plus fort et tous deux manquèrent à
leurs devoirs. Pour sauver l’honneur de sa maîtresse, il
risqua tout et la demanda en mariage; on chercha les papiers; la
vérité éclata: le père de la jeune fille
était riche, il porta plainte contre l’homme, le
procès fut instruit, le malheureux ne chercha pas à se
défendre, admit tout ce dont on l’accusa et fut
envoyé au presidio. La jeune fille mit au monde deux jumeaux, un
fils et une fille qui furent élevés en secret; on leur
fit croire que leur père était mort, ce qui
n’était pas difficile, car ils avaient vu, encore en bas
âge, mourir leur mère, et ne pensaient guère
à rechercher leur généalogie. Comme notre
grand-père était riche, notre enfance fut très
heureuse; ma sœur et moi nous grandîmes ensemble, nous
aimant comme peuvent seuls s’aimer deux jumeaux qui ne
connaissent pas d’autres amours. Très jeune, on
m’envoya étudier au Collège des jésuites et
ma sœur, pour que nous ne fussions pas complètement
séparés, entra à la pension de la Concordia. Notre
éducation fut courte, car nous n’ambitionnions que
d’être agriculteurs; aussitôt qu’elle fut
terminée, nous revînmes au pueblo pour prendre possession
de l’héritage de notre grand-père. Là,
pendant quelque temps, nous vécûmes heureux,
l’avenir nous souriait; nous avions de nombreux domestiques, nos
champs donnaient de bonnes récoltes et ma sœur
était à la veille de se marier avec un jeune homme
qu’elle adorait et qui répondait à son amour. Pour
des questions pécuniaires et aussi par mon caractère
alors hautain, je m’étais attiré la rancune
d’un lointain parent: un jour il me jeta à la face ma
ténébreuse origine et l’infamie de mon ascendance.
Je crus à une calomnie, je demandai satisfaction: la tombe
où dormaient tant de misères s’ouvrit et la
vérité en sortit pour me confondre. Pour comble de
malheur, nous avions alors depuis quelques années un vieux
domestique [382]qui souffrait tous mes caprices sans se
plaindre jamais, se contentant seulement de pleurer et de gémir
quand les autres serviteurs l’accablaient de leurs moqueries. Je
ne sais comment mon parent s’informa, toujours est-il qu’il
cita le vieillard devant la justice et lui fit déclarer la
vérité: notre vieux domestique était notre
père que souvent j’avais maltraité et dont la
déposition frappait ses enfants chéris. Notre bonheur
s’évanouit, je renonçai à notre fortune, ma
sœur perdit son fiancé, et, avec mon père, nous
abandonnâmes le pueblo pour aller vivre ailleurs, n’importe
où. La pensée qu’il avait contribué à
notre malheur abrégea les jours du vieillard; ses lèvres
me révélèrent tout le passé douloureux. Ma
sœur et moi nous restions seuls.
Elle pleura beaucoup mais, en dépit de tant de malheurs qui
fondaient sur nous elle ne pouvait oublier son amour. Sans une plainte,
sans un mot, elle vit se marier avec une autre son ancien
fiancé, mais moi, peu à peu et sans que rien pût la
consoler, je la voyais dépérir. Un jour elle disparut: en
vain je la cherchai de tous côtés, en vain je
m’informai d’elle auprès de tous; six mois
après seulement j’appris que, vers l’époque
où je l’avais perdue, après un débordement
du lac, on avait trouvé sur la plage de Calamba, dans les
rizières, le cadavre d’une jeune fille noyée ou
assassinée; elle avait, disait-on, un couteau cloué dans
la poitrine. Les autorités de ce pueblo avaient fait publier le
fait dans les pueblos voisins; personne ne s’était
présenté pour réclamer le cadavre, aucune jeune
fille n’avait disparu. Aux différents signes que
l’on me donna ensuite, au costume, aux bijoux, à la
beauté de son visage et de son abondante chevelure, je reconnus
ma pauvre sœur. Et depuis lors, j’erre de province en
province, ma renommée et mon histoire se transmettent de bouche
en bouche, on m’attribue beaucoup de choses, parfois on me
calomnie, mais je fais peu de cas des hommes et je continue mon chemin.
Voici, en résumé, mon histoire et celle de l’un des
jugements humains. [383]
Elias se tut et continua à ramer.
—Je commence à croire que vous n’avez pas tort,
murmura Crisóstomo à voix basse, quand vous dites que la
justice devrait tendre vers le bien pour la récompense de la
vertu et l’éducation des criminels. Seulement...
c’est impossible, c’est une utopie, car d’où
tirer l’argent qu’il faudrait, comment créer tant
d’emplois nouveaux?
—Et pourquoi ne se servirait-on pas de ces prêtres qui
prônent leur mission de paix et de charité? Serait-il plus
méritoire de mouiller d’un peu d’eau la tête
d’un enfant, de lui donner à manger quelques grains de
sel, que de réveiller, dans la conscience obscurcie de chaque
criminel, cette étincelle allumée par Dieu en chaque
homme pour le guider à la recherche du bien? Serait-il plus
humain d’accompagner un condamné à la potence que
de lui indiquer le difficile sentier qui du vice conduit à la
vertu? Et les espions, les bourreaux, les gardes civils, ne les
paye-t-on pas? Bien que sale, cela aussi coûte de
l’argent.
—Mon ami, quand nous le voudrions, ni vous ni moi, nous ne
pourrions réussir.
—Seuls, c’est vrai, nous ne sommes rien; mais faites
vôtre la cause du peuple, unissez-vous au peuple, ne refusez pas
d’écouter sa voix, donnez l’exemple, propagez
l’idée de ce qu’on appelle une patrie!
—Ce que demande le peuple est impossible; il faut
attendre.
—Attendre, attendre c’est souffrir!
—Si je le demandais, on se moquerait de moi.
—Et si le peuple vous soutient?
—Jamais! je ne serai jamais celui qui conduira la foule pour
qu’elle arrache de force ce que le gouvernement ne croira pas
opportun de lui accorder, non! Et si je voyais un jour s’armer
cette multitude, je me rangerais du côté du gouvernement
et je la combattrais car, en cette tourbe, je ne reconnaîtrais
pas mon pays. Je veux son bien, c’est pourquoi je bâtis une
école; je [384]le cherche ce bien au moyen de
l’instruction, par le continuel progrès; sans
lumière il n’y a pas de route, pas d’issue
possible.
—Sans lutte il n’y a pas non plus de liberté!
répondit Elias.
—C’est que je ne veux pas de cette liberté!
—Sans liberté pas de lumière! vous disiez que
vous connaissez peu votre pays, je le crois. Vous ne voyez pas la lutte
qui se prépare, vous ne voyez pas le nuage à
l’horizon; le combat commence dans la sphère des
idées pour descendre dans l’arène qui se teindra de
sang; écoutez la voix de Dieu, malheur à ceux qui
voudront résister! l’Histoire ne leur appartient pas.
Elias était transfiguré; debout, découvert, son
visage mâle, illuminé par la blanche lumière de la
lune, avait quelque chose d’extraordinaire. Il secoua son
abondante chevelure et continua.
—Ne voyez-vous pas comme tout se réveille? Le sommeil a
duré des siècles, mais un jour la foudre tombe, et la
foudre, au lieu de détruire, appelle la vie; et voici que de
nouvelles tendances travaillent les esprits, voici que ces tendances,
aujourd’hui séparées s’unissent un jour,
guidées par Dieu. Dieu n’a pas manqué aux autres
peuples, il ne manquera pas non plus au nôtre; sa cause est la
cause de la liberté!
Un solennel silence suivit ces paroles. La barque,
entraînée par les vagues s’approchait de la rive. Le
premier, Elias reprit la parole.
—Que dois-je dire à ceux qui m’envoient?
demanda-t-il en changeant de ton.
—Je vous l’ai déjà dit; je déplore
beaucoup leur situation, mais il faut qu’ils attendent! on ne
guérit pas le mal par un autre mal et, dans nos malheurs, nous
avons tous notre part de fautes.
Elias n’insista pas; il baissa la tête, continuant de
ramer; quand le bateau toucha la rive, il prit congé
d’Ibarra: [385]
—Je vous remercie, señor, lui dit-il, de votre
condescendance envers moi; dans votre intérêt, je vous
demande de m’oublier désormais et de ne jamais me
reconnaître en quelque situation que vous me trouviez.
Puis, tandis que Crisóstomo s’éloignait, il se
remit à ramer, conduisant la barque vers une touffe de roseaux
sur la plage. Seuls paraissaient occuper son attention les milliers de
diamants que soulevait la rame et qui retombaient et disparaissaient
aussitôt dans le mystère des flots doucement
azurés.
Enfin, il toucha terre; un homme sortit des roseaux et
s’approcha de lui.
—Que dois-je dire au Capitaine? demanda l’homme.
—Dis lui qu’Elias, s’il ne meurt pas avant,
accomplira sa parole, répondit tristement le pilote.
—Alors, quand nous rejoindras-tu?
—Quand votre Capitaine croira que l’heure du
péril est arrivée.
—C’est bien, adieu!
—Si je ne meurs pas avant! murmurait Elias.
[Table des matières]
LI
Commerce
Le timide Linares était inquiet et triste. Il venait de
recevoir une lettre de Da. Victorina dont nous corrigeons un peu
l’orthographe afin de la rendre intelligible:
«Estimé cousin: Je veux savoir avant trois jours si tu
as été tué par l’alférez ou bien lui
par toi. Je ne veux pas qu’un jour de plus s’écoule
sans que cet animal soit puni. Si, passé ce délai, tu ne
l’as pas encore provoqué, je dis à don Santiago que
jamais tu n’as été secrétaire de personne,
que tu n’as jamais plaisanté [386]avec Canovas ni avec le
général don Arsenio Martinez, je dis à Clarita que
tout est mensonge et ne te donne plus un cuarto. Si tu le défies
je te promets tout ce que tu voudras; je te préviens que je
n’admettrai ni excuses ni motifs de retard.
Ta cousine qui t’aime de
cœur:
Victorina de los
Reyes de De Espadana.
Sampaloc, lundi, 7 h. du soir.»
L’affaire était grave: Linares connaissait le
caractère de Da. Victorina, il savait de quoi elle était
capable; lui parler raison, c’était parler honneur et
politesse à un carabinier des douanes quand il cherche un
contrebandier là où il n’y en a pas; supplier
était inutile, jouer de ruse dangereux; il n’y avait
qu’un seul parti à prendre: provoquer.
—Mais comment? se disait-il en se promenant de long en large.
S’il m’envoie paître? Si je me trouve avec sa femme?
Qui voudra être mon témoin? Le curé? Capitan Tiago?
Maudite soit l’heure où j’ai écouté
ses conseils! Latera!1 Qui m’obligeait à me donner de
l’importance, à raconter des histoires, à les
tromper par des fanfaronnades! que va dire de moi cette demoiselle...?
Cela m’ennuie maintenant d’avoir été
secrétaire de tous les ministres.
Le bon Linares continuait encore son triste soliloque quand entra le
P. Salvi. En vérité, le franciscain était encore
plus maigre et plus pâle que de coutume, mais ses yeux brillaient
d’une lueur singulière et sur ses lèvres
s’épanouissait un étrange sourire.
—Sr. Linares, vous êtes seul? dit-il en saluant le jeune
homme, et il se dirigea vers le salon dont la porte entr’ouverte
laissait entendre quelques notes de piano.
—Et D. Santiago? ajouta le curé.
[387]
Au même instant, Capitan Tiago entrait. Il baisa la main du
curé, le débarrassa de son chapeau et de sa canne,
souriant comme un bienheureux.
—Allons, allons! dit le curé en entrant dans le salon,
suivi de Linares et de Capitan Tiago; j’ai de bonnes nouvelles
à vous communiquer à tous. J’ai reçu de
Manille des lettres qui me confirment celle que le Sr. Ibarra m’a
apportée hier... de telle sorte, D. Santiago, que
l’obstacle disparaît.
Maria Clara, assise au piano entre ses deux amies, fit un mouvement
pour se lever, mais les forces lui manquèrent, elle dut se
rasseoir. Linares devint blême et regarda Capitan Tiago qui
baissait les yeux.
—Ce jeune homme me semble très sympathique, continua le
curé; d’abord je l’avais mal jugé... il est
d’esprit un peu vif, mais, quand il fait une faute, il sait si
bien s’arranger qu’on ne saurait lui en garder rancune. Si
ce n’était pour le P. Dámaso...
Et le curé lança un regard vers Maria Clara qui
écoutait de toutes ses oreilles, mais ne quittait pas des yeux
son cahier de musique, malgré les pinçons de Sinang qui
exprimait ainsi son allégresse: si elles avaient
été seules elle aurait dansé.
—Le P. Dámaso...? demanda Linares.
—Oui, le P. Dámaso a dit, continua le curé sans
perdre de vue Maria Clara, que, comme parrain, il ne pourrait
permettre... mais enfin, je crois que, si le Sr. Ibarra lui demande
pardon, tout s’arrangera.
Maria Clara se leva, proféra une excuse et,
accompagnée de Victoria, se retira dans sa chambre.
—Et, si le P. Dámaso ne lui pardonne pas? demanda
Capitan Tiago à voix basse.
—Alors,... Maria Clara verra... le P. Dámaso est son
père... spirituel; mais je crois qu’ils
s’entendront.
Un bruit de pas se fit entendre, Ibarra entra, suivi de la tante
Isabel; son entrée produisit une impression toute
particulière, différente pour chacune des personnes
présentes. Il salua avec affabilité Capitan Tiago qui ne
[388]savait s’il devait sourire ou pleurer,
puis s’inclina profondément devant Linares. Le P. Salvi,
lui, se leva et tendit la main à Ibarra si affectueusement que
celui-ci ne put contenir un regard de surprise.
—Ne soyez pas étonné, dit le prêtre,
à l’instant même je faisais votre éloge.
Ibarra remercia et s’approcha de Sinang.
—Où as-tu été toute la journée?
lui demanda-t-elle dans son enfantin babil; nous nous interrogions et
nous disions: Où aura pu aller cette âme rachetée
du Purgatoire? Et chacune de nous disait son avis.
—Et ne puis-je savoir ce que vous disiez?
—Non, c’est un secret, mais je te le dirai quand nous
serons seuls. Maintenant dis-nous où tu es allé, pour
voir qui a le mieux deviné.
—Non, c’est aussi un secret, mais je te le dirai entre
nous si ces señores le permettent.
—Mais certainement, certainement! dit le P. Salvi.
Sinang emmena Crisóstomo à un bout du salon;
l’idée qu’elle allait connaître un secret la
rendait toute joyeuse.
—Dis-moi, petite amie, demanda Ibarra, Maria est-elle
fâchée contre moi?
—Je ne sais pas, mais elle dit qu’il vaut mieux que tu
l’oublies, puis se met à pleurer. Capitan Tiago veut
qu’elle se marie avec ce señor, le P. Dámaso aussi,
mais elle ne dit ni oui ni non. Ce matin, quand nous lui avons
causé de toi, j’ai dit: qui sait s’il n’est
pas allé faire la cour à une autre? elle m’a
répondu: Dieu le veuille!
Ibarra était grave.
—Dis à Maria que je voudrais lui parler à elle
seule.
—Toute seule? s’écria Sinang en fronçant
les sourcils et en le regardant.
—Toute seule, non; mais que celui-ci ne soit pas
là.
—C’est difficile; mais, ne t’en occupe pas, je lui
en parlerai.
—Et, quand saurai-je la réponse?
[389]
—Demain, viens de bonne heure. Maria ne veut jamais rester
seule, nous lui tenons compagnie; Victoria et moi passons chacune une
nuit près d’elle; demain, c’est mon tour. Mais,
écoute, et le secret? tu t’en vas sans me dire le
principal.
—C’est vrai; je suis allé au pueblo de Los
Baños; je vais y exploiter les cocotiers, je pense construire
une fabrique; ton père sera mon associé.
—Ce n’est que cela? En voilà un secret!
s’écria Sinang à voix haute, du ton d’un
usurier refait; je croyais...
—Prends garde! Je ne veux pas que tu le dises.
—Je n’en ai pas envie! répondit Sinang le nez
pincé. Si c’eût été quelque chose
d’important, je l’aurais dit à mes amies, mais
acheter des cocos! des cocos! qui donc s’intéresse aux
cocos?
Et elle s’enfuit vivement chercher ses amies.
Quelques moments après, voyant que la conversation ne pouvait
que languir, Ibarra prit congé; Capitan Tiago avait l’air
aigre-doux, Linares se taisait, seul le curé affectait la
gaieté et racontait des histoires. Aucune des jeunes filles
n’était revenue.
[Table des matières]
LII
La carte des morts et les ombres
Le ciel nuageux cache la lune; un vent froid, précurseur du
prochain Décembre, entraîne quelques feuilles
desséchées et soulève la poussière dans
l’étroit sentier qui conduit au cimetière.
Sous la porte, trois ombres parlent entre elles à voix
basse.
—Tu as causé à Elias? demande une voix.
—Non, tu sais qu’il est très bizarre et
très circonspect, mais il doit être des nôtres; D.
Crisóstomo lui a sauvé la vie. [390]
—C’est aussi pour cela que j’ai accepté,
dit la première voix; D. Crisóstomo fait soigner ma femme
chez un médecin à Manille! Je me suis chargé du
couvent pour régler mes comptes avec le curé.
—Et nous du quartier pour dire aux gardes civiles que notre
père avait des fils.
—Combien serez-vous?
—Cinq; avec cinq c’est suffisant. Le domestique de D.
Crisóstomo dit que nous serons vingt.
—Et, si cela finit mal?
—Pssit! fit quelqu’un; tous se turent.
Dans la demi-obscurité on voyait venir une ombre; elle se
glissait en suivant le détour du sentier, s’arrêtant
de temps à autre comme si elle se retournait pour regarder
derrière elle.
Elle avait un motif pour se retourner. A vingt pas, en effet, une
autre ombre la suivait, plus grande, et qui semblait plus sombre
encore: elle foulait légèrement le sol, disparaissant
aussitôt que celle qui marchait devant s’arrêtait et
se retournait, comme si la terre s’entr’ouvrait pour la
cacher.
—On me suit! murmurait l’une; serait-ce la garde civile?
le sacristain m’aurait-il menti?
—Il paraît que le rendez-vous est ici, disait la seconde
à voix basse; du moment que les deux frères me
l’ont caché, c’est qu’il doit s’agir de
quelque chose de mauvais.
La première ombre arriva enfin à la porte du
cimetière. Les trois autres s’avancèrent.
—C’est vous?
—C’est vous?
—Séparons-nous, on m’a suivi! Demain vous aurez
les armes, ce sera pour le soir. Le cri est: «Vive D.
Crisóstomo!» Allez!
Les trois ombres disparurent derrière les murs en torchis. Le
nouvel arrivé se cacha dans le creux de la porte et attendit
silencieux.
—Voyons qui me suivait! murmura-t-il.
Avec beaucoup de précaution, la seconde ombre
s’approcha [391]et s’arrêta comme pour regarder
autour d’elle.
—J’arrive en retard! dit-elle à mi-voix, mais
peut-être reviendront-ils.
Et, comme une pluie fine et menue commençait à tomber,
menaçant de durer, elle pensa à se mettre à
l’abri sous l’auvent de la porte.
Naturellement elle se rencontra avec le premier occupant.
—Ah! qui êtes-vous? demanda-t-elle d’une voix
mâle.
—Et vous, qui êtes-vous? répondit l’autre
très tranquillement.
Un moment de pause; tous deux s’efforçaient de se
reconnaître par le timbre de la voix et les manières.
—Qu’attendez-vous ici? demanda la voix mâle.
—Que sonnent huit heures pour avoir la carte des morts; je
veux gagner beaucoup, cette nuit, répondit l’autre; et
vous... pourquoi venez-vous?
—Pour... la même chose.
—Ah! tant mieux! je ne serai pas seul. J’ai
apporté des cartes, au premier coup de cloche je pointe, au
second, le coq: celles qui retournent sont les cartes des morts et
l’on doit se les disputer à mort! Vous avez aussi
apporté des cartes?
—Non!
—Alors?
—Simplement; de même que vous tenez la banque,
j’attends qu’ils la prennent.
—Et si les morts ne la prennent pas?
—Que faire? Le jeu n’est pas encore obligatoire chez
eux...
Il y eut un moment de silence.
—Vous êtes venu avec des armes? Comment allez-vous vous
battre avec les morts?
—Avec mes poings, répondit le plus grand.
—Ah, diable! je me souviens maintenant! Les morts
n’indiquent rien quand il y a plus d’un vivant, et nous
sommes deux. [392]
—C’est vrai? eh bien! je ne veux pas m’en
aller.
—Moi non plus, j’ai besoin d’argent,
répondit le plus petit; mais faisons ceci: jouons entre nous, le
perdant s’en ira.
—Soit... répondit l’autre avec un certain
déplaisir.
—Alors, entrons... avez-vous des allumettes?
Ils entrèrent et cherchèrent dans cette
demi-obscurité un endroit propice; ils ne furent pas longs
à trouver une niche où ils s’assirent. Celui qui
avait apporté des cartes les tira de son salakot, l’autre
fît flamber une allumette.
A la lumière, ils se regardèrent l’un
l’autre, mais, à en juger par l’expression de leurs
visages, ils ne se connaissaient pas. Cependant, nous qui les avons
déjà vus, reconnaîtrons Elias dans le plus grand,
à la voix mâle, et dans l’autre José, portant
sa cicatrice à la joue.
—Coupez! dit celui-ci, sans cesser de l’observer.
Il écarta quelques os qui se trouvaient dans la niche et tira
un as et un cheval. Elias allumait des allumettes l’une
après l’autre.
—Au cheval! dit-il, et pour signaler la carte, il posa dessus
une vertèbre.
—Je joue! dit José et, en quatre ou cinq cartes, il
tira un as.
—Vous avez perdu, ajouta-t-il; maintenant laissez-moi seul,
que je cherche ma vie.
Sans dire un mot, Elias s’éloigna et se perdit dans
l’obscurité.
Quelques minutes après, huit heures sonnèrent au
clocher de l’église et la cloche annonça
l’heure des âmes, mais José n’invita personne
à jouer; il n’évoqua pas les morts comme le lui
commandait la superstition; il se découvrit seulement, murmurant
quelques prières et multipliant les signes de croix avec autant
de ferveur que s’il avait été le chef de la
confrérie du Très Saint Rosaire.
La pluie continuait. Dans le pueblo, à neuf heures, les rues
étaient déjà obscures et solitaires; les lanternes
[393]à huile que doit suspendre chaque
habitant, éclairaient à peine un cercle de un
mètre de rayon; elles ne paraissaient allumées que pour
faire voir les ténèbres.
Deux gardes civils se promenaient d’un bout à
l’autre de la rue, près de l’église.
—Il fait froid! dit l’un, en tagal, avec un accent
visaya1, pas
de sacristain à prendre, pas de quoi regarnir le poulailler de
l’alférez... C’est ennuyeux, la mort de
l’autre les a effrayés.
—Oui, c’est ennuyeux, lui répondit son compagnon;
personne ne vole, personne ne fait de bruit; mais, grâce à
Dieu! le bruit court que le fameux Elias est dans le pueblo.
L’alférez a dit que celui qui le prendrait ne serait pas
battu pendant trois mois.
—Ah! Connais-tu son signalement de mémoire? demanda le
visaya.
—Je crois! taille, grande selon l’alférez,
ordinaire selon le P. Dámaso; teint brun; yeux, noirs; nez,
régulier; bouche, régulière; barbe, aucune;
cheveux, noirs...
—Ah, ah! et signes particuliers?
—Chemise noire, pantalon noir, bûcheron...
—Ah! il ne s’échappera pas; il me semble
déjà le voir. [394]
—Ne le confonds pas avec un autre qui lui ressemblerait.
Et les deux soldats poursuivirent leur ronde.
A la lumière des lanternes nous voyons s’avancer deux
ombres, l’une suivant l’autre en se dissimulant de son
mieux. Un énergique: Qui vive? les arrêta toutes
deux. D’une voix tremblante, la première répondit:
Espagne!
Les deux soldats s’en saisirent et la conduisirent devant une
lanterne pour la reconnaître. C’était José,
mais les gardes, moins instruits que nous de sa personnalité,
hésitaient, se consultaient du regard.
—L’alférez nous a dit qu’il avait une
cicatrice! dit à voix basse le visaya. Où vas-tu?
—Commander une messe pour demain!
—N’as-tu pas vu Elias?
—Je ne le connais pas, señor! répondit
José.
—Je ne te demande pas si tu le connais, imbécile! nous
non plus nous ne le connaissons pas, je te demande si tu l’as
vu.
—Non, señor.
—Écoute bien, je vais te dire son signalement. Taille
à la fois haute et ordinaire, cheveux et yeux, noirs; tout le
reste est ordinaire. Le connais-tu maintenant!
—Non, señor, répondit José ahuri.
—Alors, sulung2! brute, bourrique!—Et ils lui rendirent la
liberté avec une bourrade.
—Sais-tu pourquoi Elias est grand pour l’alférez
et ordinaire pour le curé? demanda pensif le tagal au
visaya.
—Non.
—C’est parce que, quand ils l’ont vu,
l’alférez était enfoncé dans la mare, tandis
que le curé était debout.
—C’est vrai! s’écria le visaya; tu as du
talent..... comment se fait-il que tu sois garde civil? [395]
—Je ne l’ai pas toujours été; autrefois
j’étais contrebandier! répondit le tagal avec
jactance.
Mais une autre ombre attira leur attention. Ils
l’arrêtèrent d’un qui vive? et
l’amenèrent aussi à la lumière. Cette fois,
c’était Elias lui-même qui se présentait.
—Où vas-tu?
—Je poursuis, señor, un homme qui a battu et
menacé de tuer mon frère; il a une cicatrice à la
figure et s’appelle Elias...
—Ha? s’écrièrent à la fois les deux
gardes, et ils se regardèrent épouvantés, puis se
mirent à courir dans la direction de l’église, du
côté où, quelques minutes auparavant, José
avait disparu.
[Table des matières]
LIII
Il buon di si conosce da mattina1.
Dès le matin, la nouvelle se répandit dans le pueblo
que, la veille au soir, de nombreuses lueurs avaient brillé dans
le cimetière.
Le chef de la V. O. T. parlait de cierges allumés et
décrivait leur forme et leur grosseur, mais il
n’était pas bien certain du nombre, il en avait seulement
compté plus de vingt.
Sœur Sipa, de la Confrérie du Très Saint
Rosaire, ne pouvait tolérer qu’un membre de
l’Association rivale pût seul se vanter d’avoir vu
cet effet de la grâce de Dieu; Sœur Sipa, donc, bien
qu’elle n’habitât pas près de là, avait
entendu des lamentations et des gémissements, elle avait
même cru reconnaître les voix de certaines personnes avec
qui autrefois... mais, par charité chrétienne, non
seulement elle leur pardonnait [396]mais même elle priait pour elles et
taisait leurs noms, ce qui la faisait incontinent déclarer
sainte par tout l’entourage. Sœur Rufa en
vérité n’avait pas l’oreille aussi fine, mais
elle ne pouvait souffrir que Sœur Sipa eût entendu quelque
chose et elle rien; aussi avait-elle eu un songe dans lequel lui
étaient apparues non seulement des personnes mortes mais encore
des vivantes; les âmes en peine demandaient une part de ses
indulgences, notées régulièrement et
thésaurisées. Elle pourrait dire les noms aux familles
intéressées, ne demandant qu’une petite
aumône pour secourir le Pape dans ses
nécessités.
Un petit gamin, pasteur de son métier, qui se risqua à
déclarer n’avoir vu rien de plus qu’une
lumière et deux hommes coiffés de salakots eut peine
à échapper aux insultes et aux coups de bâton. Il
eut beau jurer, seuls ses carabaos étaient avec lui et auraient
pu parler.
—Tu vas peut-être en savoir plus long que le
zélateur et les Sœurs, paracmason2, hérétique? lui
disait-on en le regardant avec de mauvais yeux.
Le curé monta en chaire et recommença à
prêcher sur le Purgatoire; les pesos aussitôt sortirent de
leurs cachettes pour payer des messes.
Mais laissons là les âmes en peine et écoutons
la conversation de D. Filipo et du vieux Tasio, malade, dans sa petite
maison solitaire. Depuis quelques jours le philosophe—ou le fou,
comme on voudra—ne quittait pas le lit, prostré par une
faiblesse qui progressait rapidement.
—En vérité, je ne sais si je vous
féliciterai de ce qu’on ait accepté votre
démission; l’autre jour, quand le gobernadorcillo refusa
si impudemment de tenir compte de l’avis de la majorité,
solliciter votre retraite eût été juste; mais
maintenant que vous êtes en lutte avec la garde civile, votre
départ est fâcheux. En temps de guerre on doit rester
à son poste. [397]
—Oui, mais pas quand le général est vendu
à l’ennemi, répondit D. Filipo; vous savez que le
lendemain de la fête le gobernadorcillo a mis en liberté
les soldats que j’avais fait arrêter et qu’il
s’est refusé à toute démarche pour obtenir
justice. Sans l’appui de mon supérieur, je ne puis
rien.
—Vous seul, rien, mais avec les autres, beaucoup. Vous auriez
pu profiter de cette occasion pour donner un exemple aux autres
pueblos. Au dessus de la ridicule autorité du gobernadorcillo,
il y a le droit du peuple; c’était le commencement
d’une bonne leçon et vous n’en avez pas
profité.
—J’aurais été impuissant. Voyez le Sr.
Ibarra, il s’est incliné devant les croyances de la foule;
pensez-vous qu’il croie à l’excommunication?
—Vous n’étiez pas dans la même situation;
le Sr. Ibarra veut semer et, pour semer, il faut se baisser et
obéir à la matière; votre mission était de
secouer et, pour secouer, il ne faut que de la force et de
l’énergie. De plus, la lutte ne devait pas être
dirigée contre le gobernadorcillo; la formule devait être:
contre celui qui abuse de sa force, contre celui qui trouble la
tranquillité publique, contre celui qui manque à son
devoir. Et vous n’auriez pas été seul, le pays
d’aujourd’hui n’est plus le pays d’il y a vingt
ans.
—Le croyez-vous? demanda D. Filipo.
—Ne le voyez-vous pas? répondit le vieillard en se
redressant sur sa couche. Ah! c’est que vous n’avez pas vu
le passé, que vous n’avez pas étudié
l’effet de l’immigration européenne, de
l’introduction des nouveaux livres, des voyages de la jeunesse en
Europe. Examinez et comparez: il est vrai que la Royale et Pontificale
Université de Santo Tomás existe encore avec son
sapientissisme cloître et que quelques intelligences s’y
exercent encore à formuler des distingos et à
utiliser les subtilités de la scolastique; mais où
voyez-vous maintenant cette jeunesse de notre temps,
imprégnée de métaphysique, d’instruction
archéologique, qui, l’encéphale [398]torturé,
mourait en sophistiquant dans un recoin de province, sans avoir
achevé de comprendre les attributs de l’ente, sans
avoir résolu la question de l’esencia et de
l’existencia, concepts élevés sans doute,
mais qui nous faisaient oublier les choses essentielles, notre propre
existence, notre propre entité? Voyez l’enfance
d’aujourd’hui! Pleine d’enthousiasme à la vue
des plus larges horizons, elle étudie l’Histoire, les
Mathématiques, la Géographie, la Littérature, les
Sciences physiques, les Langues, toutes matières dont nous
n’entendions parler qu’avec horreur comme d’autant
d’hérésies; le plus libre penseur de notre
époque n’hésitait pas à les déclarer
inférieures aux catégories d’Aristote et aux lois
du syllogisme. L’homme a compris enfin qu’il est homme; il
renonce à l’analyse de son Dieu, à
pénétrer l’impalpable, à expliquer ce
qu’il n’a pas vu, à donner des lois aux
fantômes créés par son cerveau; il comprend que son
héritage est le vaste monde dont la domination est à sa
portée; las d’un travail inutile et présomptueux,
il baisse la tête et examine ce qui l’entoure. Voyez
maintenant comment naissent nos poètes; les Muses de la Nature
nous révèlent peu à peu leurs trésors et
commencent à nous sourire pour nous enhardir au travail. Les
sciences expérimentales ont déjà donné
leurs premiers fruits: seul le temps les perfectionnera. Les nouveaux
avocats se modèlent suivant la nouvelle philosophie du Droit;
quelques-uns commencent à briller au milieu des
ténèbres qui entourent notre tribune et annoncent un
changement dans la marche des temps. Écoutez ce que dit la
jeunesse, visitez les centres d’enseignement, de nouveaux noms
résonnent sous les voûtes de ces cloîtres où
nous n’entendions citer que ceux de saint Thomas, de Suarez,
d’Amat, de Sanchez et autres idoles de mon temps. En vain, du
haut de la chaire, les moines clament contre la démoralisation
comme clament les vendeurs de poisson au marché contre
l’avarice des acheteurs, sans vouloir remarquer que leur
marchandise [399]est désormais passée et hors
d’usage! En vain les couvents étendent leurs
ramifications, leurs tentacules, pour étouffer partout
l’idée nouvelle qui court; les dieux s’en vont: les
racines de l’arbre peuvent affaiblir les plantes qui
s’appuient sur lui, elles sont impuissantes contre les autres
êtres qui, comme l’oiseau, montent triomphants vers les
cieux.
Le philosophe parlait avec animation, les yeux brillants.
—Cependant, le germe nouveau est bien faible; si tous
s’y efforcent, le progrès, si cher acheté, peut
encore être étouffé, objecta D. Filipo
incrédule.
—L’étouffer! Qui? L’homme, ce nain infirme,
étouffer le Progrès, le fils puissant du temps et de
l’activité? Quand l’a-t-il pu? Le dogme,
l’échafaud et le bûcher tentèrent de
l’arrêter, de le repousser. E pur si muove, disait
Galilée quand les dominicains l’obligeaient à
déclarer que la terre était immobile; c’est aussi
la devise du progrès humain. On violentera quelques
volontés, on sacrifiera quelques individus, qu’importe: le
Progrès poursuivra sa route et le sang de ceux qui sont
tombés fertilisera le sol d’où
s’élèveront de nouveaux rejetons. Voyez! la presse,
si rétrograde qu’elle veuille être, fait aussi sans
le vouloir un pas en avant; les dominicains eux-mêmes
n’échappent pas à cette loi; ils imitent les
jésuites, leurs irréconciliables ennemis, ils donnent des
fêtes dans leurs couvents, élèvent de petits
théâtres, composent des poésies, parce que, comme
ils ne manquent pas d’intelligence bien que se croyant au
XVe siècle, ils comprennent que les jésuites
ont raison s’ils veulent encore prendre part à
l’avenir des peuples jeunes qu’ils ont instruits.
—Selon vous, les jésuites vont avec le progrès?
demanda étonné D. Filipo, pourquoi donc les combat-on en
Europe?
—Je vous répondrai comme le fit un
ecclésiastique ancien, répliqua, en reposant sa
tête sur l’oreiller, le philosophe dont la physionomie
reprit son air moqueur. [400]Il y a trois manières de marcher avec le
Progrès: devant, à côté et derrière;
les premiers le guident, les seconds le suivent, les derniers sont
entraînés; c’est de ceux-là que sont les
jésuites. Ils auraient bien voulu diriger le mouvement, mais
comme ils le voient puissant, animé de tendances contraires aux
leurs, ils capitulent, préférant suivre
qu’être écrasés ou que rester au milieu de la
route, seuls, dans l’ombre. A l’heure actuelle, aux
Philippines, nous suivons la marche générale avec au
moins trois siècles de retard; à peine
commençons-nous à sortir du Moyen-Age; aussi les
jésuites qui, en Europe, sont la réaction, vus
d’ici représentent le Progrès; les Philippines leur
doivent leur instruction naissante, l’introduction des Sciences
Naturelles, âme du XIXe
siècle, de même qu’elles doivent aux dominicains le
Scolasticisme, mort maintenant, en dépit de Léon XIII, car il n’y a pas de Pape qui
puisse ressusciter ce qu’a condamné le sens commun...
Mais, où allons-nous? demanda-t-il en changeant de ton; ah! nous
parlions de l’état actuel des Philippines... Oui, nous
entrons en ce moment dans une période de lutte; vous entrez,
devrais-je dire, car notre génération appartient
déjà à la nuit, nous nous en allons. La lutte est
entre le passé qui s’accroche, se cramponne avec des
malédictions au vacillant château féodal, et
l’avenir dont le chant de triomphe s’entend au loin dans
les splendeurs d’une naissante aurore et qui, des pays lointains,
nous apporte la Bonne-Nouvelle... Qui donc doit tomber et
s’ensevelir sous les ruines de ce qui s’écroule?
Le vieillard se tut, et voyant que D. Filipo le regardait pensif, il
sourit et reprit:
—Je devine presque ce que vous pensez.
—Vraiment?
—Vous pensez que je puis très bien me tromper, dit-il
en souriant tristement; aujourd’ui j’ai la fièvre et
je ne suis pas infaillible: homo sum et nihil humani a me
alienum puto3, disait Térence; mais quelquefois [401]on se
permet de rêver; pourquoi ne pas rêver agréablement
aux dernières heures de la vie? Et puis, je n’ai jamais
vécu que de songes! Vous avez raison; je rêve! nos jeunes
gens ne pensent qu’aux amours et aux plaisirs: ils
dépensent plus de temps et se donnent plus de travail pour
tromper et déshonorer une fille que pour concourir au bien de
leur pays; nos femmes, pour s’occuper de la famille et de la
maison de Dieu, oublient et leur propre famille et leur propre maison;
nos hommes n’ont d’activité que pour le vice,
d’héroïsme que dans la honte; l’enfance se
réveille dans la routine et les ténèbres, la
jeunesse vit ses meilleures années sans idéal, et
l’âge mûr, stérile, ne sert qu’à
corrompre la jeunesse de son exemple... Je me réjouis de
mourir... claudite jam rivos, pueri4.
—Voulez-vous quelque médicament? demanda D. Filipo pour
changer le cours de la conversation en voyant s’assombrir le
visage du malade.
—Ceux qui meurent n’ont pas besoin de
médicaments; mais bien ceux qui restent. Dites à D.
Crisóstomo qu’il vienne me voir demain; j’ai des
choses très importantes à lui dire. D’ici quelques
jours je m’en irai. Les Philippines sont dans les
ténèbres.
Quelques minutes après, D. Filipo, grave et pensif, quittait
la maison du malade.
[Table des matières]
LIV
Quidquid latet, apparebit.
Nîl inultum remanebit1.
La cloche annonce la prière du soir; en entendant le
religieux tintement tous, abandonnant leurs occupations,
s’arrêtent et se découvrent; le laboureur qui
revient [402]des champs suspend son refrain, prend
l’allure compassée du carabao qu’il monte et prie;
les femmes, au milieu de la rue, se signent et remuent les
lèvres avec affectation pour que personne ne doute de leur
dévotion; l’homme cesse de caresser son coq et
récite l’Angelus pour que la chance lui soit
propice; dans les maisons on prie à voix haute, tout bruit qui
n’est pas celui de l’Ave Maria se dissipe,
s’arrête.
Cependant le curé, le chapeau sur la tête, traverse
rapidement la rue au grand scandale de quelques vieilles et, scandale
plus grand encore, c’est vers la maison de l’alférez
qu’il se dirige. Les dévotes croient le moment venu de
suspendre le mouvement de leurs lèvres pour baiser la main du
prêtre, mais le P. Salvi semble ne pas les voir; il ne trouve
aucun plaisir à placer sa main osseuse sous une
chrétienne narine pour, de là, la glisser en cachette
(selon que l’a observé Da. Consolacion) dans le sein
d’une jeune dalaga qui s’incline pour demander la
bénédiction. Une importante affaire doit le
préoccuper pour qu’il oublie ainsi ses propres
intérêts et ceux de l’Eglise!
En effet, il monte précipitamment les escaliers et frappe
avec impatience à la porte de l’alférez; celui-ci
vient ouvrir tout en grondant, suivi de sa douce moitié qui
sourit comme doivent sourire les damnés.
—Ah! Père curé, j’allais aller vous voir,
votre jeune bouc...
—J’ai une chose importante...
—Je ne puis permettre que l’on brise la clôture...
s’il revient, je lui tire dessus!
—Qui sait si demain vous vivrez encore! dit le curé
tout haletant en se dirigeant vers la salle.
—Quoi, vous croyez que cet avorton peut me tuer? Mais
j’en aurai fini d’un coup de pied!
Le P. Salvi recula et instinctivement regarda le pied de
l’alférez.
—De qui parlez-vous? demanda-t-il tremblant.
—De qui puis-je parler sinon de ce blanc bec qui me propose un
duel au revolver à cent pas? [403]
—Ah! respira le curé. Je viens, ajouta-t-il, vous
parler d’une affaire très urgente.
—Laissez-moi avec vos affaires! Serait-ce comme celle des deux
petits sacristains?
Si la lumière n’eût pas été la
pâle lueur d’une lampe à huile tamisant
péniblement à travers la poussière qui recouvrait
le globe, l’alférez aurait vu la pâleur du
curé.
—Aujourd’hui, c’est de la vie de tous qu’il
s’agit! répondit le prêtre à mi-voix.
—Sérieusement! répéta
l’alférez en pâlissant; il tire bien, ce jeune
homme?
—Je ne parle pas de lui.
—Alors?
Le moine lui montra la porte qu’il ferma à sa
manière, d’un coup de pied. Pour l’alférez
les mains étaient superflues; il n’eût rien perdu
à cesser d’être bimane. Du dehors une
imprécation et un rugissement répondirent.
—Brutal! tu m’as fendu le front! cria son
épouse.
—Maintenant, allez-y! dit-il au curé
tranquillement.
Celui-ci le regarda un long moment; puis lui demanda de cette voix
nasale et monotone qu’affectent les prédicateurs:
—Avez-vous vu comme je courais en venant?
—Redios! je croyais que vous aviez la colique!
—Eh bien! continua le P. Salvi sans se soucier de la
grossièreté de l’alférez; quand je manque
ainsi à mon devoir, c’est qu’il y a de graves
motifs.
—Et lesquels donc? Parlez!
Et l’officier frappa le sol d’un nouveau coup de
pied.
—Du calme!
—Alors, pourquoi courir si vite?
Le curé s’approcha de lui et mystérieusement lui
demanda:
—Ne... savez... vous... rien de nouveau?
L’alférez haussa les épaules.
—Vous avouez ne savoir absolument rien.
[404]
—Vous voulez me parler d’Elias, que cette nuit votre
sacristain principal a caché?
—Non, je ne m’occupe pas en ce moment de ces histoires,
répondit le curé avec mauvaise humeur; je parle
d’un grand péril.
—Eh bien, p.....! finissez-en, alors!
—Allez, dit le moine lentement avec quelque dédain;
vous verrez une fois de plus de quelle importance nous sommes, nous
autres, religieux; le dernier frère lui vaut un régiment,
un curé donc...
Et baissant la voix, avec grand mystère:
—J’ai découvert une grande conspiration.
L’alférez fit un saut et, stupéfait, regarda le
curé.
—Une conspiration terrible et bien ourdie qui doit
éclater ce soir même.
—Ce soir même! s’écria
l’alférez en s’élançant d’abord
vers le P. Salvi; puis il courut à son revolver et à son
sabre pendus au mur.
—Qui faut-il arrêter? qui? criait-il.
—Calmez-vous; il est encore temps grâce à la
hâte que j’ai mise à vous avertir;
jusqu’à huit heures...
—Je les fusille tous!
—Ecoutez! Tantôt, une femme dont je ne dois pas dire le
nom (c’est un secret de confession) s’est approchée
de moi et m’a tout découvert. A huit heures ils
s’empareront du quartier par surprise, mettront à sac le
couvent, s’empareront de la falua2 et nous assassineront avec tous
les Espagnols.
L’alférez était anéanti.
—La femme ne m’a rien dit de plus que ceci, ajouta le
curé.
—Elle n’a rien dit de plus? Mais je
l’arrête!
—Je ne puis le permettre: le tribunal de la pénitence
est le trône du Dieu des miséricordes.
—Il n’y a ni Dieu ni miséricordes qui tiennent!
je l’arrête!
—Perdez-vous la tête? Ce que vous avez à faire,
c’est [405]de vous préparer; armez silencieusement
vos soldats et placez-les en embuscade; envoyez-moi quatre gardes pour
le couvent et avertissez ceux de la falua.
—La falua n’est pas là. Je vais demander du
renfort aux autres sections.
—Non, car on le remarquerait et on ne poursuivrait pas ce qui
se trame. Ce qu’il faut, c’est que nous les prenions
vivants et les fassions chanter; je veux dire, que vous les fassiez
chanter; moi, en ma qualité de prêtre, je ne puis me
mêler de ces affaires. Attention! vous pouvez y gagner des croix
et des galons; tout ce que je vous demande c’est de faire
constater que je vous ai prévenu.
—On le constatera, Père, on le constatera, et
peut-être cela décrochera-t-il une mitre! répondit
l’alférez radieux en contemplant les manches de son
uniforme.
—Surtout, envoyez-moi les quatre gardes
déguisés; eh? de la discrétion! Ce soir à
huit heures les étoiles et les croix vont pleuvoir.
Pendant que se déroulait cette conversation, un homme courait
vers la maison d’Ibarra et, en hâte, montait les
escaliers.
—Le señor est là? demanda la voix d’Elias
au domestique.
—Il est dans son cabinet, il travaille.
Pour distraire son impatience en attendant l’heure où
il pourrait avoir une explication avec Maria Clara, Crisóstomo
s’était mis à travailler dans son laboratoire.
—Ah, c’est vous, Elias! s’écria le jeune
homme; je pensais à vous; hier, j’avais oublié de
vous demander le nom de cet Espagnol chez qui travaillait votre
grand-père...
—Señor, il ne s’agit pas de moi...
—Voyez, continua Ibarra qui, sans remarquer l’agitation
d’Elias, approcha de la flamme un morceau de bambou; j’ai
fait une grande découverte: ce bois est incombustible... [406]
—Ce n’est pas de bambou qu’il est question en ce
moment, señor; il s’agit de prendre vos papiers et de fuir
avant une minute.
Surpris, Ibarra regarda Elias. En voyant la gravité de son
visage, l’objet qu’il tenait lui échappa des
mains.
—Brûlez tout ce qui peut vous compromettre et que,
d’ici une heure, vous ayez trouvé un endroit plus
sûr!
—Mais, pourquoi?
—Mettez en sûreté ce que vous avez de plus
précieux...
—Pourquoi?
—Brûlez tout papier écrit par vous ou pour vous,
le plus innocent peut être mal interprété...
—Mais pourquoi, enfin?
—Pourquoi? parce que je viens de découvrir une
conspiration que l’on vous attribue pour vous perdre.
—Une conspiration? Et qui la trame?
—Il m’a été impossible d’en trouver
l’auteur; je viens à l’instant de causer avec un des
malheureux payés pour cela et que je n’ai pu
dissuader.
—Et cet homme ne vous a pas dit qui l’avait
payé?
—Si, en exigeant le secret il m’a dit que
c’était vous.
—Mon Dieu! s’écria Ibarra et il resta
atterré.
—Señor, ne doutez pas, ne perdons pas de temps,
peut-être la conjuration doit-elle éclater ce soir
même!
Ibarra, les yeux démesurément ouverts, la tête
dans les mains, semblait ne pas entendre.
—Le coup ne peut être paré, continua Elias; je
suis arrivé tard, je ne connais pas leurs chefs ... sauvez-vous,
señor, conservez-vous pour votre pays!
—Où fuir! On m’attend ce soir!
s’écria le jeune homme en pensant à Maria
Clara.
—Dans un autre pueblo quelconque, à Manille, chez
quelque autorité, mais ailleurs, que l’on ne dise pas que
vous dirigiez le mouvement!
—Et, si moi-même je dénonçais la
conspiration? [407]
—Vous, dénoncer? s’écria Elias le
regardant et reculant d’un pas; vous passeriez pour traître
et lâche aux yeux des conspirateurs et les autres vous
tiendraient pour trop habile ou trop prudent; on dirait que vous aviez
tendu un piège à de pauvres égarés pour
vous en faire mérite; on dirait...
—Mais que faire?
—Je vous l’ai déjà dit: détruire
tous les papiers que vous avez et qui vous touchent, fuir et attendre
les événements...
—Et Maria Clara? s’écria Crisóstomo; non,
mieux vaut mourir!
Elias se tordait les mains:
—Eh bien! dit-il, évitez au moins le coup,
préparez-vous pour quand on vous accusera!
Ibarra regarda autour de lui l’air affolé.
—Alors, aidez-moi; ici, dans ces pupitres, j’ai les
lettres de ma famille; choisissez celles de mon père qui, cette
fois, pourraient me compromettre. Lisez les adresses.
Et le jeune homme, étourdi, anéanti, ouvrait et
fermait des tiroirs, choisissait des papiers, lisait en hâte des
lettres, rejetait les unes, gardait les autres, tirait des livres, les
feuilletait, etc. Elias faisait de même avec moins de trouble
mais autant de hâte; tout d’un coup il
s’arrêta, ses yeux se dilatèrent; il tourna et
retourna un papier dans sa main, puis d’une voix tremblante:
—Votre famille connaissait D. Pedro Eibarramendia?
—Certainement! répondit Ibarra en ouvrant un tiroir
dont il sortit un monceau de papier, c’était mon
bisaïeul!
—Votre bisaïeul, D. Pedro Eibarramendia? insista Elias,
livide, l’air altéré.
—Oui, répondit Ibarra distrait; nous avons coupé
ce nom qui était très long.
—Il était basque? répéta Elias en
s’approchant de lui. [408]
—Basque, oui, mais qu’avez-vous? demanda
Crisóstomo surpris.
Elias ferma le poing, l’appuya contre son front et regarda
Crisóstomo qui recula en voyant l’expression de sa
figure.
—Savez-vous qui était D. Pedro Eibarramendia?
interrogea-t-il entre ses dents. D. Pedro Eibarramendia est ce
misérable qui a calomnié mon grand-père et
causé tout notre malheur... Je cherchais son nom, Dieu vous
livre à moi... vous allez me rendre compte de nos malheurs!
Crisóstomo anéanti le regarda, mais Elias lui secoua
le bras et d’une voix amère où rugissait la
haine:
—Regardez-moi bien voyez si j’ai souffert; et vous
vivez, et vous aimez, vous avez de la fortune, un foyer, on vous
estime, vous vivez... vous vivez!
Et hors de lui, il courut vers une petite collection d’armes;
mais à peine avait-il arraché deux poignards qu’il
les laissa tomber, regarda comme un fou Ibarra qui restait
immobile:
—Qu’allais-je faire? murmura-t-il, et il s’enfuit
hors de la maison.
[Table des matières]
LV
La catastrophe
Dans la salle à manger Capitan Tiago, Linares et la tante
Isabel dînaient; du salon, l’on entendait le bruit des
assiettes et des couverts. Maria Clara avait dit n’avoir pas faim
et s’était assise au piano, accompagnée de la
joyeuse Sinang qui lui murmurait à l’oreille de
mystérieuses phrases, tandis que le P. Salvi inquiet se
promenait de long en large.
Ce n’était pas que la convalescente n’eût
pas faim, non; mais elle attendait quelqu’un et profitait du
moment [409]où son Argus ne pouvait être
là: c’était l’heure de dîner pour
Linares.
—Tu vas voir que ce fantôme va rester
jusqu’à huit heures, murmura Sinang en montrant le
curé; à huit heures il doit venir. Celui-ci est
aussi amoureux que Linares.
Maria Clara regarda son amie avec épouvante. Celle-ci, sans
le remarquer, continua avec son terrible babillage.
—Ah! je sais pourquoi il ne s’en va pas malgré
les pointes que je lui lance: il ne veut pas dépenser de
lumière chez lui! Sais-tu? depuis que tu es tombée
malade, les deux lampes qu’il faisait allumer se sont de nouveau
éteintes... Mais, regarde-le, quels yeux et quelle figure!
En ce moment, l’horloge de la maison sonna huit heures. Le
curé frissonna et s’assit à l’écart,
dans un coin.
—Il vient! dit Sinang à Maria Clara, le voilà,
écoute! et elle lui pinça le bras.
Mais le premier coup de huit heures sonnant à
l’église: tous se levèrent pour prier. D’une
voix faible et tremblante le P. Salvi dit la consécration mais,
chacun étant absorbé par ses propres pensées,
personne ne s’occupa de lui.
A peine la prière terminée, Ibarra entra. Il
était triste et ses habits rigoureusement noirs semblaient moins
endeuillés que sa figure; Maria Clara surprise, se leva, fit un
pas pour l’interroger, le bruit d’une fusillade lui coupa
la parole. Muet, les yeux hagards, Ibarra resta cloué sur place,
le curé courut se cacher derrière un pilier. Du
côté du couvent, on entendit de nouveaux coups de feu,
puis des cris, des clameurs. En même temps, Capitan Tiago, tante
Isabel, Linares entrèrent en criant: tulisan, tulisan!
suivis d’Andeng qui, brandissant une broche, venait rejoindre sa
sœur de lait.
Tante Isabel tomba à genoux et, larmoyante, se mit à
réciter le Kyrie eleison; pâle, à demi-mort
de frayeur, [410]Capitan Tiago emporta au bout d’une
fourchette le foie d’une poule qu’il offrit en pleurant
à la Vierge d’Antipolo; Linares, la bouche pleine,
s’armait d’une cuiller; Sinang et Maria Clara
s’embrassaient, seul Crisóstomo restait immobile, comme
pétrifié, plus blanc qu’un mort.
Les cris, le tumulte continuaient, les fenêtres se fermaient
en claquant, d’instant en instant on entendait
l’éclat d’un coup de feu.
—Christe eleyson! Santiago, c’est la
prophétie qui s’accomplit... ferme les fenêtres!
gémit la tante Isabel.
—Cinquante grandes bombes et deux messes d’actions de
grâce! répliqua Capitan Tiago. Ora pro nobis!
Peu à peu tout retomba dans un silence terrible... On
entendait la voix de l’alférez criant en courant.
—Père curé! P. Salvi!! Venez!
—Miserere! L’alférez demande la
confession! s’écria la tante Isabel.
—L’alférez est blessé! demanda enfin
Linares. Ah!!!
Et la santé parut lui revenir.
—Père curé, venez! il n’y a plus rien
à craindre! cria de nouveau l’alférez.
Tout bouleversé encore, Fr. Salvi se décida enfin
à sortir de sa cachette; il descendit les escaliers.
—Les tulisanes ont tué l’alférez! Maria,
Sinang, dans votre chambre, barricadez bien la porte! Kyrie
eleison!
Ibarra, lui aussi, se dirigea vers les escaliers, malgré la
bonne tante qui, se souvenant qu’elle avait été
très amie de sa mère, ne voulait pas le laisser sortir
qu’il ne se fût confessé.
Il était dans la rue: bouleversé, il lui parut que
tout tournait autour de lui, ses oreilles bourdonnaient, ses jambes se
mouvaient avec peine, des flots de sang, des lueurs
entremêlées de ténèbres passaient dans ses
yeux.
La rue était déserte, la lune brillait splendide au
ciel [411]et cependant ses pieds trébuchaient
contre chaque pierre, contre chaque morceau de bois.
Près du quartier, baïonnette au fusil, des soldats
parlaient avec animation, ils ne l’aperçurent pas.
Dans le tribunal on entendait des cris, des coups, des plaintes, des
malédictions; la voix de l’alférez surpassait et
dominait tout.
—Au cepo1! Les menottes! Deux coups de feu à qui bouge!
Aujourd’hui ni personne ni Dieu ne passe! Capitan, ce n’est
pas le moment de dormir.
Ibarra pressa le pas vers sa maison: ses domestiques
l’attendaient, inquiets.
—Sellez le meilleur cheval et allez dormir! leur dit-il.
Il entra dans son cabinet et, à la hâte, voulut
préparer une valise. Il ouvrit un coffre de fer, prit tout
l’argent qui s’y trouvait et le mit dans un sac. Il se
munit de ses bijoux, n’oublia pas un portrait de Maria-Clara et
se dirigea vers une armoire où étaient renfermés
ses papiers.
En ce moment, trois coups secs et forts résonnèrent
à la porte.
—Qui est là? demanda-t-il d’une voix lugubre.
—Ouvrez, au nom du Roi, ouvrez de suite ou nous
enfonçons la porte! répondit en espagnol une autre voix
impérieuse.
Ibarra jeta un coup d’œil vers la fenêtre: son
regard s’alluma, il arma son revolver; mais, changeant
d’idée, il jeta ses armes et s’avança vers la
porte qu’il ouvrit lui-même, au moment où arrivaient
ses domestiques.
Trois gardes se saisirent immédiatement de lui.
—Je vous fais prisonnier, au nom du Roi! dit le sergent.
—Pourquoi?
—On vous le dira là-bas; il m’est défendu
de parler.
Le jeune homme réfléchit un moment, et ne voulant pas
que les soldats découvrissent ses préparatifs de fuite,
il prit un chapeau et leur dit: [412]
—Je suis à votre disposition! Je suppose que ce ne sera
pas pour longtemps.
—Si vous me promettez de ne pas vous échapper, nous
vous laisserons les mains libres; l’alférez vous fait
cette faveur; mais si vous essayez de fuir...
Ibarra les suivit laissant ses serviteurs consternés.
Pendant ce temps, qu’avait fait Elias?
En sortant de la maison de Crisóstomo, il courut comme un
fou, sans savoir où il allait. Violemment agité, il
traversa les champs et arriva au bois; il fuyait les hommes, les
maisons, il fuyait la lumière, la lune même le faisait
souffrir, il s’enfonça sous les arbres dans l’ombre
mystérieuse. Là, tantôt s’arrêtant,
tantôt parcourant des sentiers inconnus, tantôt grimpant
entre les broussailles, il regardait vers le pueblo qui, là-bas,
se baignait dans la lumière de la lune, s’étendait
dans la plaine, comme incliné vers le rivage du lac aux eaux
tranquilles. Les oiseaux, réveillés de leur sommeil,
voletaient; de gigantesques chauves-souris, des chouettes, des hiboux
passaient d’une branche à l’autre, le saluant de
leurs cris stridents, le regardant de leurs gros yeux arrondis. Elias
ne les voyait pas, ne s’occupait pas d’eux. Il
s’imaginait que les ombres irritées de ses ancêtres
le suivaient; il voyait pendu à chaque branche le terrible
panier contenant la tête ensanglantée de Bálat,
telle que la lui avait dépeinte son père; il croyait
trébucher au pied de chaque arbre contre le cadavre refroidi de
sa propre grand’mère, il lui semblait que se
balançait parmi les ombres le squelette pourri de son aïeul
infâme;.... et le squelette, et le cadavre, et la tête
sanglante lui criaient: lâche, lâche!
Il s’enfuit, il abandonna la montagne et redescendit vers la
plage sur laquelle il erra fiévreux; mais ses yeux vagues se
fixaient là-bas vers un point de la surface tranquille et voici
qu’entourée par les reflets de la lune comme d’un
nimbe argenté, une ombre s’élève, comme
bercée par le flot. Il lui semble la reconnaître! Mais
oui, ce sont ses cheveux épars si longs et si beaux; [413]mais oui,
c’est sa poitrine trouée d’un coup de poignard,
c’est elle, c’est sa sœur!
Et le malheureux, à genoux sur le sable, tend les bras vers
la vision chérie:
—Toi! toi aussi! s’écrie-t-il.
Le regard inébranlablement attaché sur
l’apparition, il se relève, s’avance, entre dans
l’eau, descend la douce pente du banc de sable;
déjà il est loin de la rive, la vague lui arrive à
la ceinture, il s’avance, il s’avance encore,
fasciné. Il a de l’eau jusqu’à la poitrine,
qu’importe, s’en aperçoit-il seulement?... Soudain,
une détonation déchire l’air; grâce au calme,
au silence de la nuit, le bruit des coups de feu arrive clair et
distinct jusqu’à lui. Il s’arrête,
écoute, se souvient... et la vision s’efface, et le
rêve s’enfuit. Il remarque qu’il est dans
l’eau; le lac est tranquille, il distingue les lumières
des pauvres cabanes de pêcheurs.
Il a repris conscience de la réalité, s’en
retourne vers la rive et se dirige vers le pueblo. Pourquoi? Il
n’en sait rien.
San Diego est désert. Les maisons sont fermées; les
animaux eux-mêmes se taisent, les chiens n’envoient point
à la lune leur ordinaire sérénade, craintifs, ils
se sont cachés tout au fond de leurs niches. La lumière
argentée qui inonde les rues et détache vigoureusement
les ombres semble augmenter encore la tristesse de cette solitude.
Craignant de rencontrer des gardes civils, il s’était
caché dans les jardins et les enclos qui entourent les
habitations; un moment il crut distinguer dans une de ces
huertas deux formes humaines; sans chercher à les
reconnaître, il poursuivit sa route, escaladant murs et haies,
arrivant ainsi—au prix de quels efforts!—à
l’autre bout du pueblo d’où il courut vers la maison
d’Ibarra. Sur la porte, les domestiques se lamentaient,
commentant l’arrestation de leur maître.
Il s’informa de ce qui s’était passé, fit
semblant de s’éloigner puis, passant derrière la
maison, il franchit [414]le mur, grimpa par une fenêtre et
pénétra dans le cabinet où brûlait encore la
bougie qu’y avait laissée Crisóstomo.
Il vit les livres, les papiers; trouva les armes, les petits sacs
renfermant l’argent et les bijoux; promptement il reconstitua ce
qui s’était passé; ne voulant pas laisser tant de
papiers qui pouvaient être compromettants, il songea à les
prendre, à les emporter par la fenêtre et à les
enterrer.
Il regarda vers le jardin et vit reluire des casques et des
baïonnettes: c’étaient deux gardes civils
accompagnés d’un adjudant.
Sa résolution fut vite prise: il mit en tas au milieu du
cabinet les effets et les papiers, vida sur le tout une lampe à
pétrole et mit le feu avec la bougie. Puis, s’emparant
précipitamment des armes, il aperçut le portrait de Maria
Clara, hésita... le mit dans un des petits sacs et, emportant le
tout, sauta par la fenêtre.
Il était temps; les gardes civils forçaient
l’entrée.
—Laissez-nous monter pour saisir les papiers de votre
maître, disait l’adjudant.
—Avez-vous la permission? Sinon, vous ne monterez pas,
répondait un vieillard.
A coups de crosse, les soldats chassèrent ces fidèles
serviteurs et montèrent l’escalier... mais une
épaisse fumée envahit toute la maison, puis de
gigantesques langues de feu sortirent du cabinet.
—Au feu! au feu! crièrent à la fois domestiques
et soldats.
Tous se précipitèrent pour essayer de sauver quelque
chose, mais la flamme avait gagné le petit laboratoire;
quelques-uns des produits chimiques qui s’y trouvaient firent
explosion; les gardes civils durent reculer; l’incendie
mugissant, menaçait de leur fermer le passage; en vain, on tira
de l’eau du puits, en vain tous criaient, demandaient du secours,
ils étaient isolés. Les autres appartements
brûlaient à leur tour et la flamme s’élevait
vers le ciel accompagnée de grosses [415]spirales de fumée. Toute
la maison était sa prisonnière; quelques paysans des
environs accouraient contempler l’épouvantable foyer et
l’effondrement de ce vieil édifice si longtemps
respecté par les éléments.
[Table des matières]
LVI
Ce que l’on dit et ce que l’on
croit
Enfin, Dieu se manifesta au pueblo terrorisé.
La rue où se trouvent le quartier et le tribunal était
encore déserte et solitaire; aucune maison ne donnait signe de
vie. Cependant le volet d’une fenêtre s’ouvrit avec
éclat, une tête d’enfant apparut, regardant de tous
côtés, tendant le cou, se tournant et se retournant...
plas! c’est le brusque contact d’un cuir tanné
avec une fraîche peau humaine; la bouche de l’enfant fit la
moue, ses yeux se fermèrent, il disparut et la fenêtre se
retrouva close.
L’exemple n’en était pas moins donné. Le
double bruit du volet avait été entendu; une autre
fenêtre s’ouvrit avec précaution, la tête
d’une vieille, ridée, édentée, s’y
risqua en se dissimulant: c’était cette même
sœur Puté qui avait causé un si grand tumulte
pendant le sermon du P. Dámaso. Enfants et vieilles femmes sont
les représentants de la curiosité sur la terre: les
premiers cherchent les occasions de savoir, les secondes de se
souvenir.
Sans doute, personne ne se risque à gifler la vertueuse
vieille car elle reste, regarde au loin en fronçant les
sourcils, se rince la bouche, crache avec bruit et fait le signe de la
croix. La maison d’en face ouvre alors une timide lucarne qui
donne passage à sœur Rufa, celle qui ne veut ni tromper ni
qu’on la trompe. Toutes deux se regardent un moment, sourient, se
font des gestes et se signent derechef. [416]
—Jésus! on aurait dit d’une messe d’actions
de grâce avec feu d’artifice! dit sœur Rufa.
—Depuis le sac du pueblo par Bálat, je n’ai pas
vu pareille nuit, répondit sœur Puté.
—Que de coups de feu! On dit que c’est la bande du vieux
Pablo.
—Des tulisanes? Ce n’est pas possible. On dit que ce
sont les cuadrilleros contre les gardes civils. C’est pour cela
que D. Filipo est arrêté.
—Sanctus Deus! on dit qu’il y a au moins quatorze
morts.
D’autres fenêtres se sont ouvertes, différents
visages se sont montrés échangeant des saluts et des
commentaires.
A la lumière du jour, qui promet d’être
splendide, on voit au loin, confusément, des soldats aller et
venir comme de grises silhouettes.
—C’est un autre mort! dit une voix.
—Un? j’en vois deux?
—Et moi... mais enfin, savez-vous ce que c’était?
demanda un homme sur la figure duquel se lisait la fourberie.
—Oui, les cuadrilleros!
—Non, señor, une révolte dans le quartier.
—Quelle révolte? le curé contre
l’alférez?
—Mais non, rien de tout cela, dit celui qui avait posé
la question; ce sont les Chinois qui se sont soulevés.
Et il referma sa fenêtre.
—Les Chinois! répètent tous avec le plus grand
ennui.
—C’est pour cela qu’on n’en voit pas un!
—Ils sont tous morts.
—Moi, je me doutais bien qu’ils allaient faire quelque
coup. Hier...
—Moi je le voyais! Le soir...
—Quel malheur! s’écriait la Rufa. Ils sont tous
morts avant la Noël, c’est le moment où ils font
leurs cadeaux... s’ils avaient attendu le jour de l’an...
[417]
La rue s’animait peu à peu; d’abord ce furent les
chiens, les poules, les porcs et les pigeons qui commencèrent
à circuler; puis quelques gamins déloquetés les
suivirent, se prenant par le bras et timidement s’approchant du
quartier; quelques vieilles vinrent ensuite, un mouchoir autour de la
tête, noué sous le menton; un gros chapelet à la
main, faisant semblant de prier pour ne pas être
repoussées par les soldats. Quand il fut certain que l’on
pouvait aller et venir sans risquer de recevoir un coup de feu, les
hommes commencèrent à sortir, affectant
l’indifférence; d’abord leurs promenades se
limitèrent à la façade de leur maison; puis, tout
en caressant leur coq, ils tentèrent d’aller plus loin,
revenant de temps en temps sur leurs pas, et ainsi ils
arrivèrent jusque devant le tribunal.
De quart d’heure en quart d’heure, d’autres
versions circulaient. Ibarra avec ses domestiques avait voulu enlever
Maria Clara et Capitan Tiago l’avait défendue, aidé
de la garde civile.
Le nombre des morts n’était pas de quatorze mais de
trente; Capitan Tiago était blessé et partait à
l’instant même pour Manille avec sa fille et sa
sœur.
L’arrivée de deux cuadrilleros, portant un brancard sur
lequel était étendue une forme humaine, et suivis
d’un garde civil produisit une grande sensation. On supposa
qu’ils venaient du couvent; par la forme des pieds qui pendaient,
l’un essaya de deviner qui ce pouvait être, un peu plus
loin on dit qui c’était; plus loin encore le mort se
multiplia renouvelant le miracle de la Sainte Trinité; puis ce
fut le miracle des pains et des poissons qui se réédita
et le nombre des morts s’éleva à trente et un.
A sept heures et demie, quand des pueblos voisins arrivèrent
d’autres gardes civiles, la version qui rencontrait le plus de
crédit était claire et détaillée.
—J’arrive du tribunal où j’ai vu
prisonniers D. Filipo et D. Crisóstomo, disait un homme à
sœur Puté; j’ai parlé à l’un des
cuadrilleros de garde. Eh bien! Bruno, [418]le fils de celui qui est mort
bâtonné, a tout déclaré cette nuit. Comme
vous le savez, Capitan Tiago marie sa fille avec le jeune Espagnol; D.
Crisóstomo, offensé, voulut se venger et projeta de
massacrer tous les Espagnols, même le curé; hier soir ils
ont attaqué le quartier et le couvent; heureusement, par la
miséricorde de Dieu, le curé était chez Capitan
Tiago. On dit que beaucoup se sont sauvés. Les gardes civils ont
brûlé la maison de D. Crisóstomo et, si on ne
l’avait pas arrêté avant, ils l’auraient
brûlé aussi.
—Ils ont brûlé la maison?
—Tous les domestiques sont arrêtés. Voyez,
d’ici on distingue encore la fumée! dit le narrateur en
s’approchant de la fenêtre; ceux qui viennent de
là-bas, racontent des choses bien tristes.
Tous regardèrent vers l’endroit indiqué: une
légère colonne de fumée montait lentement vers le
ciel. Et les commentaires d’abonder, plus ou moins empreints de
pitié, plus ou moins accusateurs.
—Pauvre jeune homme! s’écria un vieillard, le
mari de la Puté.
—Oui! répondit celle-ci; mais remarque qu’hier il
n’a pas commandé de messe pour l’âme de son
père et, sans doute, elle en avait besoin plus que les
autres.
—Mais, femme, n’as-tu pas pitié...?
—De pitié pour les excommuniés? C’est
péché d’en avoir pour les ennemis de Dieu, disent
les curés. Vous rappelez-vous? il courait dans le
cimetière comme dans un enclos!
—Mais, si l’enclos et le cimetière se
ressemblent! répondit le vieillard; il est vrai que dans
celui-ci il n’entre que des animaux d’une seule
espèce...
—Allons! lui cria sœur Puté: tu vas encore
défendre celui que Dieu a puni si clairement. Tu verras
qu’on t’arrêtera, toi aussi. Tu soutiens une maison
qui tombe!
Le mari se tut; l’argument avait porté.
—Oui! poursuivit la vieille; après avoir frappé
le [419]P.
Dámaso, il ne lui restait plus qu’à tuer le P.
Salvi.
—Mais tu ne peux pas nier qu’il était bon quand
il était enfant.
—Oui, il était bon, répliqua la vieille, mais il
est allé en Europe, et tous ceux qui s’en vont en Europe
en reviennent hérétiques, disent les curés.
—Ohoy! lui répliqua le mari qui tenait sa revanche; et
le curé, et tous les curés, et l’Archevêque,
et le Pape, et la Vierge, ils ne sont pas d’Espagne? Quoi!
seraient-ils aussi hérétiques? quoi!
Heureusement pour sœur Puté, l’arrivée
d’une servante qui accourait, effarée, pâle, coupa
court à la discussion.
—Un pendu dans le jardin du voisin! disait-elle haletante.
—Un pendu! s’écrièrent-ils tous, pleins de
stupeur.
Les femmes se signèrent; personne ne pouvait bouger.
—Oui, señor, continua la servante encore frissonnante;
j’étais allée cueillir des pois... je regarde dans
le jardin du voisin pour voir s’il y était... je vois un
homme se balancer; je crus que c’était Teo, le domestique,
qui me donne toujours... je m’approche pour... cueillir des pois,
et je vois que ce n’est pas lui mais un autre, un mort; je cours,
je cours et...
—Allons le voir, dit le vieux en se levant; conduis-nous.
—N’y va pas! lui cria sœur Puté en le
saisissant par la chemise; il va t’arriver malheur! il
s’est pendu? eh bien! tant pis pour lui!
—Laisse-moi le voir, femme; toi, Juan, cours au tribunal pour
prévenir; peut-être n’est-il pas encore mort.
Et il s’en fut au jardin, suivi de la servante qui se cachait
derrière lui; les femmes et sœur Puté
elle-même venaient ensuite, pleines de crainte mais aussi de
curiosité.
—Il est là-bas, señor! et la servante
désigna du doigt un santol1. [420]
Le groupe s’arrêta à distance respectable,
laissant le vieillard s’avancer seul.
Pendu à une branche du santol, un corps humain se
balançait doucement sous l’impulsion de la brise. Le brave
homme l’examina: les pieds, les bras étaient
déjà rigides, les vêtements tachés, la
tête inclinée.
—Nous ne devons pas y toucher jusqu’à
l’arrivée de la justice, dit le vieillard à voix
haute; il est déjà roide, il y a longtemps qu’il
est mort.
Peu à peu, les femmes s’approchèrent.
—C’est le voisin; il habitait cette petite maison; il
était arrivé il y a quinze jours; voyez sa cicatrice
à la figure.
—Ave Maria! s’écrièrent quelques
femmes.
—Prions-nous pour son âme? demanda une jeune, quand elle
eut achevé de le regarder sous toutes les faces.
—Sotte, hérétique! lui répondit avec
colère la sœur Puté; ne sais-tu pas ce qu’a
dit le P. Dámaso? C’est tenter Dieu de prier pour un
damné; celui qui se suicide se damne sans rémission,
c’est pour cela qu’on ne l’enterre pas en terre
sainte.
Et elle ajouta:
—Je me doutais bien que cet homme finirait mal, on n’a
jamais pu savoir de quoi il vivait.
—Je l’ai vu causer deux fois avec le sacristain
principal, observa une jeune fille.
—Ce n’était pas pour se confesser ni pour
commander une messe!
Les voisins accouraient: un cercle nombreux entourait le cadavre qui
se balançait toujours. Au bout d’une demi-heure les
autorités arrivèrent: un alguazil, le directorcillo et
deux cuadrilleros. On descendit le cadavre qui fut placé sur un
brancard.
—Les gens sont bien pressés de mourir! dit en riant le
directorcillo tout en déposant la plume qu’il portait
derrière l’oreille.
Il commença son interrogatoire, recueillit la
déclaration [421]de la servante qu’il
s’efforça d’embrouiller, la regardant avec de
mauvais yeux, lui attribuant des paroles qu’elle n’avait
pas dites; la pauvre fille croyant qu’on allait l’envoyer
en prison commença à pleurer et finit par déclarer
qu’elle ne cherchait pas des pois, mais que..... et elle appela
Teo en témoignage.
Pendant ce temps, un paysan coiffé d’un large salakot,
le cou recouvert d’un grand emplâtre, examinait le cadavre
et la corde.
La figure n’était pas plus violacée que le reste
du corps; au-dessus du nœud se voyaient deux égratignures
et deux petites ecchymoses; les traces de la corde étaient
blanches et ne portaient pas de traces de sang. Le curieux paysan
détaillait avec soin la chemise et le pantalon, il remarqua que
ces vêtements étaient remplis de poussière et
avaient été tout récemment déchirés
en quelques endroits, mais ce qui appela le plus
particulièrement son attention ce furent les semences
d’amores-secos2, plantées jusque dans le cou de la
chemise.
—Que regardes-tu? lui demanda le directorcillo.
—Je regardais, señor, si je pouvais le
reconnaître, balbutia-t-il en se découvrant à demi;
c’est-à-dire en baissant encore plus son salakot.
—Mais, n’as-tu pas entendu que c’est un
nommé José? Tu dormais?
Tous se mirent à rire. Le paysan, confus, balbutia quelques
mots et se retira la tête basse, à pas lents.
—Oy! où vas-tu? lui cria le vieillard; on ne sort pas
par là, on va à la maison du mort.
—Cet homme n’est pas encore réveillé! dit
en se moquant le directorcillo; il n’y a qu’à lui
jeter un peu d’eau.
Les rires éclatèrent de nouveau.
Le paysan abandonna cet endroit où son rôle avait
été si mal jugé et se dirigea vers
l’église. Dans la sacristie, il demanda à causer au
sacristain principal. [422]
—Il dort encore! lui répondit-on grossièrement;
vous ne savez donc pas que cette nuit le couvent a été
attaqué?
—J’attendrai qu’il se réveille.
Les sacristains le regardèrent avec cette
grossièreté particulière aux gens dont
l’habitude est d’être maltraités.
Dans un coin, à l’ombre, le borgne dormait
étendu sur une chaise longue. Ses lunettes étaient
remontées sur le front entre deux longues touffes de poils; la
poitrine nue s’élevait et s’abaissait
régulièrement.
Le paysan s’assit près du dormeur, disposé
à attendre avec patience, mais, ayant laissé tomber une
pièce de monnaie, il dut pour la chercher s’aider
d’une bougie et regarder sous le fauteuil du sacristain. Le
paysan put remarquer que des semences d’amores-secos parsemaient
aussi le pantalon et les manches de la chemise du dormeur qui se
réveilla enfin, frotta son œil unique et, d’assez
mauvaise humeur, reprocha à l’homme de le
déranger.
—Je voulais commander une messe, señor, répondit
celui-ci comme pour se disculper.
—Toutes les messes sont déjà dites, reprit le
borgne en s’adoucissant un peu; si vous voulez pour demain...
c’est pour les âmes du Purgatoire?
—Non, señor, répondit le paysan en lui donnant
un peso.
Et, le regardant fixement, dans son œil unique, il ajouta:
—C’est pour une personne qui va bientôt mourir. Et
il sortit de la sacristie.
—On aurait pu l’enlever cette nuit! dit-il en soupirant
tandis qu’il retirait son emplâtre et se redressait pour
reprendre la figure et la taille d’Elias.
[423]
[Table des matières]
LVII
Væ victis
L’air sinistre, des gardes civils se promènent devant
la porte du tribunal, menaçant de la crosse de leur fusil les
intrépides gamins qui se dressent sur la pointe des pieds ou se
font la courte échelle pour voir à travers les
grilles.
La salle n’a plus le même aspect que le jour où
s’y discutait le programme de la fête; il est maintenant
sombre et peu rassurant. Les gardes civils et les cuadrilleros qui
l’occupent ne prononcent qu’à voix basse de rares et
brèves paroles. Sur la table, le directorcillo, deux greffiers
et quelques soldats entassent des papiers; l’alférez va
d’un côté à l’autre regardant de moment
en moment vers la porte d’un air féroce:
Thémistocle ne devait pas être plus orgueilleux
lorsqu’il se montra aux Jeux Olympiques après la bataille
de Salamine. Dans un coin, laissant voir une gorge noire et une denture
quelque peu abîmée, bâille Da. Consolacion; son
regard se fixe froid et sinistre sur la porte de la prison
qu’ornent d’indécents dessins. Elle avait suivi son
mari qui, amadoué par la victoire, lui permettait
d’assister à l’interrogatoire et aux tortures
s’il y avait lieu. La hyène sentait le cadavre, elle
s’en léchait les babines et chaque minute lui paraissait
longue qui n’annonçait pas le commencement du
supplice.
Le gobernadorcillo avait un air de componction très solennel;
son fauteuil, ce grand fauteuil placé sous le portrait de S. M.,
était vide et paraissait destiné à recevoir une
autre personne.
Il était près de neuf heures quand le curé
arriva, pâle, le front plissé. [424]
—Eh bien! vous ne vous êtes pas fait attendre! lui dit
l’alférez.
—Je préférerais n’être pas
là, répondit le P. Salvi à voix basse, sans faire
cas du ton persifleur de l’officier; je suis très
nerveux.
—Comme personne n’est venu pour ne pas abandonner le
poste, j’ai jugé que votre présence... Vous savez
qu’ils partent tantôt.
—Le jeune Ibarra et le lieutenant principal...?
L’alférez désigna la porte de la prison.
—Il y en a huit ici, dit-il; le Bruno est mort à
minuit, mais sa déclaration avait déjà
été prise.
Le curé salua Da. Consolacion qui répondit d’un
bâillement auquel elle ajouta un: aah! puis il s’assit dans
le fauteuil d’honneur, sous le portrait de S. M.
—Nous pouvons commencer! dit-il.
—Sortez les deux qui sont au cepo! commanda
l’alférez d’une voix qu’il
s’efforça de rendre le plus terrible possible; puis
changeant de ton, il ajouta en se retournant vers le curé:
—On leur a mis en sautant deux trous.
Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les instruments de torture
en usage aux Philippines, nous leur dirons que le cepo est un des plus
innocents. Les trous dans lesquels on introduit les jambes des
détenus sont distants d’environ un palmo1; quand on saute deux trous,
le prisonnier se trouve dans une position un peu forcée, avec
une singulière gêne dans les chevilles, les
extrémités inférieures étant distantes
d’environ une vare2: comme on peut bien le penser, cela ne tue pas de
suite.
Le geôlier, suivi de quatre soldats, tira le verrou et ouvrit
la porte. Une odeur nauséabonde, un air épais et obscur
s’échappa de l’obscurité en même temps
qu’on entendit des plaintes et des sanglots. Un soldat [425]fit flamber
une allumette mais, dans cette atmosphère viciée et
corrompue, la flamme s’éteignit et l’on dut attendre
que l’air se fût renouvelé.
A la vague clarté d’une bougie, se dessinèrent
quelques formes humaines, entourant leurs genoux de leurs bras et
s’y cachant la tête, couchés à plat ventre,
ou bien debout, tournés contre le mur, etc. On entendit des
coups, des cris, des jurons: le cepo s’ouvrit.
Da. Consolation s’inclinait à demi en avant, les
muscles du cou tendus, les yeux saillants cloués sur la porte
entr’ouverte.
Une figure sombre sortit, entre deux soldats, Társilo, le
frère de Bruno. Il avait les menottes aux mains, ses
vêtements déchirés découvraient une
musculature bien développée. Ses yeux se fixèrent
insolemment sur la femme de l’alférez.
—C’est celui qui s’est défendu avec le plus
de bravoure et commanda de fuir à ses compagnons, dit
l’alférez au P. Salvi.
Celui qui vint ensuite avait l’aspect malheureux, il se
lamentait et pleurait comme un enfant; il boitait, son pantalon
était taché de sang.
—Miséricorde, señor, miséricorde! je
n’entrerai plus dans le patio! criait-il.
—C’est un gueux, fit observer l’alférez au
curé, il a voulu fuir, mais il a été blessé
à la cuisse. Ce sont les deux seuls que nous ayons vivants.
—Comment t’appelles-tu? demanda l’alférez
à Társilo.
—Társilo Alasigan.
—Que vous a promis D. Crisóstomo pour que vous
attaquiez le couvent?
—D. Crisóstomo n’a jamais communiqué avec
nous.
—Ne niez pas! C’est pour cela que vous vouliez nous
surprendre.
—Vous vous trompez; vous aviez tué notre père
à coups de bâton, nous l’avons vengé et rien
de plus. Cherchez vos deux compagnons. [426]
L’alférez surpris, regarda le sergent.
—Ils sont là-bas dans un précipice, nous les y
avons jetés hier, ils y pourriront. Maintenant, tuez-moi, vous
ne saurez rien de plus.
Silence et surprise générale.
—Tu vas nous dire quels sont tes autres complices,
menaça l’alférez en brandissant un jonc.
Un sourire de mépris se dessina sur les lèvres de
l’accusé.
L’alférez conversa quelques instants à voix
basse avec le curé, puis, se retournant vers les soldats.
—Conduisez-le où sont les cadavres, ordonna-t-il.
Dans un coin du patio, sur un vieux chariot, cinq cadavres
étaient entassés, à demi-couverts par un morceau
de natte déchirée, pleine de saletés. Un soldat
les gardait, faisant les cent pas, crachant à chaque
instant.
—Les connais-tu? demanda l’alférez en levant la
natte.
Társilo ne répondit pas; il vit le cadavre du mari de
la folle avec deux autres, celui de son frère, criblé de
baïonnettes et celui de José, la corde encore pendue au
cou. Son regard s’assombrit et un soupir parut
s’échapper de sa poitrine.
—Les connais-tu? lui demanda-t-on à nouveau.
Társilo resta muet.
Un sifflement déchira l’air, le jonc frappa ses
épaules. Il frémit, ses muscles se contractèrent.
Les coups se répétèrent, mais Társilo
était toujours impassible.
—Qu’on le bâtonne jusqu’à ce
qu’il crève ou qu’il avoue! cria
l’alférez exaspéré.
—Parle donc! lui dit le directorcillo; de toutes façons
on te tuera.
On le reconduisit dans la salle où l’autre prisonnier
invoquait les saints, claquant des dents et fléchissant sur ses
jambes.
—Connais-tu celui-ci? demanda le P. Salvi.
—C’est la première fois que je le vois!
répondit Társilo en regardant l’autre avec une
certaine compassion. [427]
L’alférez lui donna un coup de poing suivi d’un
coup de pied.
—Attachez-le au banc!
Sans lui ôter les menottes tachées de sang, il fut
attaché à un banc de bois. Le malheureux regarda autour
de lui comme cherchant quelque chose; il vit Da. Consolacion et sourit
sardoniquement. Les assistants surpris le suivirent du regard et virent
la señora, qui se mordait légèrement les
lèvres.
—Je n’ai jamais vu de femme aussi laide!
s’écria Társilo au milieu du silence
général; je préfère me coucher sur un banc
comme celui-ci qu’à côté d’elle comme
l’alférez.
La Muse pâlit.
—Vous allez me tuer à coups de bâton,
señor alférez, continua-t-il; cette nuit, en vous
embrassant, votre femme m’aura vengé.
—Bâillonnez-le! cria l’alférez furieux,
tremblant de colère.
Il paraît que Társilo ne désirait que le
bâillon car, dès qu’il l’eut, ses yeux
lancèrent un éclair de satisfaction.
A un signe de l’alférez, un garde, armé
d’un jonc, commença sa triste tâche.
Tout le corps de Társilo se contracta, un rugissement
étouffé, prolongé, se laissa entendre
malgré le mouchoir qui lui fermait la bouche; il baissa la
tête; ses effets se tachèrent de sang.
Le P. Salvi, pâle, le regard égaré, se leva
péniblement, fit un signe de la main et quitta la salle
d’un pas vacillant. Dans la rue, il vit une jeune fille qui, le
dos appuyé contre le mur, raide, immobile, écoutait
attentive, regardant au loin, les mains crispées contre le vieux
mur. Le soleil l’inondait de lumière. Elle comptait,
semblant ne pas respirer, les coups secs, sourds, suivis de cette
déchirante plainte. C’était la sœur de
Társilo.
Dans la salle, la scène de torture continuait: le malheureux,
[428]exténué de douleur, se tut et
attendit que ses bourreaux se lassassent. Enfin, le soldat haletant
laissa tomber son bras; pâle de colère, sombre,
l’alférez fit un geste et ordonna qu’on
détachât sa victime.
Alors Da. Consolacion se leva et murmura quelques mots à
l’oreille de son mari. Celui-ci hocha la tête en signe
d’intelligence.
—Au puits avec lui! dit-il.
Les Philippins savent ce que cela veut dire; en tagal ils le
traduisent par timbaîn3. Nous ne savons qui a inventé ce
procédé d’instruction judiciaire, mais nous croyons
qu’il doit être assez ancien. La vérité
sortant d’un puits n’en est peut-être qu’une
sarcastique interprétation.
Au milieu du patio du tribunal s’élève la
pittoresque margelle d’un puits, faite grossièrement de
pierres vives. Un rustique assemblage de bambou, en forme de manivelle,
sert pour tirer l’eau, visqueuse, sale, puante. Des vases
cassés, de la vidange, d’autres ordures s’y
mélangent; mais ce puits est comme la prison; il est là
pour recueillir ce que la société rejette comme mauvais
ou inutile, l’objet qui y tombe, quelque bon qu’il ait
été est désormais perdu. Cependant, il ne se
bouchait jamais; parfois on condamnait les prisonniers à le
creuser, à l’approfondir, non parce que l’on croyait
retirer un profit quelconque de cette punition, mais à cause des
difficultés que le travail présentait: le prisonnier qui
y était une fois descendu y gagnait une fièvre dont
régulièrement il mourait.
Társilo contemplait d’un regard fixe tous les
préparatifs des soldats; il était très pâle,
ses lèvres tremblaient, à moins qu’elles ne
murmurassent une prière. L’orgueil de son désespoir
semblait avoir disparu ou, tout au moins, s’être affaibli.
Il baissa plusieurs fois sa tête jusqu’alors altière
et regarda le sol, résigné à souffrir. [429]
On l’amena à côté de la margelle, suivi de
Da. Consolacion souriante. Le malheureux lança un regard
d’envie vers le monceau de cadavres, un soupir
s’échappa de sa poitrine.
—Parle donc! lui redit le directorcillo; n’importe
comment tu seras pendu, mais au moins meurs sans tant souffrir.
—Tu ne sortiras d’ici que pour mourir, lui dit un
cuadrillero.
Le bâillon lui fut enlevé, puis on lui lia les pieds.
Il devait être descendu la tête en bas et rester quelque
temps sous l’eau, comme on le fait pour le seau; seulement
l’homme reste plus longtemps.
L’alférez s’éloigna pour chercher une
montre et compter les minutes.
Pendant ce temps, Társilo était suspendu, sa longue
chevelure ondoyant à l’air, les yeux à demi
fermés.
—Si vous êtes chrétiens, si vous avez du
cœur, supplia-t-il à voix basse, descendez-moi rapidement
ou faites en sorte que ma tête cogne contre une pierre et que je
meure. Dieu vous récompensera pour cette bonne œuvre...
peut-être un jour vous verrez-vous comme moi!
L’alférez revint et présida à la
descente, montre en main.
—Lentement, lentement, criait Da. Consolacion en suivant le
malheureux du regard: prenez garde!
La manivelle tournait lentement; Társilo frottait et
s’écorchait contre les pierres saillantes et les plantes
immondes qui croissaient entre les crevasses. Puis, la manivelle
s’arrêta; l’alférez comptait les secondes.
—Montez! commanda-t-il sèchement au bout d’une
demi-minute.
Le bruit argentin et harmonieux des gouttes retombant dans
l’eau annonça le retour du supplicié à la
lumière. Cette fois, comme la pesanteur du contrepoids
était plus grande, il monta avec rapidité. Les cailloux,
les débris de pierre, arrachés des parois, tombaient en
crépitant. [430]
Le front et la chevelure couverts de fange bourbeuse, la figure
remplie de blessures et d’écorchures, le corps
mouillé et dégouttant, il apparut aux yeux de
l’assemblée silencieuse: le vent le faisait trembler de
froid.
—Veux-tu avouer? lui demanda-t-on.
—Prenez soin de ma sœur! murmura le malheureux en
regardant suppliant un cuadrillero.
La manivelle de bambou grinça de nouveau et le
condamné redescendit. Da. Consolacion observa que l’eau
restait tranquille. L’alférez compta une minute.
Quand Társilo remonta, ses membres étaient
contractés, violacés. Il dirigea un regard sur ceux qui
l’entouraient et maintint ouverts ses yeux injectés de
sang.
—Veux-tu avouer? lui demanda encore l’alférez
avec ennui.
Társilo secoua négativement la tête; on le
redescendit pour la troisième fois. Ses paupières se
fermèrent peu à peu, ses pupilles continuèrent
à regarder le ciel où flottaient quelques nuages blancs;
il plia le cou pour voir le plus longtemps possible la lumière
du jour, mais promptement il s’enfonça dans l’eau et
ce voile infâme lui cacha le spectacle du monde.
Une minute se passa; la Muse, en observation, vit de grosses bulles
d’air qui montaient à la surface.
—Il a soif, dit-elle en riant.
Et l’eau reprit sa tranquillité.
Cette fois ce ne fut qu’au bout d’une minute et demie
que l’alférez fit un signe.
Les membres de Társilo n’étaient plus
contractés; les paupières entr’ouvertes laissaient
voir le fond blanc de l’œil; de la bouche sortait une bave
sanguinolente; le vent soufflait, froid, mais déjà son
corps ne frémissait plus.
Tous, pâles, consternés, se regardèrent en
silence. L’alférez fit un signe pour qu’on le
détachât et, pensif, s’éloigna quelques
instants. A plusieurs reprises Da. Consolacion appliqua sur ses jambes
dénudées le feu [431]de son cigare, le feu
s’éteignit, mais la chair n’eut pas un frisson.
—Il s’est asphyxié lui-même! murmura un
cuadrillero, regardez comme il s’est retourné la langue,
on dirait qu’il a voulu l’avaler.
L’autre prisonnier, tremblant et suant, contemplait cette
scène, regardant de tous côtés comme un fou.
L’alférez chargea le directorcillo de
l’interroger.
—Señor, señor, gémissait-il; je dirai
tout ce que vous voudrez.
—C’est bon! nous allons voir: comment
t’appelles-tu?
—Andong, señor!
—Bernardo... Leonardo... Ricardo... Eduardo... Gerardo... ou
quoi?
—Andong, señor! répéta
l’imbécile.
—Mettez Bernardo ou ce que vous voudrez, décida
l’alférez.
—Nom de famille?
L’homme le regarda épouvanté.
—Quel nom as-tu, pour ajouter à celui de Andong?
—Ah, señor! Andong Medio-tonto4, señor!
Les assistants ne purent s’empêcher de rire;
l’alférez lui-même suspendit sa promenade.
—Métier?
—Tailleur de cocos, señor, et serviteur de ma
belle-mère.
—Qui vous a commandé d’attaquer le quartier?
—Personne, señor!
—Comment personne? ne mens pas ou l’on va te mettre au
puits! Qui vous l’a commandé? Dis la
vérité!
—La vérité, señor!
—Qui?
—Qui, señor! [432]
—Je te demande qui vous a commandé de faire la
révolution?
—Quelle révolution, señor!
—Allons, pourquoi étais-tu hier soir dans le patio du
quartier?
—Ah, señor! s’écria Andong en
rougissant.
—A qui en est la faute?
—A ma belle-mère, señor!
Le rire, puis la surprise accueillirent cette déclaration.
L’alférez se retourna et regarda le malheureux d’un
œil sévère. Celui-ci, croyant que ses paroles
avaient produit bon effet, continua avec plus d’animation.
—Oui, señor, ma belle-mère ne me donne rien
à manger que ce qui est pourri et hors de service; hier soir,
quand je revins, le ventre me faisait mal; j’ai vu tout
auprès le patio du quartier et je me suis dit: C’est la
nuit, personne ne te verra. Je suis entré... et, au moment
où je me relevais en entendant beaucoup de coups de fusil,
j’attachai mon caleçon...
Un coup de rotin lui coupa la parole.
—A la prison! commanda l’alférez; et cette
après-midi, au chef-lieu de la province!
[Table des matières]
LVIII
Le maudit
La nouvelle du départ des prisonniers se répandit
rapidement dans le pueblo, soulevant la terreur d’abord, puis les
plaintes et les lamentations.
Les familles des prisonniers couraient comme des folles, du couvent
au quartier, du quartier au tribunal, ne trouvant nulle part de
consolation, remplissant les airs de gémissements et de cris. Le
curé s’était enfermé sous prétexte de
maladie; l’alférez avait augmenté le nombre de ses
gardes qui recevaient à coups de crosse les femmes suppliantes;
le gobernadorcillo, être inutile [433]s’il en fut, plus bête
et plus insignifiant que jamais.
En face la prison, celles qui conservaient quelque force couraient
d’une extrémité à l’autre, celles qui
n’en avaient plus, s’asseyaient à terre, appelant
les noms des personnes aimées.
Le soleil brûlait, et cependant aucune de ces malheureuses ne
pensait à se retirer. Doray, la gaie et heureuse épouse
de D. Filipo, errait désolée, portant dans ses bras son
enfant; tous deux pleuraient.
—Retirez-vous, lui disait-on, votre enfant va prendre un coup
de soleil.
—A quoi lui servira-t-il de vivre s’il n’a plus de
père pour l’élever? répondait-elle,
inconsolable.
—Votre mari est innocent, il reviendra!
—Oui, quand nous serons morts!
Capitana Tinay pleurait et appelait son fils Antonio; la valeureuse
Capitana Maria regardait vers la petite grille derrière laquelle
étaient ses deux jumeaux, ses uniques enfants.
—Avez-vous vu chose pareille? prendre mon Andong, tirer sur
lui, le mettre au cepo et l’emmener au chef-lieu, tout cela
pourquoi... parce qu’il avait des caleçons neufs? Ceci
demande vengeance! Les gardes civils abusent! Je jure que, si
j’en retrouve un, comme il est souvent arrivé, cherchant
un endroit retiré dans mon jardin, je le châtre, oui, je
le châtre! sinon... qu’on me châtre!!!
Mais peu de personnes faisaient cœur avec la musulmane
belle-mère.
—La faute de tout est à D. Crisóstomo, soupirait
une femme.
Confondu dans la foule, errait le maître d’école;
señor Juan, sans plomb et sans mètre, ne se frottait plus
les mains: il était vêtu de noir, car il avait eu de
mauvaises nouvelles et, fidèle à sa coutume de
considérer l’avenir comme réalisé, il
portait déjà le deuil d’Ibarra.
A deux heures, après-midi, une charrette découverte,
[434]tirée par deux bœufs,
s’arrêta devant le tribunal.
La foule l’entoura, menaçant de la dételer et de
la briser.
—Ne faites pas cela, s’écria Capitana Maria,
voulez-vous qu’ils aillent à pied?
Ce mot arrêta les familles. Vingt soldats sortirent du
tribunal et entourèrent le véhicule, puis les prisonniers
parurent.
Le premier était D. Filipo, attaché; il salua en
souriant son épouse, Doray répondit par un amer sanglot
et deux gardes durent faire tous leurs efforts pour
l’empêcher d’embrasser son mari. Antonio, le fils de
Capitana Tinay, pleurait con±me un enfant, ce qui ne fit
qu’augmenter les cris de sa famille. L’imbécile
Andong, à la vue de sa belle-mère, cause de sa
mésaventure, gémit à fendre l’âme.
Albino, l’exséminariste et les deux jumeaux de Capitana
Maria, avaient les mains attachées; tous trois étaient
sérieux et graves. Enfin sortit Ibarra, les mains libres,
marchant entre deux gardes civils. Le jeune homme était
pâle, ses yeux cherchaient une figure amie.
—C’est lui le coupable! crièrent de nombreuses
voix; c’est lui le coupable et il a les mains libres!
—Mon gendre n’a rien fait et il a les menottes!
Ibarra se retourna vers ses gardes:
—Attachez-moi, mais attachez-moi bien, coude à coude,
dit-il.
—Nous n’avons pas d’ordre!
—Attachez-moi!
Les soldats obéirent.
L’alférez parut, à cheval, armé
jusqu’aux dents, suivi de dix à quinze autres soldats.
Chaque prisonnier avait là sa famille qui priait pour lui, le
saluait de noms affectueux; seul Ibarra n’avait personne; le
maître d’école et señor Juan lui-même
avaient disparu.
—Que vous ont fait à vous mon mari et mon fils? [435]lui disait
Doray en pleurant. Voyez mon pauvre enfant, vous l’avez
privé de son père!
La douleur se changeait en colère contre le jeune homme,
accusé d’avoir provoqué la révolte.
L’alférez ordonna le départ.
—Tu es un lâche! cria à Crisóstomo la
belle-mère d’Andong. Tandis que les autres se battaient
pour toi, tu te cachais, lâche!
—Sois maudit! lui dit un vieillard en le poursuivant. Maudit
soit l’or amassé par ta famille pour troubler notre paix!
Maudit! Maudit!
—Qu’on te pende, toi, hérétique! lui cria
une parente d’Albino, et sans pouvoir se contenir, elle prit une
pierre et la lui lança.
L’exemple fut promptement suivi: une pluie de poussière
et de cailloux s’abattit sur le malheureux jeune homme.
Ibarra souffrit impassible, sans colère, sans plainte,
l’injuste vengeance de tant de cœurs blessés.
C’était là l’au revoir, l’adieu que lui
faisait son pays adoré où étaient tous ses amours.
Il baissa la tête: peut-être pensait-il à un homme
qu’il avait vu frapper dans les rues de Manille, à une
vieille femme tombant morte à la vue de la tête de son
fils; peut-être se rappelait-il l’histoire
d’Elias.
L’alférez crut nécessaire d’écarter
la foule, mais les pierres ne cessèrent pas de tomber, les
insultes de retentir. Seule, une mère ne vengeait pas sur lui
ses douleurs: Capitana Maria. Sans un geste, les lèvres
serrées, les yeux remplis de larmes silencieuses, elle voyait
s’éloigner ses deux fils. Devant cette immobilité
et cette douleur muette, Niobé cessait d’être
fabuleuse.
Le cortège s’éloigna.
De toutes les personnes qui se montrèrent aux rares
fenêtres ouvertes, les seules qui témoignèrent
quelque compassion pour le jeune homme furent les indifférents
et les curieux. Tous ses amis s’étaient cachés,
[436]tous,
même Capitan Basilio qui défendit de pleurer à sa
fille Sinang.
Ibarra vit les ruines fumantes de sa maison, de la maison de ses
pères, où il était né, où vivaient
les plus doux souvenirs de son enfance et de sa jeunesse; les larmes,
longtemps refoulées, jaillirent de ses yeux, il baissa la
tête et pleura sans avoir, attaché comme il était,
la consolation de dissimuler son chagrin, sans que sa douleur
éveillât quelque sympathie. Maintenant, il n’avait
plus ni patrie, ni foyer, ni amour, ni amis, ni avenir!
D’une hauteur, un homme contemplait la triste caravane.
C’était un vieillard, pâle, amaigri,
enveloppé dans un manteau de laine, s’appuyant avec effort
sur un bâton. A la nouvelle de l’événement,
le vieux philosophe Tasio avait voulu quitter son lit et accourir, mais
ses forces ne le lui avaient pas permis. Le vieillard maintenant suivit
des yeux la charrette jusqu’à ce qu’elle eut disparu
au loin; il resta quelque temps pensif et le front baissé, puis
se leva et, péniblement, reprit le chemin de sa maison, se
reposant à chaque pas.
Le lendemain, des pâtres le trouvèrent mort à
l’ombre même de sa solitaire retraite.
[Table des matières]
LIX
Patrie et intérêts.
Le télégraphe avait transmis secrètement
à Manille la nouvelle de cet événement et,
trente-six heures après, les journaux augmentés,
corrigés, mutilés par le fiscal1, en parlaient avec beaucoup de
mystère et de nombreuses menaces. Entre temps, les nouvelles
particulières, émanées des couvents, furent les
premières qui coururent de bouche en bouche, en secret, à
la grande terreur de ceux qui arrivaient à les connaître.
[437]Le
fait, défiguré par mille versions, fut accepté
comme vrai avec plus ou moins de facilité selon qu’il
flattait ou contrariait les passions et la façon de penser de
chacun.
Sans que la tranquillité publique en parût
troublée, la paix des foyers devenait semblable à un
étang: la superficie restant lisse et calme, tandis qu’au
fond pullulent, courent, se poursuivent les poissons muets. Les croix,
les décorations, les galons, les emplois, le prestige, le
pouvoir, l’importance, les dignités, etc.,
commencèrent à voltiger comme des papillons dans une
atmosphère dorée pour une partie de la population. Pour
les autres un nuage obscur s’éleva à
l’horizon, sur son fond cendré se détachaient,
comme de noires silhouettes, des grilles, des chaînes et le
fatidique bois de la potence. On croyait entendre dans les airs les
interrogatoires, les sentences, les cris qu’arrachent les
tortures; les Mariannes et Bagumbayan se présentaient
enveloppés d’un voile déchiré et sanglant:
dans le brouillard on voyait des pêcheurs et des
pêchés. Le Destin présentait
l’événement aux imaginations manilènes comme
certains éventails de Chine: une face peinte en noir,
l’autre dorée, de couleurs vives, ornée
d’oiseaux et de fleurs.
Dans les couvents, la plus grande agitation régnait. Faisant
atteler leurs voitures, les provinciaux se visitaient, tenaient de
secrètes conférences. Ils se présentaient au
palais pour offrir leur appui au Gouvernement qui courait les plus
grands périls. On parlait à nouveau de
comètes, d’allusions, de coups d’épingle,
etc.
—Un Te Deum, un Te Deum! disait un moine dans un
couvent. Cette fois que personne ne manque dans le chœur!
C’est une grande bonté de Dieu de faire voir maintenant,
précisément en des temps si mauvais, tout ce que nous
valons!
—Ce petit général Mal-Aguëro2, se sera mordu
[438]les
lèvres après cette petite leçon, répondit
un autre.
—Qu’en aurait-il été de lui sans les
Congrégations?
—Et pour mieux célébrer la fête que
l’on avertisse le Frère cuisinier et le procurateur...
Réjouissances pour trois jours!
—Amen!—Amen!—Vive Salví!—Vive!
Dans un autre couvent, on parlait d’autre sorte.
—Voyez? c’est un élève des
Jésuites; les flibustiers sortent de l’Ateneo!
—Et les anti-religieux!
—Je l’ai toujours dit: les Jésuites perdent le
pays, ils corrompent la jeunesse; mais on les tolère parce
qu’ils tracent quelques lignes sur du papier quand il y a des
tremblements de terre...
—Et Dieu sait comment elles sont faites!
—Oui, allez donc les contredire! Quand tout tremble et remue,
qui donc pourrait écrire des griffonnages! Rien, le P.
Secchi...
Et ils sourirent avec un souverain mépris.
—Mais, et les ouragans? et les báguios3? demanda un autre
avec une sarcastique ironie; n’est-ce pas divin?
—Un pêcheur quelconque les pronostique!
—Quand celui qui gouverne est un sot... dis-moi comment tu as
la tête et je te dirai comment est ta patte! Mais vous verrez si
les amis se favorisent les uns les autres; les journaux vont presque
jusqu’à demander une mitre pour le P. Salví.
—Et il va l’avoir! il s’en consume!
—Tu le crois?
—Pourquoi pas! Aujourd’hui on la donne pour
n’importe quoi. J’en sais un qui l’a coiffée
pour moins; il avait écrit un petit travail où il
démontrait que les Indiens n’étaient capables de
rien que d’être artisans... fi! de vieilles
vulgarités!
—C’est vrai! tant d’injustices nuisent à la
Religion! [439]s’écria l’autre; si les
mitres avaient des yeux et pouvaient voir sur quels crânes...
—Si les mitres étaient des objets de la Nature! ajouta
une voix nasale, Natura abhorret vacuum4...
—C’est pour cela qu’on se les arrache; le vide les
attire!
Nous faisons grâce à nos lecteurs d’autres
commentaires politiques, métaphysiques ou simplement spirituels.
Nous allons entrer chez un simple particulier, et comme à
Manille nous connaissons peu de monde, nous frapperons à la
porte de Capitan Tinong, l’homme officieux et prévenant
que nous avons vu inviter Ibarra avec tant d’insistance pour
qu’il l’honorât de sa visite.
Dans son riche et spacieux salon, à Tondo, Capitan Tinong est
assis dans un large fauteuil; il se passe la main sur le front, puis
sur la nuque en signe de désespoir tandis que sa femme, la
Capitana Tinchang, pleure et le sermonne devant ses deux filles qui,
dans un coin, écoutent muettes, hébétées et
émues.
—Ah! Vierge d’Antipolo! criait la femme, ah! Vierge du
Rosaire et de la Courroie! ah! ah! Notre-Dame de Novaliches!
—Nanay!... répondit la plus jeune des filles.
—Je te l’avais dit! continua la femme sur un ton de
récrimination; je te l’avais dit! ah! Vierge du Carmel!
ah!
—Mais non, tu ne m’avais rien dit! se risqua à
répondre en pleurnichant Capitan Tinong; au contraire, tu me
disais que je faisais bien de conserver l’amitié et de
fréquenter la maison de Capitan Tiago... parce que... parce
qu’il était riche... et tu me disais...
—Quoi? que te disais-je? Je ne te l’avais pas dit? je ne
t’avais rien dit? Ah! si tu m’avais
écouté!
—Maintenant tu me rejettes la faute! répliqua-t-il
d’un ton amer, en donnant un coup de poing sur le bras du
fauteuil. Ne me disais-tu pas que j’avais bien [440]fait de
l’inviter à dîner avec nous, parce que, comme il
était riche... tu disais que nous ne devions avoir
d’amitiés qu’avec les riches? N’est-ce
pas?
—Il est vrai que je te disais cela parce que... parce que
déjà il n’y avait plus de remède; tu ne
faisais que le louer; D. Ibarra par ci, D. Ibarra par là, D.
Ibarra partout. Et voilà! Mais je ne t’ai pas
conseillé de le voir ni de lui parler à cette
réunion; cela tu ne peux-pas le nier.
—Savais-je moi, par hasard, qu’il devait y aller?
—Eh bien! tu aurais dû le savoir!
—Comment, si je ne le connaissais même pas?
—Eh bien! tu aurais dû le connaître!
—Mais, Tinchang, si c’était la première
fois que je le voyais, que j’entendais parler de lui!
—Eh bien! tu aurais dû l’avoir vu avant, avoir
entendu parler de lui; c’est pour cela que tu es homme, que tu
portes des pantalons et que tu lis le Diario de Manila!
répondit intrépidement l’épouse en lui
lançant un regard terrible.
Capitan Tinang ne sut que répliquer.
Son épouse, non contente de cette victoire, voulut la
compléter et s’approchant de lui les poings
fermés.
—C’est pour cela que j’ai travaillé des
années et des années, économisant, pour que toi,
par ta bêtise, tu viennes perdre le fruit de mes fatigues? lui
reprocha-t-elle. Maintenant on va t’envoyer en exil, nous
dépouiller de nos biens, comme la femme de... Oh! si
j’étais homme, si j’étais homme!
Et voyant que son mari baissait la tête, elle
recommença à sangloter, répétant
toujours:
—Ah! si j’étais homme! si j’étais
homme!
—Et si tu étais homme, lui demanda enfin son mari
vexé, que ferais-tu?
—Quoi? eh bien!... eh bien!... aujourd’hui même je
me présenterais au capitaine général, pour lui
offrir de me battre contre les révoltés,
aujourd’hui même!
—Mais, n’as-tu pas lu ce que dit le Diario? Lis!
[441]«La trahison infâme et
bâtarde a été réprimée avec
énergie, force et vigueur, et promptement les rebelles ennemis
de la Patrie et leurs complices sentiront tout le poids et toute la
sévérité des lois...» Vois! il n’y a
pas de soulèvement.
—Cela ne fait rien, tu dois te présenter; beaucoup
l’ont fait en 1872 et ainsi n’ont pas été
inquiétés.
—Oui! il l’avait fait aussi le P. Burg...
Mais il ne put achever le mot; sa femme accourut et lui ferma la
bouche.
—Dis-le! prononce ce nom pour que demain on te pende à
Bagumbayan! Ne sais-tu pas qu’il suffit de prononcer ce nom pour
être exécuté sans autre forme de procès?
Voyons, dis-le!
Quand même Capitan Tinong aurait voulu lui obéir, il
n’aurait pas pu; sa femme lui fermait la bouche à deux
mains, serrant sa petite tête contre le dossier du fauteuil et
peut-être le pauvre homme serait-il mort asphyxié si un
nouveau personnage n’était intervenu.
C’était le cousin D. Primitivo, qui savait par
cœur l’Amat, homme d’environ quarante ans, vêtu
avec recherche, pansu et bedonnant.
—Quid video? s’écria-t-il en entrant; que
se passe-t-il? Quare?5
—Ah! cousin! dit la femme éplorée en courant
vers lui, je t’ai fait appeler, car je ne sais ce qu’il va
en être de nous... que nous conseilles-tu? Parle, toi qui as
étudié le latin et qui connais les arguments...
—Mais avant quid quaeritis?
Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu; nihil volitum
quin praecognitum6.
Et il s’assit posément. Comme si les phrases latines
avaient eu une vertu tranquillisatrice, les époux
cessèrent de pleurer et s’approchèrent attendant le
conseil [442]de ses lèvres, comme autrefois les Grecs
attendaient la phrase salvatrice de l’oracle qui allait leur
livrer les Perses envahisseurs.
—Pourquoi pleurez-vous? Ubinam gentium sumus7?
—Tu sais déjà la nouvelle du
soulèvement...
—Alzamentum Ibarrae ab alferesio Guardiae civilis
destructum? Et nunc?8 Eh bien, quoi! D. Crisóstomo vous doit
quelque chose.
—Non, mais sais-tu que Tinong l’avait invité
à dîner, il l’a salué sur le Pont
d’Espagne... en plein jour! On va dire qu’il est son
ami!
—Ami? s’écria surpris le latin en se levant. Amice, amicus Plato sed magis arnica veritas9! Dis-moi qui tu
hantes et je te dirai qui tu es. Malum est negotium et est
timendum rerum istarum horrendissimum resultatum. Hemn!10
Tant de mots en um épouvantèrent Capitan
Tinong; il pâlit effroyablement, ce son lui semblait d’un
mauvais présage. Son épouse joignit des mains
suppliantes:
—Cousin, tu nous parles maintenant en latin; tu sais que nous
ne sommes pas philosophes comme toi; parle-nous en tagal ou en
castillan, mais donne-nous un conseil.
—Il est à déplorer que vous n’entendiez
pas le latin, cousine: les vérités latines sont des
mensonges tagals; par exemple: contra principia negantem
fustibus est arguendum11, en latin c’est une vérité
aussi certaine que l’arche de Noé; je l’ai mise une
fois en pratique en tagal et c’est moi qui ai reçu les
coups de bâton. Aussi [443]c’est un malheur que vous ne sachiez pas
le latin. En latin, tout pouvait s’arranger.
—Nous savons aussi beaucoup d’oremus, parce
nobis et Agnus Dei catolis12, mais maintenant nous ne nous
comprendrions pas. Donne un conseil à Tinong pour qu’on ne
le pende pas.
—Tu as mal fait, très mal fait, cousin, en liant
amitié avec ce jeune homme! répondit le latin. Les justes
paient pour les pécheurs, je te conseillerais presque de faire
ton testament... Væ illis. Ubi est fumus est ignis!
Similis simili gaudet; atqui Ibarra ahorcatur, ergo ahorcaberis13....
Et, ennuyé, il hochait la tête de côté et
d’autre.
—Saturnino, qu’as-tu! cria Capitana Tinchang, pleine de
terreur; ah! mon Dieu! il est mort! un médecin! Tinong,
Tinongoy!
Les deux filles accoururent et toutes trois commencèrent
à se lamenter.
—Ce n’est rien qu’un évanouissement,
cousine, un évanouissement! J’aurais été
content que... que... mais malheureusement ce n’est rien de plus
qu’un évanouissement. Non timeo mortem in
catre sed super espaldonem Bagumbayanis14. Apportez de
l’eau!
—Ne meurs pas! pleurait la femme. Ne meurs pas, on viendrait
te prendre! Ah! si tu mourais et si les soldats venaient! ah! ah!
Le cousin lui arrosa la figure avec de l’eau et le malheureux
revint à lui.
—Allons, il ne faut pas pleurer! Inveni remedium,
j’ai trouvé le remède. Transportons-le à son
lit; allons! [444]du courage! je suis ici avec vous et toute la
sagesse des anciens... Qu’on appelle un docteur; et
aujourd’hui même, cousine, va voir le capitaine
général et porte-lui un cadeau, une chaîne
d’or, une bague... Davidæ quebrantant
peñas;15 dis que c’est un cadeau de Noël. Ferme
les fenêtres, les portes et, si quelqu’un demande mon
cousin, réponds qu’il est gravement malade. Pendant ce
temps, je brûle toutes les lettres, papiers et livres pour que
l’on ne puisse rien trouver, comme a fait D. Crisóstomo.
Scripti testes sunt! Quod medicamenta non sanant ferrum
sanat; quod ferrum non sanat, ignis sanat16.
—Oui, prends, cousin, brûle tout! dit Capitana Tinchang;
voici les clefs, voici les lettres de Capitan Tiago. brûle-les!
Qu’il ne reste aucun journal d’Europe, ils sont très
dangereux. Voici quelques Times que je conservais pour
envelopper des savons et du linge. Voici les livres.
—Va-t’en chez le capitaine général,
laisse-moi seul. In extremis extrema17. Donne-moi le pouvoir
d’un director romain et tu verras comment je sauverai la
pat..., que dis-je, le cousin.
Et il commença à donner des ordres, à retourner
les rayons de la bibliothèque, à déchirer les
papiers, les livres, les lettres, etc. Puis il alluma un foyer dans la
cuisine; on brisa avec une hache de vieilles escopettes, on jeta dans
les cabinets des revolvers rouillés; la servante qui voulait
conserver le canon de l’une de ces armes pour en faire un
soufflet fut vertement reçue.
—Conservare etiam sperasti, perfida18? Au feu! [445]
Et l’auto-da-fé continua.
Il aperçut un vieux tome en parchemin et en lut le titre:
—«Révolutions des globes célestes, par
Copernic» pfui! ite, maledicti, in ignem Kalanis19!
s’écria-t-il en le jetant dans la flamme. Des
Révolutions et Copernic! Crime sur crime! Si je n’arrive
pas à temps...
«La Liberté aux Philippines». Tatata! quels
livres! au feu!
Et des livres innocents, écrits par les auteurs les plus
simples, n’échappèrent pas au sort commun.
Même le «Capitan Juan», œuvre très
candide, suivit les autres. Le cousin Primitivo avait raison; les
justes paient pour les pécheurs.
Quatre ou cinq heures plus tard dans une tertulia20 à prétentions,
intra muros, on commentait les événements du jour.
Beaucoup de vieilles dames et de vieilles filles y étaient
réunies avec des femmes ou des filles d’employés,
vêtues à l’européenne,
s’éventant et bâillant. Parmi les hommes qui, par
leurs manières, dénotaient comme les femmes leur
instruction et leur origine, était un homme déjà
âgé, tout petit, manchot, que l’on traitait avec
beaucoup d’égards et qui gardait envers les autres un
silence dédaigneux.
—En vérité, je ne pouvais auparavant souffrir ni
les moines ni les gardes civils à cause de leur mauvaise
éducation, disait une grosse dame, mais maintenant que je vois
leur utilité et quels services ils rendent, je serais presque
heureuse de me marier avec l’un d’eux. Je suis
patriote.
—Je suis du même avis! ajouta une maigre; quel malheur
que nous n’ayons pas l’ancien gouverneur; celui-là
laisserait le pays net comme une patène.
—Et il en finirait avec la race des
filibusterillos!
—Ne dit-on pas qu’il reste de nombreuses îles
à [446]peupler? Pourquoi n’y déporte-t-on
pas tous ces Indiens mécontents? Si j’étais le
capitaine général...
—Señoras, dit le manchot, le capitaine
général sait son devoir; selon ce que j’ai entendu
il est très irrité, car il avait comblé de faveurs
cet Ibarra.
—Comblé de faveurs? répéta la maigre en
s’éventant avec furie. Voyez combien ingrats sont ces
Indiens! Peut-on par hasard les traiter comme des personnes?
Jésus!
—Savez-vous ce que j’ai entendu? demanda un
militaire.
—Non!—Qu’est-ce?—Que dit-on?
—Des personnes dignes de foi, reprit le militaire au milieu du
plus grand silence, assurent que tout ce bruit fait pour élever
une école était un pur conte.
—Jésus! Vous avez vu?
s’écrièrent-elles toutes, croyant
déjà au conte.
—L’école était un prétexte; ce
qu’il voulait bâtir était un fort, où il
aurait pu se défendre quand nous aurions été
l’attaquer...
—Jésus! Quelle infamie! Un Indien seul est capable
d’aussi lâches pensées, s’écria la
grosse dame. Si j’étais le capitaine
général, ils verraient... ils verraient...
—Je pense comme vous! s’écria la maigre en
s’adressant au manchot. Que l’on arrête tous ces
avocassons, tous ces petits clercs, tous ces commerçants et que,
sans autre forme de procès on les exile, on les emprisonne! Il
faut arracher la racine du mal!
—Mais on dit que ce flibustier-là est fils
d’espagnol, ajouta le manchot sans regarder personne.
—Ah! voilà! s’écria la grosse; ce sont
toujours les créoles! aucun Indien ne comprend quelque chose
à la Révolution! Élève des corbeaux21...
élève des corbeaux...
—Savez-vous ce que j’ai entendu dire, demanda une
créole qui coupa ainsi la conversation. La femme de [447]Capitan Tinong...
vous rappelez-vous? celui chez qui nous avons dansé et
dîné à la fête de Tondo...
—Celui qui a deux filles? eh bien, quoi?
—Eh bien, sa femme vient de donner cette après-midi au
capitaine général une bague de mille pesos de valeur.
Le manchot se retourna.
—Vrai? et pourquoi? demanda-t-il, les yeux brillants.
—Elle a dit que c’était comme cadeau de
Noël...
—La Noël ne vient que dans un mois!...
—Elle aura craint une averse... observa la grosse.
—Et elle se met à couvert, ajouta la maigre.
—Satisfaction non réclamée, faute
confessée.
—C’est ce que je pensais; vous avez mis le doigt sur la
plaie.
—Ceci est à voir, observa le manchot pensif; je crains
qu’il n’y ait là quelque chat enterré.
—Un chat enterré, c’est cela! j’allais le
dire, répéta la maigre.
—Et moi aussi, dit l’autre en lui coupant la parole; la
femme de Capitan Tinong est très avare... elle ne nous a encore
envoyé aucun cadeau et cependant nous sommes allés chez
elle. De sorte que, quand une personne aussi chiche et aussi avide
lâche un petit cadeau de mille petits pesos...
—Mais, est-ce certain? demanda le manchot.
—Absolument certain, c’est l’aide-de-camp de Son
Excellence qui l’a dit à ma cousine, dont il est le
fiancé. Je suis tentée de croire que c’est la
même bague qu’elle portait le jour de la fête. Elle
est toujours pleine de brillants!
—Un scarabée marchant!
—C’est une manière comme une autre de se faire de
la réclame! Au lieu d’acheter un mannequin ou de payer une
boutique...
Le manchot trouva un prétexte et abandonna la tertulia. [448]
Deux heures après, quand tout le monde dormait, divers
habitants de Tondo reçurent une invitation par l’entremise
de soldats... L’Autorité ne pouvait tolérer que
certaines personnes ayant une position ou des propriétés
dormissent en des maisons si mal gardées et si peu
fraîches: au Fort de Santiago et dans d’autres
édifices du gouvernement leur sommeil serait plus tranquille et
plus réparateur. Parmi ces personnes se trouvait le malheureux
Capitan Tinong.
[Table des matières]
LX
Maria Clara se marie
Capitan Tiago était très content. Pendant cette
période terrible, personne ne s’était occupé
de lui; on ne l’avait pas arrêté, on ne
l’avait pas mis au secret, on ne l’avait pas soumis aux
interrogatoires, aux machines électriques, aux bains de pieds
continuels en de souterraines habitations, et autres plaisanteries bien
connues de certains personnages qui s’appellent eux-mêmes
civilisés. Ses amis, c’est-à-dire ceux qui
l’avaient été (car il avait renié ses amis
philippins aussitôt qu’ils avaient été
suspects aux yeux du gouvernement), étaient retournés
chez eux après quelques jours de vacances, dans les
édifices de l’État. Le capitaine
général lui-même avait ordonné qu’on
les jetât hors de ses possessions, ne les jugeant pas dignes
d’y rester, au grand déplaisir du manchot qui voulait
célébrer la Noël prochaine en leur nombreuse et
riche compagnie.
Capitan Tinong revint à son domicile malade, pâle,
affecté,—l’excursion ne lui avait pas
profité—et si changé qu’il ne dit pas un mot,
ne salua pas sa famille qui riait, pleurait et devenait folle de joie.
Le pauvre homme ne sortit plus de chez lui de peur de saluer un
flibustier. Le cousin Primitivo lui-même, avec toute la [449]sagesse des
anciens, ne pouvait le tirer de son mutisme.
—Crede, prime, lui disait-il; si je
n’étais pas arrivé à brûler tous tes
papiers, on apprêtait ton cou; mais si j’avais
brûlé toute la maison, on ne te touchait pas un cheveu.
Mais quod eventum, eventum; gratias agamus Domino Deo quia
non in Marianis Insulis es, camotes seminando1.
Les histoires semblables à celle de Capitan Tinang
étaient nombreuses; Capitan Tiago ne les ignorait pas. Il
regorgeait de gratitude, sans savoir exactement à qui il devait
des faveurs si signalées. Tante Isabel attribuait le miracle
à la Vierge d’Antipolo, à la Vierge du Rosaire, ou
tout au moins à la Vierge du Carmel; à tout
hasard—et c’était le moins qu’elle pouvait
concéder—à Nuestra Señora de la Correa:
selon elle, le miracle ne pouvait s’échapper de ce cercle.
Capitan Tiago ne niait pas le miracle, mais il ajoutait:
—J’y crois, Isabel, mais la Vierge d’Antipolo ne
l’aura pas fait seule; mes amis y auront aidé, mon futur
gendre, le Señor Linares, qui, comme tu le sais, plaisante avec
le Señor Antonio Canovas lui-même, celui dont
l’Illustration nous a donné le portrait et qui ne
daigne montrer aux yeux que la moitié de sa figure.
Et le bonhomme ne pouvait réprimer un sourire de satisfaction
chaque fois qu’il entendait une nouvelle importante au sujet des
événements. On chuchotait à voix basse
qu’Ibarra serait pendu; que, bien que l’on manquât de
beaucoup de preuves pour le condamner, on en avait trouvé une
qui confirmait l’accusation; que les experts avaient
déclaré qu’en effet les travaux de
l’école pouvaient passer pour un rempart, une
fortification, [450]assez défectueuse comme étant
l’œuvre d’ignorants Indiens. Ces rumeurs le
tranquillisaient et le faisaient sourire.
De même que Capitan Tiago et sa cousine les amis de la famille
se partageaient en deux partis: l’un tenant pour le miracle,
l’autre pour le gouvernement, mais celui-ci était
insignifiant. Les miraculistes étaient subdivisés: le
sacristain principal de Binondo, la vendeuse de cierges et le chef
d’une confrérie voyaient la main de Dieu, mise en
mouvement par la Vierge du Rosaire; le marchand de bougies chinois, son
fournisseur quand il allait à Antipolo, lui disait en
s’éventant et en remuant la jambe:
—No siya osti gongong; Miligen li Antipulo esi! Esi pueli mas
cón tolo; no siya osti gongong2.
Capitan Tiago avait en grande estime ce Chinois qui se faisait
passer pour prophète, médecin, etc. En examinant la main
de sa défunte épouse, au sixième mois de sa
grossesse, il avait pronostiqué:
—Si esi no homele y no pactaylo, muje juete-juete3!
Et Maria Clara vint au monde pour accomplir la prophétie.
Capitan Tiago donc, homme prudent et craintif, ne pouvait se
décider si facilement que le troyen Pâris; il ne pouvait
donner la préférence à une Vierge de peur
d’offenser l’autre, ce qui aurait pu lui attirer de graves
ennuis.
—Prudence! se disait-il à lui-même,
n’allons pas nous perdre maintenant.
Il se trouvait dans ces doutes quand arriva le parti [451]gouvernemental:
Da. Victorina, D. Tiburcio et Linares.
Da. Victorina parla pour les trois hommes et pour elle-même,
mentionna les visites de Linares au capitaine général et
insinua à plusieurs reprises les avantages que pouvait offrir un
parent de catégorie.
—Na! concluait-elle, comme nous izons: zelui qui ze couche
à une bonne ombre, z’appuie zur un bon bâton.
—C’est... c’est le contraire, femme, corrigea le
docteur.
Car, depuis quelques jours, elle avait prétendu se
naturaliser andalouse en supprimant les d et en
remplaçant le son s par le son z; cette
idée, personne n’avait pu lui ôter de la cervelle;
il aurait fallu d’abord arracher les boucles postiches.
—Zi! ajoutait-elle, en parlant d’Ibarra; zelui-zi le
méritait bien! ze l’avais it la première fois que
ze l’avais vu: z’est un flibustier. Que t’a it
à toi, cousin, le Général? Que lui as-tu it,
quelles nouvelles lui as-tu onné zur Ibarra?
Et, voyant que le cousin tardait à répondre, elle
poursuivit en s’adressant à Capitan Tiago.
—Croyez-moi, zi on le conamne à mort, comme z’est
à ezpérer, ze zera grâce à mon cousin.
—Señora, señora, protesta Linares.
Mais elle ne lui donna pas le temps:
—Ah! quel iplomate tu fais. Nous zavons que tu es le
conzeiller du général, qu’il ne peut rien faire
zans toi... Ah! Clarita, quel plaisir de te voir!
Maria Clara paraissait pâle encore, bien que presque
entièrement remise de sa maladie. Sa longue chevelure
était attachée par un ruban de soie d’un bleu
léger. Elle salua timidement, souriant avec tristesse, et
s’approcha de Da. Victorina pour le baiser de
cérémonie.
Après les phrases ordinaires, la pseudo-andalouse continua:
[452]
—Nous venions vous rendre visite; vous avez été
zauvés graze à vos relazions!—ici, un regard
significatif à Linares.
—Dieu a protégé mon père! répondit
la jeune fille à voix basse.
—Oui, Clarita, mais le temps es miracles est éjà
pazé. Nous, les Espagnols, nous isons: n’aie pas confianze
en la Vierge et sauve-toi en courant!
—C’est... c’est... le contraire!
Capitan Tiago qui, jusqu’alors n’avait pas trouvé
un moment pour parler, se risqua à demander en écoutant
la réponse de toute son attention:
—De façon que vous croyez, Da. Victorina, que la
Vierge...
—Nous venions prezizément causer avec vous e la
Vierge, répondit-elle mystérieusement en
désignant Maria Clara. Nous avons à causer affaires!
La jeune fille comprit qu’elle devait se retirer: elle chercha
un prétexte et s’éloigna en s’appuyant aux
meubles.
Ce qui se dit dans cette conférence fut si bas et si mesquin
que nous préférons ne pas le rapporter. Qu’il
suffise de noter que, lorsqu’ils se séparèrent,
tous étaient contents. Capitan Tiago dit ensuite à la
tante Isabel.
—Préviens le restaurant que demain nous donnons une
fête. Va-t’en préparer Maria Clara et lui annoncer
que nous la marions dans trois jours.
Tante Isabel le regarda épouvantée.
—Tu verras! quand le señor Linares sera notre gendre,
tous les palais nous seront ouverts; on nous enviera, ils mourront tous
d’envie.
Et c’est ainsi que, vers huit heures, le lendemain, la maison
de Capitan Tiago était pleine encore une fois; seulement il
n’avait invité que des Espagnols et des Chinois: le beau
sexe était représenté par des Espagnoles
péninsulaires et philippines.
La plus grande partie de nos connaissances s’y retrouvaient:
le P. Sibyla, le P. Salvi, parmi divers [453]franciscains et dominicains, le
vieux lieutenant de la Garde civile, plus sombre que jamais;
l’alférez racontant pour la millième fois sa
victoire, regardant tout le monde par dessus les épaules, se
croyant un Don Juan d’Autriche, maintenant qu’il est
lieutenant avec le grade de commandant; De Espadaña qui le
regarde avec respect et crainte et esquive ses regards; Da. Victorina
qui ne peut le voir sans colère. Linares n’était
pas arrivé encore car, comme personnage important, il devait se
faire attendre. Il y a des êtres si candides qu’une heure
de retard suffit à faire de grands hommes.
Dans le groupe des femmes, Maria Clara était l’objet
des murmures de toutes. La jeune fille les avait saluées et
reçues cérémonieusement, sans perdre son air de
tristesse.
—Bah! disait l’une; petite orgueilleuse...
—Assez jolie! reprenait une autre, mais il aurait pu en
choisir quelqu’une qui ait la figure plus intelligente.
—Et l’argent, ma petite, le bon garçon se
vend.
D’un autre côté, on disait:
—Se marier quand son premier fiancé est pour être
pendu!
—Cela s’appelle être prudente, avoir sous la main
un remplaçant.
—Eh bien! quand on devient veuve...
Peut-être ces conversations arrivaient-elles aux oreilles de
la jeune fille qui, assise sur une chaise, arrangeait une guirlande de
fleurs, car on la voyait pâlir et, par moments, sa main
tremblait, ses lèvres semblaient se mouvoir.
Dans le cercle des hommes on causait tout haut et, naturellement,
les derniers événements défrayaient la
conversation. Tous parlaient, même D. Tiburcio; le P. Salvi seul,
gardait toujours son dédaigneux silence.
—J’ai entendu dire que V. R. quittait déjà
le pueblo, P. Salvi; demanda le nouveau lieutenant que sa nouvelle
étoile avait rendu plus aimable. [454]
—Je n’ai plus rien à y faire; je dois me fixer
pour toujours à Manille... et, vous?
—Je quitte aussi le pueblo, répondit-il en se
redressant. Le gouvernement a besoin de moi pour que, avec une colonne
volante, je désinfecte les provinces de tous les
flibustiers.
Fr. Salvi le regarda rapidement des pieds à la tête et
lui tourna complètement le dos.
—Sait-on certainement ce qu’il va en être du chef,
du flibustier? demanda un employé.
—Vous parlez de D. Crisóstomo Ibarra? répondit
un autre. Il est très probable qu’il sera pendu comme ceux
de 1872 et ce sera très juste.
—Il sera exilé! dit sèchement le vieux
lieutenant.
—Exilé! rien de plus qu’exilé! Mais ce
sera un exil perpétuel! s’écrièrent de
nombreuses voix en même temps.
—Si ce jeune homme, poursuivit à voix haute le
lieutenant Guevara avait été plus prudent, s’il
s’était moins confié à certaines personnes
à qui il écrivait, si nos fiscaux ne savaient pas
interpréter trop subtilement ce qu’ils lisent, il est
certain que l’accusé aurait été absous!
Cette déclaration du vieux lieutenant et le ton de sa voix
produisirent une grande surprise dans son auditoire; tous ne savaient
que dire. Le P. Salvi regarda d’un autre côté,
peut-être pour ne pas voir le regard sombre que le vieillard lui
adressait, Maria Clara laissa tomber les fleurs et resta immobile. Le
P. Sibyla, qui savait se taire, parut être aussi le seul qui
sût questionner.
—Vous parlez de lettres, Sr. Guevara?
—Je parle de ce que m’a dit son défenseur, qui
s’est intéressé à sa cause et la
défend avec zèle. En dehors de quelques lignes
ambiguës trouvées dans une lettre adressée à
une femme avant de partir pour l’Europe, lignes dans lesquelles
le fiscal a vu un projet et une menace contre le gouvernement et que le
jeune [455]homme a reconnues comme écrites par lui,
on ne pouvait rien trouver pour l’accuser.
—Et la déclaration faite par le bandit avant de
mourir?
—Le défenseur l’a annulée car, selon le
bandit lui-même, ils n’ont jamais communiqué avec
Ibarra, à part un nommé José qui était son
ennemi, ainsi qu’il peut se prouver, et qui s’est
suicidé, peut-être par remords. On a prouvé que les
papiers trouvés sur le cadavre étaient faux, car
l’écriture, en était semblable à celle
qu’avait Ibarra il y a sept ans mais non à celle
qu’il a aujourd’hui, ce qui fait supposer que la lettre
accusatrice a servi de modèle. Bien plus, le défenseur
disait que s’il n’avait pas voulu la reconnaître,
cette lettre, on aurait pu faire beaucoup pour le sauver, mais à
sa vue, il a pâli, s’est troublé et a ratifié
tout ce qui y était écrit.
—Vous disiez, demanda un franciscain qu’il avait
adressé cette lettre à une femme; comment est-elle
parvenue entre les mains du fiscal?
Le lieutenant ne répondit pas: il regarda un moment le P.
Salvi et s’éloigna, tordant nerveusement la pointe
effilée de sa barbe grise, tandis que les assistants
échangeaient leurs commentaires.
—C’est là que se voit la main de Dieu! disait
l’un; même les femmes le haïssent.
—Il a fait brûler sa maison, croyant se sauver, mais il
comptait sans son hôtesse, c’est-à-dire sans sa
maîtresse, sa babai, ajoutait un autre en riant. Dieu le
voulait! Santiago cierra España4!
Cependant le vieux soldat s’était approché de
Maria Clara qui écoutait la conversation, immobile sur son
siège: les fleurs restaient à ses pieds.
—Vous êtes une jeune fille très prudente, lui
dit-il à voix basse. Vous avez très bien fait de livrer
la [456]lettre... vous vous assuriez ainsi un
tranquille avenir.
Puis il s’éloigna tandis qu’elle le regardait
avec des yeux hébétés, se mordant les
lèvres. Heureusement la tante Isabel passa. Maria Clara eut la
force suffisante pour la prendre par sa robe.
—Tante! murmura-t-elle.
—Qu’as-tu? demanda la vieille dame
épouvantée en voyant la figure de sa nièce.
—Conduisez-moi à ma chambre!
Et la jeune fille prit le bras de sa tante pour se lever.
—Tu es malade, ma fille? On dirait que tu as perdu toute
force? qu’as-tu?
—Mal au cœur... c’est la foule dans cette salle...
tant de lumière... j’ai besoin de me reposer. Dites
à mon père que je vais dormir.
—Tu es froide! Veux-tu du thé?
Maria Clara remua la tête négativement, ferma à
clef la porte de son alcôve et, à bout de forces, se
laissa tomber à terre au pied d’une image, en
sanglotant:
—Mère, mère, ma mère!
Par la fenêtre, par la porte qui communiquait avec celle de la
terrasse, entrait la lumière de la lune.
La musique poursuivait ses valses joyeuses; jusqu’à
l’alcôve arrivaient l’éclat des rires et le
ron ron des conversations; plusieurs fois on frappa à la
porte, son père, tante Isabel, Da. Victorina, Linares
même, Maria Clara ne bougea pas: un râle
s’échappait de sa poitrine.
Des heures se passèrent. Les plaisirs de la table
épuisés, on était passé à ceux du
bal. Sa bougie consumée s’était éteinte,
mais toujours à terre, sans mouvement, illuminée par la
lumière de la lune, la jeune fille restait toujours
étendue au pied de l’image de la Mère de
Jésus.
Peu à peu la maison redevint silencieuse et rentra dans
l’ombre; la tante Isabel vint encore une fois frapper à la
porte.
—Allons, elle s’est endormie! dit la vieille femme
à [457]haute voix; à son âge, sans rien
qui la tourmente, elle dort comme un cadavre!
Quand tout fut silencieux, Maria Clara se releva lentement, jeta un
regard autour d’elle, vit la terrasse, les petites treilles
baignées de blanches lumières.
—Un tranquille avenir! Dormir comme un cadavre! murmura-t-elle
à voix basse, et elle se dirigea vers la terrasse.
La ville reposait muette; seul, de temps à autre
s’entendait le bruit d’une voiture traversant, sur le pont
de bois, le rio dont les eaux solitaires reflétaient tranquilles
le mélancolique astre des nuits.
La jeune fille leva les yeux vers ce ciel d’une
limpidité de saphir; lentement elle retira ses bagues, ses
boucles d’oreilles, ses aiguilles à cheveux et son peigne,
les plaçant sur la balustrade de la terrasse, puis elle regarda
vers la rivière.
Une barque, chargée de zacate, s’arrêta au pied
de l’embarcadère que chaque maison possède sur les
rives du rio. Un des deux hommes qui la montaient gravit les marches de
pierre, sauta le mur et, quelques secondes après, elle entendait
ses pas dans l’escalier conduisant à la terrasse.
Maria Clara le vit s’arrêter lorsqu’il
l’aperçut, puis reprendre lentement sa marche vers elle
et, à trois pas, de nouveau s’arrêter. Elle
recula.
—Crisóstomo! murmura-t-elle, terrifiée.
—Oui, je suis Crisóstomo! reprit le jeune homme
d’une voix grave. Un ennemi, un homme qui a de graves raispns
pour me haïr, Elias, m’a tiré de la prison où
m’avaient jeté mes amis.
Un triste silence suivit ces paroles; Maria Clara inclina la
tête.
Ibarra continua:
—Près du cadavre de ma mère j’ai
juré de te faire heureuse, quelle que dût être ma
destinée! Tu as pu manquer à ton serment, elle
n’était pas ta mère; mais moi, moi qui suis son
fils, je tiens sa mémoire pour [458]sacrée, et au travers de
mille périls, je suis venu ici pour accomplir le mien; le hasard
permet que je te parle à toi-même Maria, nous ne nous
reverrons plus; tu es jeune, peut-être quelque jour ta conscience
te reprochera... je viens te dire, avant de disparaître, que je
te pardonne. Maintenant, sois heureuse et adieu!
Il allait s’éloigner; elle le retint.
—Crisóstomo! dit-elle; Dieu t’a envoyé
pour me sauver du désespoir... Écoute et juge-moi!
Ibarra voulut doucement se dégager d’elle.
—Je ne suis pas venu pour te demander de comptes... je suis
venu pour te rendre la tranquillité.
—Je ne veux pas de cette tranquillité que tu me donnes;
la tranquillité je me la donnerai moi-même. Tu me
méprises, et ton mépris me rendra amère la mort
elle-même!
Il vit le désespoir de la pauvre jeune fille et lui demanda
ce qu’elle désirait:
—Que tu croies que je t’ai toujours aimé.
Il eut un amer sourire!
—Ah! tu doutes de moi, tu doutes de l’amie de ton
enfance qui jamais ne t’a caché une seule de ses
pensées! s’écria-t-elle. Je te comprends! Quand tu
sauras mon histoire, la triste histoire que l’on m’a
révélée pendant ma maladie, tu me plaindras et tu
n’auras plus ce sourire pour répondre à ma douleur.
Pourquoi ne m’as-tu pas laissée mourir dans les mains de
mon ignorant médecin? Toi et moi, nous aurions été
plus heureux!
Elle se reposa un moment, puis continua.
—Tu l’as voulu, tu as douté de moi, que ma
mère me pardonne! Dans une de mes douloureuses nuits de
souffrances, un homme me révéla le nom de mon
véritable père et me défendit de t’aimer...
S’il n’avait pas été mon père
lui-même, il t’aurait pardonné l’injure que tu
lui avais faite.
Ibarra recula et terrifié regarda la jeune fille.
—Oui, continua-t-elle; cet homme m’a dit qu’il ne
[459]pouvait permettre notre union, car sa
conscience le lui interdisait; qu’il se verrait obligé de
publier la vérité, au risque de causer un grand scandale,
parce que mon père est...
Et à voix basse elle murmura un nom à l’oreille
du jeune homme.
—Que faire? Devais-je sacrifier à mon amour la
mémoire de ma mère, l’honneur de celui que
l’on supposait être mon père et le bon renom de
celui qui l’était? Aurais-je pu le faire sans soulever ton
propre mépris?
—Mais, des preuves, tu as eu des preuves? Il te fallait des
preuves! s’écria Crisóstomo bouleversé.
La jeune fille tira de son sein deux papiers.
—Deux lettres de ma mère, deux lettres dictées
par ses remords quand elle me portait dans ses entrailles. Prends,
lis-les, tu verras comme elle me maudit, comme elle désire ma
mort... ma mort, que mon père s’efforça
d’obtenir à l’aide de médicaments! Ces
lettres, il les a oubliées dans la maison où il habitait
autrefois, l’homme les a trouvées et conservées, et
elles ne m’ont été livrées qu’en
échange de ta lettre... pour s’assurer, disait-il, que je
ne me marierais pas avec toi sans le consentement de mon père.
Depuis que je les porte sur moi, à la place de la tienne, je
sens le froid sur mon cœur. Je t’ai sacrifié,
j’ai sacrifié mon amour... Que ne fait-on pas pour une
mère morte et pour deux pères vivants? Pouvais-je
prévoir l’usage que l’on allait faire de ta
lettre?
Ibarra était atterré, Maria Clara poursuivit:
—Que me restait-il à faire? pouvais-je, par hasard, te
dire qui était mon père, pouvais-je te dire de lui
demander pardon, à lui qui a tant fait souffrir le tien?
pouvais-je le dire à mon père qui, peut-être,
t’aurait pardonné, pouvais-je lui dire que
j’étais sa fille, à lui qui avait tant
souhaité ma mort? Il ne me restait qu’à souffrir,
à garder en moi mon secret, et à mourir en souffrant!...
Maintenant, mon ami, maintenant que tu [460]connais la triste histoire de ta
pauvre Maria, auras-tu encore pour elle ce dédaigneux
sourire!
—Maria, tu es une sainte!
—Je suis heureuse puisque tu crois en moi...
—Cependant, ajouta le jeune homme en changeant de ton,
j’ai entendu dire que tu te mariais...
—Oui, sanglota la pauvre fille, mon père exige ce
sacrifice... il m’a aimée et nourrie et ce
n’était pas son devoir, je lui paye cette dette de
gratitude en lui assurant la paix au moyen de cette nouvelle
parenté, mais...
—Mais?
—Je n’oublierai pas les serments de
fidélité que je t’ai jurés.
—Que médites-tu? demanda Ibarra en essayant de lire
dans ses yeux.
—L’avenir est obscur et le destin est environné
d’ombres; je ne sais ce que je dois faire; mais sache bien que je
ne puis aimer qu’une fois et que, sans amour, je ne serai jamais
à personne. Et toi? que vas-tu devenir?
—Je ne suis plus qu’un fugitif... je fuis, D’ici
peu on découvrira ma fuite, Maria...
Maria prit dans ses mains la tête du jeune homme,
l’embrassa plusieurs fois sur les lèvres, le serra dans
ses bras, puis le repoussant brusquement:
—Fuis, fuis! lui dit-elle; fuis, adieu!
Ibarra, les yeux brillants, la regarda, mais elle fit un signe et il
s’éloigna, vacillant, comme un homme ivre...
Il sauta de nouveau le mur et reprit sa place dans la barque.
Accoudée sur l’appui de la terrasse, Maria Clara le
regardait s’éloigner.
Elias se découvrit et la salua profondément. [461]
[Table des matières]
LXI
La chasse sur le lac
—Écoutez, señor, le plan que j’ai
conçu, dit Elias pensif tandis qu’ils se dirigeaient vers
San Gabriel. Je vais maintenant vous cacher chez un ami que j’ai
à Mandaluyong; je vous apporterai tout votre argent que
j’ai sauvé et caché au pied du balitî, dans
la tombe mystérieuse de votre aïeul; vous quitterez le
pays...
—Pour aller à l’étranger? interrompit
Ibarra.
—Pour vivre en paix les années qui vous restent
à vivre. Vous avez des amis en Espagne, vous êtes riche,
vous pourrez vous faire amnistier. De toutes façons
l’étranger pour nous est une patrie meilleure que la
vraie.
Crisóstomo ne répondit pas; il
réfléchissait en silence.
Ils arrivaient au Pasig et la barque commença à
remonter le courant. Sur le pont d’Espagne un cavalier
hâtait sa course, un sifflement aigu et prolongé se fit
entendre.
—Elias, reprit Ibarra, vous devez votre malheur à ma
famille, vous m’avez sauvé deux fois la vie et je vous
dois non seulement ma gratitude mais aussi la restitution de votre
fortune. Vous me conseillez de partir à l’étranger,
eh bien! venez avec moi, et vivons comme deux frères. Vous aussi
êtes malheureux en ce pays.
Elias hocha tristement la tête et répondit:
—Impossible! Il est vrai que je ne puis ni aimer ni être
heureux dans mon pays, mais je puis y vivre et y mourir, et
peut-être même mourir pour lui; c’est toujours
quelque chose. Que le malheur de ma patrie soit mon propre malheur et,
puisqu’une noble pensée ne nous unit pas, puisque nos
cœurs ne battent pas pour un seul nom, au moins qu’une
commune souffrance [462]m’unisse à mes compatriotes, au
moins que je pleure avec eux nos douleurs et qu’une même
infortune opprime tous nos cœurs!
—Alors, pourquoi me conseillez-vous de partir?
—Parce qu’ailleurs vous pourrez être heureux, moi
non; parce que vous n’êtes pas fait pour souffrir, parce
qu’un jour vous détesterez votre pays si vous vous voyez
malheureux par sa faute: et détester son pays est la plus grande
des infortunes.
—Vous êtes injuste envers moi! s’écria
amèrement Ibarra; vous oubliez que, à peine arrivé
ici, je me suis consacré à rechercher son bien...
—Ne vous fâchez pas, señor, je ne vous ai fait
aucun reproche. Puissent tous vous imiter! Mais je ne vous demande pas
l’impossible; ne vous offensez pas si je vous dis que votre
cœur vous trompe. Vous aimiez votre patrie parce que votre
père vous l’avait enseigné, vous l’aimiez
parce que vous y aviez amour, fortune, jeunesse, parce tout vous y
souriait, qu’elle ne vous avait fait aucune injustice; vous
l’aimiez comme nous aimons tout ce qui nous rend heureux. Mais le
jour où vous vous verrez pauvre, affamé, poursuivi,
dénoncé et vendu par vos compatriotes eux-mêmes, ce
jour-là vous renierez tout, vous, votre pays et eux.
—Vos paroles me peinent! dit Ibarra avec colère.
Elias baissa la tête, médita et répondit:
—Je veux vous détromper, señor, et vous
éviter un triste avenir.
Souvenez-vous de cette nuit où je vous parlais dans cette
même barque, à la lueur de cette même lune; il y a
un mois, à quelques jours près; alors vous étiez
heureux. La supplication de ceux qui ne l’étaient pas
n’arrivait pas jusqu’à vous; vous dédaigniez
leurs plaintes parce que c’étaient des plaintes de
criminels; vous écoutiez plutôt leurs ennemis et,
malgré mes raisons et nos prières, vous vous mettiez du
côté de leurs oppresseurs, et de vous dépendait
alors que je devinsse criminel ou que je me laissasse tuer pour
accomplir une [463]parole sacrée. Dieu ne l’a pas
permis, l’ancien chef des malfaiteurs est mort... Un mois
s’est passé et maintenant vous ne pensez plus ce que vous
pensiez alors.
—Vous avez raison, Elias, mais l’homme est un animal qui
varie selon les circonstances; alors j’étais
aveuglé, contrarié, que sais-je? Maintenant les revers
ont arraché le bandeau de mes yeux; la misère et la
solitude de ma prison m’ont instruit; je vois aujourd’hui
l’horrible cancer qui ronge cette société; qui
s’accroche à ses chairs et qui doit être violemment
extirpé. Ils m’ont ouvert les yeux, m’ont fait voir
la plaie et me forcent à être criminel. Et
puisqu’ils l’ont voulu, je serai flibustier, mais
flibustier véritable; j’appellerai tous les malheureux,
tous ceux qui dans leur poitrine sentent battre un cœur, tous
ceux qui m’enviaient moi-même... non, je ne serai pas
criminel, il ne l’est jamais celui qui lutte pour sa patrie, au
contraire! Pendant trois siècles, nous leur avons tendu la main,
nous leur avons demandé leur amour, nous brûlions du
désir de les appeler nos frères! comment nous ont-ils
répondu? Par l’insulte et la moquerie, en nous
déniant même la qualité d’êtres
humains. Il n’y a pas de Dieu, il n’y a pas
d’espérances, il n’y a pas d’humanité;
il n’y a rien que le droit de la force!
Ibarra était nerveux, tout son corps tremblait.
Ils passèrent devant le palais du général et
crurent remarquer une certaine agitation parmi les gardes.
—On aura découvert l’évasion? murmura
Elias. Couchez-vous, señor, que je vous couvre avec le zacate,
car nous passerons à côté de la poudrière et
la sentinelle peut s’étonner que nous soyons deux.
La barque était une de ces fines et étroites pirogues
qui ne voguent pas, qui volent à la surface de l’eau.
Comme Elias l’avait prévu, la sentinelle
l’arrêta et lui demanda d’où il venait.
—De Manille, porter du zacate aux oidores1 et aux curés,
répondit-il en imitant l’accent de ceux de Pandakan. [464]
Un sergent sortit et s’informa de ce qui se passait.
—Sulung! dit-il à Elias, je t’avertis de ne
recevoir personne dans ta barque; un prisonnier vient de
s’échapper. Si tu l’arrêtes et que tu me le
ramènes, je te donnerai une bonne récompense.
—C’est bien, señor, quel est son signalement?
—Il porte une lévite et parle espagnol; ainsi,
attention!
La barque s’éloigna. Elias se retourna et vit la
silhouette de la sentinelle, debout près de la rive.
—Nous perdrons quelques minutes, dit-il à voix basse;
nous devons entrer dans le rio Beata pour faire croire que je suis de
Peña Francia. Vous verrez le rio qu’a chanté
Francisco Baltazar.
Le pueblo dormait sous la lumière de la lune.
Crisóstomo se leva pour admirer la paix sépulcrale de la
Nature. Le rio était étroit et ses rives formaient une
plaine semée de zacate.
Elias jeta sa charge sur le rivage, cueillit un long roseau et tira
de dessous l’herbe où ils étaient cachés
quelques-uns de ces sacs en feuille de palmier que l’on appelle
bayones. Puis ils continuèrent à naviguer.
—Vous êtes maître de votre volonté,
señor, et de votre avenir, dit le pilote à
Crisóstomo qui restait silencieux. Mais, si vous me permettez
une observation, je vous dirai: Regardez bien ce que vous allez faire:
vous allez allumer la guerre, car vous avez de l’argent, de
l’intelligence et vous trouverez promptement des bras, les
mécontents sont si nombreux! Mais, dans cette lutte que vous
entreprendrez, qui souffrira le plus, sinon les innocents, les
désarmés? Les mêmes sentiments qui, il y a un mois,
me poussaient à m’adresser à vous, à vous
demander de nous aider à obtenir des réformes, me font
maintenant vous demander de réfléchir. Le pays,
señor, ne pense pas à se séparer de la Mère
Patrie; il ne demande qu’un peu de liberté, de justice et
d’amour. Les mécontents, les
désespérés, les criminels vous seconderont, mais
le peuple s’abstiendra. Vous vous trompez si, voyant tout en
noir, [465]vous croyez que le pays est
désespéré. Le pays souffre, oui, mais il
espère encore, il croit, il ne se lèvera que
lorsqu’il aura perdu patience, c’est-à-dire quand le
voudront ceux qui le gouvernent: nous n’en sommes pas là.
Moi-même, je ne vous suivrai pas; je ne recourrai jamais à
ces moyens extrêmes tant que je verrai dans les hommes une
espérance possible.
—Alors, je marcherai sans vous! répondit
Crisóstomo résolu.
—C’est votre ferme décision?
—Ferme et unique, j’en atteste la mémoire de mon
père! Je ne me laisserai pas impunément arracher la paix
et le bonheur, moi qui ne désirais que le bien, moi qui ai tout
accepté et tout souffert par respect pour une religion
hypocrite, par amour pour ma patrie. Comment m’a-t-on
répondu? En m’enfouissant dans un cachot infâme, en
prostituant ma fiancée! Non, ne pas me venger serait un crime,
ce serait les encourager à de nouvelles injustices! Non, ce
serait lâcheté, puérilité de gémir et
de pleurer quand il y a du sang et de la vie, quand le mépris
s’unit à l’insulte et au défi!
J’appellerai ce peuple ignorant, je lui ferai voir sa
misère, je lui montrerai qu’on ne le traite pas
fraternellement; il n’y a que les loups qui se dévorent,
et je leur dirai que, contre cette oppression, se lève et
proteste le droit éternel de l’homme à
conquérir sa liberté.
—Le peuple innocent souffrira!
—Tant mieux! Pouvez-vous me conduire jusqu’à la
montagne?
—Jusqu’à ce que vous soyez en
sûreté! répondit Elias.
De nouveau ils voguèrent sur le Pasig. De temps à
autre, ils causaient de choses indifférentes.
—Santa Ana! murmura Ibarra, connaîtriez-vous cette
maison?
Ils passaient devant la maison de campagne des jésuites.
—J’y ai passé nombre de jours heureux et joyeux!
[466]soupira Elias. Dans mon enfance, nous y venions
chaque mois... alors j’étais comme les autres:
j’avais de la fortune, de la famille, je rêvais,
j’entrevoyais un avenir. J’allais voir ma sœur dans
un collège voisin; elle me donnait quelque travail de ses
mains... une amie l’accompagnait, une belle jeune fille. Tout
cela est passé comme un songe.
Ils restèrent silencieux jusqu’à ce qu’ils
furent arrivés au poste de Malapad-na-batô2. Ceux qui parfois
ont sillonné le Pasig par quelqu’une de ces nuits magiques
des Philippines, quand de l’azur limpide la lune verse sa
mélancolique poésie, quand les ombres cachent la
misère des hommes et que le silence éteint les accents
mesquins de leur voix, quand la Nature seule parle, ceux-là
comprendront les méditations des deux jeunes gens.
A Malapad-na-batô le carabinier avait sommeil et, voyant que
la barque était vide et n’offrait aucun butin à
prendre, selon la traditionnelle coutume de son corps et l’usage
de ce poste, il la laissa passer facilement.
Le garde civil de Pasig ne suspectait rien non plus et ne leur dit
rien.
L’aurore commençait à poindre lorsqu’ils
arrivèrent au lac, calme et tranquille comme un gigantesque
miroir. La lune pâlissait, l’Orient se teignait de teintes
rosées. A quelque distance, ils distinguèrent une masse
grise qui s’avançait peu à peu.
—C’est la falúa, murmura Elias; elle vient;
couchez-vous et je vous couvrirai de ces sacs.
Les formes de l’embarcation se faisaient plus claires et plus
perceptibles.
—Elle se place entre le rivage et nous, observa Elias
inquiet.
Et peu à peu il changea la direction de sa barque, ramant
vers Binangonan. A sa grande stupeur, il nota [467]que la falúa changeait
aussi de direction, tandis qu’une voix l’appelait.
Elias s’arrêta et réfléchit. La rive
était encore loin; avant peu ils seraient à portée
des fusils de la falúa. Il pensa retourner vers le Pasig: sa
barque était plus rapide que l’autre. Mais
fatalité! une autre barque venait du Pasig, on y voyait briller
les casques et les baïonnettes des gardes civils.
—Nous sommes pris! murmura-t-il en pâlissant.
Il regarda ses bras robustes et, prenant l’unique
résolution possible, il commença à ramer de toutes
ses forces vers l’île de Talim. Le soleil commençait
à se montrer.
La barque glissait rapidement sur les eaux; sur la falúa qui
virait de bord, Elias vit quelques hommes debout, faisant des
signes.
—Savez-vous guider une barque? demanda-t-il à
Ibarra.
—Oui, pourquoi?
—Parce que nous sommes perdus si je ne saute pas à
l’eau pour leur faire perdre la piste. Ils me poursuivront, je
nage et je plonge très bien... je les éloignerai de vous,
et vous tâcherez de vous sauver.
—Non, restons et vendons chèrement nos vies!
—Inutile, nous n’avons pas d’armes et, avec leurs
fusils, ils nous tueraient comme des oiseaux.
Au même moment, on entendit un chiss dans l’eau,
produit par la chute d’un corps brûlant,
immédiatement suivi d’une détonation.
—Voyez-vous? dit Elias en posant la rame dans la barque! Nous
nous verrons à la Nochebuena3 à la tombe de votre
grand-père. Sauvez-vous!
—Et vous?
—Dieu m’a tiré de plus grands périls.
Elias ôta sa chemise; une balle l’arracha de ses mains,
et deux détonations se firent entendre. Sans se troubler, il
serra la main d’Ibarra, toujours étendu dans [468]le fond de la
barque, puis se leva et sauta à l’eau repoussant du pied
la petite embarcation.
On entendit divers cris; promptement, à quelque distance,
apparut la tête du jeune homme, revenant à la surface pour
respirer, puis se cachant immédiatement.
—Là-bas, il est là-bas! crièrent diverses
voix, et les balles sifflèrent de nouveau.
La falúa et la barque se mirent à la poursuite du
nageur: un léger sillage signalait son passage,
s’éloignant de plus en plus de la barque d’Ibarra
qui voguait comme abandonnée. Chaque fois qu’Elias
montrait la tête pour respirer, les gardes civils et les hommes
de la falúa tiraient sur lui.
La chasse continuait; la barquette d’Ibarra était
déjà loin. Elias s’approchait du rivage, dont il
n’était plus éloigné que d’environ
cinquante brasses. Les rameurs étaient déjà las,
mais Elias l’était aussi, car il sortait continuellement
la tête de l’eau et toujours dans une direction distincte,
comme pour déconcerter les poursuivants. Déjà le
sillage perfide ne révélait plus la trace du plongeur.
Pour la dernière fois on le vit à une dizaine de brasses
de la rive, les soldats firent feu... des minutes et des minutes se
passèrent, rien n’apparut plus sur la surface tranquille
et déserte du lac.
Une demi-heure après, un des rameurs prétendait avoir
découvert, près de la rive, des traces de sang, mais ses
camarades secouaient la tête d’un air de doute.
[Table des matières]
LXII
Le P. Dámaso s’explique
En vain les précieux cadeaux de noce s’amoncelaient sur
une table; ni les brillants dans leurs écrins de velours, ni les
broderies de piña, ni les coupons de soie n’attiraient les
regards de Maria Clara. La jeune fille regardait, sans voir ou sans
lire, le journal qui relatait la mort d’Ibarra, noyé dans
le lac. [469]
Tout à coup elle sentit que deux mains se posaient sur ses
yeux, lui tenant la tête, tandis qu’une voix joyeuse, celle
du P. Dámaso, lui disait:
—Qui est-ce? qui est-ce?
Maria Clara sauta sur sa chaise et le regarda avec terreur.
—Petite folle, tu as eu peur, eh? tu ne m’attendais pas,
eh? Eh bien, je suis venu de province pour assister à ton
mariage.
Et, s’approchant avec un sourire de satisfaction, il lui
tendit la main pour qu’elle la baisât. Elle la prit,
tremblante, et la porta avec respect à ses lèvres.
—Qu’as-tu, Maria? demanda le franciscain, perdant son
gai sourire et sentant l’inquiétude le gagner; ta main est
froide, tu pâlis... es-tu malade, fillette?
Et le P. Dámaso l’attira à lui avec une
tendresse dont on ne l’aurait pas cru capable, puis, prenant les
deux mains de la jeune fille, il l’interrogea du regard.
—N’as-tu pas confiance en ton parrain? demanda-t-il
d’un tonde reproche; allons, assieds-toi ici et raconte-moi tes
petits chagrins, comme tu le faisais étant enfant, quand tu
voulais des cierges pour faire des poupées de cire. Tu sais que
je t’ai toujours aimée... jamais je ne t’ai
grondée...
La voix du P. Dámaso n’avait plus son ordinaire
brusquerie, les modulations en devenaient caressantes. Maria Clara se
mit à pleurer.
—Tu pleures? ma fille, pourquoi pleures-tu? Tu t’es
disputée avec Linares?
Maria Clara mit les mains sur les yeux.
—Non, ce n’est pas de lui... maintenant! cria la jeune
fille.
Le P. Dámaso la regarda effrayé.
—Tu ne veux pas me confier tes secrets? Ne me suis-je pas
efforcé de toujours satisfaire tes plus petits caprices?
La jeune fille leva vers lui ses yeux pleins de larmes, [470]le regarda un
moment, puis sanglota de nouveau amèrement.
—Ne pleure pas ainsi, ma fille, tes larmes me peinent.
Raconte-moi tes chagrins; tu verras comme ton parrain t’aime!
Maria Clara s’approcha lentement de lui, tomba à genoux
à ses pieds et, levant son visage baigné de larmes, lui
dit d’une voix basse, à peine perceptible.
—M’aimez-vous encore?
—Enfant!
—Alors... protégez mon père et faites
qu’il rompe mon mariage!
Et la jeune fille lui raconta sa dernière entrevue avec
Ibarra, tout en se taisant sur le secret de sa naissance.
Le P. Dámaso pouvait à peine croire ce qu’il
entendait.
—Tant qu’il vivait, continua-t-elle, je pouvais lutter,
j’espérais, j’avais confiance! Je voulais vivre pour
entendre parler de lui... mais maintenant qu’on l’a
tué, je n’ai plus de motifs pour vivre ni pour
souffrir.
Elle avait parlé lentement, à voix basse, avec calme,
sans pleurer.
—Mais, sotte, Linares ne vaut-il pas mille fois mieux
que...?
—Quand il vivait, je pouvais me marier... je pensais
m’enfuir après... mon père ne voulant que la
parenté! Maintenant qu’il est mort, nul autre ne
m’appellera son épouse... Quand il vivait, je pouvais
m’avilir, il me restait cette consolation de savoir qu’il
existait et que peut-être il pensait à moi; maintenant
qu’il est mort... le couvent ou la tombe!
L’accent de la jeune fille avait une telle fermeté que
le P. Dámaso réfléchit.
—Tu l’aimais donc tant? demanda-t-il en balbutiant.
Maria Clara ne répondit pas. Fr. Dámaso inclina la
tête sur sa poitrine et resta silencieux.
[471]
—Ma fille! s’écria-t-il enfin d’une voix
comme brisée; pardonne-moi de t’avoir faite malheureuse
sans le savoir! Je pensais à ton avenir, je voulais ton bonheur!
Comment pouvais-je permettre ton mariage avec un homme du pays, pour te
voir ensuite épouse malheureuse et mère
infortunée? Je ne pouvais ôter de ta tête cet amour
et je m’y suis opposé de toutes mes forces; j’ai
usé de tous les moyens, pour toi, seulement pour toi. Si tu
avais été sa femme, tu aurais pleuré ensuite,
à cause de la situation de ton mari, exposé sans
défense à toutes les vexations; mère, tu aurais
pleuré sur le sort de tes enfants. Les aurais-tu instruits? tu
leur préparais un triste avenir, ils devenaient ennemis de la
Religion, la potence ou l’exil les auraient attendus. Les
aurais-tu laissés dans l’ignorance? c’eût
été pour les voir tyrannisés et
dégradés. Je n’y pouvais consentir! C’est
pour cela que je t’ai cherché un mari qui pût te
rendre la mère heureuse d’enfants qui commandassent et
n’obéissent pas, qui châtiassent et ne souffrissent
pas... Je savais que ton ami d’enfance était bon, je
l’aimais comme j’avais aimé son père, mais je
les ai haïs tous deux dès que j’ai vu qu’ils
allaient causer ton malheur, parce que je t’aime comme on aime
une fille, parce que je t’idolâtre... Je n’ai
d’autre amour que le tien, je t’ai vue grandir, il
n’est pas une heure où je ne pense à toi, je
rêve de toi, tu es mon unique joie...
Et le P. Dámaso se mit à pleurer comme un enfant.
—Eh bien, si vous m’aimez, ne me faites pas
éternellement malheureuse; il est mort, je veux être
religieuse!
Le vieillard appuya son front sur sa main.
—Religieuse! religieuse! répéta-t-il. Tu ne
connais pas, ma fille, la vie, le mystère, tout ce qui se cache
derrière les murs du couvent, tu ne le sais pas! Je
préfère mille fois te voir malheureuse dans le monde
qu’au cloître... Ici tes plaintes peuvent s’entendre,
là tu n’auras que les murs... Tu es belle, très
belle, tu n’es pas née pour cela, pour être
épouse du Christ! Crois-moi, ma [472]fille, le temps efface tout; plus
tard, tu l’oublieras, tu aimeras, tu aimeras ton mari...
Linares.
—Ou le couvent ou... la mort! répéta Maria
Clara.
—Le couvent! le couvent ou la mort! s’écria le P.
Dámaso. Maria, je suis vieux, je ne pourrai veiller bien
longtemps sur toi, sur ta tranquillité... Choisis autre chose,
cherche un autre amour, un autre jeune homme, celui que tu voudras,
tout, mais pas le couvent.
—Le couvent ou la mort!
—Mon Dieu, mon Dieu! s’écria le prêtre, se
couvrant la figure de ses mains; tu me châties, soit! mais veille
sur ma fille!...
Et revenant à Maria Clara.
—Tu veux être religieuse? tu le seras, je ne veux pas
que tu meures.
Maria Clara lui prit les deux mains, les serra, les embrassa en
s’agenouillant.
—Parrain, mon parrain! répétait-elle.
Fr. Dámaso sortit ensuite, triste, tête basse et
soupirant.
—Dieu, Dieu, tu existes puisque tu châties! Mais
venge-toi sur moi et ne frappe pas l’innocente, sauve ma
fille!
[Table des matières]
LXIII
La «Nochebuena»
Là-haut, sur le versant de la montagne d’où
jaillit un torrent, se cache entre les arbres une cabane, construite
sur des troncs tordus. Sur son toit de kogon1, grimpent les rameaux,
chargés de fruits et de fleurs, de la calebasse; des cornes de
cerf, des têtes de sanglier, [473]quelques-unes portant de longues
défenses, ornent le rustique foyer. C’est la demeure
d’une famille tagale, vivant de la chasse et de la coupe des
bois.
A l’ombre d’un arbre, l’aïeul fait des balais
avec les nervures des palmes, tandis qu’une jeune fille place
dans un panier des œufs, des citrons et des légumes. Deux
enfants, un garçon et une fille, jouent à
côté d’un autre pâle, mélancolique, aux
grands yeux et au profond regard, assis sur un tronc renversé. A
sa mine amaigrie nous reconnaîtrons le fils de Sisa, Basilio, le
frère de Crispin.
—Quand ton pied sera guéri, lui disait la fillette,
nous jouerons pico-pico avec cachette, je serai la
mère.
—Tu monteras avec nous à la cime du mont, ajoutait le
petit garçon, tu boiras du sang de cerf avec du jus de citron et
tu engraisseras; alors je te montrerai à sauter de rocher en
rocher par dessus le torrent.
Basilio souriait avec tristesse, examinait la plaie de son pied et
regardait ensuite le soleil qui brillait splendide.
—Vends ces balais, dit l’aïeul à la jeune
fille et achète quelque chose pour tes frères,
c’est aujourd’hui Noël.
—Des pétards, je veux des pétards, cria le
petit.
—Moi, une tête pour ma poupée! clama la
petite.
—Et toi, que veux-tu? demanda le vieillard à
Basilio.
Celui-ci se leva avec peine et s’approchant du
grand-père:
—Señor, lui dit-il. J’ai donc été
malade plus d’un mois?
—Depuis que nous t’avons trouvé évanoui et
couvert de blessures, deux lunes se sont passées, nous croyions
que tu allais mourir...
—Dieu vous récompense; nous sommes très pauvres,
reprit Basilio, mais, puisque c’est aujourd’hui Noël,
je veux m’en aller au pueblo voir ma mère et mon petit
frère; ils m’auront cherché.
[474]
—Mais, fils, tu n’es pas encore bien et ton pueblo est
loin; tu n’y seras pas arrivé à minuit.
—N’importe, señor! Ma mère et mon petit
frère doivent être bien tristes; tous les ans nous
passions ensemble cette fête... l’an dernier nous avons
mangé un poisson à nous trois... ma mère aura
pleuré en me cherchant.
—Tu n’arriveras pas vivant au pueblo, garçon! Ce
soir nous avons de la poule et un morceau de sanglier. Mes fils te
chercheront quand ils reviendront des champs.
—Vous avez beaucoup d’enfants et ma mère
n’a que nous deux; peut-être me croit-elle
déjà mort! Ce soir, je veux lui faire une joie, lui
donner ses étrennes... un fils!
Le vieillard sentit s’humecter ses yeux; il mit la main sur la
tête de l’enfant et, tout ému, lui dit:
—Tu es sage comme un vieillard! Va, cherche ta mère,
donne-lui les étrennes... de Dieu, comme tu dis; si
j’avais su le nom de ton pueblo, j’y serais allé
quand tu étais malade. Va, mon fils, que Dieu et le Señor
Jésus t’accompagnent. Lucia, ma petite-fille, ira avec toi
jusqu’au prochain pueblo.
—Comment? tu t’en vas? lui demanda le garçon.
Là-bas, en bas, il y a des soldats, il y a beaucoup de voleurs?
Tu ne veux pas voir mes pétards? Pum purumpum!
—Tu ne veux pas jouer à la poule aveugle avec cachette?
demandait la petite fille; t’es-tu caché quelquefois?
Vrai, rien n’est plus amusant que d’être poursuivi et
de se cacher?
Basile sourit, il prit son bâton, et, les yeux baignés
de larmes:
—Je reviendrai bientôt, dit-il, j’amènerai
mon petit frère, vous le verrez et vous jouerez avec lui; il est
aussi grand que toi.
—Marche-t-il aussi en boitant? demanda la petite fille, alors
nous en ferons la mère au pico-pico. [475]
—Ne nous oublie pas, lui dit le vieillard; emporte cette
tranche de sanglier et donne-la à ta mère.
Les enfants l’accompagnèrent jusqu’au pont de
bambous, jeté sur le cours rapide et troublé du
torrent.
Lucia le fit s’appuyer sur son bras et, bientôt, les
enfants les perdirent tous deux de vue.
Basilio marchait légèrement malgré le bandage
qui lui serrait la jambe.
Le vent du nord siffle et les habitants de San Diego tremblent de
froid.
C’est la Nochebuena, et cependant le pueblo est triste.
Pas une lanterne de papier pendue aux fenêtres, aucun bruit dans
les maisons n’annonce la réjouissance comme les autres
années.
A l’entresol de la maison de Capitan Basilio, près
d’une grille, conversent le maître de la maison et D.
Filipo—le malheur de ce dernier les avait fait amis,—tandis
que par l’autre Sinang, sa cousine Victoria et la belle Iday
regardent vers la rue.
La lune décroissante, commence à briller à
l’horizon et argente les nuages, les arbres, les maisons,
projetant de longues et fantastiques ombres.
—C’est une chance rare que la vôtre, sortir absous
en ce moment! disait Capitan Basilio à D. Filipo; on vous a
brûlé vos livres, c’est vrai, mais d’autres
ont perdu plus.
Une femme s’approcha de la grille et regarda vers
l’intérieur. Ses yeux étaient brillants, sa figure
creuse, sa chevelure dénouée et éparse; la lune
lui donnait un aspect singulier.
—Sisa! s’écria surpris D. Filipo et se retournant
vers Capitan Basilio, tandis que la folle s’éloignait.
—N’était-elle pas chez un médecin?
demanda-t-il, on l’a déjà guérie?
Capitan Basilio sourit amèrement.
—Le médecin a eu peur d’être accusé
comme ami de D. Crisóstomo et il l’a chassée.
Maintenant elle erre [476]comme autrefois, toujours aussi folle; elle
chante, est inoffensive et vit dans le bois...
—Quels autres changements se sont encore produits dans le
pueblo depuis que nous l’avons quitté? Je sais que nous
avons un nouveau curé et un nouvel alférez...
—Terribles temps, l’Humanité recule! murmura
Capitan Basilio en songeant au passé. Voyez, le lendemain de
votre départ, le sacristain principal fut trouvé mort,
pendu dans le grenier de sa maison. Le P. Salvi fut vivement
touché par cette mort et s’empara de tous les papiers du
défunt. Ah! le philosophe Tasio est mort aussi, on l’a
enterré dans le cimetière des Chinois.
—Pauvre D. Anastasio! soupira D. Filipo, et ses livres?
—Les dévots, croyant être agréables
à Dieu, les ont brûlés. Rien n’a pu
être sauvé, pas même les œuvres de
Cicéron... le gobernadorcillo n’a rien fait pour
empêcher quoi que ce soit.
Tous deux gardèrent le silence.
En ce moment on entendait le triste et mélancolique chant de
la folle.
—Sais-tu quand Maria Clara se marie? demandait Iday à
Sinang.
—Je ne le sais pas, répondit celle-ci; j’ai
reçu une lettre d’elle, mais je ne l’ouvre pas par
crainte de le savoir. Pauvre Crisóstomo!
—On dit que si ce n’avait pas été à
cause de Linares, Capitan Tiago était pendu; que devait faire
Maria Clara? observa Victoria.
Un enfant passa en boitant; il courait vers la place
d’où partait le chant de Sisa. C’était
Basilio. L’enfant avait trouvé sa maison déserte et
en ruines; après beaucoup de demandes il avait appris que sa
mère était folle et vaguait par le pueblo; de Crispin on
ne lui avait pas dit un mot.
Basilio essuya ses larmes, étouffa son chagrin et, sans se
reposer, partit à la recherche de sa mère. Il arriva au
pueblo, s’informa d’elle et bientôt le chant vint [477]frapper ses
oreilles. Le malheureux, malgré la faiblesse de ses jambes,
voulut courir pour se jeter dans les bras de sa mère.
La folle quitta la place et arriva devant la maison du nouvel
alférez. Maintenant comme autrefois une sentinelle est à
la porte et une tête de femme se montre à la
fenêtre; mais ce n’est plus la Méduse, c’est
une jeune femme: alférez et mal partagé ne sont pas
toujours synonymes.
Sisa commença à chanter devant la maison, regardant la
lune qui régnait dans le ciel bleu entre des nuages d’or.
Basilio voyait sa mère et n’osait pas s’en
approcher; il espérait peut-être qu’elle quitterait
cet endroit: il allait d’un côté à
l’autre, mais évitant toujours de s’approcher du
quartier.
La jeune femme qui était à la fenêtre
écoutait attentive le chant de la folle; elle commanda à
la sentinelle de la faire monter.
Sisa, à la vue du soldat qui s’approchait, à sa
voix, terrifiée se mit à courir, et Dieu sait comment
peut courir une folle. Basilio la vit s’enfuir et, craignant de
la perdre, oubliant la douleur de ses pieds, il se jeta à sa
poursuite.
—Regardez comme ce gamin poursuit la folle!
s’écria indignée une servante qui se trouvait dans
la rue!
Et voyant qu’il ne cessait pas sa course, elle prit une pierre
et la lança contre lui en disant:
—Quel malheur que le chien soit attaché.
Basilio sentit un coup frapper sa tête, mais il continua
à courir sans s’en occuper. Les chiens aboyaient, les oies
criaient, quelques fenêtres s’ouvraient pour donner passage
à la tête d’un curieux, d’autres se fermaient
par crainte d’une nouvelle nuit de troubles.
Promptement, ils furent hors du pueblo. Sisa commença
à modérer sa course; une grande distance la
séparait de son poursuivant.
—Mère! lui cria-t-il quand il la distingua.
La folle entendit à peine la voix qu’elle reprit sa
course. [478]
—Mère! c’est moi! criait l’enfant
désespéré.
La folle n’entendait pas, le pauvre petit la suivait haletant.
Les champs cultivés étaient maintenant
dépassés, déjà ils étaient sur la
lisière du bois.
Basilio vit sa mère y entrer; il l’y suivit. Les
buissons, les arbustes, les joncs épineux, les racines des
arbres saillant hors de terre entravaient leur marche. L’enfant
suivait la silhouette de sa mère, éclairée par
instant des rayons de la lune, traversant les branchages touffus.
C’était le bois mystérieux de la famille
d’Ibarra.
Basilio plusieurs fois trébucha et tomba, mais il se
relevait, insensible à la douleur; toute son âme se
concentrait dans ses yeux qui ne perdaient pas de vue la figure
chérie.
Ils passèrent le ruisseau qui murmurait doucement; les
épines des roseaux, tombées sur le bord du rivage,
s’enfonçaient dans ses pieds nus: il ne
s’arrêtait pas pour les arracher.
A sa grande surprise, il vit que sa mère
s’enfonçait dans les fourrés et entrait par la
porte de bois fermant la tombe du vieil Espagnol au pied du
balitî.
Il s’efforça de la suivre, mais la porte était
fermée. De ses bras décharnés, de sa tête
échevelée, Sisa défendait l’entrée,
maintenant la porte fermée de toutes ses forces.
—Mère, c’est moi, c’est moi, c’est
Basilio, votre fils! cria l’enfant exténué en se
laissant tomber.
Mais la folle ne cédait pas; s’appuyant des pieds
contre le sol, elle offrait une énergique résistance.
Basilio frappa la porte de son poing, de sa tête
baignée de sang, pleura, tout fut vain. Se levant
péniblement il regarda le mur, pensant à
l’escalader, mais il ne trouva rien qui l’y aidât. Il
en fit alors le tour et vit une branche du fatidique balitî se
croisant avec une de celles d’un autre arbre. Il grimpa; son
amour filial faisait des miracles, de branche en branche, il parvint au
balitî, et vit sa mère soutenant encore avee sa tête
les planches de la porte. [479]
Le bruit qu’il faisait dans les branches appela
l’attention de Sisa; elle se retourna, voulut fuir, mais son
fils, se laissant tomber de l’arbre, la saisit dans ses bras, la
couvrit de baisers, puis, épuisé,
s’évanouit.
Sisa vit le front baigné de sang; elle s’inclina vers
lui; ses yeux tendus à sortir de leurs orbites se
fixèrent sur cette figure dont la mine pâlie secoua les
cellules endormies de son cerveau; quelque chose comme une
étincelle en jaillit, elle reconnut son fils, et, poussant un
cri, tomba sur l’enfant évanoui, le pressant sur son
cœur, l’embrassant et pleurant.
Mère et fils restèrent immobiles.
Quand Basilio revint à lui, il trouva sa mère sans
connaissance. Il l’appela, lui prodigua les noms les plus tendres
et, voyant qu’elle ne respirait pas, qu’elle ne se
réveillait pas, il se leva, courut à l’arroyo
chercher un peu d’eau dans un cornet de feuilles de platane et en
arrosa le pâle visage de sa mère. Mais la folle ne fit pas
le moindre mouvement, ses yeux restèrent fermés.
Epouvanté, Basilio la regarda; il appuya son oreille sur le
cœur de sa mère, mais le sein amaigri et flétri de
la pauvre femme était déjà froid, le cœur ne
battait plus: il posa les lèvres sur ses lèvres et ne
perçut aucun souffle. Le malheureux embrassa le cadavre et
pleura amèrement.
Dans le ciel la lune brillait toujours majestueuse, la brise
soufflait en soupirant dans les branches et, dans l’herbe, les
grillons fredonnaient.
La nuit de lumière et de joie pour tant d’enfants qui,
au foyer bien chaud de la famille, célèbrent la
fête des plus doux souvenirs, la fête qui rappelle le
premier regard d’amour que le ciel envoya à la terre,
cette nuit où toutes les familles chrétiennes mangent,
boivent, dansent, chantent, rient, jouent, aiment,
s’embrassent... cette nuit qui, dans les pays froids, est magique
pour l’enfance avec son traditionnel sapin chargé de
lumières, de poupées, de bonbons, de bibelots que [480]regardent
éblouis ces yeux arrondis où se reflète
l’innocence, cette nuit n’offrait à Basilio que la
solitude et le deuil. Qui sait? Peut-être au foyer du taciturne
P. Salvi des enfants jouent-ils, peut-être y chante-t-on
La Nochebuena vient
La Nochebuena s’en va...
L’enfant pleura et gémit beaucoup; quand il leva la
tête, un homme était devant lui qui le contemplait en
silence.
L’inconnu lui demanda à voix basse:
—Tu es le fils?
L’enfant affirma d’un signe de tête.
—Que penses-tu faire?
—L’enterrer.
—Au cimetière?
—Je n’ai pas d’argent et le curé ne le
permettrait pas.
—Alors...?
—Si vous voulez m’aider...
—Je suis trop faible, répondit l’homme qui se
laissa tomber peu à peu sur le sol, en s’appuyant des deux
mains à terre; je suis blessé... il y a deux jours que je
n’ai ni mangé ni dormi... Personne n’est venu cette
nuit?
L’homme restait pensif, regardant l’intéressante
physionomie du jeune garçon.
—Écoute? continua-t-il d’une voix plus faible; je
serai mort, moi aussi, avant le jour... A vingt pas d’ici, de
l’autre côté de l’arroyo, il y a un gros tas
de bois; apportes-en, fais un bûcher, places-y nos deux cadavres,
recouvre-les et allume du feu, un grand feu, jusqu’à ce
que nous soyons réduits en cendres...
Basile écoutait.
—Ensuite, si personne ne vient... tu creuseras ici, tu
trouveras beaucoup d’or... et tout sera à toi.
Étudie!
La voix de l’inconnu se faisait de plus en plus
inintelligible. [481]
—Va chercher le bois... je veux t’aider.
Basilio s’éloigna. L’inconnu tourna la tête
vers l’Orient et murmura comme s’il priait:
—Je meurs sans voir l’aurore briller sur ma patrie...!
vous, qui la verrez, saluez-la... n’oubliez pas ceux qui sont
tombés pendant la nuit!
Il leva ses yeux au ciel, ses lèvres
s’agitèrent, comme murmurant une ultime oraison, puis il
baissa la tête et lentement, tomba à terre...
Deux heures plus tard, sœur Rufa était dans le
batalan2
de sa maison, faisant ses ablutions matinales avant d’aller
à la messe. La pieuse femme, regardant vers le bois voisin, vit
monter une grosse colonne de fumée; elle fronça les
sourcils et, saisie d’une sainte indignation,
s’écria:
—Quel est l’hérétique qui dans un jour de
fête fait kaiñgin3? C’est de là que
viennent tant de malheurs! Va-t’en au Purgatoire, et tu verras si
je te tire de là, sauvage!
[Table des matières]
Épilogue
Comme beaucoup de nos personnages vivent encore et que nous avons
perdu de vue les autres, un véritable épilogue est
impossible. Pour le bien de tous, nous les tuerions avec plaisir en
commençant par le P. Salvi et en terminant par Da. Victorina,
mais ce n’est pas possible... Qu’ils vivent! c’est le
pays et non nous qui doit les nourrir...
Depuis que Maria Clara est entrée au couvent, le P.
Dámaso a quitté son pueblo pour habiter Manille, comme le
P. Salvi qui, en attendant une mitre vacante, prêche souvent
à l’église de Santa Clara, au couvent de [482]laquelle il
occupe un emploi important. Peu de mois après, le P.
Dámaso recevait du T. R. P. Provincial l’ordre de
retourner comme curé dans une province très lointaine. On
dit qu’il en eut une telle contrariété que le
lendemain on le trouva mort dans son lit. Selon les uns,
c’était l’apoplexie qui l’avait tué,
selon les autres un cauchemar, le médecin dissipa tous les
doutes en déclarant qu’il était mort
subitement.
Personne maintenant ne reconnaîtrait Capitan Tiago. Quelques
semaines déjà avant la prise de voile de Maria Clara il
était tombé dans un abattement tel qu’il
commença à maigrir; en même temps son
caractère changea: il devint triste, méditatif,
méfiant comme son ex-ami, le malheureux Capitan Tinong.
Aussitôt que se furent fermées les portes du couvent, il
ordonna à sa cousine désolée, la tante Isabel, de
recueillir tout ce qui avait appartenu à sa fille et à sa
défunte épouse et de s’en aller à Malabon ou
à San Diego car, désormais, il voulait vivre seul. Il
s’adonna avec furie au liampô et à la
gallera, et commença à fumer l’opium. Il ne va plus
à Antipolo, il ne commande plus de messes; Da. Patrocinio, sa
vieille concurrente, célèbre pieusement son triomphe en
ronflant pendant les sermons. Si quelquefois, à la tombée
de la nuit, vous passez par la première rue de Santo Cristo,
vous verrez, assis dans la boutique d’un Chinois, un homme petit,
jaune, maigre, courbé, les yeux creusés et somnolents,
les lèvres et les ongles sales, regardant les gens comme
s’il ne les voyait pas. À la tombée de la nuit,
vous le verrez se lever avec peine, et, appuyé sur un
bâton, se diriger vers une étroite impasse, entrer dans
une cahute sale sur la porte de laquelle on lit en grandes lettres
rouges:
Fumadero publico de
anfion1.
C’est là ce capitan Tiago si célèbre,
aujourd’hui complètement oublié, même du
sacristain principal. [483]
Da. Victorina a ajouté à ses fausses frisures et
à son andalousement, si l’on nous permet cette
expression, la nouvelle manie de vouloir conduire elle-même les
chevaux de la voiture, obligeant D. Tiburcio à rester
tranquille. Comme la faiblesse de sa vue est cause de beaucoup
d’accidents, elle fait usage de lorgnons qui lui donnent un
aspect bizarre. Le docteur n’a plus voulu être
appelé pour assister personne: nombreux sont les jours de la
semaine où les domestiques le voient sans dents, ce qui, on le
sait, est de très mauvais augure.
Linares, seul défenseur de cette malheureuse, se repose
quelque temps à Paco, victime d’une dyssenterie et des
mauvais traitements de sa parente.
Le victorieux alférez est parti en Espagne, lieutenant avec
le grade de commandant; il a laissé son aimable femme dans sa
chemise de flanelle dont la couleur est déjà
inqualifiable. La pauvre Ariane, se voyant abandonnée,
s’est consacrée, comme la fille de Minos, au culte de
Bacchus et à la culture du tabac; elle boit et fume avec une
telle passion que les jeunes filles ne sont plus seules à la
craindre, mais aussi les vieilles femmes et les enfants.
Beaucoup de nos connaissances du pueblo de San Diego vivent
probablement encore, s’il ne s’en est pas trouvé
parmi les victimes de l’explosion du vapeur
«Lipa» qui fait le voyage de Manille à cette
province. Comme personne ne s’est inquiété de
savoir quels furent les malheureux qui périrent dans cette
catastrophe, ni à qui appartenaient les bras et les jambes
éparpillés dans l’Ile de la Convalecencia et sur
les rives du rio, nous ignorons complètement si, parmi ces
malheureux, se trouvait quelqu’un de nos amis. Nous sommes
satisfaits, comme le furent alors le gouvernement et la presse, de
savoir que le seul moine qui était dans le vapeur s’est
sauvé et nous n’en demandons pas davantage. Le principal
pour nous est la vie des prêtres vertueux
[484]dont Dieu prolonge le
règne aux Philippines pour le bien de nos âmes2.
De Maria Clara on ne sut plus rien sinon que le sépulcre
semblait l’avoir gardée dans son sein. Nous nous sommes
informé près de diverses personnes de beaucoup
d’influence, mais aucune n’a voulu nous en dire un seul
mot, pas même les dévotes bavardes, qui reçoivent
de la fameuse friture de foies de poules et de la sauce plus fameuse
encore, appelée «des religieuses»,
préparées par l’intelligente cuisinière des
Vierges du Seigneur.
Cependant:
Une nuit de septembre, l’ouragan rugissait et frappait de ses
gigantesques ailes les édifices de Manille; le tonnerre
résonnait à chaque instant, les éclairs
illuminaient par moments les ravages du vent
déchaîné et plongeaient les habitants dans une
épouvantable terreur. La pluie tombait à torrents. Aux
lueurs qui zébraient l’obscurité on voyait parfois
un morceau de toit, un volet emportés par le vent,
s’abattre avec un horrible fracas: pas une voiture, pas un
passant ne se risquait par les rues. Quand l’écho rauque
du tonnerre, cent fois répercuté, se perdait au loin, on
entendait le soupir du vent qui faisait tourbillonner la pluie,
produisant un trac-trac répété contre les conchas
des fenêtres fermées.
Des gardes s’étaient abrités dans un
édifice en construction près du couvent:
c’étaient un soldat et un distinguido3.
—Que faisons-nous ici? disait le soldat; il n’y a
personne dans la rue... nous devrions aller quelque part; ma
maîtresse demeure dans la calle del Arzobispo.
—D’ici là, il y a un bon bout, et nous nous
mouillerons, répondit le distinguido. [485]
—Qu’est-ce que cela fait, pourvu que la foudre ne nous
tue pas?
—Bah! n’aie pas peur; les religieuses doivent avoir un
paratonnerre pour se garer.
—Oui, dit le soldat, mais à quoi sert-il quand la nuit
est aussi obscure.
Et il leva les yeux pour voir dans l’ombre: en ce moment, un
éclair répété brilla, suivi d’un
formidable coup de tonnerre.
—Naku! Susmariôsep4! s’écria le
soldat en se signant. Et, secouant son camarade: Allons-nous en
d’ici!
—Qu’as-tu?
—Allons-nous en, allons-nous en d’ici!
répéta-t-il en claquant les dents de terreur.
—Qu’as-tu vu?
—Un fantôme! murmura-t-il tremblant.
—Un fantôme?
—Sur le toit... ce doit être la sœur qui recueille
des braises pendant la nuit.
Le distinguido avança la tête et voulut voir.
Un autre éclair brilla, une veine de feu sillonna le ciel,
laissant entendre un horrible éclat.
—Jésus! s’écria-t-il en se signant
à son tour.
En effet, à la lueur brillante du météore, il
avait vu une figure blanche, debout, presque sur le faîtage du
toit, les bras et la figure dirigés vers le ciel comme pour
l’implorer. Le ciel répondait par ses éclairs et
son tonnerre! Après le coup de tonnerre on entendit une triste
plainte.
—Ce n’est pas le vent, c’est le fantôme!
murmura le soldat comme répondant à la pression de mains
de son compagnon.
—Ay! ay! ce cri traversait l’air, dominant le bruit de
la pluie; le vent ne pouvait couvrir de ses sifflements cette voix
douce et plaintive, pleine de désespoir.
[486]
Un autre éclair brilla avec une intensité
éblouissante.
—Non, ce n’est pas un fantôme!
s’écria le distinguido, je l’ai vue autrefois; elle
est belle comme la Vierge... Allons-nous en d’ici!
Le soldat ne se fit pas répéter l’invitation et
tous deux disparurent.
Qui donc gémit ainsi au milieu de la nuit, malgré le
vent, la pluie et la tempête? Qui, la timide vierge,
l’épouse de Jésus-Christ; elle défie les
éléments déchaînés et choisit la nuit
redoutable et le libre ciel pour, d’une hauteur
périlleuse, exhaler ses plaintes à Dieu? Le Seigneur
aurait-il abandonné son temple dans le couvent,
n’écouterait-il plus les supplications? Les voûtes
saintes ne laisseraient-elles pas les soupirs de cette âme monter
jusqu’au trône du Très-Miséricordieux?
La tempête hurla furieuse presque toute la nuit; pas une
étoile ne brilla; les cris désespérés,
mêlés aux soupirs du vent continuèrent, mais la
nature et les hommes étaient sourds; Dieu s’était
voilé, il n’entendait pas.
Le lendemain quand, le ciel débarrassé des nuages
obscurs, le soleil brilla de nouveau au milieu de l’éther
purifié, une voiture s’arrêta à la porte du
couvent de Santa Clara, un homme en descendit qui excipa de sa
qualité de représentant de l’Autorité et
demanda à parler immédiatement à l’abbesse
et à voir toutes les religieuses.
On raconte qu’il en parut une portant un habit tout
mouillé, en lambeaux, qui demanda en pleurant la protection de
cet homme contre les violences de l’hypocrisie et qui
dénonça des horreurs. On raconte aussi qu’elle
était très belle et avait les yeux les plus beaux et les
plus expressifs qui se puissent voir.
Le représentant de l’Autorité n’accueillit
pas cette plainte; il parlementa avec l’abbesse et, malgré
ses larmes et ses prières, abandonna la malheureuse. La jeune
religieuse vit se fermer la porte derrière lui, comme le
damné doit voir se fermer les portes du ciel, si toutefois [487]le ciel est
aussi injuste et aussi cruel que les hommes. L’abbesse avait
déclaré que la pauvre fille était folle.
L’homme ne savait-il pas qu’à Manille est
un’hospice pour les déments? ou bien encore jugeait-il que
le couvent de religieuses n’était par lui-même
qu’un asile de folles? Encore que l’on prétende
qu’il était suffisamment ignorant pour ne pas
reconnaître quoi que ce soit, surtout s’il s’agissait
de décider qu’une personne était ou
n’était pas en possession de sa raison.
On raconte encore que, lorsque le fait lui fut connu, le
général Sr. J.5, en eut une opinion différente. Il voulut
protéger cette folle et demanda à la voir.
Mais cette fois, aucune jeune fille belle et
désespérée n’apparut et l’abbesse,
invoquant le nom de la Religion et les Saints Statuts, ne permit pas
que l’on visitât le cloître.
On ne parla plus jamais ni de cet incident ni de la malheureuse
Maria Clara.
FIN