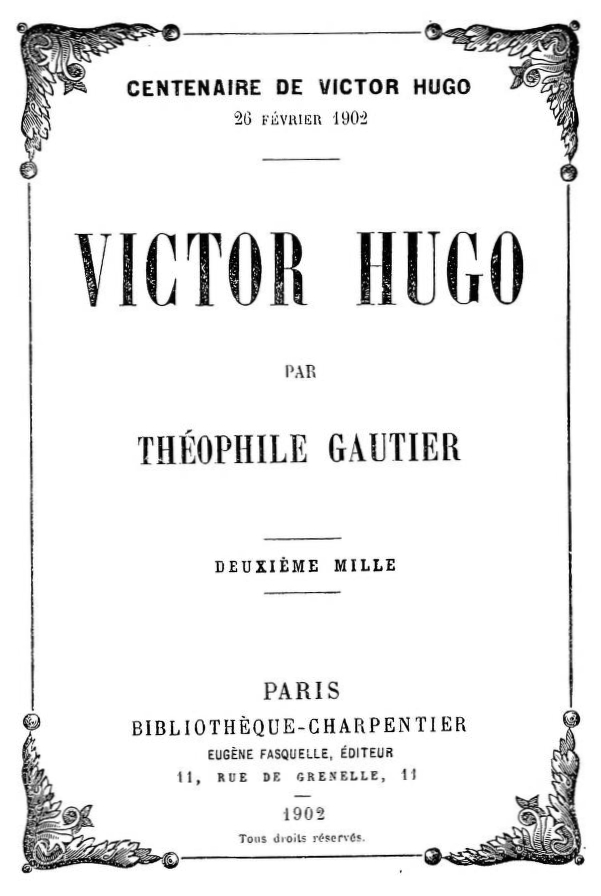
The Project Gutenberg EBook of Victor Hugo, by Théophile Gautier This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Victor Hugo Author: Théophile Gautier Release Date: May 3, 2016 [EBook #51977] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VICTOR HUGO *** Produced by Laura Natal Rodriguez and Marc D'Hooghe at http://www.freeliterature.org (Images generously made available by the Hathi Trust.)
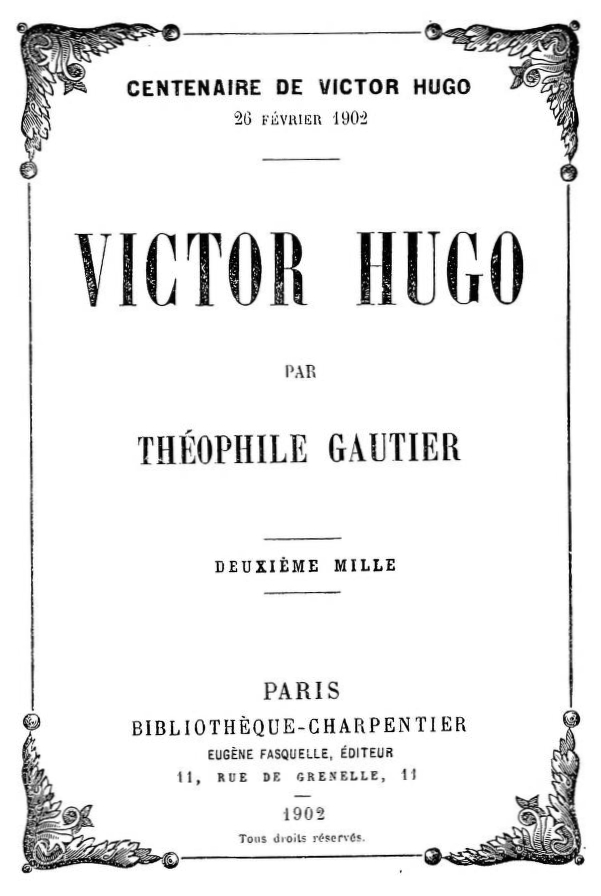
«Si j'avais le malheur de croire qu'un vers de Victor Hugo n'est pas beau, je n'oserais pas me l'avouer à moi-même, tout seul, dans une cave, sans chandelle.»
THÉOPHILE GAUTIER
1830!... Les générations actuelles doivent se figurer difficilement l'effervescence des esprits à cette époque; il s'opérait un mouvement pareil à celui de la Renaissance. Une sève de vie nouvelle circulait impétueusement. Tout germait, tout bourgeonnait, tout éclatait à la fois. Des parfums vertigineux se dégageaient des fleurs; l'air grisait, on était fou de lyrisme et d'art. Il semblait qu'on vînt de retrouver le grand secret perdu, et cela était vrai, on avait retrouvé la poésie.
On ne saurait imaginer à quel degré d'insignifiance et de pâleur en était arrivée la littérature. La peinture ne valait guère mieux. Les derniers élèves de David étalaient leur coloris fade sur les vieux poncifs gréco-romains. Les classiques trouvaient cela parfaitement beau; mais devant ces chefs-d'œuvre, leur admiration ne pouvait s'empêcher de mettre la main devant la bouche pour masquer un bâillement, ce qui ne les rendait pas plus indulgents pour les artistes de la jeune école, qu'ils appelaient des sauvages tatoués et qu'ils accusaient de peindre avec «un balai ivre». On ne laissait pas tomber leurs insultes à terre; on leur renvoyait momies pour sauvages, et de part et d'autre on se méprisait parfaitement.
En ce temps-là, notre vocation littéraire n'était pas encore décidée; notre intention était d'être peintre, et, dans cette idée, nous étions entré à l'atelier de Rioult.
On lisait beaucoup alors dans les ateliers. Les rapins aimaient les lettres, et leur éducation spéciale, les mettant en rapport familier avec la nature, les rendait plus propres à sentir les images et les couleurs de la poésie nouvelle. Ils ne répugnaient nullement aux détails précis et pittoresques si désagréables aux classiques. Habitués à leur libre langage entremêlé de termes techniques, le mot propre n'avait pour eux rien de choquant. Nous parlons des jeunes rapins, car il y avait aussi les élèves bien sages, fidèles, au dictionnaire de Chompré et au tendon d'Achille, estimés du professeur et cités par lui pour exemple. Mais ils ne jouissaient d'aucune popularité, et l'on regardait avec pitié leur sobre palette où ne brillait ni vert véronèse, ni jaune indien, ni laque de Smyrne, ni aucune des couleurs séditieuses proscrites par l'Institut.
Chateaubriand peut être considéré comme l'aïeul, ou, si vous l'aimez mieux, comme le Sachem du Romantisme en France. Dans le Génie du Christianisme il restaura la cathédrale gothique; dans les Natchez, il rouvrit la grande nature fermée; dans René, il inventa la mélancolie et la passion moderne. Par malheur, à cet esprit si poétique manquaient précisément les deux ailes de la poésie—le vers—ces ailes, Victor Hugo les avait, et d'une envergure immense, allant d'un bout à l'autre du ciel lyrique, il montait, il planait, il décrivait des cercles, il se jouait avec une liberté et une puissance qui rappelaient le vol de l'aigle.
Quel temps merveilleux! Walter Scott était alors dans toute sa fleur de succès; on s'initiait aux mystères du Faust de Gœthe, qui contient tout, selon l'expression de Mme de Staël, et même quelque chose d'un peu plus que tout. On découvrait Shakespeare sous la traduction un peu raccommodée de Letourneur, et les poèmes de lord Byron, le Corsaire, Lara, le Giaour, Manfred, Beppo, Don Juan, nous arrivaient de l'Orient, qui n'était pas banal encore. Comme tout cela était jeune, nouveau, étrangement coloré d'enivrante et forte saveur! La tête nous en tournait; il semblait qu'on entrât dans des mondes inconnus. À chaque page on rencontrait des sujets de composition qu'on se hâtait de crayonner ou d'esquisser furtivement, car de tels motifs n'eussent pas été du goût du maître et auraient pu, découverts, nous valoir un bon coup d'appui-main sur la tête.
C'était dans ces dispositions d'esprit que nous dessinions notre académie, tout en récitant à notre voisin de chevalet le Pas d'armes du roi Jean ou la Chasse du Burgrave. Sans être encore affilié à la bande romantique, nous lui appartenions par le cœur! La préface de Cromwell rayonnait à nos yeux comme les Tables de la Loi sur le Sinaï, et ses arguments nous semblaient sans réplique. Les injures des petits journaux classiques contre le jeune maître, que nous regardions dès lors et avec raison comme le plus grand poète de France, nous mettaient en des colères féroces. Aussi brûlions-nous d'aller combattre l'hydre du perruquinisme, comme les peintres allemands qu'on voit montés sur Pégase, Cornélius en tête, à l'instar des quatre fils Aymon dans la fresque de Kaulbach, à la Pinacothèque nouvelle de Munich. Seulement une monture moins classique nous eût convenu davantage, l'hippogriffe, de l'Arioste, par exemple.
Hernani se répétait, et, au tumulte qui se faisait déjà autour de la pièce, on pouvait prévoir que l'affaire serait chaude. Assister à cette bataille, combattre obscurément dans un coin pour la bonne cause était notre vœu le plus cher, notre ambition la plus haute; mais la salle appartenait, disait-on, à l'auteur, au moins pour les premières représentations, et l'idée de lui demander un billet, nous, rapin inconnu, nous semblait d'une audace inexécutable...
Heureusement, Gérard de Nerval, avec qui nous avions eu au collège Charlemagne une de ces amitiés d'enfance que la mort seul dénoue, vint nous faire une de ces rapides visites inattendues dont il avait l'habitude et où, comme une hirondelle familière entrant par la fenêtre ouverte, il voltigeait autour de la chambre en poussant de petits cris, et ressortait bientôt, car cette nature légère, ailée, que des souffles semblaient soulever comme Euphorion, le fils d'Hélène et de Faust, souffrait visiblement à rester en place, et le mieux pour causer avec lui, c'était de l'accompagner dans la rue. Gérard, à cette époque, était déjà un assez grand personnage. La célébrité l'était venue chercher sur les bancs du collège. À dix-sept ans, il avait eu un volume de vers imprimé, et, en lisant la traduction de Faust par ce jeune homme presque enfant encore, l'olympien de Weimar avait daigné dire qu'il ne s'était jamais si bien compris. Il connaissait Victor Hugo, était reçu dans la maison, et jouissait bien justement de toute la confiance du maître, car jamais nature ne fut plus délicate, plus dévouée et plus loyale.
Gérard était chargé de recruter des jeunes gens pour cette soirée qui menaçait d'être si orageuse et soulevait d'avance tant d'animosités. N'était-il pas tout simple d'opposer la jeunesse à la décrépitude, les crinières aux crânes chauves, l'enthousiasme à la routine, l'avenir au passé?
Il avait dans ses poches, plus encombrées de livres, de bouquins, de brochures, de carnets à prendre des noies, car il écrivait en marchant, que celles du Colline de la Vie de Bohème, une liasse de petits carrés de papier rouge timbrés d'une griffe mystérieuse inscrivant au coin du billet le mot espagnol: hierro, voulant dire fer. Celte devise, d'une hauteur castillane bien appropriée au caractère d'Hernani, et qui eût pu figurer sur son blason signifiait aussi qu'il fallait être, dans la lutte, franc, brave et fidèle comme l'épée.
Nous ne croyons pas avoir éprouvé de joie plus vive en notre vie que lorsque Gérard, détachant du paquet six carrés de papier rouge, nous les tendit d'un air solennel, en nous recommandant de n'amener que des hommes sûrs. Nous répondions sur notre tête de ce petit groupe, de cette escouade dont le commandement nous était confié.
Parmi nos compagnons d'atelier, il y avait deux romantiques féroces qui auraient mangé de l'académicien; parmi nos condisciples de Charlemagne, deux jeunes poètes qui cultivaient secrètement la rime riche, le mot propre et la métaphore exacte, et ayant grand-peur d'être déshérités par leurs parents, pour ces méfaits. Nous les enrôlâmes en exigeant d'eux le serment de ne faire aucun quartier aux Philistins. Un cousin à nous compléta la petite bande qui se comporta vaillamment, nous n'avons pas besoin de le dire.
Les haines entre classiques et romantiques étaient aussi vives que celles des guelfes et des gibelins, des gluckistes et des piccinistes. Le succès fut éclatant comme un orage, avec sifflements des vents, éclairs, pluie et foudres. Toute une salle soulevée par l'admiration frénétique des uns et la colère opiniâtre des autres!
A dater de là, je fus considéré comme un chaud néophyte, et j'obtins le commandement d'une petite escouade à qui je distribuais des billets rouges. On a dit et imprimé qu'aux batailles d'Hernani j'assommais les bourgeois récalcitrants avec mes poings énormes. Ce n'était pas l'envie qui me manquait, mais les poings. J'avais dix-huit ans à peine, j'étais frêle et délicat, et je gantais sept un quart. Je fis, depuis, toutes les grandes campagnes romantiques. Au sortir du théâtre, nous écrivions sur les murailles: «Vive Victor Hugo!» pour propager sa gloire et ennuyer les philistins. Jamais Dieu ne fut adoré avec plus de ferveur qu'Hugo. Nous étions étonnés de le voir marcher avec nous dans la rue comme un simple mortel, et il nous semblait qu'il n'eût dû sortir par la ville que sur un char triomphal traîné par un quadrige de chevaux blancs, avec une Victoire ailée suspendant une couronne d'or au-dessus de sa tête.
Le gilet rouge! on en parle encore après plus de quarante ans, et l'on en parlera dans les âges futurs, tant cet éclair de couleur est entré profondément dans l'œil du public. Si l'on prononce le nom de Théophile Gautier devant un philistin, n'eût-il jamais lu de nous deux vers ou une seule ligne, il nous connaît au moins par le gilet rouge que nous portions à la première représentation d'Hernani, et il dit d'un air satisfait d'être si bien renseigné: «Oh oui! le jeune homme au gilet rouge et aux longs cheveux!» C'est la notion de nous que nous laisserons à l'univers. Nos poésies, nos livres, nos articles, nos voyages seront oubliés; mais l'on se souviendra de notre gilet rouge. Cette étincelle se verra encore lorsque tout ce qui nous concerne sera depuis longtemps éteint dans la nuit, et nous fera distinguer des contemporains dont les œuvres ne valaient pas mieux que les nôtres et qui avaient des gilets de couleur sombre. Il ne nous déplaît pas, d'ailleurs, de laisser de nous cette idée; elle est farouche et hautaine, et, à travers un certain mauvais goût de rapin, montre un assez aimable mépris de l'opinion et du ridicule.
Qui connaît le caractère français conviendra que cette action de se produire dans une salle de spectacle où se trouve rassemblé ce qu'on appelle tout Paris avec des cheveux aussi longs que ceux d'Albert Durer et un gilet aussi rouge que la muleta d'un torrero andalou, exige un autre courage et une autre force d'âme que de monter à l'assaut d'une redoute hérissée de canons vomissant la mort. Car dans chaque guerre une foule de braves exécutent, sans se faire prier, cette facile prouesse, tandis qu'il ne s'est trouvé jusqu'à présent qu'un seul Français capable de mettre sur sa poitrine un morceau d'étoffe d'une nuance si insolite, si agressive, si éclatante. A l'imperturbable dédain avec lequel il affrontait les regards, on devinait que, pour peu qu'on l'eût poussé, il fut revenu à la seconde représentation pavoisé d'un gilet jonquille.
Ce dut être, plutôt encore que l'étrangeté de la couleur, cette folie d'héroïsme qui s'exposait avec un sang-froid si parfait aux railleries des jeunes femmes, aux hochements de tête des vieillards, aux lorgnons dédaigneux des dandys, aux gros rires des bourgeois, qui causa le profond étonnement du public et perpétua cette impression qui eût dû être oubliée après le premier entr'acte.
Après avoir essayé de déchirer ce gilet de Nessus qui s'incrustait à notre peau, nous l'acceptâmes bravement devant l'imagination des bourgeois dont l'œil halluciné ne nous voit jamais habillé d'une autre couleur, malgré les paletots tête-de-nègre, vert bronze, marron, mâchefer, suie-d'usine, fumée-de-Londres, gris de fer, olive pourrie, saumure tournée et autres teintes de bon goût, dans les gammes neutres, comme peut en trouver, a la suite de longues méditations, une civilisation qui n'est pas coloriste.
Il en est de même de nos cheveux. Nous les avons portés courts, mais cela n'a servi à rien: ils passaient toujours pour longs, et eussions-nous arrondi à l'orchestre sous l'artillerie des lorgnettes, un crâne aux tons d'ivoire nu et luisant comme un œuf d'autruche, toujours on eût assuré que sur nos épaules roulaient à grands flots des cascades de cheveux mérovingiennes,—ce qui était bien ridicule!—Aussi nous avons donné carte blanche à ceux qui nous restent, et ils en ont profité—les traîtres—pour nous conserver un petit air d'Absalon romantique.
Nous avons dit, dès les premières lignes de cette série de souvenirs, comment nous avions été recruté par Gérard pour la bande d'Hernani dans l'atelier de Rioult, et investi du commandement d'une petite escouade répondant au mot d'ordre Hierro. Cette soirée devait être, selon nous et avec raison, le plus grand événement du siècle, puisque c'était l'inauguration de la libre, jeune et nouvelle Pensée sur les débris des vieilles routines, et nous désirions la solenniser par quelque toilette d'apparat, quelque costume bizarre et splendide faisant honneur au maître, à l'école et à la pièce. Le rapin dominait encore chez nous le poète, et les intérêts de la couleur nous préoccupaient fort. Pour nous le monde se divisait en flamboyants et en grisâtres, les uns objet de notre amour, les autres de notre aversion. Nous voulions la vie, la lumière, le mouvement, l'audace de pensée et d'exécution, le retour aux belles époques de la Renaissance et à la vraie antiquité, et nous rejetions le coloris effacé, le dessin maigre et sec, les compositions pareilles à des groupements de mannequins, que l'Empire avait légués à la Restauration.
Grisâtre avait aussi des acceptions littéraires dans notre pensée: Diderot était un flamboyant, Voltaire un grisâtre, de même que Rubens et Poussin. Mais nous avions en outre un goût particulier, l'amour du rouge; nous aimions cette noble couleur, déshonorée maintenant par les fureurs politiques, qui est la pourpre, le sang, la vie, la lumière, la chaleur, et qui se marie si bien à l'or et au marbre, et cela était un vrai chagrin pour nous de la voir disparaître de la vie moderne et même de la peinture. Avant 1789, on pouvait porter un manteau écarlate avec des galons d'or; et à présent, pour voir quelques échantillons de cette teinte proscrite, on en était réduit à regarder la garde suisse relever le poste ou les habits rouges des fox-hunters des chasses anglaises aux vitrines des marchands d'estampes. Hernani n'est-il pas une occasion sublime pour réintégrer le rouge dans la place qu'il n'aurait jamais dû cesser d'occuper? et n'est-il pas convenable qu'un jeune rapin à cœur de lion se fasse le chevalier du Rouge et vienne secouer le flamboiement de la couleur odieuse aux grisâtres, sur ce tas de classiques également ennemis des splendeurs de la poésie? Ces bœufs verront du rouge et entendront des vers d'Hugo.
Nous n'avons pas la prétention de corriger une légende, mais nous devons cependant dire que ce gilet était un pourpoint taillé dans la forme des cuirasses de Milan ou des pourpoints des Valois busqués en pointe sur le ventre en formant arête dans le milieu. On a dit que nous savions beaucoup de mots, mais nous n'en connaissons pas, il faut l'avouer, qui puissent exprimer suffisamment l'air ahuri de notre tailleur lorsque nous lui exposâmes ce plan de gilet.
Il demeura stupide,
aurait-il pu s'exclamer comme l'Hippolyte de Pradon en entendant l'aveu de Phèdre; et les cahiers d'expression du peintre Lebrun, à la page de l'ÉTONNEMENT, ne contiennent pas de têtes aux pupilles plus dilatées, aux sourcils plus surélevés et chassant les rides du front vers la racine des cheveux, que cette offerte en ce moment par l'honnête Gaulois (c'était son nom). Il nous crut fou, mais le respect l'empêchant de découvrir sa pensée tout entière pour la famille duquel il avait de la considération, il se contenta d'objecter d'une voix timide:
—Mais, monsieur, ce n'est pas la mode.
—Eh bien, ce sera la mode quand nous l'aurons porté une fois répondîmes-nous, avec un aplomb digne de Brummel, de Nash, du comte d'Orsay ou de toute autre célébrité du dandysme.
—Je ne connais pas cette coupe; ceci rentre dans le costume de théâtre plutôt que dans l'habit de ville, et je pourrais manquer la pièce.
—Nous vous donnerons un patron en toile grise que nous avons dessiné, coupé et faufilé, nous-même; vous l'ajusterez. Cela s'agrafe dans le dos comme le gilet des saint-simoniens sans aucun symbolisme.
—N'ayez pas peur! n'ayez pas peur! Mes confrères se moqueront de moi, mais j'en ferai à votre fantaisie; et en quelle étoffe doit s'exécuter ce précieux accoutrement?
Nous tirâmes d'un bahut un magnifique morceau de satin cerise ou vermillon de la Chine, que nous déployâmes triomphalement sous les yeux du tailleur épouvanté, avec un air de tranquillité et de satisfaction qui l'alarma pour notre raison.
La lumière miroitait et glissait sur les cassures de l'étoffe que nous chiffonnions pour en faire jouer les reflets et les brillants. Les gammes les plus chaudes, les plus riches, les plus ardentes, les plus délicates du rouge étaient parcourues. Pour éviter l'infâme rouge de 93, nous avions admis une légère proportion de pourpre dans notre ton; car nous étions désireux qu'on ne nous attribuât aucune intention politique. Nous n'étions pas dilettante de Saint-Just et de Maximilien de Robespierre, comme quelques-uns de nos camarades qui posaient pour les montagnards de la poésie, mais plutôt moyen âge, vieux baron de fer, féodal, prêt à nous réfugier contre l'envahissement du siècle, dans le bourg de Goetz de Berlichingen, comme il convenait à un page du Victor Hugo de ce temps-là, qui avait aussi sa tour dans la Sierra.
Malgré les répugnances bien concevables du brave Gaulois, le pourpoint s'exécuta, s'agrafa par derrière et, sauf le ridicule d'être dans la salle le seul de sa coupe et de sa couleur, nous allait aussi bien qu'un gilet à la mode. Le reste du costume se composait d'un pantalon vert d'eau très pâle, bordé sur la couture d'une bande de velours noir, d'un habit noir à revers de velours largement renversés, et d'un ample pardessus gris doublé de satin vert. Un ruban de moire, servant de cravate et de col de chemise, entourait le cou. Le costume, il faut en convenir, n'était pas mal combiné pour irriter et scandaliser les philistins. N'allez pas croire à des enjolivements après coup. Rien de plus exact. Nous voyons dans Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie: «Il n'y eut que l'excentricité des costumes, qui, du reste, suffit amplement à l'horripilation des loges. On se montrait avec horreur M. Théophile Gautier, dont le gilet flamboyant éclatait ce soir-là sur un pantalon gris tendre, orné au côté d'une bande de velours noir, et dont les cheveux s'échappaient à flots d'un chapeau plat à larges bords. L'impassibilité de sa figure régulière et pâle et le sang-froid avec lequel il regardait les honnêtes gens des loges démontraient à quel degré d'abomination et de désolation le théâtre était tombé.»
Oui, nous les regardâmes avec un sang-froid parfait toutes ces larves du passé et de la routine, tous ces ennemis de l'art, de l'idéal, de la liberté et de la poésie, qui cherchaient de leurs débiles mains tremblotantes à tenir fermée la porte de l'avenir; et nous sentions dans notre cœur un sauvage désir d'enlever leur scalp avec notre tomahawk pour en orner notre ceinture; mais à cette lutte, nous eussions couru le risque de cueillir moins de chevelures que de perruques; car si elle raillait l'école moderne sur ses cheveux, l'école classique, en revanche, étalait au balcon et à la galerie du Théâtre-Français une collection de têtes chauves pareille au chapelet de crânes de la déesse Dourga. Cela sautait si fort aux yeux, qu'à l'aspect de ces moignons glabres sortant de leurs cols triangulaires avec des tons couleur de chair et de beurre rance, malveillants malgré leur apparence paterne, un jeune sculpteur de beaucoup d'esprit et de talent, célèbre depuis, dont les mots valent les statues, s'écria au milieu d'un tumulte: «A la guillotine, les genoux!»
Nous demandons pardon à nos lecteurs de les avoir fait tant attendre sur le seuil d'Hernani, et cela pour leur parler de nous; mais ce n'est pas chez nous un péché d'habitude, et, si nous connaissions un moyen de disparaître tout à fait de notre œuvre, nous l'emploierions;—le je nous répugne tellement que notre formule expressive est nous, dont le pluriel vague efface déjà la personnalité et vous replonge dans la foule. Mais l'apparition surnaturelle, le flamboiement farouche et météorique de notre pourpoint écarlate à l'horizon du Romantisme ayant été regardé «comme un signe des temps», dirait la Revue des Deux Mondes, et occupé ce XIXe siècle qui avait pourtant bien autre chose à faire, il a bien fallu faire violence, à notre modestie naturelle et nous mettre en scène un instant, puisque aussi bien c'est nous qui étions le moule de ce pourpoint mirifique.
Nos états de service d'Hernani (trente campagnes, trente représentations, vivement disputées) nous donnaient presque le droit d'être présenté au grand chef. Rien n'était plus simple: Gérard de Nerval ou Petrus Borel, dont nous avions fait récemment la connaissance, n'avaient qu'à nous mener chez lui. Mais à cette idée, nous nous sentions pris de timidités invincibles. Nous redoutions l'accomplissement de ce désir si longtemps caressé. Lorsqu'un incident quelconque faisait manquer les rendez-vous arrangés avec Gérard ou Pétrus, ou tous les deux, pour la présentation, nous éprouvions un sentiment de bien-être, notre poitrine était soulagée d'un grand poids, nous respirions librement.
Victor Hugo, que le nombre de visiteurs amenés par les représentations d'Hernani avait fait renvoyer de la paisible retraite qu'il habitait au fond d'un jardin plein d'arbres, rue Notre-Dame-des-Champs, était venu se loger dans une rue projetée du quartier François-Ier, la rue Jean-Goujon, composée alors d'une maison unique, celle du poète; autour, s'étendaient les Champs-Élysées presque déserts, et dont la solitude était favorable à la promenade et à la rêverie.
Deux fois nous montâmes l'escalier lentement, lentement, comme si nos bottes eussent eu des semelles de plomb. L'haleine nous manquait; nous entendions notre cœur battre dans notre gorge, et des moiteurs glacées nous baignaient les tempes. Arrivé devant la porte, au moment de tirer le cordon de la sonnette, pris d'une terreur folle, nous tournâmes les talons et nous descendîmes les degrés quatre à quatre, poursuivi par nos acolytes qui riaient aux éclats.
Une troisième tentative fut plus heureuse; nous avions demandé à nos compagnons quelques minutes pour nous remettre, et nous nous étions assis sur une des marches de l'escalier car nos jambes flageolaient sous nous et refusaient de nous porter, mais voici que la porte s'ouvrit et qu'au milieu d'un flot de lumière, tel que Phébus-Apollon franchissant les portes de l'Aurore, apparut sur l'obscur palier, qui? Victor Hugo, lui-même dans sa gloire.
Comme Esther devant Assuérus, nous faillîmes nous évanouir. Hugo ne put, comme le satrape vers la belle Juive, étendre vers nous, pour nous rassurer, son long sceptre d'or, par la raison qu'il n'avait pas de sceptre d'or, ce qui nous étonna. Il sourit, mais ne parut pas surpris, ayant l'habitude de rencontrer journellement sur son passage de petits poètes en pâmoison, des rapins rouges comme des coqs ou pâles comme des morts, et même des hommes faits, interdits et balbutiants. Il nous releva de la maniéré la plus gracieuse et la plus courtoise, car il fut toujours d'une exquise politesse, et renonçant à sa promenade il rentra avec nous dans son cabinet.
Henri Heine raconte que s'étant proposé de voir le grand Gœthe, il avait longtemps préparé dans sa tête les superbes discours qu'il lu tiendrait, mais qu'arrivé devant lui il n'avait trouvé rien à lui dire sinon «que les pruniers sur la route d'Iéna à Weimar portent des prunes excellentes contre la soif»; ce qui avait fait sourire doucement le Jupiter Mansuetus de la poésie allemande, plus flatté peut-être de cette ânerie éperdue que d'un éloge ingénieusement et froidement tourné. Notre éloquence ne dépassa pas le mutisme, quoique, nous aussi, nous eussions rêvé pendant de longues soirées aux apostrophes lyriques par lesquelles nous aborderions Hugo pour la première fois.
Un peu remis, nous pûmes bientôt prendre part à la conversation engagée entre Hugo, Gérard et Pétrus. On peut regarder les dieux, les rois, les jolies femmes, les grands poètes un peu plus fixement que les autres personnages, sans qu'ils s'en fâchent, et nous examinions Hugo avec une intensité admirative dont il ne paraissait pas gêné. Il y reconnaissait l'œil du peintre prenant des notes pour écrire à jamais un aspect, une physionomie, à un moment qu'on ne veut pas oublier.
Dans l'armée Romantique comme dans l'armée d'Italie, tout le monde était jeune.
Les soldats pour la plupart n'avaient pas atteint leur majorité, et le plus vieux de la bande était le général en chef, âgé de vingt-huit ans. C'était l'âge de Bonaparte et de Victor Hugo à cette date.
Nous avons dit quelque part: «Il est rare qu'un poète, qu'un artiste, soit connu sous son premier et charmant aspect; la réputation ne lui vient que plus tard lorsque déjà les fatigues de la vie, la lutte et les tortures des passions ont altéré sa physionomie primitive. Il ne laisse de lui qu'un masque usé, flétri, où chaque douleur a mis pour stigmate une meurtrissure ou une ride. C'est de cette dernière image, qui a sa beauté aussi, dont on se souvient». Nous avons eu le bonheur de les connaître à leur plus frais moment de jeunesse, de beauté et d'épanouissement tous ces poètes de la pléiade moderne dont on ne confiait plus le premier aspect.
Ce qui frappait d'abord dans Victor Hugo, c'était le front vraiment monumental qui couronnait comme un fronton de marbre blanc son visage d'une placidité sérieuse. Il n'atteignait pas, sans doute, les proportions que lui donnèrent plus tard, pour accentuer chez le poète le relief du génie, David d'Angers et d'autres artistes; mais il était vraiment d'une beauté et d'une ampleur surhumaines; les plus vastes pensées pouvaient s'y écrire; les couronnes d'or et de laurier s'y poser comme sur un front de dieu ou de césar. Le signe de la puissance y était. Des cheveux châtain clair l'encadraient et retombaient un peu longs. Du reste, ni barbe ni moustaches, ni favoris ni royale, une face soigneusement rasée, d'une pâleur particulière, trouée et illuminée de deux yeux fauves pareils à des prunelles d'aigle, et une bouche à lèvres sinueuses, à coins sur-baissés, d'un dessin ferme et volontaire qui, en s'entr'ouvrant pour sourire, découvrait des dents d'une blancheur étincelante. Pour costume, une redingote noire, un pantalon gris, un petit col de chemise rabattu, la tenue la plus exacte et la plus correcte. On n'aurait vraiment pas soupçonné dans ce parfait gentleman le chef de ces bandes échevelées et barbues, terreur des bourgeois à menton glabre. Tel Victor Hugo nous apparut à cette première rencontre, et l'image est restée ineffaçable dans notre souvenir. Nous gardons précieusement ce portrait beau, jeune, souriant, qui rayonnait de génie, et répandait comme une phosphorescence de gloire.
De tout les portraits de Victor Hugo que l'on a faits jusqu'à présent, aucun ne reproduit les traits et la physionomie de ce Gengiskan de la pensée; on connaît la lithographie de Devéria, belle comme une œuvre, d'art et d'une grande tournure; mais je ne crois pas que le caractère de la tête soit bien saisi, surtout moralement; on dirait presque un Byron, un Shelley, ou quelque autre de l'école satanique; il y a de l'orage sur le front, de l'amertume dans ce sourcil contracté; le nez est loin d'être exact, il vise à l'aquilin; la bouche et le menton manquent un peu de ces méplats fortement accusés, de ces contours fouillés si puissamment, qu'on remarque dans Victor Hugo et qui donnent quelque chose de grand et de ferme à son profil. David, dans ses bas-reliefs pour le tombeau du général Foy, n'a guère été plus heureux; il a cru qu'il suffisait d'exagérer certains détails pour arriver au but; ce n'est plus un portrait, c'est ce qu'on appelle en argot d'atelier une charge. D'ailleurs, le haut de la figure est tellement déprimé (à l'opposé du portrait de Gœthe, où le front surplombe), qu'anatomiquement parlant, un personnage constitué ainsi ne pourrait vivre.
Voici un nouvel essai de M. Jehan Duseigneur, auteur de Roland furieux, d'un Napoléon refusé et qui, certes, valait mieux que celui de Seurre, ridiculement étayé d'un aigle, ou d'une bûche, je ne sais trop lequel; voyons s'il a mieux réussi.
Son buste est d'une belle proportion, un tiers plus grand que nature; le masque a de la bonhomie et du repos; on voit bien là l'homme qui a confiance en sa force et qui poursuit majestueusement sa haute mission, l'homme dont la devise littéraire est hierro, et qui n'en est pas moins doux à l'usage et simple dans sa vie ordinaire, comme s'il n'était pas lui. M. Duseigneur a très heureusement, selon nous, fondu le poète avec l'homme, chose que l'on néglige trop souvent dans les portraits de célébrités à qui l'on donne presque toujours un air de dithyrambe et de smorpha méditative, on ne peut plus ridicule chez nous, où le poète est citoyen, comme dit Sainte-Beuve.
Le front, un des plus beaux laboratoires à pensées qui soient au monde contemporain, est étudié avec scrupule, modelé avec finesse. Le travail est souple et moelleux; cela singe la chair autant qu'il l'est donné à l'argile; les lèvres sont d'un sentiment délicat et vrai; elles respirent bien, et, dans le globe vide de l'œil, M. Duseigneur, différent en cela des sculpteurs grecs, nous a fait deviner, avec tout l'art imaginable, cette prunelle d'aigle et ce regard large que la peinture est seule en possession de rendre. Seulement, et peut-être est-ce une observation minutieuse, les sourcils sont un peu trop saillants et coupent la ligne frontale un peu trop brusquement. Ce buste nous paraît destiné à un grand succès, surtout à l'étranger où les intelligences plus artistes sont en avant de nous dans l'admiration du plus grand poète que nous ayons. Nous ne doutons pas que tous les religieux de ce beau talent ne s'empressent d'orner leurs bibliothèques de ce portrait, dont le moulage a été confié à l'un de nos habiles, M. Lambert Misson, rue Mazarine.
En 1830, je demeurais avec mes parents à la place Royale, n° 8, dans l'angle de la rangée d'arcades où se trouvait la mairie. Si je note ce détail, ce n'est pas pour indiquer à l'avenir une de mes demeures. Je ne suis pas de ceux dont la postérité signalera les maisons avec un buste ou une plaque de marbre, mais cette circonstance influa beaucoup sur la direction de ma vie. Victor Hugo, quelque temps après la révolution de Juillet, était venu loger à la place Royale, au n° 6, dans la maison en retour d'équerre. On pouvait se parler d'une fenêtre à l'autre.
Le voisinage de l'illustre chef romantique rendit mes relations avec lui et avec l'école naturellement plus fréquentes. Peu à peu je négligeai la peinture et me tournai vers les idées littéraires. Hugo m'aimait assez et me laissait asseoir comme un page familier sur les marches, de son trône féodal. Ivre d'une telle faveur, je voulus la mériter, et je rimai la légende d'Albertus, que je joignis avec quelques autres pièces à mon volume sombré dans la tempête, et dont l'édition me restait presque entière; à ce volume, devenu rare, était jointe une eau-forte ultra-excentrique de Célestin Nanteuil. Ceci se passait vers 1833. Le surnom d'Albertus me resta, et l'on ne m'appelait guère autrement dans ce qu'Alfred de Musset appelait: «la grande boutique romantique».
25 février 1830! Cette date reste écrite dans le fond de notre passé en caractères flamboyants: la date de la première représentation d'Hernani! Cette soirée décida de notre vie! Là nous reçûmes l'impulsion qui nous pousse encore après tant d'années et qui nous fera marcher jusqu'au bout de la carrière. Bien du temps s'est écoulé depuis, et notre éblouissement est toujours le même. Nous ne rabattons rien de l'enthousiasme de notre jeunesse, et toutes les fois que retentit le son magique du cor, nous dressons l'oreille comme un vieux cheval de bataille prêt à recommencer les anciens combats.
Le jeune poète, avec sa fière audace et sa grandesse de génie, aimant mieux d'ailleurs la gloire que le succès, avait opiniâtrement refusé l'aide de ces cohortes stipendiées qui accompagnent les triomphes et soutiennent les déroutes. Les claqueurs ont leur goût comme les académiciens. Ils sont en général classiques. C'est à contre-cœur qu'ils eussent applaudi Victor Hugo: leurs hommes étaient alors Casimir Delavigne et Scribe, et l'auteur courait risque, si l'affaire tournait mal, d'être abandonné au plus fort de la bataille. On parlait de cabales, d'intrigues ténébreusement ourdies, de guet-apens presque, pour assassiner la pièce et en finir d'un seul coup avec la nouvelle École. Les haines littéraires sont encore plus féroces que les haines politiques, car elles font vibrer les fibres les plus chatouilleuses de l'amour-propre, et le triomphe de l'adversaire vous proclame imbécile. Aussi n'est-il pas de petites infamies et même de grandes que ne se permettent, en pareil cas, sans le moindre scrupule de conscience, les plus honnêtes gens du monde.
On ne pouvait cependant pas, quelque brave qu'il fût, laisser Hernani se débattre tout seul contre un parterre mal disposé et tumultueux, contre des loges plus calmes en apparence mais non moins dangereuses dans leur hostilité polie, et dont le ricanement bourdonne si importun au-dessous du sifflet plus franc, du moins, dans son attaque. La jeunesse romantique pleine d'ardeur et fanatisée par la préface de Cromwell, résolue à soutenir «l'épervier de la montagne», comme dit Alarcón du Tisserand de Ségovie, s'offrit au maître qui l'accepta. Sans doute tant de fougue et de passion était à craindre, mais la timidité n'était pas le défaut de l'époque. On s'enrégimenta par petites escouades dont chaque homme avait pour passe le carré de papier rouge timbré de la griffe Hierro. Tous ces détails sont connus, et il n'est pas besoin d'y insister.
On s'est plu à représenter dans les petits journaux et les polémiques du temps ces jeunes hommes, tous de bonne famille, instruits, bien élevés, fous d'art et de poésie, ceux-ci écrivains, ceux-là peintres, les uns musiciens, les autres sculpteurs ou architectes, quelques-uns critiques et occupés à un titre quelconque de choses littéraires, comme un ramassis de truands sordides. Ce n'étaient pas les Huns d'Attila qui campaient devant le Théâtre-Français, malpropres, farouches, hérissés, stupides; mais bien les chevaliers de l'avenir, les champions de l'idée, les défenseurs de l'art libre; et ils étaient beaux, libres et jeunes. Oui, ils avaient des cheveux—on ne peut naître avec des perruques—et ils en avaient beaucoup qui retombaient en boucles souples et brillantes, car ils étaient bien peignés. Quelques-uns portaient de fines moustaches, et quelques autres des barbes entières. Cela est vrai, mais cela seyait fort bien à leurs tètes spirituelles, hardies et fières, que les maîtres de la Renaissance eussent aimé à prendre pour modèles.
Ces brigands de la pensée, l'expression est de Philothée O'Neddy, ne ressemblaient pas à de parfaits notaires, il faut l'avouer, mais leur costume où régnaient la fantaisie du goût individuel et le juste sentiment de la couleur, prêtait davantage à la peinture. Le satin, le velours, les soutaches, les brandebourgs, les parements de fourrures, valaient bien l'habit noir à queue de morue, le gilet de drap de soie trop court remontant sur l'abdomen, la cravate de mousseline empesée où plonge le menton, et les pointes des cols en toile blanche faisant œillères aux lunettes d'or. Même le feutre mou et la vareuse des plus jeunes rapins qui n'étaient pas encore assez riches pour réaliser leurs rêves de costume à la Rubens et à la Velasquez, étaient plus élégants à coup sûr que le chapeau en tuyau de poêle et le vieil habit à plis cassés des anciens habitués de la Comédie-Française, horripilés par l'invasion de ces jeunes barbares shakespeariens. Ne croyez donc pas un mot de ces histoires. Il aurait suffi de nous faire entrer une heure avant le public; mais, dans une intention perfide, et dans l'espoir sans doute de quelque tumulte qui nécessitât ou prétextât l'intervention de la police, on fit ouvrir les portes à deux heures de l'après-midi, ce qui faisait huit heures d'attente jusqu'au lever du rideau.
La salle n'était pas éclairée. Les théâtres sont obscurs le jour, et ne s'illuminent que la nuit. Le soir est leur aurore, et la lumière ne leur vient que lorsqu'elle s'éteint au ciel. Ce renversement s'accorde avec leur vie factice. Pendant que la réalité travaille, la fiction dort.
Rien de plus singulier qu'une salle de théâtre pendant la journée. À la hauteur, à l'immensité du vaisseau encore agrandies par la solitude, on se croirait dans la nef d'une cathédrale. Tout est baigné d'une ombre vague où filtrent, par quelque ouverture des combles, ou quelque regard de loge, des lueurs bleuâtres, des rayons blafards contrastant avec les tremblotements rouges des fanaux de service disséminés en nombre suffisant, non pour éclairer, mais pour rendre l'obscurité visible. Il ne serait pas difficile à un œil visionnaire, comme celui d'Hoffmann, de trouver là le décor d'un conte fantastique. Nous n'avions jamais pénétré dans une salle de spectacles le jour, et lorsque notre bande, comme le flot d'une écluse qu'on ouvre, creva à l'intérieur du théâtre, nous demeurâmes surpris de cet effet à la Piranèse.
On s'entassa du mieux qu'on put aux places hautes, aux recoins obscurs du cintre, sur les banquettes de derrière des galeries, à tous les endroits suspects et dangereux où pouvait s'embusquer dans l'ombre une clé forée, s'abriter un claqueur furieux, un prudhomme épris de Campistron et redoutant le massacre des bustes par des septembriseurs d'un nouveau genre. Nous n'étions là guère plus à l'aise que don Carlos n'allait l'être tout à l'heure au fond de son armoire; mais les plus mauvaises places avaient été réservées aux plus dévoués, comme en guerre les postes les plus périlleux aux enfants perdus qui aiment à se jeter dans la gueule même du danger. Les autres, non moins solides, mais plus sages, occupaient le parterre, rangés en bon ordre sous l'œil de leurs chefs, et prêts à donner avec ensemble sur les philistins au moindre signal d'hostilité.
Six ou sept heures d'attente dans l'obscurité; ou, tout au moins, la pénombre d'une salle dont le lustre n'est pas allumé, c'est long, même lorsqu'au bout de cette nuit Hernani doit se lever comme un soleil radieux.
Des conversations sur la pièce s'engagèrent entre nous, d'après ce que nous en connaissions. Quelques-uns, plus avant dans la familiarité du maître, en avaient entendu lire des fragments dont ils avaient retenu quelques vers qu'ils citaient et qui causaient un vif enthousiasme. On y pressentait un nouveau Cid, un jeune Corneille non moins fier, non moins hautain et castillan que l'ancien, mais ayant pris cette fois la palette de Shakespeare. On discutait sur les divers titres qu'avait dû porter le drame. Quelques-uns regrettaient Trois pour une, qui leur semblait un vrai titre à la Calderon, un titre de cape et d'épée, bien espagnol et bien romantique, dans le sens de La vie est un songe, des Matinées d'avril et de mai; d'autres, et avec raison, trouvaient plus de gravité au titre ou plutôt au sous-titre L'Honneur castillan, qui contenait l'idée de la pièce.
Le plus grand nombre préférait Hernani tout court, et leur avis a prévalu, car c'est ainsi que le drame s'appelle définitivement, et que, pour nous servir de la formule homérique, il voltige, nom ailé, sur la bouche des hommes à la voix articulée.
Dix ans plus tard, nous voyagions en Espagne. Entre Astigarraga et Tolosa, nous traversâmes au galop de mules un bourg à demi ruiné par la guerre entre les christinos et les carlistes, dont nous entrevoyions confusément dans l'ombre les murs historiés d'énormes blasons sculptés au-dessus des portes, et les fenêtres noires à serrureries compliquées, grilles et balcons touffus, témoignant d'une ancienne splendeur, et nous demandâmes à notre zagal qui courait près de la voiture, la main posée sur la maigre échine de la mule hors montoir, le nom de ce pillage; il nous répondit: «Hernani». A ces trois syllabes évocatrices, la somnolence qui commençait à nous envahir, après une journée de fatigue, se dissipa tout à coup. A travers le perpétuel tintement de grelots de l'attelage, passa comme un soupir lointain une note du cor d'Hernani. Nous revîmes, dans un éblouissement soudain, le fier montagnard avec sa cuirasse de cuir, ses manches vertes et son pantalon rouge; don Carlos dans son armure d'or, Doña Sol pâle et vêtue de blanc, Ruy Gomez de Silva debout devant les portraits de ses aïeux; tout le drame complet. Il nous semblait même entendre encore la rumeur de la première représentation.
Victor Hugo enfant, revenant d'Espagne en France, après la chute du roi Joseph, a dû traverser ce bourg dont l'aspect n'a pas changé, et recueillir de la bouche d'un postillon ce nom bizarre, d'une sonorité éclatante, si bien fait pour la poésie, qui, mûrissant plus tard dans son cerveau comme une graine oubliée dans un coin, a produit cette magnifique floraison dramatique.
La faim commençait à se faire sentir. Les plus prudents avaient emporté du chocolat et des petits pains,—quelques-uns—proh! pudor—des cervelas; des classiques malveillants disent à l'ail. Nous ne le pensons pas; d'ailleurs, l'ail est classique; Thestylis en broyait pour les moissonneurs de Virgile. La dînette achevée, on chanta quelques ballades d'Hugo, puis on passa à quelques-unes de ces interminables scies d'atelier, ramenant, comme les norias leurs godets, leurs couplets versant toujours la même bêtise; ensuite, on se livra à des imitations du cri des animaux dans l'arche, que les critiques du Jardin des Plantes auraient trouvées irréprochables. On se livra à d'innocentes gamineries de rapins; on demanda la tête, ou plutôt le gazon, de quelque membre de l'Institut; on déclama des songes tragiques! et l'on se permit, à l'endroit de Melpomène, toutes sortes de libertés juvéniles qui durent fort étonner la bonne vieille déesse, peu habituée à sentir chiffonner de la sorte son péplum de marbre.
Cependant, le lustre descendait lentement du plafond avec sa triple couronne de gaz et son scintillement prismatique; la rampe montait, traçant entre le monde idéal et le monde réel sa démarcation lumineuse. Les candélabres s'allumaient aux avant-scènes, et la salle s'emplissait peu à peu. Les portes des loges s'ouvraient et se fermaient avec fracas. Sur le rebord de velours, posant leurs bouquets et leurs lorgnettes, les femmes s'installaient comme pour une longue séance, donnant du jeu aux épaulettes de leur corsage décolleté, s'asseyant bien au milieu de leurs jupes. Quoiqu'on ait reproché à notre école l'amour du laid, nous devons avouer que les belles, jeunes et jolies femmes furent chaudement applaudies de cette jeunesse ardente, ce qui fut trouvé de la dernière inconvenance et du dernier mauvais goût par les vieilles et les laides. Les applaudies se cachèrent derrière leurs bouquets avec un sourire qui pardonnait.
L'orchestre et le balcon étaient pavés de crânes académiques et classiques. Une rumeur d'orage grondait sourdement dans la salle; il était temps, que la toile se levât; on en serait peut-être venu aux mains avant la pièce, tant l'animosité était grande de part et d'autre. Enfin les trois coups retentirent. Le rideau se replia lentement sur lui-même, et l'on vit, dans une chambre à coucher du seizième siècle, éclairée par une petite lampe, doña Josepha Duarte, vieille en noir, avec le corps de sa jupe cousu de jais, à la mode d'Isabelle la Catholique, écoutant les coups que doit frapper à la porte secrète un galant attendu par sa maîtresse:
Serait-ce déjà lui? ... C'est bien à l'escalier
Dérobé.
La querelle était déjà engagée. Ce mot rejeté sans façon à l'autre vers, cet enjambement audacieux, impertinent même, semblait un spadassin de profession, un Saltabadil, un Scoronconcolo allant donner une pichenette sur le nez du classicisme pour le provoquer en duel.
—Eh quoi! dès le premier mot l'orgie en est déjà là? On casse les vers et on les jette par les fenêtres! dit un classique admirateur de Voltaire avec le sourire indulgent de la sagesse pour la folie.
Il était tolérant d'ailleurs, et ne se fût pas opposé à de prudentes innovations, pourvu que la langue fût respectée; mais de telles négligences au début d'un ouvrage devaient être condamnées chez un poète, quels que fussent ses principes, libéral ou royaliste.
—Mais ce n'est pas une négligence, c'est une beauté, répliquait un romantique de l'atelier de Devéria, fauve comme un cuir de Cordoue et coiffé d'épais cheveux rouges comme ceux d'un Giorgione.
...C'est bien à l'escalier
Dérobé.
Ne voyez-vous pas que ce mot dérobé rejeté, et comme suspendu en dehors du vers, peint admirablement l'escalier d'amour et de mystère qui enfonce sa spirale dans la muraille du manoir! Quelle merveilleuse science architectonique! quel sentiment de l'art du XIVe siècle! quelle intelligence profonde de toute civilisation!
L'ingénieux élève de Devéria voyait sans doute trop de choses dans ce rejet, car ses commentaires, développés outre mesure, lui attirèrent des chut et des à la porte, dont l'énergie croissante l'obligea bientôt au silence.
Il serait difficile de décrire, maintenant que les esprits sont habitués à regarder comme des morceaux pour ainsi dire classiques les nouveautés qui semblaient alors de pures barbaries, l'effet que produisaient sur l'auditoire ces vers si singuliers, si mâles, si forts, d'un tour si étrange, d'une allure si cornélienne et si shakespearienne à la fois. Nous allons cependant l'essayer. Il faut d'abord bien se figurer qu'à cette époque, en France, dans la poésie et même aussi dans la prose, l'horreur du mot propre était poussé à un degré inimaginable. Quoi qu'on fasse, on ne peut concevoir cette horreur qu'au point de vue historique, comme certains préjugés dont les motifs ou les prétextes ont disparu.
Quand on assiste aujourd'hui à une représentation d'Hernani, en suivant le jeu des acteurs sur un vieil exemplaire marqué de coups d'ongle à la marge pour désigner des endroits tumultueux, interrompus ou sifflés, d'où partent d'ordinaire maintenant les applaudissements comme des vols d'oiseaux avec de grands bruits d'ailes, et qui étaient jadis des champs de bataille piétinés, des redoutes prises et reprises, des embuscades où l'on s'attendait au détour d'une épithète, des relais de meutes pour sauter à la gorge d'une métaphore poursuivie, on éprouve une surprise indicible que les générations actuelles, débarrassées de ces niaiseries par nos vaillants efforts, ne comprendront jamais tout à fait. Comment s'imaginer qu'un vers comme celui-ci:
Est-il minuit?—Minuit bientôt
ait soulevé des tempêtes, et qu'on se soit battu trois jours autour de cet hémistiche? On le trouvait trivial, familier, inconvenant; un roi demande l'heure comme un bourgeois et on lui répond comme à un rustre: minuit. C'est bien fait. S'il s'était servi d'une belle périphrase, on aurait été poli; par exemple:
—L'heure
Atteindra bientôt sa dernière demeure.
Si l'on ne voulait pas de mots propres dans les vers, on y supportait aussi fort impatiemment les épithètes, les métaphores, les comparaisons, les mots poétiques enfin, le lyrisme, pour tout dire, ces échappées rapides vers la nature, ces élans de l'âme au-dessus de la situation, ces ouvertures de la poésie à travers le drame, si fréquentes dans Shakespeare, Calderon et Gœthe, si rares chez nos grands auteurs du XVIIe siècle, que tout le théâtre de ce temps ne fournit que ces deux vers pittoresques, l'un de Corneille, l'autre de Molière, le premier dans le récit du Cid, le second dans les propos d'Orgon revenant de voyage et se chauffant les mains devant le feu. Le vers de Corneille est une cheville magnifique taillée par des mains souveraines dans le cèdre des parvis célestes pour amener la rime de «voiles» dont il avait besoin:
Cette obscure clarté qui tombe des étoiles.
Celui de Molière:
La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie,
respire un sentiment de bien-être bourgeois et de satisfaction de ne plus être exposé aux intempéries de l'air, mais qui cependant fait penser, dans cette noire maison du vieux Paris où s'enchevêtrent comme des reptiles les tortuosités de l'intrigue, qu'il y a encore là-bas, à la campagne, quelque chose de vert, et que l'homme, quoiqu'il ne la regarde guère, est toujours enveloppé de la nature.
Ce spectacle si nouveau occupait la malveillance. On suivait, sans la quitter des yeux, cette action si, vivement engagée, et l'on sacrifiait plus d'une fois le plaisir de chuter ou d'interrompre à celui d'entendre. Le génie du poète dominait par instants les routines et les mauvais instincts de la foule qui regimbe contre tout ascendant qu'elle ne subissait pas la veille, et trouve qu'elle admire déjà bien assez de gens comme cela.
Malgré la terreur qu'inspirait la bande d'Hugo répandue par petites escouades et facilement reconnaissable à ses ajustements excentriques et à ses airs féroces, bourdonnait dans la salle cette sourde rumeur des foules agitées, qu'on ne comprime pas plus que celle de la mer. La passion qu'une salle contient se dégage toujours et se révèle par des signes irrécusables. Il suffisait de jeter les yeux sur ce public pour se convaincre qu'il ne s'agissait pas là d'une représentation ordinaire; que deux systèmes, deux armées, deux civilisations même—ce n'est pas trop dire—étaient en présence, se haïssant cordialement, comme on se hait dans les haines littéraires, ne demandant que la bataille, et prêts à fondre l'un sur l'autre. L'attitude générale était hostile, les coudes se faisaient anguleux, la querelle n'attendait pour jaillir que le moindre contact, et il n'était pas difficile de voir que ce jeune homme à longs cheveux trouvait ce monsieur à face bien rasée désastreusement crétin et ne lui cacherait pas longtemps cette opinion particulière.
En effet, de petits tumultes aussitôt étouffés éclataient aux plaisanteries romantiques de don Carlos, aux saint Jean d'Avila! de don Ruy Gomez de Silva, et à certaines touches de couleur locale espagnole prise à la palette du Romancero pour plus d'exactitude. Mais comme au fond on sentait que ce mélange de familiarité et de grandeur, d'héroïsme et de passion, de sauvagerie chez Hernani, de rabâchage homérique chez le vieux Silva, révoltait profondément la portion du public qui ne faisait pas pas partie des salteadores d'Hugo! De ta suite—j'en suis! qui termine l'acte, devint, nous n'avons pas besoin de vous le dire, pour l'immense tribu des glabres, le prétexte des plus insupportables scies; mais les vers de la tirade sont si beaux, que dits même par ces canards de Vaucanson, ils semblaient encore admirables.
Madame Gay, qui fut plus tard Madame Delphine de Girardin, et qui était déjà célèbre comme poétesse, attirait les yeux par sa beauté blonde. Elle prenait naturellement la pose et le costume que lui donne le portrait si connu d'Hersent, robe blanche, écharpe bleue, longues spirales de cheveux d'or, bras replié et bout du doigt appuyé sur la joue dans l'attitude de l'attention admirative; cette Muse avait toujours l'air d'écouter un Apollon. Lamartine et Victor Hugo étaient ses grands amis; elle se tint en adoration devant leur génie jusqu'au dernier jour, et sa belle main pâle ne laissa tomber l'encensoir que glacée. Ce soir-là, ce grand soir à jamais mémorable d'Hernani, elle applaudissait, comme un simple rapin entré avant deux heures avec un billet rouge, les beautés choquantes, les traits de génie révoltants...[1]
[1] Ce chapitre, inachevé, est le dernier qu'ait écrit Théophile Gautier.
Novembre 1837.
Le grand événement dramatique de la semaine est le procès de M. Victor Hugo, contre la Comédie-Française, qui doit se dénouer aujourd'hui. L'issue n'en paraît pas douteuse, et nous nous réjouissons à l'idée de voir enfin au Théâtre-Français autre chose que des comédies sans couplets fabriquées par des vaudevillistes à la retraite. Il est très curieux que Victor Hugo, le plus grand poète de France, soit obligé de se faire jouer par autorité de justice, comme M. Laverpillière, auteur des Deux Mahométans. Heureusement M. Victor Hugo aura pour lui, en premier et en dernier ressort, tous les juges, le tribunal et le public.
M. Hugo, fort occupé de ses dissidences avec la Comédie-Française, n'a rien donné au théâtre depuis un an, et c'est grand dommage. Nous en voulons doublement à M. Vedel: un drame en vers de M. Hugo aurait aujourd'hui un grand succès. Les questions de césure et d'enjambement sont assoupies, et tout le monde reconnaît M. Hugo pour un admirable poète: Lucrèce, Marie Tudor, Angelo ont prouvé que c'était un grand dramaturge et qu'il connaissait «les planches» aussi bien que le plus habile charpentier scénique.
A défaut de pièces nouvelles, la reprise récente de Lucrèce Borgia a obtenu un succès qui n'est pas encore près de se ralentir. Quelle fermeté de lignes, quel caractère et quelle port de style! Comme l'action est simple et sinistre à la fois! C'est une œuvre, à notre avis, d'une perfection classique; jamais la prose théâtrale n'a atteint cette vigueur et ce relief.
Marie Tudor, que l'on vient aussi de reprendre, n'a pas moins réussi; jamais Mademoiselle Georges n'a été plus familièrement terrible et plus royalement belle; la grande scène de la fin, d'une anxiété suffocante, a produit le même effet qu'aux premières représentations.
Comme on est heureux de revoir, après tant de mimodrames, d'hippodrames, de vaudevilles avec ou sans couplets une œuvre d'une conception large et grande, exécutée sévèrement en beau style magistral! Nous voudrions seulement que M. Hugo eût un peu pitié de nous et nous fît plus souvent des drames en prose ou en vers; une pièce nouvelle s'accorderait merveilleusement bien avec les reprises d'Hernani et de Marion Delorme qui vont avoir lieu.
(THÉÂTRE-FRANÇAIS)
22 janvier 1838.
C'est samedi dernier qu'a eu lieu la reprise d'Hernani,—par autorité de justice.—A vrai dire, la physionomie de la salle n'avait rien de très judiciaire, et l'on ne se serait guère douté qu'une si nombreuse affluence de spectateurs se parlât à une pièce jouée de force; beaucoup d'ouvrages joués librement sont loin d'attirer une telle foule, même dans toute la fraîcheur de leur nouveauté.
Outre sa valeur poétique, Hernani est un curieux monument d'histoire littéraire. Jamais œuvre dramatique n'a soulevé une plus vive rumeur; jamais on n'a fait tant de bruit autour d'une pièce. Hernani était le champ de bataille où se colletaient et luttaient avec un acharnement sans pareil et toute l'ardeur passionnée des haines littéraires les champions romantiques et les athlètes classiques; chaque vers était pris et repris d'assaut. Un soir, les romantiques perdaient une tirade; le lendemain, ils la regagnaient, et les classiques, battus, se portaient sur un autre point avec une formidable artillerie de sifflets, appeaux à prendre les cailles, clefs forées, et le combat recommençait de plus belle. Qui croirait, par exemple, que cette phrase si simple: «Quelle heure est-il?—Minuit!» ait excité des tumultes effroyables? Il n'y a pas un seul mot dans Hernani qui n'ait été applaudi ou sifflé à outrance. En effet, Hernani, si l'on se reporte à l'époque où il a été joué, est une pièce de la plus audacieuse étrangeté: tout y est nouveau, sujet, mœurs, conduite, style et versification. Passer tout d'un coup des pièces de MM. Debrieu, Arnand, Jory et autres à ce drame de cape et d'épée; après cette fade boisson édulcorée, boire ce vin de Xérès, haut de bouquet et de saveur, la transition était brusque.
Huit ans se sont écoulés; le public a fait comme le prophète qui voyant que la montagne ne venait pas à lui, alla lui-même à la montagne: il est allé au poète. Hernani n'a pas excité le plus léger murmure: il a été écouté avec la plus religieuse attention et applaudi avec un discernement admirable; pas un seul beau vers, pas un seul mouvement héroïque, n'ont passé incompris; le public s'est abandonné de bonne foi au poète et l'a suivi complaisamment jusque dans les écarts de sa fantaisie; ces beaux vers cornéliens, amples et puissants, s'enlevant aux cieux d'un seul coup d'aile, comme des aigles montagnards, ont excité les plus vifs transports. Le sentiment de la poésie n'est pas aussi mort en France que certains critiques, qui sans doute ont leurs raisons pour cela, veulent bien le dire: l'art est encore aimé; et nous n'en sommes pas réduits à ne pouvoir digérer comme nourriture intellectuelle que la crème fouettée du vaudeville. Les œuvres sérieuses et passionnées trouveront toujours des approbateurs intelligents dans ce beau pays de France, dont la littérature nationale ne consistera pas, nous l'espérons bien, en opéras-comiques et en flonflons.
Le mérite principal d'Hernani, c'est la jeunesse: on y respire d'un bout à l'autre une odeur de sève printanière et de nouveau feuillage d'un charme inexprimable; toutes les qualités et tous les défauts en sont jeunes: passion idéale, amour chaste et profond, dévouement héroïque, fidélité au point d'honneur, effervescence lyrique, agrandissement des proportions naturelles, exagération de force; c'est un des plus beaux rêves dramatiques que puisse accomplir un grand poète de vingt-cinq ans.
Les autres pièces de M. Hugo, égales pour le moins en mérite à Hernani, n'ont pas cet attrait particulier. Hernani est la fleur, Lucrèce Borgia est le fruit. Peut-être aussi cette sensation se joint-elle pour nous à des souvenirs d'adolescence et de juvénile ardeur; mais cet effet était généralement ressenti et tout le monde semblait surpris de se trouver encore tant d'enthousiasme après huit ans révolus. C'est M. Hugo lui-même qui l'a dit: «Il ne faut guère revoir les idées et les femmes que l'on avait à vingt ans; elles paraissent bien ridées, bien édentées, bien ridicules». Hernani a subi victorieusement cette chanceuse épreuve. Doña Sol a retrouvé ses anciens amants plus épris que jamais: il, est vrai qu'elle avait emprunté les traits et la voix de Madame Dorval.
Il est inutile de faire l'analyse d'Hernani, on sait la pièce par cœur; nous dirons quelques mots de la manière dont les acteurs ont joué, et nous constaterons les progrès du public. La magnifique scène des portraits de famille, si profondément espagnole, et qui semble écrite avec la plume qui traça le Cid, a été applaudie comme elle le mérite; autrefois elle était criblée de sifflets. Le monologue de Charles-Quint au tombeau de Charlemagne n'a paru long à personne; cette sublime méditation a été parfaitement écoutée et comprise.
La singularité et la sauvagerie de quelques détails n'ont distrait personne de la beauté sérieuse de l'ensemble, et le succès a été aussi complet que possible. Hernani consacré par l'épreuve de la première représentation, de la lecture et de la reprise, restera à tout jamais au répertoire avec le Cid dont il est le cousin et le compatriote.
Jamais le génie de M. Hugo, plus espagnol que français, ne s'est développé dans un milieu plus favorable: il a le style à larges plis, la phrase au port grave et hautain, le grandiose pointilleux qui conviennent pour faire parler des hidalgos. Personne n'a, d'ailleurs, un sentiment plus intime et plus profond des mœurs et de la famille féodales: aucun poète vivant n'aurait inventé Ruy Gomez de Sylva.
M. Vedel s'est exécuté de bonne grâce: la pièce est convenablement montée et de manière à couvrir bientôt les six mille francs de dommages-intérêts alloués à l'auteur par le tribunal.
Firmin (Hernani) a rempli son rôle avec sa chaleur et son intelligence ordinaires: il est à regretter que cet acteur, plein de sentiment, manque un: peu de moyens d'exécution, et soit trahi par ses forces. Joanny est magnifique dans Ruy de Sylva: il est ample et simple, paternel et majestueux, amoureux avec dignité, bon et confiant au commencement de la pièce, implacable et sinistre dans l'acte de la vengeance. Il a merveilleusement conservé à ce rôle sa physionomie homérique dans la scène de l'hospitalité, il a été d'une onction et d'une simplicité tout antiques. Quant à Madame Dorval, nous ne savons comment la louer; il est impossible de mieux rendre cette passion profonde et contenue qui s'échappe en cris soudains aux endroits suprêmes, cette fierté adorablement soumise aux volontés de l'amant: cette abnégation courageuse, cet anéantissement de toute chose humaine dans un seul être, cette chatterie délicieuse et pudique de la jeune fille qui dit au désir: «Tout à l'heure», et à travers tout cela l'orgueil castillan, l'orgueil du sang et de la race, qui lui fait répondre au vieux Sylva:
On n'a pas de galants quand on est doña Sol
Et qu'on a dans le cœur de bon sang espagnol.
Madame Dorval a exprimé toutes ces nuances si délicates avec le plus rare bonheur. Au cinquième acte, elle a été sublime d'un bout à l'autre; aussi, la toile tombée, elle a été redemandée à grands cris et saluée par de nombreuses salves d'applaudissements. Nous l'attendons dans Marion Delorme, avec la plus vive impatience. N'oublions pas Ligier, qui a été très convenable dans tout son rôle, et qui a particulièrement bien dit le grand monologue.
(THÉÂTRE-FRANÇAIS)
15 juin 1841.
Hernani est toujours pour nous le drame de Victor Hugo que nous préférons, non pas que nous pensions, comme M. de Salvandy, que l'illustre poète n'ait rien fait qui vaille depuis sa pièce couronnée aux Jeux floraux: mais Hernani réveille en nous de tels souvenirs d'enthousiasme et de jeunesse, qu'il nous est impossible de ne pas avoir pour lui quelque partialité. C'était un beau temps que celui-là! Un temps de lutte, de passion, d'enivrement et de fanatisme; jamais la querelle littéraire ne fut débattue plus vivement. Les représentations étaient de vraies batailles rangées: on sifflait, on applaudissait avec fureur; chaque vers était pris et repris, on combattait des heures entières pour le moindre hémistiche. Un jour, les romantiques emportaient le vieillard stupide; l'autre jour les classiques, que ce mot choquait particulièrement comme une allusion personnelle, le reprenaient à l'aide d'une supérieure artillerie de sifflets. Nous avons assisté pour notre compte à plus de quarante représentations consécutives d'Hernani; nous allions là par bandes, tous fous de poésie, d'amour de l'art, fanatiques comme des Turcs, et prêts à tout faire pour notre Mahomet. Nous entrions dès trois heures, nous attendions le lever du rideau en nous récitant des tirades de la pièce, que nous savions mieux que les acteurs. C'était charmant! On demandait, par-ci par-là, la tête de quelque académicien. Qui eût dit alors que notre chef passerait à l'ennemi et serait académicien lui-même! Et l'on battait un peu les bourgeois, qui ne comprenaient pas. Nous avions, d'ailleurs, la mine singulièrement farouche avec nos barbes, nos moustaches, nos royales, nos cheveux mérovingiens, nos chapeaux excessifs, nos gilets de couleur féroce. Certes, tout cela peut sembler ridicule aujourd'hui; mais c'était une belle chose que toute cette jeunesse ardente, passionnée, combattant pour la liberté de l'esprit, et introduisant de force dans le temple de Melpomène la muse moderne dont Victor Hugo était, à cette époque le prêtre le plus fidèle; une chose encore distingue cette époque: c'est l'absence d'envie et de jalousie littéraires; l'on s'aimait et l'on s'admirait franchement: dès que l'on avait fait une pièce de vers, ou un sonnet, on courait les montrer aux camarades, on se félicitait, on se complimentait: et certes il y avait de quoi, car la poésie, enterrée par les versifications de l'Empire, venait enfin de ressusciter.
Nous avions raison, cependant, nous les jeunes fous, les enragés qui faisions de si belles peurs aux membres de l'Institut, tout inquiets dans leurs stalles; Hernani n'est interrompu aujourd'hui que par les applaudissements; cette passion si chaste et si dévouée, cette couleur romanesque et sauvage, cette fierté héroïque et castillane dont Victor Hugo semble avoir dérobé le secret à Corneille, tout cela a été compris et senti admirablement par cette même foule qui repoussait autrefois le poète au nom d'Aristote, qu'elle n'a jamais lu.
Mademoiselle Émilie Guyon, jeune et belle personne que le public avait déjà eu occasion d'applaudir dans la Fille du Ciel, de M. Casimir Delavigne, débutait par le rôle de doña Sol où Mademoiselle Mars et Madame Dorval avaient déjà montré un talent si brillant et si divers; elle a bien compris la physionomie de cette figure profondément espagnole, passionnément calme, hautaine, et douce, fière et tendre à la fois, qui s'honore de l'amour d'un banni et s'offense du caprice d'un' roi. Son costume de velours, noir et or, semble dérobé à un portrait de Zurbarán et lui sied à ravir. Beauvallet, qui manque peut-être de suavité dans les portions amoureuses de son rôle, a parfaitement rendu l'âpre mélancolie, la majesté sauvage et l'allure romanesque du chef de montagnards: il est, sous ce rapport, bien supérieur à Firmin. Guyon n'a qu'un défaut dans le Ruy Gomez de Silva, c'est qu'il est trop vert encore sous ses cheveux blancs, sa belle voix, sonore et vibrante comme un timbre de cuivre, a de la peine à imiter le chevrotement de la sénilité. À part ce défaut que nous lui pardonnons bien volontiers, et dont il n'est pas responsable, il a été simple, majestueux, et bon ... Quant à Ligier, c'est un tragédien d'un grand talent sans doute, mais il nous est impossible de le prendre, ne fût-ce qu'un instant, pour le jeune roi don Carlos, avec sa barbe rousse et sa lèvre autrichienne.
12 février 1844.
On a repris cette semaine Hernani à la Comédie-Française. Le chef-d'œuvre du maître, cet admirable poème dramatique interprété par Ligier, Guyon, Beauvallet et Madame Mélingue qui prenait possession du rôle de doña Sol, a été accueilli, nous ne dirons pas seulement avec attention et respect, mais avec le plus vif enthousiasme. Pour ceux qui comme nous ont assisté aux luttes des premières représentations, où chaque mot soulevait une tempête, où chaque vers était disputé pied à pied, c'est à coup sûr une chose merveilleuse que de voir aujourd'hui toutes les pensées, toutes les intentions du poète unanimement comprises et applaudies. Pourquoi donc, si ce n'est sous prétexte de longueurs, Messieurs les comédiens ont-ils cru devoir écourter la magnifique apostrophe de don Ruy Gomez, au premier acte la scène des tableaux, le monologue de Charles-Quint, etc.? Ne serait-ce pas, au contraire, le moment de rétablir le texte primitif, de jouer la pièce telle que l'auteur l'avait d'abord conçue et qu'elle se trouve imprimée dans la Bibliothèque Charpentier? Les tragédies classiques nous amusent médiocrement, on le sait; à notre avis, les plus courtes sont tes meilleures, mais, lorsqu'on fait tant que de les représenter, nous les voulons entières, et toutes les modifications qu'on s'aviserait d'y introduire au nom d'un prétendu bon goût nous paraîtraient sacrilèges. A plus forte raison devons-nous protester contre les mutilations qu'on a fait subir à Hernani. La pièce est très bien jouée, du reste, par Ligier, Guyon et Beauvallet, qui ont tort de reculer devant certaines parties de leurs rôles; c'est vraiment trop modeste à eux. Madame Mélingue a parfaitement saisi le côté pathétique du rôle de doña Sol; le cinquième acte surtout a été pour elle un triomphe; il lui a valu presque une ovation de la part des habitués, de de l'orchestre, fort prévenus, comme on sait, contre tout ce qui vient du Boulevard. Encore quelques succès pareils, et Madame Mélingue aura, nous l'espérons, complètement lavé sa tache originelle.
10 mars 1845.
La reprise Hernani attire la foule au Théâtre-Français; on écoute avec admiration, avec recueillement ce beau drame qui ressemble à une tragédie de Corneille non retouchée par MM. Andrieux ou Planat.
Quand on songe aux tumultes, aux cris, aux rages de toutes sortes soulevés par cette pièce, il y a dix ans, on est tout étonné que la postérité soit venue si vite pour elle; on y assiste comme à un des chefs-d'œuvre de nos grands maîtres, et chaque spectateur achève lui-même le vers commencé par l'acteur. Cet Hernani, si sauvage, si féroce, si baroque, si extravagant, qui a fait soupçonner M. Hugo de cannibalisme par les bonnes têtes de l'époque, est aujourd'hui une œuvre calme, sereine, se mouvant et planant comme l'aigle des montagnes dans cette région d'azur éternel et de neige immaculée que le fumier et les brouillards ne peuvent atteindre. On en met des morceaux dans les cours de littérature, et les jeunes gens en apprennent des tirades pour se former le goût. C'est maintenant une pièce classique.
Une chose qui pourrait donner un nouvel attrait à ces représentations, qui certes n'en ont pas besoin, ce serait de jouer la pièce dans son intégrité, telle que l'auteur l'a écrite. Le public est assez mûr pour applaudir ce qu'il aurait sifflé autrefois. Pourquoi ne restituerait-on pas au rebelle Hernani quelques détails caractéristiques effacés à regret par le poète? Pourquoi ne rendrait-on pas à don Carlos son sublime monologue et ces beaux vers qui n'ont jamais été prononcés à la scène:
. . . . . . .
. . . . .
Ce Corneille Agrippa pourtant en sait bien long!
Dans l'océan céleste il a vu treize étoiles
Vers la mienne, du Nord, venir à pleines voiles.
J'aurai l'empire, allons!—Mais d'autre part on dit
Que l'abbé Jean Tritème à François l'a prédit,
J'aurais dû, pour mieux voir ma fortune éclaircie
Avec quelque armement aider la prophétie!
Toutes prédictions du sorcier le plus fin
Viennent bien mieux à terme et font meilleure fin,
Quand une bonne armée avec canons et piques,
Gens de pied, de cheval, fanfares et musiques,
Prête à montrer la route au sort qui veut broncher,
Leur sert de sage-femme et les fait accoucher.
Lequel vaut mieux: Corneille Agrippa? Jean Tritème?
Celui dont une armée explique le système,
Qui met un fer de lance au bout de ce qu'il dit,
Et compte maint soudard, lansquenet ou bandit
Dont l'estoc refaisant la fortune imparfaite
Taille l'événement au plaisir du prophète?
—Pauvres fous qui, l'œil fier, le front haut, visent droit.
A l'empire du monde, et disent: J'ai mon droit!
Ils ont force canons, rangés en longues files,
Dont le souffle embrasé ferait fondre des villes;
Ils ont vaisseaux, soldats, chevaux, et vous croyez
Qu'ils vont marcher au but sur les peuples broyés?
Baste! au grand carrefour de la fortune humaine
Qui mieux encore qu'au trône à l'abîme nous mène,
A peine ils font trois pas, qu'indécis, incertains,
Tachant en vain de lire au livre des destins,
Ou hésitent, peu sûrs d'eux-mêmes, et, dans le doute,
Au nécromant du coin vont demander leur route.
Des vers comme ceux-là ne peuvent faire longueur, comme on dit en argot dramatique. Il serait temps de ne pas chercher au théâtre la rapidité aux dépens de la poésie, du style, des développements historiques et humains. En suivant ce système, on en arrive à faire des pièces qui ne sont en quelque sorte que des pantomimes, avec un mot çà et là pour indiquer le sujet de la scène.
Ce bel édifice poétique où les styles moresque, gothique et de la Renaissance se fondent si heureusement, pourrait se montrer avec tous ses ornements, toutes ses arabesques et tous ses caprices. Nous sommes guéris heureusement de cet amour excessif de la sobriété qui nous faisait préférer les planches aux bas-reliefs; il n'est plus nécessaire de casser le nez des statues, et les aiguilles des cathédrales.
Madame Mélingue joue doña Sol avec une grande supériorité. C'est bien l'Espagnole ardente et contenue, la jeune fille et la grande dame romanesque et sublime qui peut prendre un bandit pour époux et refuser un roi pour amant.
Quant à Beauvallet, le rôle semble avoir été fait tout exprès pour lui; il y apporte cette âpreté, cette énergie qui le caractérisent et qui s'allient à une tendresse hautaine et grave, de façon à former le plus parfait Hernani qu'on puisse voir et entendre, car cette voix de cuivre pourrait dominer le bruit des torrents, et jeter l'appel du cor d'une montagne à l'autre.
Ligier n'a guère ce qu'il faut pour représenter un prince de vingt ans qui poussait le blond jusqu'au roux; mais au moins il dit avec intelligence et netteté.
Guyon, sans faire oublier Joanny dans ce rôle épique de Ruy Gomez de Silva, le joue cependant d'une manière satisfaisante; sa belle tête et sa voix forte composent un ensemble énergiquement mâle, tout à fait approprié au personnage.
Puisque M. Victor Hugo a renoncé au théâtre, à défaut de pièces nouvelles on devrait bien reprendre Le Roi s'amuse, un des plus beaux drames du poète,—qui n'a été joué qu'une fois;—l'interdiction serait facilement levée; et le Théâtre-Français pourrait compter sur une suite de représentations fructueuses.
8 novembre 1847.
L'on a repris Hernani, cette œuvre hardie, touffue et luxuriante de la jeunesse d'un grand poète. Maintenant, les orages soulevés par la haine, l'envie et la médiocrité, se sont apaisés. L'on apporte à cette belle pièce, cousine germaine du Cid, l'admiration sereine et tranquille qu'inspire la contemplation des chefs-d'œuvre classiques; ces nobles alexandrins à l'allure cornélienne, ces sentiments chevaleresques, cette folie du point d'honneur, si profondément espagnole, cette poésie nerveuse et colorée dont l'auteur semble avoir dérobé le secret aux auteurs inconnus du Romancero, sont écoutés avec une attention respectueuse. Qu'ils sont loin les jours de bataille où chaque hémistiche était pris et repris par les écoles rivales, au milieu du vacarme le plus étourdissant. Quels cris! quels tumultes! lorsque Don Carlos, au lieu de demander, selon le style alors généralement employé:
En quel point de l'émail pose le pied de l'heure?
dit, avec une crudité féroce, une barbarie sanglante:
Quelle heure est-il?
Et que Ricard lui répond tout sauvagement:
Minuit!
et non pas, comme il en avait le droit:
Dans sa fuite, il atteint la douzième demeure.
Quelle étrange chose, que les destinées littéraires! Le principal reproche que l'on faisait en ce temps-là à Victor Hugo, c'était de ne pas savoir le français: on le traitait de Goth, d'Ostrogoth, de Visigoth, de Huron, de Malgache et d'Uscoque, et maintenant il est reconnu non seulement pour un grand poète, mais encore pour un grammairien de première force, un linguiste consommé, un lexicographe profond. L'Académie le consulte pour son Dictionnaire, dans les cas embarrassants.
Nous ne trouvons pas que les acteurs jouent cette pièce avec le sentiment poétique qu'y apportèrent les créateurs des rôles principaux, Firmin, Joanny et Michelot surtout. Le retour de la tragédie a peut-être un peu gâté les caractères français d'aujourd'hui. Ils négligent les nuances délicates pour la sonorité des vers. Ils mènent les alexandrins de Victor Hugo deux par deux, comme si c'étaient «des vers classiques ou des bœufs». Il faut beaucoup d'oreille pour comprendre l'harmonie des vers à enjambement ou à césure déplacée. Nous voudrions qu'on fit un cours de prosodie pour les acteurs, et qu'on leur apprît même à faire des Vers français. On nous dira que plusieurs d'entre eux savent en faire... Aussi, parlons-nous surtout pour ceux-là.
5 décembre 1854.
Le nom d'Hernani réveille en nous un de nos plus vils souvenirs de jeunesse. Munis du billet rouge timbré de la symbolique devise «Hierro», nous avions pris notre place, dans la salle, dès trois heures, prêts à soutenir la grande lutte contre les classiques et les bourgeois, et nous montâmes à l'assaut du succès avec les jeunes bandes romantiques, enfants perdus de la sainte cause de l'Art. Encore aujourd'hui, nous réciterions des tirades entières de la pièce, et, malgré nous, sous les chants de Verdi, nous murmurons les vers de Victor Hugo; ce qui est un double plaisir, partagé sans doute par beaucoup de personnes.
21 juin 1867.
Il y a trente-sept ans que, grâce au carré de papier rouge égratigné de la griffe Hierro, nous entrions au Théâtre-Français bien avant l'heure de la représentation, en compagnie de jeunes poètes, de jeunes peintres, de jeunes sculpteurs,—tout le monde était jeune alors!—enthousiastes, pleins de foi et résolus à vaincre ou mourir dans la grande bataille littéraire qui allait se livrer. C'était le 25 février 1830, le jour d'Hernani une date qu'aucun romantique n'a oubliée, et dont les classiques se souviennent peut-être, car la lutte fut acharnée de part et d'autre. Beaux temps où les choses de l'intelligence passionnaient à ce point la foule!
Notre émotion n'a pas été moindre jeudi dernier. Trente-sept ans! c'est plus de deux fois ce que Tacite appelle «un grand espace de la vie humaine». Hélas! des anciennes phalanges romantiques, il ne reste que bien peu de combattants; mais tous ceux qui ont survécu étaient là, et nous les reconnaissions dans leur stalle ou dans leur loge avec un plaisir mélancolique en songeant aux bons compagnons disparus à tout jamais. Du reste, Hernani n'a plus besoin de sa vieille bande, personne ne songe à l'attaquer. Le public a fait comme don Carlos, il a pardonné au rebelle, et lui a rendu tous ses titres. Hernani est maintenant Jean d'Aragon, grand maître d'Avis, duc de Segorbe et duc de Cardona, marquis de Monroy, comte Albatera, et les bras de doña Sol se rejoignent autour de son cou sur l'ordre de la Toison d'or. Sans le pacte imprudent conclu avec Ruy Gomez, il serait parfaitement heureux.
Autrefois ce n'était pas ainsi, et chaque soir Hernani était obligé de sonner du cor pour rassembler ses éperviers de montagne, qui parfois emportaient dans leurs serres quelque bonne perruque classique en signe de triomphe. Certains vers étaient pris et repris comme des redoutes disputées par chaque armée avec une opiniâtreté égale. Un jour les romantiques enlevaient une tirade que l'ennemi reprenait le lendemain, et dont il fallait le déloger. Quel vacarme! quels cris! quelles huées! quels sifflets! quels ouragans de bravos! quels tonnerres d'applaudissements! Les chefs de parti s'injuriaient comme les héros d'Homère avant d'en venir aux mains, et quelquefois, il faut le dire, ils n'étaient guère plus polis qu'Achille et qu'Agamemnon. Mais les paroles ailées s'envolaient au cintre, et l'attention revenait bien vite à la scène.
On sortait de là brisé, haletant, joyeux quand la soirée avait été bonne, invectivant les philistins quand elle avait été mauvaise; et les échos nocturnes, jusqu'à ce que chacun fût rentré chez soi, répétaient des fragments du monologue d'Hernani ou de don Carlos, car nous savions tous la pièce par cœur, et aujourd'hui nous-même la soufflerions au besoin.
Pour cette génération, Hernani a été ce que fut le Cid pour les contemporains de Corneille. Tout ce qui était jeune, vaillant, amoureux, poétique en reçut le souffle. Ces belles exagérations héroïques et castillanes, cette superbe emphase espagnole, ce langage si fier et si hautain dans sa familiarité, ces images d'une étrangeté éblouissante, nous jetaient comme en extase et nous enivraient de leur poésie capiteuse. Le charme dure encore pour ceux qui furent alors captivés. Certes l'auteur d'Hernani a fait des pièces aussi belles, plus complètes et plus dramatiques que celle-là peut-être, mais nulle n'exerça sur nous une pareille fascination.
Dix ans plus lard, nous venions d'entrer en Espagne, le pays où nous avons nos châteaux; nous parcourions la route entre Irun et Tolosa, lorsqu'à un relai de poste un nom magique pour nous fit vibrer jusqu'au fond de notre cœur notre fibre romantique. Le bourg où l'on s'arrêtait s'appelait «Hernani». C'était une surprise pareille à celle qu'on éprouverait en entendant donner à un lieu réel un nom des pièces de Shakespeare. Le bourg était d'ailleurs bien digne du titre célèbre qu'il portait. Ses maisons de pierre grise, aux portes étoilées de gros clous, aux fenêtres grillées de serrureries touffues, aux toits fortement projetés, historiées de grands blasons sculptés, à lambrequins énormes et à supports bizarres qu'accompagnaient de graves légendes castillanes où parlaient en quelques mots l'honneur, la foi et la fierté, convenaient admirablement, chose rare, au souvenir évoqué. A chaque instant nous nous attendions à voir déboucher par une ruelle Hernani eu personne avec sa cuirasse de cuir, son ceinturon à boucle de cuivre, son pantalon gris, ses alpargatas, sou manteau brun, son chapeau à larges bords, armé de son épée et de sa dague, et portant à une ganse verte son cor aussi connu que celui de Roland. Sans doute le poète, dont l'enfance s'est passée au collège noble de Madrid, a traversé ce bourg, et, ce nom sonore et bien fait lui étant resté dans quelque recoin de sa mémoire, il en a baptisé plus tard le héros de son drame.
Mais nous voilà comme Nestor, le bon chevalier de Gerennia, dont nous n'avons cependant pas encore l'âge, occupé à raconter des histoires et à dire aux hommes d'aujourd'hui ce qu'étaient les hommes d'autrefois. Laissons, comme il convient, le passé pour le présent, et revenons à la représentation de jeudi. La salle n'était pas moins remplie ni moins animée que le 25 février 1830; mais il n'y avait plus d'antagonisme classique et romantique. Les deux camps s'étaient fondus en un seul, battant des mains avec un ensemble que ne troublait plus aucune discordance. Les passages qui jadis provoquaient des luttes étaient, nuance délicate, particulièrement applaudis, comme si l'on voulait dédommager le poète d'une antique injustice. Les années se sont écoulées, et l'éducation du public s'est faite insensiblement; ce qui le révoltait naguère lui semble tout simple. Les prétendus défauts se transforment en beautés, et tel s'étonne de pleurer là où il riait, et de s'enthousiasmer à l'endroit qu'il sifflait. Le prophète n'est pas allé à la montagne, mais la montagne est allée au prophète, contrairement à la légende de l'Islam.
L'œuvre elle-même a gagné avec le temps une magnifique patine; comme sous un vernis d'or qui adoucit et qui réchauffe en même temps, les couleurs violentes se sont calmées, les âpretés de touche, les férocités d'empâtement ont disparu; le tableau a la richesse grave, l'autorité et la largeur de pinceau d'un de ces portraits où Titien, le peintre de Charles-Quint, représentait quelque haut personnage avec son blason dans le coin de la toile.
Dans la préface de sa pièce, l'auteur disait en parlant de lui-même: «Il n'ose se flatter que tout le monde ait compris du premier coup ce drame dont le Romancero general est la véritable clef. Il prierait volontiers les personnes que cet ouvrage a pu choquer, de relire Le Cid, Don Sanche, Nicomède, ou plutôt tout Corneille et tout Molière, ces grands et admirables poètes. Cette lecture, si pourtant elles veulent bien faire d'abord la part de l'immense infériorité de l'auteur d'Hernani, les rendra peut-être moins sévères pour certaines choses qui ont pu les blesser dans le fond ou la forme de ce drame».
Dans ces quelques lignes se trouve le secret du style romantique qui procède de Corneille, de Molière et de Saint-Simon, en y ajoutant pour les images quelques nuances de Shakespeare. Racine seul paraît classique aux délicats qui, au fond, n'aiment guère les mâles poètes et le vigoureux prosateur que nous venons de citer. C'est cette veine de langage qui leur déplaît dans les poètes modernes, en général, et chez Hugo en particulier.
C'est un bien vif plaisir de voir, après tant de mélodrames et de vaudevilles, cette œuvre de génie avec ses personnages plus grands que nature, ses passions gigantesques, son lyrisme effréné et son action qui semble une légende du Romancero mise au théâtre comme l'a été celle du Cid Campéador, et surtout d'entendre ces beaux vers colorés, si poétiques, si fermes et si souples à la fois, se prêtant à la rapidité familière du dialogue où les répliques s'entrecroisent comme des lames et semblent jeter des étincelles, et planant avec des ailes d'aigle ou de colombe aux moments de rêverie et d'amour.
Dans le grand monologue de don Carlos devant le tombeau de Charlemagne, il nous semblait monter par un escalier dont chaque marche était un vers, au sommet d'une flèche de cathédrale, d'où le monde nous apparaissait comme dans la gravure sur bois d'une cosmographie gothique, avec des clochers pointus, des tours crénelées, des toits à découpure, des palais, des enceintes de jardins, des remparts eu zigzag, des bombardes sur leurs affûts, des tire-bouchons de fumée, et tout au fond un immense fourmillement de peuple. Le poète excelle dans ces vues prises de haut sur les idées, la configuration ou la politique d'un temps.
La pièce qui portait ce sous-titre: Hernani ou L'Honneur castillan, a pour fatalité el pundonor, cette anankê de tant de comédies espagnoles; Jean d'Aragon y obéit, mais ce n'est pas sans regret; la vie lui est si douce quand sonne le rappel du serment oublié, et il suit Doña Sol dans la mort, plutôt qu'il ne tient sa promesse. Mais voilà que l'habitude de l'analyse nous emporte, et que nous racontons Hernani.
On nous demandera sans doute si d'origine l'exécution de la pièce était supérieure à celle d'aujourd'hui; à l'exception du vieux Joanny, les acteurs qui créèrent les rôles étaient peu sympathiques au nouveau genre, et jouaient loyalement à coup sûr, mais sans grande conviction; Firmin donnait à Hernani cette trépidation fiévreuse qui, chez lui, simulait la chaleur; Michelot était un don Carlos assez médiocre, dont les coupes du vers moderne embarrassaient la diction; Mademoiselle Mars ne pouvait prêter à la fière et passionnée doña Sol qu'un talent sobre et fin, préoccupé des convenances, plus fait d'ailleurs pour la comédie que pour le drame. Seul Joanny réalisait l'idéal de Ruy Gomez de Silva. Il était enchanté de son rôle et il y croyait absolument. Sa main mutilée à la guerre lui donnait l'air d'un héros en retraite, et il disait superbement ce vers:
Essaye à soixante ans ton harnais de bataille.
Delaunay a joué Hernani avec une rare intelligence et il est difficile de lutter plus habilement contre une physionomie qui est naturellement charmante et qui, pendant quatre actes du drame, doit être sinistre, orageuse et fatale. Mais au dénouement, quand le bandit redevenu grand seigneur a dépouillé ses guenilles de salteador, Delaunay, rentré dans son milieu de grâce et d'élégance, joue admirablement la scène d'amour et d'agonie. Ruy Gomez, «le vieillard stupide», est représenté par Maubant avec une dignité, une mélancolie et un sentiment de la vie féodale qu'on ne saurait trop louer; il a dit de la façon la plus noble, la plus paternelle et la plus louchante, la déclaration d'amour du bon vieux duc. Dressant a derrière les portraits historiques de Charles-Quint retrouvé un Don Carlos jeune, brave et galant avec une légère barbe dorée admirablement réussie. Il a bien dit le grand monologue. Quant à Mademoiselle Favart, elle est la véritable doña Sol: hautaine et soumise à la fois, faisant plier sa fierté devant l'amour et se révoltant contre la galanterie; aventureuse et fidèle comme une héroïne de Shakespeare, elle a, au dernier acte, une agonie digne de Rachel.
«MON CHER MAITRE,
«Je n'appartiens pas au parapluie élégant égaré dans votre charmant ermitage. J'ai gardé de mes jeunes années de romantisme une horreur sacrée pour ce meuble bourgeois.
«Hernani n'avait pas de parapluie, puisque Doña Sol lui dit:
... Jésus! Votre manteau ruisselle!
«Et je me suis toujours conformé aux opinions du héros castillan, en matière de riflard.
«Agréez l'expression bien sincère de ma respectueuse et cordiale sympathie.
«THÉOPHILE GAUTIER.»
Écrit à propos de la représentation sur le théâtre du comte de Castellane, les 4 et 5 avril 1837, d'une comédie de Madame Sophie Gay: La Veuve du Tanneur:
«Parmi les illustrations littéraires on remarquait M. Alexandre Duval, ce bon vieillard qui offrit si naïvement à Victor Hugo de lui faire la charpente de ses pièces, et qui a cause de son grand âge jouit du privilège d'être assis avec les femmes.»
Août-septembre 1835.
Notre Dame de Paris est un livre qui n'a plus besoin d'éloges; ses nombreuses éditions le louent mieux que nous ne pourrions le faire; elles se sont succédé avec une prodigieuse rapidité, et n'ont pas suffi à l'empressement du public. C'est à coup sûr le roman le plus populaire de l'époque: son succès a été complet. Artistes et gens du monde se sont réunis dans la même admiration; les critiques les plus hostiles eux-mêmes n'ont pu s'empêcher de joindre leurs applaudissements à l'applaudissement général; et s'il était permis de donner une limite à un génie dans toute sa force et de tant d'avenir, on pourrait croire que Notre-Dame de Paris est et demeurera le plus bel ouvrage du poète.
C'est une vraie Iliade, que ce roman. Variété de physionomies, exactitude de costume, miraculeux artifices de description, haute et sublime éloquence, comique vrai et irrésistible, grandes vues historiques, intrigue souple et forte, sentiment profond de l'art, science de bénédictin, verve de poète, tout se trouve dans cette épopée en prose qui, si M. Victor Hugo n'eût pas été déjà vingt fois célèbre, eût rendu à elle seule son nom à tout jamais illustre.
Byron, celui de tous les poètes qui a créé les plus charmantes idéalités féminines, n'a rien à opposer à la divine Esmeralda; Gulnare, Medora, Haydée sont aussi belles, mais pas plus, et elles sont moins touchantes.
Maturin n'eût pas dessiné avec moins d'énergie la sombre figure de Claude Frollo, dévoré par sa soif de science qui se change en soif d'amour.
Le Phœbus de Châteaupers a aussi bonne grâce sous son harnais que ces beaux jeunes gens souriants et basanés, tout habillés de velours, qui se pavanent dans les toiles de Paul Véronèse avec un oiseau sur le poing ou un lévrier en laisse. Sa bonhomie insouciante et brutale est peinte de main de maître. C'est la vie et la vérité mêmes.
Qui n'a ri de tout son cœur aux angoisses du péripatéticien Gringoire, avec son pourpoint qui montre les dents, ses souliers, qui tirent la langue et sa faim toujours inassouvie? Les poètes à jeun de Régnier ne sont pas dessinés d'un crayon plus franc et plus vif.
Et Quasimodo, ce monstrueux escargot dont Noire-Dame est la coquille! Qui n'a admiré son dévouement de chien et ses vertus d'ange dans un corps de diable? Qui n'en a pas voulu un peu à la Esmeralda de ne pas l'aimer malgré sa double bosse, son œil crevé, sa jambe cagneuse et sa défense de sanglier? Qui n'a pas pleuré sur la pauvre Chantefleurie? Sur quel fond magnifique se détachent ces figures devenues des types! Tout le vieux Paris: églises, palais, bastilles, le retrait de Louis XI et la Cour des Miracles; une ville morte déterrée et ressuscitée; un Pompéi gothique retiré des fouilles; deux mille in-folio compulsés, une érudition à effrayer un Allemand du moyen âge, acquise tout exprès! Et sur tout cela un style éclatant et splendide de granit et de bronze, aussi indestructible que la cathédrale qu'il célèbre.
Notre-Dame de Paris est dès aujourd'hui un livre classique.
C'est à de tels livres que doit être réservé le luxe des illustrations, la beauté du papier et des caractères, et non à d'autres.
Celle édition, en trois volumes in-octavo, tirée à onze mille exemplaires et publiée par livraisons de cinquante centimes, tous les samedis, sera illustrée de douze vignettes des meilleurs artistes anglais et français, et le burin de Finden y luttera de vigueur et de grâce avec le pinceau des Boulanger, des Johannot, des Raffet, etc. Les vignettes vaudront les pages auxquelles elles correspondent, et ce n'est pas peu dire.
Avril 1850.
Notre-Dame de Paris est dans l'œuvre de Victor Hugo comme la cathédrale elle-même dans la ville: un monument haut et sombre que l'on aperçoit de tous les points de l'horizon. Autour se pressent les constructions les plus variées: palais, maisons, tourelles de style différent et de mérite égal, qu'on visite et qu'on admire; mais toujours, au bord de quelque perspective subite, se dressent les deux grandes tours s'élevant vers le ciel comme les deux bras d'un géant de pierre.
Nous ne reviendrons pas sur cette merveilleuse épopée; œuvre immense et touffue, et qui, bonheur singulier, a pu devenir populaire en restant dans les conditions de l'art le plus fantasque, le plus capricieux et le plus exigeant; jamais livre n'eut un succès pareil: aux éditions épuisées succèdent les nouvelles éditions de tous formats et de tous prix.
M. Paul Fouché a extrait le drame que contient le roman avec cette habitude de la scène qu'il possède, les acteurs sont entrés dans la peau et le costume des personnages, les décorateurs ont traduit les descriptions aussi littéralement qu'une brosse peut interpréter la plume d'un grand poète; les chapitres ont fait les tableaux, et tout le côté pittoresque du livre a été transporté au théâtre avec un art merveilleux. La dernière décoration que représente «Paris à vol d'oiseau», est la meilleure illustration qu'on puisse faire des magnifiques pages qu'il retrace. Saint-Ernest, qui représente le pauvre Quasimodo, est arrivé à une puissance de laideur inimaginable; il a tout à fait l'air «d'un cauchemar à cheval sur une cloche», Phœbus de Châteaupers ne désavouerait pas la grâce soldatesque et la haute mine de Fechter, Arnauld a donné à Claude Frollo l'aspect sombre, ardent et ravagé du prêtre alchimiste oubliant toutes les sciences pour l'amour. Chilley est un Gringoire excellent, et Madame Naptal-Arnault a joué le rôle de l'Esmeralda avec une grâce et une sensibilité exquises.
N'oublions pas de mentionner une ronde de truands, mise en musique par M. Artus et qui a beaucoup d'entrain et de caractère.
Quasimodo jettera deux cents fois de suite Claude Frollo du haut des tours Notre-Dame, devant un public émerveillé et nombreux.
5 juillet 1835.
Pour les dramaturges ordinaires il n'est besoin que d'une seule représentation. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est occuper la scène pendant trois ou quatre heures et réunir dans un rôle composé ad hoc tous les mots à effet d'un acteur en vogue; c'est fournir à une actrice un prétexte de changer plusieurs fois de toilette: d'avoir au premier acte une robe de satin blanc broché, au deuxième une autre de velours noir et au troisième le peignoir obligé d'organdi ou de mousseline avec lequel on peut se rouler passionnément par terre, sans que la crainte d'y faire un accroc ou une tache d'huile ne vienne vous préoccuper au milieu d'une convulsion dramatique; beaucoup de pièces n'ont été fabriquées que pour donnera Mademoiselle telle ou telle l'occasion de paraître avec tous ses diamants. Le satin éraillé, le velours rompu à ses plis, les diamants resserrés dans l'écrin, la pièce s'enfonce au plus profond du noir Léthé, tout le monde l'oublie, jusqu'à l'auteur lui-même qui la refait six mois après, mais sans que lui ou le public s'en aperçoive. Il est vrai que dans celle-ci la jupe de la diva est de brocart à fleurs d'or, qu'elle a des plumes au lieu d'être en turban, ce qui différencie considérablement le caractère et fait de la vieille pièce une pièce toute neuve.
A ces gens-là, il suffit d'une petite colonne de prose taillée à la hâte avec le nom et la date au bas, pour marquer dans le vaste cimetière dramatique du siècle la place précise où est enterré chacun de leurs avortons. Mais avec M. Hugo on ne peut pas se permettre d'en agir de la sorte.
De tout drame de M. Hugo il reste un beau livre; tout n'est pas dit quand la toile a été baissée et l'actrice redemandée; ce qui est important pour les autres n'est qu'un détail pour lui. La pièce a soixante représentations comme Hernani, ou n'en a qu'une comme Le Roi s'amuse, qu'importe? Cela importe si peu que c'est une chose reconnue maintenant de tout le monde que ce même Roi s'amuse, si outrageusement sifflé, est la meilleure pièce de M. Hugo. Le lecteur a cassé le jugement du spectateur et le livre a corrigé le théâtre. Chaque individu de cette foule qui faisant ho! et ha! aux plus beaux endroits a applaudi séparément. Car le poète, face à face avec lui débarrassé des mille empêchements matériels, des faux-jours des quinquets, du nez de celui-ci, des jambes de celui-là, des gaucheries de mise en scène et de l'inintelligence de tous, s'emparait de lui et le pénétrait de son souffle, et l'emportait sur ses ailes puissantes bien au-dessus de la vieille salle des Français.
Angelo a eu une meilleure fortune au théâtre. Les drames ont leurs destins comme les livres. Il poursuit bravement sa marche triomphale à travers les préoccupations politiques les plus graves, et par une chaleur presque sénégambienne. Tous les jours, la queue s'allonge de quelques anneaux et elle balaye au loin les couloirs obscurs du Palais-Royal.
De l'intrigue de la pièce, nous n'en dirons rien; tout le monde la connaît; mais nous entrerons dans quelques considérations d'art et de style à propos du livre.
La cause de la réussite complète d'Angelo est l'absence de lyrisme. Cela est honteux à dire pour notre public, mais cela est ainsi. Une autre cause de succès, aussi triste que celle-là, c'est qu'Angelo est en prose. M. Hugo ayant résolu de marcher et non de voler, pour que le parterre ne le perdit pas de vue, a prudemment serré ses talonnières dans son tiroir. Car les poètes sont comme les hippogriffes, ils peuvent courir et voler, tandis que les prosateurs, si envieux qu'ils soient, ne peuvent que courir. Tout poète, quand il voudra descendre à cette besogne, fera de l'excellente prose; jamais un prosateur-né, fût-ce M. de Chateaubriand, ne fera de beaux vers.
Nous avons dit que la pièce n'était pas lyrique. Cependant l'aigle de M. Hugo donne de temps en temps de grands coups d'ailes, et beaucoup de phrases sont de véritables strophes d'ode. Fresque toutes ces phrases sont, couvertes d'applaudissements, par une contradiction assez singulière.
Le caractère de M. Hugo n'est ni anglais, ni allemand, ni français; il n'est pas profond et humain comme Shakespeare, magnifiquement placide et indifférent comme Gœthe, spirituel et sensé comme Molière. Il est volontaire et démesuré, il est espagnol et castillan. Il admire bien Homère et la Bible si vous voulez, mais soyez sûre qu'il donnerait l'un et l'autre pour le Romancero.
C'est un génie de même trempe que celui du vieux Corneille, orgueilleux et sauvagement hérissé. Quoique de temps en temps il se donne des grâces de lion, il fasse des coquetteries gigantesques, c'est un rude dessinateur, capable de dire comme Michel-Ange que la peinture à l'huile n'est bonne que pour les femmes et pour les paresseux: il va tout droit au nerf, le dégage des chairs et le fait saillir avec une vigueur prodigieuse. On prendrait certaines phrases de M. Hugo pour ces figures qui sont dans les encoignures et les pendentifs de la Sixtine et dont les muscles adducteurs et extenseurs sont également boursouflés; mais la boursouflure de son style est comme celle des hommes de Buonarotti, c'est une boursouflure de bronze.
Puget a dit que les blocs, de marbre tremblaient comme la feuille lorsqu'ils le sentaient approcher et qu'ils lui fondaient entre les mains comme de la cire; je crois qu'il en doit être autant des blocs où le poète taille sa pensée. Il me semble le voir avec son coin de fer faisant sauter à droite et à gauche d'énormes caillots, sculptant plutôt à la hache qu'au ciseau, ouvrant à grands coups de marteau la bouche béante d'un masque tragique, et travaillant largement, robustement, sans petites finesses et sans petites délicatesses, comme il sied à un artiste primitif dont les figures doivent être placées haut.
Au milieu de l'affaiblissement général où nous vivons, dans ce siècle où rien n'a conservé ses angles, une nature avec des arêtes aussi vierges et aussi franches est une véritable merveille. Ce fier génie s'est trompé en naissant aujourd'hui. Il aurait dû venir au seizième, un peu avant l'apparition du Cid. Ce n'est pas qu'il eût été plus grand, mais il eût été plus heureux. En ce temps, il n'aurait vu ni le Panthéon, ni la Bourse; il eût été peintre, sculpteur, architecte, ingénieur et poète comme le Vinci, comme Benvenuto, comme Buonarotti, comme tous les autres, car c'est un génie essentiellement plastique, amoureux et curieux de la forme, ainsi que tout véritable jeune. La forme, quoi qu'on ait dit, est tout. Jamais on n'a pensé qu'une carrière de pierre fût artiste de génie; l'important est la façon que l'on donne à cette pierre, car autrement, où serait la différence d'un bloc et d'une statue! Où serait la différence de Victor Ducange à Victor Hugo?
Le monde est la carrière, l'idée le bloc, et le poète le sculpteur. Sait-il son métier, ou ne le sait-il pas? Voilà la question!
Angelo est un drame dont le tragique ressort plutôt du choc des situations que du développement d'une passion première. Il est de la famille de Cymbeline, de Mesure par mesure et Troïlus et Cressida, ces pièces romanesques de Shakespeare qui reposent sur des aventures et non sur des généralités, sont le seul drame possible dans une civilisation aussi décuplée que la nôtre; on ne peut guère plus faire de comédie sur un péché capital ou sur un caractère, ce qui est la même chose, car les physionomies se dessinent au moyen des ombres, et rien ne fût moins dramatique au monde que les gens vertueux.
On a fait l'Avare, l'Hypocrite, le Menteur, le Jaloux, le Méchant, le Misanthrope, etc. Ce sont choses sur quoi on ne peut plus revenir, et l'on aurait aussi mauvaise grâce à retoucher Othello que Tartufe: les passions et les défauts de l'homme ne sont pas inépuisables, et ne peuvent donner lieu qu'à un certain nombre de combinaisons qui ont été déjà reproduites mille fois. Reste donc l'aventure, le roman, le caprice, la fantaisie curieuse de style, car le drame de passion, la comédie de mœurs, aujourd'hui qu'il n'y a plus ni passions ni mœurs, ne peuvent intéresser ni amuser personne.
La science est malheureusement trop répandue pour qu'un drame historique puisse avoir le moindre succès: c'est ce que M. Victor Hugo a très bien compris. Le plus grand moyen de réussite au théâtre est la surprise, et où peut être la surprise dans un drame historique? Comment trembler pour tel ou tel héros, lorsqu'on sait qu'il est mort trente ans plus tôt dans son lit, après avoir fait son testament et reçu l'extrême-onction? Comment s'intéresser au sort d'une héroïne que l'on sait avoir été hydropique et bossue? M. Hugo ne prend de l'histoire que les noms, du temps que les couleurs générales, de pays que quelques traits de localité, pour en faire un fond harmonieux à l'action qu'il veut développer.
Peut-être ferait-il mieux encore de ne pas mettre de noms du tout, et d'appeler ses personnages: le Duc, la Reine, le Prince, la Princesse, et ainsi de suite; j'aimerais autant pour ma part les vieux noms consacrés de Silvio, de Léandre, de Perside, de Graciosa, qui donnent aux pièces où ils sont mêlés un air d'invraisemblance charmante. Cela aurait l'avantage ineffable de clore la bouche à tous les savants critiques qui ne manquent jamais, à chaque drame de M. Hugo, de demander avec leur esprit ordinaire: «Voici François Ier, mais où est Léonard de Vinci, où est Luther, où est le pape, où est Caillette, où est Charles-Quint, où sont tous les personnages qui ont vécu en ce temps-là? où est-il, lui-même, ce beau seizième siècle?» Pardieu! il est couché entre le quinzième et le dix-septième, dans son linceul d'éternité, au plus profond du néant, dans la vallée de Josaphat, où le Temps enterre les siècles morts, de ses vieilles mains toujours jeunes! Et je ne vois pas, parce qu'on parle d'un personnage historique, où est la nécessite de parler de tous les personnages historiques contemporains. Il n'est pas absolument indispensable qu'un drame soit un autre dictionnaire Moréri. Mais il faut bien que le critique montre qu'il a relu fraîchement son histoire et ses chroniques.
Je trouve que les drames de M. Hugo sont suffisamment exacts. La scène est à Padoue, Francisco Donato étant doge. C'est bien. Elle serait à Trébizonde sous le règne d'Hassan, deuxième du nom, ce serait aussi bien. Avez-vous été ému, avez-vous pleuré, avez-vous frémi? Tout est là!
Une qualité que M. Hugo porte à un degré aussi éminent qu'Anne Radcliffe et Maturin, c'est la terreur ténébreuse et architecturale, si on peut s'exprimer de la sorte. Le palais d'Angelo est une construction aussi effroyablement mystérieuse que le château d'Udolphe. Il a un autre palais inconnu à qui il sert de boîte extérieure et dont il n'est que l'enveloppe. Vous croyez que ceci est un mur, c'est un corridor. Voici un buffet d'un travail admirable, que les merveilleux artistes de la Renaissance ont ciselé à plaisir, c'est une porte. Des escaliers montent et descendent dans le noyau des colonnes, les boiseries entendent et parlent, la tapisserie a tremblé. Si Hamlet était là, ce ne serait ni un rat, ni un Polonius qui piquerait de son épée, mais quelque sbire armé d'un poignard. Que dis-je? Hamlet ne serait pas si courageux à Padoue qu'à Elseneur, ou peut-être il n'oserait pas: «Il y a un couloir secret, perpétuel traiteur de toutes les salles, de toutes les chambres, de toutes les alcôves, un corridor ténébreux dont d'autres que vous connaissent les portes et qu'on sent serpenter autour de soi sans savoir au juste où il est, une sape mystérieuse où vont et viennent sans cesse des hommes inconnus qui font quelque chose.» La nuit on entend des pas dans le mur, et l'on ne sait pas si l'un des beaux tableaux de courtisanes nues peintes par Titien ne va pas tourner sur lui-même, et donner passage à un bravo qu'il faudra suivre dans quelque lieu profond et humide dont il ressortira seul.
Il y a toute sorte d'entrées masquées; de fausses portes qui s'ouvrent avec de petites clés singulières. Ici il y a un bouton à presser, là une trappe à lever. Piranèse, le grand Piranèse lui-même, ce démon du cauchemar architectural, lui qui sait arrondir des voûtes si noires, si suantes, si prêtes à crouler, qui fait pousser dans ses décombres des plantes qui ont l'air de serpents, et qui tortille si hideusement les jambes difformes de la mandragore entre les pierres lézardées et les corniches disjointes, n'aurait pas, dans son eau-forte la plus fiévreuse et la plus surnaturelle, atteint à cette puissance de terreur opaque et étouffante.
On tend des églises en noir, on chante un service, on lève une dalle dans un caveau, on creuse une fosse pour une personne vivante. Derrière ces beaux rideaux de brocart brodés richement, à la place du lit il y 'a un billot de bois grossier, une hache et un drap. Toutes les chambres ont l'air sinistre et inhabitable. La chambre même de la Tisbé a l'air d'une nef d'église abandonnée, et c'est en vain que cette draperie d'étoffe brochée rompt coquettement ses plis, et fait scintiller outre mesure ses filaments et ses fleurs d'or. C'est en vain que les masques de théâtre sourient tant qu'ils peuvent sur les fauteuils et le parquet. Les chaises ont beau faire, elles ressemblent à des prie-Dieu, et l'habit pailleté de la Rosemonde n'est autre chose que le suaire oublié par un fantôme. Les murs sont d'une couleur à ce que le sang n'y paraisse guère. On sent bien que quelqu'un doit mourir là. C'est une chambre délicieuse pour assassiner, et très logeable pour les morts.
Réellement, je ne crois pas que la Catarina soit sortie de là bien vivante, et je ne jurerais pas que la Tisbé, toute bonne fille qu'elle est, n'ait mêlé un peu du flacon noir avec le flacon blanc. Je conseillerais amicalement au Rodolfo de modérer sa joie.
Une scène d'espions a été retranchée tout entière, et sera rétablie à la reprise. Elle se passait dans une espèce de coupe-gorge ou d'hôtellerie douteuse pour laquelle on a craint la susceptibilité trop chatouilleuse des loges du Théâtre-Français.
Je ne sais pas trop jusqu'à quel point il est bon de casser le nez ou les doigts aux bas-reliefs, et d'ébarber une cathédrale de ses guivres et de ses tarasques; mais que voulez-vous? en fait de bas-reliefs le public aime mieux une planche rabotée. Une branche d'arbre coupée peut contribuer à rendre l'air d'un berceau plus pur, mais elle fait une plaie au tronc de l'arbre, et y laisse un écusson blanc, hideux à voir comme un ulcère.
Je ne suis point de ceux qui croient qu'une pensée peut être ôtée impunément d'une œuvre quelconque. Vous avez une toile où il y a un nœud, vous arrachez ce nœud, mais vous arrachez avec lui le fil auquel il tient, et vous faites un vide dans toute la longueur de la trame: il en est ainsi des pensées. Retranchez une phrase au premier acte: vous en rendez trois autres inintelligibles au second, six au troisième, et ainsi de suite.
Toute œuvre naît complète, bien ou mal conformée, elle a la jambe fine, ou elle est boiteuse. C'est la chance; mais couper la cuisse à un pied bot ne me paraît pas un moyen de lui faire une belle jambe.
Quant à la pièce de M. Hugo, elle a d'aussi belles jambes que la Diane Chasseresse, et on ne lui a retranché que quelques boucles de cheveux, qui voltigeaient trop capricieusement et trop sauvagement sur ses blanches épaules, pour être du goût des bourgeois bien cravatés de la bonne ville de Paris; et les précieuses boucles, aussi fines et aussi déliées que la plus belle soie, se retrouvent intactes entre les feuilles satinées de la brochure.
27 mai 1850.
Angelo est le seul drame en prose que Victor Hugo ait fait représenter au Théâtre-Français; mais une telle prose, si nette, si solide, si sculpturale, vaut le vers; elle en a l'éclat, la sonorité le rythme même; elle est tout aussi littéraire et difficile à écrire.
Nous croyons que jusqu'ici on n'a pas tiré de la prose, au théâtre, tous les effets qu'elle contient. Presque tous les chefs-d'œuvre de notre répertoire sont en vers, et les quelques exceptions que l'on citerait ne feraient que confirmer la règle.
Les pièces régulières de Molière, celles sur lesquelles il comptait, sont en vers: lorsqu'il emploie la prose, ce n'est que comme à regret et lorsqu'il est pressé par les ordres du roi.
Son Festin de Pierre, ou pour parler correctement, son Convié de Pierre, d'un si beau style pourtant, a été versifié après coup, par Thomas Corneille, et ce n'est que dans ces derniers temps qu'il a été restitué dans sa forme première; on a cru longtemps que la prose n'était pas quelque chose d'assez achevé, d'assez savant, d'assez poli pour être offert au public raffiné de la Comédie-Française.
Marivaux et Lesage, qui écrivirent en prose en furent moins prisés par les délicats d'alors, bien qu'ils vinssent à une époque relativement moderne. Beaumarchais fut le premier qui installa victorieusement la prose sur le théâtre habitué à la mélopée tragique et à l'éclat de rire scandé de la comédie, mais aussi quelle prose habile, travaillée, taillée à facettes, pleine de science et d'adresse féconde en ressources inattendues, en ruses acoustiques, en moyens de détacher la phrase, de faire scintiller le mot et aiguiser le trait, de produire des effets harmonieux ou saccadés! Cette science est poussée à un tel point que, dans certains passages, non seulement les résultats du vers sont atteints, mais encore ceux de la musique, comme dans la tirade de la calomnie, par exemple, que Rossini n'a eu que la peine de noter, en l'accentuant un peu, pour en faire un air admirable. Beaumarchais va si loin qu'il se sert de l'assonance et de l'allitération, et souvent du vers blanc de huit pieds.
Une prose ainsi faite a toutes les qualités du vers, avec, plus d'aisance, de rapidité et de souplesse; elle est peut-être le langage le plus accommodé au théâtre, où elle tiendrait la place entre le vers et la langue vulgaire. Nous manquons pour la scène, et c'est un malheur, du vers ïambique que possédaient les Grecs et les Latins. Nous sommes obligés de nous servir du vers héroïque. L'hexamètre ou alexandrin, pour lui donner son nom moderne, quoique admirablement manié par de grands poètes et assoupli avec une prodigieuse habileté métrique dans ces dernières années, garde toujours quelque chose de redondant et d'emphatique. Sa césure mal placée se fait trop sentir dans le débit, et gêne l'illusion. Nous ne voulons pas dire par là que ces difficultés n'ont jamais été surmontées; elles l'ont été souvent, et de la manière la plus brillante.
Quand on est habile, on tire des accords mélodieux d'un roseau, mais une flûte à plusieurs clés ne gâte rien; les Anglais et les Allemands ont au théâtre une grande liberté métrique: Shakespeare part de la prose pour arriver, par le vers blanc, au vers rimé. Les Espagnols ont le vers de romance octosyllabe rapide chargé d'une légère assonance, ne rimant pas quand il le veut et pour produire un effet. La prose ainsi que l'ont faite Beaumarchais et Victor Hugo, l'un pour la comédie et l'autre pour le drame, nous paraît parfaitement pouvoir remplacer cet jambe qui nous fait faute. Cela ne veut pas dire que nous proscrivions le vers de la scène: bien que l'arrangement de la vie ait fait de nous un critique, nous nous souvenons que nous sommes poète, et ce n'est pas nous qui méconnaîtrons jamais le charme et les droits de la poésie; mais nous pensons que certains sujets peuvent être creusés plus profondément en prose qu'en vers, et qu'un autre ordre d'idées dramatiques s'exprimeraient mieux par ce moyen.
Nous étions sûr que Mademoiselle Rachel obtiendrait un immense succès dans la Tisbé, et qu'elle serait parfaitement à l'aise avec ces lignes aussi fermes que les alexandrins de Corneille. Rien ne va mieux à son débit détaillé et savant, à son accent profond, que ces phrases qui résonnent sur l'idée comme une armure d'airain sur les épaules d'un guerrier, que ce style si arrêté, si net et si magistral, qui vient en avant comme un bas-relief taillé par le ciseau; en jouant la Tisbé, Mademoiselle Rachel s'est emparée du drame comme elle s'est emparée de la tragédie. Elle régnera désormais sans rivale sur l'empire romantique, comme elle régnait naguère sur l'empire classique.
Le rôle de Tisbé a été, comme chacun sait, rempli, d'origine, par Mademoiselle Mars; nous n'en avons pas gardé un souvenir bien enthousiaste, le talent de Mademoiselle Mars, nous l'avouons à notre honte, ne nous a jamais fait grande impression dans ce rôle. Tout en rendant justice à ses incontestables qualités, nous trouvons qu'elle n'avait compris la Tisbé que très imparfaitement. Mademoiselle Mars possédait au plus haut degré la distinction bourgeoise et le bon ton vulgaire, si ces mois ne souffrent pas d'être accouplés ensemble. Elle n'avait pas cette distinction native dont une duchesse peut manquer, et qui se trouve quelquefois chez une bohémienne. Les grâces étudiées, apprises, ne résultent pas d'un heureux naturel, mais bien d'une volonté patiente. La préoccupation du comme-il-faut était visible chez elle, comme chez une femme de banquier dans une soirée aristocratique. Certes, il n'y avait rien à reprendre ni dans la voix, ni dans le geste, mais ce n'était pas là la distinction aisée, naturelle, sûre d'elle-même et qui s'oublie sans cesser d'être. En un mot, elle manquait de race.
Le rôle de Tisbé l'effarouchait. Elle l'effaçait plutôt qu'elle ne le faisait ressortir. Elle en apprivoisait les sauvageries, croyant le rendre ainsi de bon goût. Elle faisait de Tisbé une dame, qu'on aurait pu présenter dans les salons, et qui n'y aurait pas été déplacée. Elle prosaïsait tant qu'elle pouvait, pour la rendre convenable, la fougueuse et fantasque comédienne. Tout le côté pittoresque du rôle avait disparu; le costume même, n'avait pas la fantaisie bizarre et la folle richesse caractéristique de la comédienne courtisane qui retient quelque chose à la ville de l'oripeau du théâtre, et en l'outrant se venge sur le luxe, de ce qu'il coûte de honte.
C'était quelque chose de décent et de sobre dans le style troubadour, des turbans et des toques, des jockeys aux manches, un costume avec lequel on eût pu aller en soirée.
Une grande qualité de Mademoiselle Rachel, est qu'elle réalise plastiquement l'idée de son rôle: dans Phèdre, c'est une princesse grecque des temps héroïques; dans Angelo, une courtisane italienne du XVIe siècle, et cela d'une manière incontestable aux yeux. Personne ne s'y trompera, les sculpteurs et les peintres ne feraient pas mieux. Elle domine tout de suite, le public par cet aspect impérieusement vrai. Dans la tragédie, elle semble se détacher d'un bas-relief de Phidias pour venir sur l'avant-scène: dans le drame, on dirait qu'elle descend d'un cadre de Bronzino ou du Titien. L'illusion est complète. Avant d'être une grande actrice, elle est une grande artiste. Sa beauté, dont les bourgeois ne se rendent pas compte et qu'ils nient quelquefois tout en en subissant l'empire, a une flexibilité étonnante.
Tout à l'heure c'était un marbre pâle, maintenant c'est une chaude peinture vénitienne. Elle s'est assortie au milieu dans lequel elle doit se mouvoir. Quelle profonde harmonie entre cette pâleur dorée, ces perles, ces passequilles, ces sequins d'or, ces tapisseries de cuir de Cordoue, ces boiseries de chêne! Comme c'est bien la figure de cet intérieur, comme elle se détache vigoureusement du fond! comme elle vit aisément dans ce siècle, et nous fait croire à la vérité de l'action!
Il est impossible de rêver quelque chose de plus radieux, de plus étincelant, d'une plus splendide indolence que la toilette de la Tisbé quand elle traverse la fête, tramant en laisse le podestat qui gronde et grogne comme un tigre dont le belluaire tire trop vite la chaîne... C'est bien là le luxe effréné de l'Italie artiste et courtisane de ce temps où Titien peignait les maîtresses de prince toutes nues, et où Véronèse inondait de soie, de velours et de brocart d'or les blancs escaliers des terrasses.
De quel air gracieusement distrait elle écoute les doléances du pauvre tyran, l'éloignant toujours du but où il veut revenir, et comme elle détaille admirablement ce récit où elle raconte comment sa mère, pauvre femme sans mari, qui chantait des chansons morlaques sur les places, a été délivrée, au moment où on la conduisait à la potence pour avoir soi-disant, insulté, dans un couplet, la sacrissime république de Venise, par une gentille enfant qui a demandé sa grâce! Quel sentiment! quelle émotion sous ce débit rapide et négligé fait à contre-cœur et par manière d'acquit à quelqu'un qui n'est pas capable de le comprendre! et avec quelle aisance de comédienne et de grande dame elle détourne les soupçons du tyran, et comme elle le renvoie pour dire à Rodolfo qu'elle l'aime!'On n'est pas plus actrice et plus femme.
Quelle grâce câline et indifférente à la fois pour ne pas trop marquer le but dans la scène de la clé et dans la grande querelle de la femme honnête et de la courtisane! Comme elle tient aux dents sa victime, comme elle la secoue, comme elle la cogne contre les murs; quelle fureur sauvage, quelle férocité implacable! c'est le sublime de l'ironie et de l'insulte: il semble que par la voix de l'actrice s'exhale toute la rancune longuement amassée d'une classe déshéritée et proscrite; que le paria femelle prend sa revanche en une fois contre les heureuses du monde, à qui la vertu est si facile et qui n'en cachent pas moins des amants sous le lit de l'époux! La race maudite relève son front et jouit superbement du droit de mépriser celle qui méprise, et d'outrager celle qui outrage; c'est l'accusé jugeant le magistrat, le patient exécutant le bourreau, c'est tout cela avec plus de rage encore, c'est la courtisane piétinant l'honnête femme qui lui a pris son amant.
Nous n'avons jamais rien vu de plus grand, de plus sinistre, de plus terrible: c'était le même sentiment d'affreuse angoisse que l'on éprouverait à regarder tourner autour d'une gazelle effarée et tremblante une tigresse, les yeux enflammés et les ongles en arrêt. Mais lorsqu'au crucifix elle reconnaît dans Catarina la jeune fille qui a sauvé sa mère, comme sa colère tombe! comme on la sent désarmée! Et plus tard, quand elle comprend que Rodolfo ne l'aime pas, ne l'a jamais aimée, comme elle renonce à la vie et n'a plus d'autre ambition que de lui faire dire quelquefois: La Tisbé, c'était une bonne fille!
On peut affirmer hardiment que personne ne jouera mieux la Tisbé que Mademoiselle Rachel; son cachet y est empreint d'une manière indélébile. Ce rôle fait corps avec elle; il lui appartient comme elle lui appartient. Chaque actrice a ainsi dans son répertoire un rôle qui la résume. Mademoiselle Rachel en a deux: Phèdre, dans la tragédie, Tisbé dans le drame. Quand on veut voir tout ce qu'elle est, c'est là qu'il faut la voir. Mademoiselle Rachel, maintenant qu'elle a mis le pied sur le riche théâtre de Victor Hugo, devrait penser à Lucrèce Borgia et à Marie Tudor qui seraient pour elle l'occasion de triomphes non moins éclatants. Le magnifique rôle de femme qui se trouve dans Warwick ou le Faiseur de rois, drame d'Auguste Vacquerie, récemment reçu à la Comédie-Française, est aussi très bien coupé à sa taille, et elle y sera superbe à coup sûr.
Maintenant, venons aux autres interprètes du drame. Mademoiselle Rébecca, qui représentait Catarina, jouée autrefois, par Madame Dorval; n'est pas restée au-dessous de son illustre devancière. Cette jeune sœur de Rachel possède un don précieux, le don des larmes; elle en verse, et en fait répandre, en dépit du paradoxe de Diderot sur le comédien, où il est dit que pour faire éprouver il ne faut rien sentir. Jamais sensibilité plus vraie, plus communicative, n'a soulevé la poitrine d'une actrice. Elle s'est fait admirer à côté de sa sœur; l'étoile n'a pas été éteinte par le rayonnement de l'astre: que dire de plus?
Maillard est élégant, passionné et fatal dans le rôle de Rodolfo.
Beauvallet est toujours le plus redoutable tyran de Padoue qu'on puisse voir et entendre. Le personnage lui va si bien que ses défauts mêmes y deviennent des qualités. Avec son masque de marbre et sa voix de bronze il représente admirablement la haine impassible et froide; on dirait la Fatalité qui marche.
23 juin 1838.
M. Hugo n'est pas seulement un poète, c'est encore un peintre, mais un peintre que ne désavoueraient pas pour père Louis Boulanger, Camille Roqueplan et Paul Huet. Quand il voyage, il crayonne tout ce qui le frappe. Une arête de colline, une dentelure d'horizon, une forme bizarre de nuage, un détail curieux de porte ou de fenêtre, une tour, ébréchée, un vieux beffroi: ce sont ses notes; puis le soir, à l'auberge, il retrace son trait à la plume, l'ombre le colore, y met des vigueurs, un effet toujours hardiment choisi; et le croquis informe poché à la hâte sur le genou ou sur le fond du chapeau, souvent à travers les cahots de la voiture ou le roulis du bateau de passe, devient un dessin assez semblable à une eau-forte, d'un caprice et d'un ragoût à surprendre les artistes eux-mêmes.
Le dessin que nous donnons au public est un souvenir d'une tournée en Belgique, et porte, écrit au revers: Liège(?) 12 août; pluie fine.
C'est une place d'architecture moitié Renaissance, moitié gothique, avec un effet de nuages entassés les uns sur les autres, comme des quartiers de montagnes, gros d'orage, et laissant tomber de leurs flancs entr'ouverts quelques filets de pluie, comme des carquois renversés dont les traits se répandent.
Un beffroi d'une hauteur prodigieuse enfouit dans la nue son front chargé d'une couronne de clochetons et de tourelles en poivrière: une girouette, représentant une comète avec sa queue, palpite au souffle de l'orage sur la flèche principale. L'action du vent se fait parfaitement sentir par les lambeaux de nuées balayés tous dans le même sens. Un rayon de soleil blafard et fauve éclaire une partie du beffroi, dont les détails d'architecture et d'ornement sont rendus avec une finesse, un esprit, un pétillant et une adresse admirables. Ce cadran, où les heures sont ménagées en blanc sur le fond du papier, a dû exiger, de la part du fougueux poète, bien de la patience et des précautions. Au pied du beffroi s'élève, sur des piliers massifs, une halle bizarrement tigrée d'ombres noires, avec des ardoises imbriquées en manière d'écailles de poisson et de lucarnes à contrefort en volière. Des jets vifs de lumière pétillent brusquement entre les sombres colonnes, qui semblent disposées tout exprès pour cacher des Aubetta ou des Omodei. Cette disposition est très pittoresque et fournirait un beau motif de décoration. De charmantes maisons dans le goût espagnol gothique et flamand, ciselées et travaillées comme des bagues, occupent le fond de la place. On reconnaît facilement, dans ce dessin d'architecture, la plume qui a tracé le chapitre de Paris à vol d'oiseau (Notre-Dame de Paris).
Une charmante vue de Notre-Dame de Paris prise du côté de la rivière par M. André Durand, accompagne le beffroi de Lierre. Notre-Dame et Victor Hugo sont maintenant inséparables.
(RENAISSANCE)
12 novembre 1838.
Jamais solennité littéraire n'a excité dans le public un intérêt aussi vif; car outre la première représentation de Ruy Blas il y avait la première représentation de la salle, et c'était ce soir-là que devait définitivement se juger la grande question de savoir si Frédérick parviendrait à dépouiller cette hideuse défroque de Robert Macaire, dont les lambeaux semblaient s'attacher à sa chair comme la tunique empoisonnée du centaure Nessus. Position étrange que celle d'un acteur qui ne peut se séparer de sa création, et dont le masque gardé trop longtemps finit par devenir la figure!
Ruy Blas—qu'une plume plus docte que la nôtre a apprécié ce matin—Ruy Blas, disons-nous a résolu le problème. Robert Macaire n'est plus; de ce tas de haillons s'est élancé, comme un dieu qui sort du tombeau, Frédérick, le vrai Frédérick que vous savez, mélancolique, passionné, le Frédérick plein de force et de grandeur, qui sait trouver des larmes pour attendrir, des tonnerres pour menacer, qui a la voix, le regard et le geste, le Frédérick de Faust, de Rochester, de Richard Darlington et de Gennaro, le plus grand comédien et le plus grand tragédien moderne. C'est un grand bonheur pour l'art dramatique.
La salie est décorée avec une élégance et une splendeur sans égales, dans le goût dit Renaissance, quoique certains ornements se rapportent au commencement du règne de Louis XIV et même de Louis XV: le ton adopté est or sur blanc, des médaillons en camaïeu ornent le pourtour des galeries; de larges cadres sculptés et dorés remplacent, aux avant-scènes, l'inévitable colonne corinthienne; et, font, de chaque loge une espèce de tableau vivant où les figures paraissent à mi-corps comme dans les toiles du Valentin et du Caravage; le rideau, peint par Zara, représente une immense draperie de velours incarnat relevée par des tresses d'or, et laissant voir une doublure de satin blanc d'une richesse extrême; le plafond, que l'on a surbaissé, offre une foule de figures allégoriques et mythologiques dans des cartouches ovales, par M. Valbrun. Ces figures nous ont paru peu dignes du reste de la décoration: elles rappellent un peu trop les paravents du temps de l'Empire; c'est la seule chose que nous trouvons à reprendre dans toute l'ordonnance de la salle. Les loges sont tendues d'un bleu tendre, très favorable aux toilettes; de merveilleux tapis rouges garnissent les couloirs, et même, chose inouïe! les ouvreuses sont jeunes, jolies et gracieuses, recherche de bon goût, car rien n'est plus déplaisant à voir que les ouvreuses ordinaires, pour qui semble avoir été fait ce vers de don César:
... Affreuse compagnonne
Dont le menton fleurit, et dont le nez trognonne!
Nous souhaitons mille prospérités au théâtre nouveau, entré franchement dans une voie d'art et de progrès, et qui, nous l'espérons, ne s'appellera pas pour rien le Théâtre de la Renaissance. Un discours de M. Méry, un drame de M. Hugo, voilà qui est bien. Continuez; mais surtout pas de prose, des vers, des vers et encore des vers! Il faut laisser la prose aux boutiques du Boulevard; des poètes, pas de faiseurs, il n'y a pas besoin d'ouvrir un nouvel étal pour les fournitures de ces messieurs; il faut bien que la fantaisie, le style, l'esprit, la poésie, aient un petit coin pour se produire dans cette vaste France qui se vante d'être le plus intelligent pays du monde, dans ce Paris qui se proclame lui-même le cerveau de l'univers, nous ne savons pourquoi. Il y a bien assez de dix-huit théâtres pour les mélodrames et le vaudeville.
28 février 1872.
Pour nous qui avons vu la première représentation de Ray Blas au théâtre de la Renaissance, qu'elle inaugurait, cette reprise si longtemps annoncée du beau, drame de Victor Hugo, avait, outre son intérêt propre, un indéfinissable charme mélancolique.
Dans Marie Tudor, Hoshua Farnaby, le geôlier de la tour de Londres, dit à Gilbert: «Vois-tu, Gilbert, quand on a des cheveux gris, il ne faut pas revoir les opinions pour qui l'on faisait la guerre, et les femmes à qui l'on faisait l'amour, à vingt ans. Femmes et opinions vous paraissent bien laides, bien vieilles, bien chétives, bien édentées, bien ridées, bien sottes». Cela sans doute est vrai des opinions et des femmes, mais pas des œuvres de génie. On peut les revoir; elles ont l'immortelle jeunesse. En glissant sur leur bronze ou leur marbre, les années ne font qu'y ajouter la patine et le poli suprêmes. Ruy Blas nous a paru aussi beau, plus beau peut-être que la première fois.
Malgré le temps écoulé, nous nous sommes senti, comme à vingt ans, emporté par ce grand souffle de passion; nous avons éperdûment aimé la Reine, et franchi avec Ruy Blas le grand mur hérissé d'une broussaille de fer, pour lui apporter les petites fleurs bleues d'Allemagne cueillies à Coramanchel. Don Salluste, ce Satan grand d'Espagne, nous a inspiré la même suffocante terreur, et le joyeux bohème Zafari, jadis Don César de Bazan, le même entraînement sympathique. Nous avions retrouvé nos pures impressions de jeunesse, et le romantisme endormi qui est toujours en nous s'est réveillé, prêt à recommencer les luttes d'Hernani; mais il n'en était pas besoin. Chez Victor Hugo, le poète dramatique n'est plus contesté. Il a forcé les plus rebelles à l'admiration.
Jamais représentation d'œuvre inédite n'excita curiosité plus ardente. Il est inutile de dire que le théâtre renversait l'axiome mathématique: le contenant doit être plus grand que le contenu, et renfermait à coup sûr moins de places que de spectateurs, par un de ces phénomènes de compressibilité dont le corps humain est susceptible ces soirs-là. Mab, la fée microscopique, arrivant dans sa coquille de noix, n'aurait pas trouvé un interstice où glisser sa petite personne. Sous les arcades tournaient des théories d'aspirants désappointés, la place était noire de groupes stationnaires, et les cafés des alentours regorgeaient de monde attendant des nouvelles de la salle.
On pourrait croire qu'il y avait dans cet empressement, en dehors de l'attrait littéraire, quelque préoccupation politique. Ruy Blas renferme, en effet, sans y avoir visé.—Le poète a toujours dédaigné le succès d'allusion—de ces passages dont l'opposition peut profiter, contre un gouvernement quelconque, car ils expriment des vérités toujours applicables, et sont comme les grands lieux-communs de l'éternelle justice.
Eh bien, dès les premiers vers, toute préoccupation de ce genre avait disparu. Le poète s'était emparé de son public, et d'un coup de son aile puissante, l'avait élevé loin des réalités du moment, dans la haute sphère de son art. On ne sentait même pas cet esprit d'antagonisme entre les deux écoles rivales, qui, à la première épreuve, inquiétait parfois l'admiration. On écoutait avec un respect religieux, comme on eût fait pour le Ciel ou Don Sanche d'Aragon ou tout autre chef-d'œuvre consacré, pour lequel la critique n'est plus permise.
Cependant, du premier public, de celui qui assistait à la représentation de la Renaissance, il restait très peu de survivants. Trente-quatre ans déjà nous séparent de cette soirée, et nous cherchions vainement dans les loges les têtes connues autrefois. À peine en avons-nous distingué cinq ou six, qui se souriaient de loin, heureuses de se retrouver encore à cette fête de poésie: c'était pour Ruy Blas un public de postérité.
C'est, comme on sait, Frédérick Lemaître qui à l'origine joua Ruy Blas, et l'on se demandait avant le lever du rideau s'il parviendrait à dépouiller la hideuse défroque de Robert Macaire, dont les lambeaux semblaient s'attacher à sa chair comme la tunique empoisonnée de Nessus. Position étrange que celle d'un acteur qui ne peut se séparer de sa création, et dont le masque gardé trop longtemps finit par devenir la figure. Ruy Blas eut bien vite raison de Robert Macaire. De ce tas de haillons laissés à ses pieds, s'élança comme un dieu qui sort du tombeau, Frédérick, le vrai Frédérick que vous savez, mélancolique, passionné, le Frédérick plein de force et de grandeur, qui sait trouver des larmes pour attendrir, des tonnerres pour menacer, qui a la voix, le regard, le geste, le Frédérick de Faust, de Rochester, de Richard d'Arlington, et de Gennaro,—c'est-à-dire le plus grand tragédien du plus grand comédien moderne.
L'effet, comme on le pense, fut prodigieux, et le coup de talon sous lequel, au troisième acte, Ruy Blas écrase don Salluste, comme l'Archange le Démon, retentit encore dans la mémoire de tous ceux qui l'ont entendu.
Frédérick vit toujours, mais la force ou plutôt la jeunesse manque à son génie. Le vieux lion serait encore capable de secouer sa crinière, et de tirer de sa poitrine un profond rugissement. Il chasserait les ministres, il tuerait Don Saluste, mais il ne pourrait plus se rouler avec une grâce amoureuse aux pieds de la Reine, sur les marches du trône. Cependant, si l'on reprenait les Burgraves, cette œuvre titanique et digne d'Eschyle, il ne faudrait aller chercher d'autre acteur que Frédérick. Quel magnifique Job ou quel superbe Barberousse il ferait! Comme, il rendrait également bien le bandit patriarche et l'empereur-fantôme!
Dans l'œuvre dramatique de Victor Hugo, Ruy Blas est une des pièces qui nous plaît le plus—nous disons qui nous plaît;—il en est d'autres que nous admirons autant.
La charpente du drame s'emmanche avec une précision qui ne laisse pas apercevoir les jointures, car l'intrigue s'y meut à l'aise, malgré ses complications et ses tortuosités; le sujet est un de ceux qui excitent le plus l'imagination, et qu'on retrouve au fond de chaque jeune cœur, à l'état de rêve secret: sortir brusquement de l'obscurité par un coup du sort qui ressemble à de la magie, et s'élever d'un vol rapide vers l'amour idéal, radieux, sublime, l'amour dans la majesté, et la toute-puissance,—ce qui se rapproche le plus de la Divinité sur terre:—en un mot, être l'amant de la Reine.
A cette ivresse, à cet éblouissement, à ce vertige des hauts sommets, se mêle l'appréhension, perpétuelle de la chute inconnue. Sur ce plancher qui semble ne cacher aucun piège, peut s'ouvrir une trappe précipitant la victime en quelque gouffre de ténèbres. D'une porte cachée, va peut-être déboucher, silencieux, glacial, implacable comme la Haine et la Vengeance, ce diabolique don Salluste qui, mettant sa main sur l'épaule du malheureux, lui arrachera la peau de don César de Bazan, pour ne lui laisser devant la Reine que sa casaque de laquais. Quelle situation tragique et poignante! Travailler malgré soi et sans savoir comment faire, par une nécessité inéluctable, au piège que le démon tend à l'ange adoré, et dont on pressent dans l'ombre les rouages compliqués formidables.
Tous ces personnages sont dessinés et peints comme des portraits de Vélasquez, avec une maestria souveraine, une force de couleur, une liberté de touche, une grandeur d'attitude et un sentiment de l'époque qui fait illusion. Que de fois ne l'avons-nous pas rencontré ce marquis de Finlas, au Prado, à l'Escurial, à Aranjuez, lui ou quelqu'un de sa race, dans un cadre blasonné, riche, vêtu de noir, avec ses yeux de braise trouant sa face morte. Combien d'heures sommes-nous restés pensifs devant ces pâles infantes, ces reines exsangues, ces mortes devenues fantômes, n'ayant d'autre trace de vie, sous les blancheurs argentées des salons et sous le ruissellement des perles, que le carmin de leurs lèvres et les plaques de fard de leur pommette! Toute l'Espagne picaresque vit dans cet étonnante figure de don César de Bazan qui est pour l'œuvre de Victor Hugo ce que l'étincelant Mercutio est pour l'œuvre de Shakespeare. Quelle élégance encore sous ce délabrement! Quels beaux haillons noblement portés! Quelle hauteur d'âme dans cette misère, et quel effrayant et philosophique oubli des prospérités disparues! Comme il reste loyal, délicat et fier à travers ces désordres, cet ami de Matalobos et de Gulatremba, comte de Garofa, puis de Villalcazar! Et don Geritan, le grotesque rival de Ruy Blas, quel bon type de la vieille galanterie espagnole! c'est don Quichotte à la cour, ayant la reine pour Dulcinée du Toboso.
A quoi bon insister si longtemps sur des choses si connues? Faisons plutôt remarquer que jamais la vie dramatique ne fut menée avec une aisance si souveraine, avec une puissance si absolue. Le poète, lui, peut tout exprimer, depuis les effusions les plus lyriques de l'amour jusqu'aux minutieux détails d'étiquette, de blason et de généalogie! depuis la plus haute éloquence jusqu'à la plaisanterie la plus hasardeuse, passant du sublime au grotesque sans le moindre effort, mêlant tous les tons dans le plus magnifique langage que le théâtre ait jamais parlé. La franchise de Molière, la grandeur de Corneille, l'imagination de Shakespeare, fondues au creuset d'Hugo, forment ici un airain de Corinthe supérieur à tous les métaux.
Bien que le vieux critique soit, en général, laudator temporis acti et trouve que dans sa jeunesse on jouait bien mieux la comédie, la tragédie et le drame qu'aujourd'hui, nous devons dire que la reprise de Ruy Blas à l'Odéon a été supérieure comme jeu, rendu et mise en scène à la première représentation de la Renaissance, en faisant exception bien entendu de Frédérick que personne ne peut remplacer.
Lafontaine, dans Ruy Blas, sans chercher ni éviter de périlleux souvenirs, a donné ce que permettait son talent inégal, sa nature ardente et passionnée: des élans inattendus, des cris du cœur, des accents vrais à travers des emphases et des incohérences. Il a très bien dit la scène du premier acte, où il conte à Zafari son amour insensé pour la Reine. Il a été d'une violence magnifique et d'un emportement superbe dans sa célèbre apostrophe aux Ministres. La déclaration d'amour qui suit a été soupirée avec une adoration craintive et passionnée très bien sentie, et au dénouement le laquais a repris implacablement sa revanche du gentilhomme. Quant à Geffroy, il est l'idéal même du rôle. Le poète n'a pu concevoir dans son imagination un don Salluste plus glacial, plus impassible, plus étranger à tout sentiment humain, plus profond, plus satanique en un mot, sous une apparence correcte de gentilhomme; chacune de ses paroles a la froideur polie d'un tranchant de hache et vous donne un frisson derrière le cou. Alexandre Mauzon était bien loin de cette perfection sinistre.
Le rôle de don César de Bazan semble appeler invinciblement Mélingue; ce manteau d'escudero avait été troué et déchiqueté exprès pour lui, ce pommeau de rapière à coquille sollicitait sa main, cette plume énervée demandait à palpiter sur son feutre. Qui donc mieux que lui pouvait se promener d'une mine triomphante, sa cape au-dessus du cou, et ses bas en spirales? De plus, ces mots charmants, toutes ces folies étincelantes éclatant sur le fond sombre du drame comme des chandelles romaines sur un ciel noir, Mélingue n'a pas eu de peine à faire oublier Saint-Firmin à ceux qui se souvenaient encore du premier don César.
La Marie de Neubourg de la Renaissance—Atala Beauchêne—avait été trouvée insuffisante, malgré sa beauté. Rien de plus suave, de plus charmant, de plus poétique que Mademoiselle Sarah Bernhardt, la Marie de Neubourg de l'Odéon. Quelle mélancolique langueur! quel air de colombe dépareillée manquant d'air, de liberté et d'amour dans cette triste cage dorée où l'enferme le camarera-mayor, personnification momifiée de l'étiquette! Jamais l'ennui morne et étouffant de la cour d'Espagne ne fut mieux rendu. Quelle chaste réserve dans son abandon, quelle délicatesse féminine, et comme chez elle la reine préserve toujours l'amante! Comme elle est faite pour être adorée! et comme cette petite, couronne en dentelle d'argent posée au sommet de la tète lui donne bien l'air de la Madone de l'Amour!
Fabien a fait de don Geritan, le vieux beau duelliste, un caractère élégant et sympathique. Son costume de nuance tendre, tout passementé et tout couvert de rubans, contraste comiquement avec la personne longue, sèche, raide, longitudinale, rappelant le jeune échassier. Malgré son ridicule, il aime la Reine, et se ferait bravement tuer pour elle. Ruy Blas l'a bien jugé. Mademoiselle Broisat est la plus gentille Casilda qui puisse égayer l'ennui d'une cour d'Espagne et contre-balancer la soporifique influence d'un camarera-mayor. Puisque nous parlons de la duchesse d'Albuquerque, disons que Mademoiselle Ramelli est impatientante de vérité dans son rôle de dragon en basquine noire; à chaque fois qu'elle tire le fil pour arrêter par la patte l'essor de quelque fantaisie, on serait tenté, comme la Reine de lui flanquer une paire de bons soufflets.
Madame Lambquin s'était chargée, sans la moindre coquetterie, de représenter l'affreuse compagnonne—dont le menton fleurit et dont le nez trognonne—. Il semble qu'elle ait été chercher son costume et son type dans les caprichos de Goya, parmi des sorciers du collège de Bozozona, dans les tias du Rasho et ces duègnes à gros chapelets qui sous le porche des églises vous demandent l'aumône, d'abord pour une vieille, ensuite pour une jeune.
13 juin 1843.
Victor Hugo, un de ces poètes que Dante appelle souverains et qu'il place dans l'Élysée, une grande épée à la main comme des guerriers, et qui réunit en lui deux qualités qui semblent d'abord opposées l'une à l'autre, un lyrisme effréné et une miraculeuse patience de ciselure dans l'exécution, a fait accomplir à la versification un immense progrès qui a été pris pour une décadence par certains esprits, judicieux sur d'autres points, lesquels s'imaginent que les vers romantiques ne sont que de la prose plus ou moins rimée, et que le vers droit, à période carrée, est beaucoup plus difficile que le vers moderne. Déjà Lamartine avec ses grands coups d'ailes, des élégances enchevêtrées comme des lianes en fleur, ses larges périodes, ses vastes nappes de vers s'étalant comme des fleuves d'Amérique, avait fait crever de toutes parts le vieux moule de l'alexandrin; mais il restait encore beaucoup à faire.
Dans ses Orientales, Victor Hugo se plut à réunir un grand nombre de formes de stances, ou entièrement neuves, ou restaurées des vieux maîtres. Il revêtit son inépuisable fantaisie de tous les rythmes et de toutes les mesures, il donna des exemples de tous les entrecroisements et de tous les redoublements de rimes, et reproduisit dans son œuvre l'ornementation mathématique et compliquée de l'Orient. Son École, composée alors d'Alfred de Vigny, de Sainte-Beuve, d'Alfred de Musset et d'Antony Deschamps, auxquels d'autres vinrent bientôt s'adjoindre, chercha la richesse de la rime, la variété de la coupe, la liberté de la césure, et trouva mille charmants secrets de facture. Bien des mots exilés dans la prose purent enfin rentrer dans les vers. L'exclusion systématique du mot propre produit dans les poètes de l'École racinienne une tonalité toute particulière; les terminaisons en er, en é, en eux, en ant et able finissent presque tous les vers pseudo-classiques, ce qui n'a rien d'étonnant, vu l'énorme consommation d'infinitifs et d'adjectifs à laquelle oblige la périphrase.
On nous pardonnera ces réflexions qui ont pour but de faire comprendre aux gens du monde que l'École romantique ne procède pas à l'aventure. Ces vers brisés ou cassés, comme disent les classiques dans leur aimable atticisme, exigent de longs travaux, de patientes combinaisons, sont plus riches de rimes, plus sobres d'inversions et de licences grammaticales, que les vers qu'ils s'imaginent être des chefs-d'œuvre de pureté, parce qu'ils sont tout simplement monotones.
30 juillet 1843.
Le drame a toujours eu beaucoup de mal à s'établir parmi nous. Diderot, avec son Père de famille, Beaumarchais, avec son Eugénie, ont trouvé nombre de contradictions.
Nanine, l'Enfant Prodigue, Mélanie, Céline, l'Écossaise, le Philosophe sans le savoir, déplaisent également par ce mélange du comique, du tempéré et du touchant, qui pourtant est le procédé même de la nature.
Dans l'éloquente préface d'Eugénie, il faut voir avec quelle raison et quelle puissance de dialectique Beaumarchais proclame la poétique de l'École nouvelle, ce qui n'a pas empêché Victor Hugo d'écrire son admirable préface de Cromwell. On avait à peu près alors accepté le drame en prose en le flétrissant du nom de mélodrame; mais pour le drame en vers, le travail était à recommencer.
9 novembre 1839.
Constatons le succès qu'obtient en ce moment, à la Comédie-Française, la reprise de Marion Delorme. Faire l'éloge de Marion Delorme est maintenant chose superflue. Quatre-vingts représentations et trois éditions successives valent le meilleur panégyrique du monde. Ce beau drame réunit la gravité passionnée de Corneille, et la folle allure des comédies romanesques de Shakespeare; quelle variété de ton, quelle vivacité charmante et castillane! Comme tous ces beaux seigneurs qui ne font que traverser la pièce pour jeter l'éclair de leur épée et de leur esprit, parlent bien la langue cavalière et superbe du XVIe siècle! Quel sincère accent de comédie! Voyez! voyez ce Taillebras, ce Scaramouche et ce Gracioso! Scarron lui-même, l'auteur de Japhet d'Arménie et de Jodelet, ne les eût pas dessinés d'un trait plus vif et plus libre. Et comme les larmes de Marion, perles divines du repentir, ruissellent limpidement sur tous ces visages grimaçants ou terribles! Quel charmant marquis que ce mauvais sujet de Gaspard de Saverny! Quelle mâle, sévère et fatale figure que ce Didier de rien! Marion Delorme est une des pièces de M. Hugo où l'on aime le plus à revenir; c'est un roman, une comédie, un drame, un poème où toutes les cordes de la lyre vibrent tour à tour.
1er décembre 1851.
On a repris vendredi dernier Marion Delorme, au théâtre de la République. Le grand et beau drame qui a déjà la consécration du temps, de romantique à l'époque où il s'est joué, est devenu classique comme une tragi-comédie de Corneille ou de Rotrou. Il a pris place, sans cesser d'être vivant, dans ces galeries de tableaux de maîtres que le Théâtre-Français offre aux études des jeunes générations; il a été écouté avec un religieux respect par ceux qui le connaissent et par ceux qui l'ignoraient. On ne saurait guère rêver pour jouer Marion Delorme, la courtisane Madeleine, une actrice plus assortie à son rôle que Mademoiselle Judith; elle a la jeunesse, la beauté, l'intelligence et la passion, les larmes et le sourire. Si elle n'atteint pas certains côtés profonds et douloureux comme Madame Dorval, en revanche elle fait mieux ressortir certaines faces du rôle et l'éclairé autrement.
Jeffroy ne joue pas Louis XIII, c'est Louis XIII lui-même, ce roi qui avait fait de l'ennui un art, presque une volupté, et qui oublia sa couronne sur le front de la Mélancolie. Il est impossible d'être plus terne, plus morne et plus éteint, plus souverainement accablé de ce spleen royal, lourde chape de plomb qui double le manteau d'hermine et dont nul ne sentit le poids comme ce pâle Louis, pas même Philippe II à l'Escurial; pas-même Charles-Quint à Saint-Just.
Brindeau a donné au personnage de Saverny son éloquence railleuse, et Maillard a bien rendu la physionomie passionnée, douloureuse et fatale de Didier, ce type des Antony.
19 février 1851.
La première faute chez M. Augier, faute qui domine toute la pièce et qui nous étonne chez un homme qui a la familiarité des choses de théâtre, c'est le choix du sujet de Diane. M. Augier ignore-t-il qu'un poète, nommé Victor Hugo, a déjà traité d'une façon assez supérieure les principales situations de Diane, dans un livre intitulé Marion Delorme, qui a fait quelque bruit dans son temps et que cent cinquante représentations ont fait connaître de tout le monde? Comment un écrivain va-t-il reprendre pour thème d'un drame un duel au temps de Richelieu, sous la juridiction qui condamnait tout duelliste à mort, en refaisant une par une toutes les scènes qui découlent forcément de ce point de départ: la fuite du coupable, son arrestation, la demande en grâce, la peinture du caractère de Louis XIII, l'explication de la politique du cardinal et tout ce qui s'ensuit?
En regardant cette pièce où figurent Richelieu, Louis XIII, Laffemas, et sous des noms qui les déguisent peu, Saverny, Brichanteau, Bouchavannes et la troupe débraillée des raffinés d'honneur, nous éprouvions une impression bizarre; dans les situations analogues, les vers d'Hugo, gardés précieusement dans notre mémoire, voltigeaient involontairement sur les lèvres et devançaient les alexandrins de M. Émile Augier; l'ancienne pièce reparaissait sous la nouvelle, comme à travers les antiphonaires du XIIe siècle revivent les œuvres palimpsestes d'Homère et de Virgile, grattées par l'ignorance des moines; Marion Delorme, attristée, moralisée et transformée en vieille fille ayant pour Didier un frère étourdi, nous faisait surtout une peine profonde, tant elle semblait embarrassée de ce déguisement; Louis XIII, ce pâle fantôme, cet Hamlet de l'ennui, cherchant à son côté son bouffon L'Angely pour laisser divaguer sa tristesse en plaisanteries lugubres, et l'ancien Laffemas, si noir, si scélérat, si sinistre, si caverneusement infernal, paraissait humilié de n'être plus qu'un simple agent de police brutal et bête, n'ayant de féroce que son costume d'alguazil.
Cette impression était partagée par toute la salle, qui se demandait quelle avait pu être l'intention de l'écrivain, si cette ressemblance était fortuite ou volontaire, s'il avait cru inventer en se ressouvenant, ou s'il avait imité de parti pris. Les antécédents de M. Émile Augier ne permettent guère de s'arrêter à cette dernière supposition. Il appartient à une école qui s'est séparée du grand mouvement littéraire romantique, et qui a obtenu un succès de réaction.
Cette école n'admire guère que les anciens et les poètes du XVIIe siècle: quelque talent qu'elle puisse reconnaître à Victor Hugo, elle ne l'admet pas comme un maître et rejette ses doctrines. L'auteur de Gabrielle s'y est-il récemment converti? Cela n'est pas probable. Achille classique a-t-il voulu provoquer le Siegfried du Romantisme sur son propre terrain, et en traitant le même sujet, lui montrer de quelle manière s'y prenait un champion de l'école du bon sens?
Peut-être s'est-il donné pour tâche de montrer Marion Delorme à l'état sobre, dénuée de lyrisme, de passions, de rimes riches, d'images et de couleur locale; ou bien encore,—comme ces élèves d'Ingres qui n'osent jeter les yeux sur les tableaux de Rubens, de peur d'altérer leur gris par la contemplation de ce maître flamboyant,—n'a-t-il ni vu ni lu le drame de Victor Hugo.
«4 octobre 1844.
«Vous êtes un grand poète et un charmant esprit, cher Théophile, je lis votre Roi Candaule avec bonheur. Vous prouvez, avec votre merveilleuse puissance, que ce qu'ils appellent la poésie romantique a tous les génies à la fois, le génie grec comme les autres. Il y a à chaque instant dans votre poème d'éblouissants rayons de soleil. C'est beau, c'est joli, et c'est grand.
«Je vous envierais de toute mon âme si je ne vous aimais de tout mon cœur.»
«VICTOR HUGO.»
(OPÉRA NATIONAL)
22 novembre 1841.
Une de ces chansons singulières que Victor Hugo désigne sous le nom fantasque de «guitare», comme pour indiquer leur accent espagnol, a servi de point de départ à M. Dennery pour le livret que M. Maillard a brodé de sa musique. Nous voulons parler de Gastibelza, «l'homme à la carabine», rendu si populaire par le refrain de Monpou. M. Dennery a l'habitude de détrousser M. Hugo; il lui a pris don César de Bazan, il lui prend Gastibelza. M. Dennery est un voleur plein de goût, et s'il fait le foulard de l'idée, il ne s'adresse du moins qu'aux poches bien garnies.
Gastibelza est une de ces chansons folles et décousues dont les images se succèdent avec l'incohérence du rêve et qui, malgré la puérilité bizarre des détails, vous troublent profondément et vous laissent pensif des heures entières. Cette guitare ressemble, à s'y méprendre, à ces romances populaires faites par on ne sait qui, par le pâtre qui rêve, par l'écolier en voyage, par le soldat sous la tente, par le marin que berce la mer paresseuse. Un vers s'ajoute siècle par siècle au vers balbutié; l'oiseau, au besoin, souffle la rime qui manque, et peu à peu, avec l'air, le soleil, le ciel bleu, le gazouillis de la fauvette et de la source, le bruit de la rosée qui se détache des branches, la chanson se trouve faite, et les plus grands poètes la gâteraient en y touchant. C'est dans la carrière lyrique de M. Victor Hugo une merveilleuse bonne fortune que d'avoir trouvé Gastibelza.
Toutes les fois que nous entendons ce refrain:
Le vent qui vient à travers la montagne,
nous voyons se dérouler devant nos yeux les crêtes neigeuses des sierras, et, sur les chemins que côtoie le précipice, s'avancer par file la caravane des mulets caparaçonnés de couvertures bariolées, et talonnés par les arrieros au chant guttural.
Le vent souffle par folles bouffées dans notre tête comme dans la chanson, et, quoiqu'il ne ne vienne pas du mont Falou, il nous rend malade, et nous donne la nostalgie de l'Espagne.
Un de ces êtres maladroits qu'on appelle poètes, voulant transporter au théâtre cette ballade empreinte d'une couleur si sauvagement locale, se fût contenté de traduire en forme de drame légendaire les infortunes du pauvre Gastibelza, et eût fait un tableau de chaque couplet; mais il faut aux habiles plus de complications que cela, les idées qui semblent les plus rebelles à l'estampage des faiseurs, sont forcées, comme les autres, de se modeler dans les cases du gaufrier.
M. Dennery a donc rendu Gastibelza intéressant, dans le sens qu'on attache à ce mot au théâtre. Doña Sabine reçoit bien toujours l'anneau d'or du comte de Saldagne, mais c'est dans le pieux motif de sauver son père, et de reprendre les papiers de famille nécessaires à la justification de cet honnête vieillard, et détournés par le comte. Gastibelza, qui se trouve être de noble race, épouse à la fin de la pièce doña Sabine, reconnue comtesse de Mendoce; car, en apprenant l'innocence de celle qu'il aime, il a recouvré la raison. Bref, tout le parfum de la chanson s'est évaporé, mais aussi la pièce est carrée, comme on dit. Inexprimable avantage!
Qu'est devenue Sabine, la fille de cette vieille bohémienne d'Antiquerra, orfraie logée dans une ruine, et piaulant la nuit et la journée son chant d'incantation; Sabine, avec ses cheveux de jais, son œil d'étincelles, son sourire, éclair blanc dans la figure brune, sa beauté provoquante où pétille le sang maure, son corset noir qui fait abonder la hanche, ses parures de sequins, ses colliers bizarres, et son chapelet du temps de Charlemagne? Pourquoi, après avoir traversé la place de Zocodover, ne descend-elle pas au Tage par la porte d'Alcantara, et ne vient-elle pas, accompagnée de sa sœur, se baigner dans le fleuve, et montrer, la coquette, ce genou poli qui a bien autant contribué à la démence de Gastibelza que le vent venu de la montagne? Gastibelza lui-même, cette fauve figure, moitié pasteur moitié bandit, qu'on croirait peinte par Velasquez, avec son œil noir et profond que fait vaciller l'égarement, et sa carabine usée par sa main rude, Gastibelza, ce pauvre rêveur éperdu d'amour et de mélancolie, et regardant toujours le chemin qui mène vers la Cerdagne, a été réduit aux proportions d'un soupirant d'opéra-comique. Sans doute, il le fallait, puisque, pour réussir au théâtre, suivant les gens expérimentés, la banalité est une chose nécessaire.
Cela ne veut pas dire que Gastibelza ne soit pas un bon poème d'opéra-comique: au contraire, il a réussi sans doute par les mêmes côtés qui nous déplaisent; en outre, il faut le dire, pendant toute la représentation, nous avions dans l'oreille les arpèges, les pizzicati de cette guitare vraiment espagnole, pincée par Victor Hugo, le poète de la ballade.
M. Maillard, l'auteur de la partition, a justifié tout de suite, même pour les gens les plus hostiles à l'érection d'un théâtre lyrique, l'utilité et la nécessité de l'Opéra National, car, dès la première soirée, le théâtre de M. Adam a révélé un compositeurs M. Maillard, sans le troisième théâtre lyrique, eût été ignoré longtemps encore, et se fût éteint dans l'attente du petit acte qu'octroie aux prix de Rome la charité officielle de l'Opéra-Comique. Dans Gastibelza, on sent l'exubérance d'un compositeur longtemps contenu, et les défauts du nouvel ouvrage sont les longueurs et la disproportion des effets. La manière de M. Maillard montre qu'il a beaucoup étudié Donizetti et surtout Verdi. Ces deux courants colorent, sans l'altérer, sa veine naturelle. Sa musique est bien faite, ingénieuse, et si elle n'est pas toujours originale, elle est du moins rarement commune. A cette première audition, nous avons remarqué un chant de chasseurs, le duo entre Gastibelza et doña Sabine, les couplets du comte de Saldagne, un sextuor fort beau, un chœur d'hommes avec effet imitatif, et le grand air de Gastibelza.
Mademoiselle Chérie-Courand, qui jouait le rôle long et difficile de doña Sabine, a surmonté avec bonheur l'émotion bien naturelle qui l'étranglait, puisque, jusque-là, elle n'avait jamais mis le pied sur un théâtre. Elle a supporté très courageusement ce premier feu de la rampe qui intimide les plus hardis, et a pu faire voir qu'elle était excellente musicienne, et possédait une belle voix de mezzo soprano. Gastibelza n'est pas un drame lyrique, c'est un opéra-comique dans le vieux sens du mot. Il faut excuser les tâtonnements d'une administration nouvelle; mais le genre qui convient à l'Opéra-Comique est encore à créer en France. C'est tout simplement l'opéra tel qu'il se joue en Allemagne, une sorte de drame énergique et rapide, poétique si l'on peut, violent et passionné toujours, sevré autant que possible de ces préparations et de ces adresses vulgaires où triomphe l'industrie des fileurs de scènes et des escamoteurs d'idées. Quelque chose comme le Robin des Bois de l'Odéon, qui, faiblement traduit, sans doute conservait beaucoup de l'énergie du poème original, comme le don Juan, dont le livret romantique n'a pas peu contribué sans doute à féconder le génie de Mozart. Si le préjugé du public dilettante ne repoussait pas l'humble librettiste de la gloire accordée au musicien, rien n'empêcherait, certes, les véritables poètes de composer ce qui, aujourd'hui, s'appelle si improprement des poèmes. Croira-t-on que Lucrèce Borgia, par exemple, ou Hernani, n'auraient pas été, au besoin, d'excellents drames lyriques? Cette forme leur conviendrait mieux même que celle du grand opéra, où le récitatif obscurcit ou affaiblit une grande partie des détails.
La question du drame lyrique considéré comme genre, est donc facile à résoudre. Mozart et Weber ont fait de la musique pour des drames; pourquoi donc Victor Hugo, Alfred de Musset ou Mérimée dédaigneraient-ils de faire des drames pour la musique?
7 février 1849.
Qu'il a fallu de temps pour arriver, sans se faire regarder comme un hydrophobe, à lever le rideau quelques fois de plus que le nombre sacramentel, et à changer à vue dans le milieu d'un acte! Hugo lui-même, le grand Vandale, le grand Barbare, le Hun, l'Attila romantique, ne l'a pas osé. Il a reculé devant cette action capitale de retrousser un bord de toile à torchon barbouillée de détrempe, après trois ou quatre scènes, pour passer dans un autre endroit; et, cependant, il n'avait pas craint de mettre du lyrisme, des images, des métaphores et même des rimes, dans ses dramatiques férocités qui lui ont valu longtemps une réputation de cannibale.
(Écrit à propos de la représentation de Monte-Cristo (Alexandre Dumas et Maquet), au Théâtre-Historique.)
(THÉÂTRE ITALIEN)
14 février 1840.
Jamais drame ne fut plus merveilleusement coupé pour la musique que celui de Lucrèce: aussi l'arrangeur n'a-t-il pas eu grand'chose à faire, et dans beaucoup d'endroits s'est-il contenté de mettre en méchants vers de livret l'admirable prose du poète. Le sujet amenait si invinciblement la musique, que le dénouement de la pièce doit ses principaux effets de terreur au contraste des chants de fête et des litanies funèbres des moines. Le souper chez la princesse Négroni est une des plus belles situations lyriques qui se puissent voir et revenait de droit à l'Opéra. La scène de l'insulte, celle des flacons et celle de l'orgie, à cela près des cercueils et des moines, qui restent dans la coulisse, ont été presque textuellement conservées: malheureusement la couleur tragique n'est pas reproduite, et, si l'on tournait le dos au théâtre, on s'imaginerait difficilement qu'il s'y passe des choses si terribles.
(ODÉON)
13 mars 1843.
On a repris à l'Odéon Lucrèce Borgia. Ce drame gigantesque, peut-être plus près d'Eschyle que de Shakespeare, a produit son effet accoutumé. Mademoiselle Georges s'y est montrée sublime comme à son ordinaire, et jamais, depuis la création, le petit rôle de la princesse Négroni n'avait été rendu avec plus de grâce, de beauté, d'esprit et de jeunesse. C'était mademoiselle Volet qui était chargée d'attirer dans les pièges de la vindicative Lucrèce les trop confiants amis de Gennaro. On comprend qu'ils ne se soient pas fait prier pour la suivre.
Quelle étrange destinée que celle de Lucrèce! Célébrée par tous les poètes contemporains, chantée par le divin Arioste, qui la proposa comme le modèle de toutes les vertus, elle a en quelque sorte une réputation double: ange chez les poètes, démon chez les chroniqueurs. Lesquels ont menti? Elle était blonde et de la physionomie la plus douce qui se puisse imaginer. Lord Byron raconte avoir trouvé dans une bibliothèque d'Italie, nous ne savons plus si c'est à Ravenne ou à Ferrare, un recueil de lettres autographes de Lucrèce Borgia, entre les feuillets desquelles était placée une boucle de ses cheveux. Ces lettres parlaient d'amour platonique, de tendresse idéale; ces cheveux étaient doux, pâles et soyeux, on eût dit le rayon de l'auréole d'un ange.
Ce grand poète en déroba quelques-uns qu'il emporta et conserva soigneusement. Maintenant cette femme est devenue un type de scélératesse titanique, de même que par les calomnies de Virgile, Bidon, la prude la plus refrognée, la bégueule la plus sèche de son temps, subsistera éternellement comme le type de l'amour et de la passion.
(THÉÂTRE-ITALIEN)
20 novembre 1853.
Lucrezia Borgia, ce drame d'une grandeur titanique, un des plus beaux de Victor Hugo par sa large charpente et son développement gigantesque, semblait appeler les masses chorales et les riches accompagnements de l'orchestre; la musique même se mêle à l'action dans l'œuvre du poète et produit ces terribles effets des versets funèbres alternant avec les couplets joyeux de l'orgie, scène comparable, en noir épouvantement, en terreur opaque, en anxiété profonde, aux scènes les plus tragiquement sombres d'Eschyle et de Shakespeare, et pour laquelle Meyerbeer n'eût pas été de trop. Le compositeur n'avait à craindre dans un pareil sujet que d'y rester inférieur, et peut-être Donizetti n'a-t-il pas abordé avec le tremblement convenable cette donnée colossale qui eût mérité tous les efforts de son génie. Son insouciante facilité italienne n'a sans doute vu là qu'un mélodrame rimé en livret; mais les situations commandent si impérieusement la musique, que l'inspiration sérieuse lui est venue plusieurs fois sans qu'il l'ait cherchée. Nous n'avons pas à faire ici l'appréciation d'un poème et d'une partition connus de tout le monde; là, du reste, n'était pas l'intérêt de la soirée. Le désir de revoir Mario le ténor aimé, le brillant émule de Rubini, absent depuis trop d'années, préoccupait la salle plus que l'œuvre de Donizetti elle-même quoiqu'elle soit l'une des mieux reçues du répertoire.
De cordiales salves d'applaudissements, au risque de le réveiller, ont accueilli Gennaro sur le banc où il dort d'un si bon sommeil pendant que le bal chante, fredonne et chuchote, le masque noir à la main, et que les gondoles étoilées de fanaux débarquent de mystérieux convives sur la terrasse vénitienne. Mario est toujours le même, il a toujours cette tête suave et charmante qu'on croirait détachée d'une fresque de Benozzo-Pozzoli; il a gardé sa sveltesse juvénile, et l'embonpoint, si fatal aux jeunes premiers lyriques, ne l'a point envahi: il a plutôt maigri, l'heureux homme! et il peut exprimer vraisemblablement les mélancolies de son cœur sans être contredit par des pectoraux d'athlète et des joues d'ange bouffi. La prima donna assoluta n'a rien à objecter lorsqu'il lui soupire élégamment ses peines amoureuses, et couronne volontiers sa flamme, en dépit des obstacles apportés par la basse et le baryton, ces éternels trouble-fêtes qui se vengent si cruellement de ce qu'il ne sauraient donner l'ut de poitrine, et charmer aussi la beauté. Sa voix est toujours ce qu'elle était: pure, fraîche, sympathique, la plus belle voix de ténor qu'il y ait au monde à cette heure. Mario a été rappelé trois fois, et il lui a fallu revenir saluer le public tout convulsé encore par ce terrible poison des Borgia, qui scintille comme de la poudre de marbre de Carrare, et pousse la perfidie jusqu'à faire trouver la vie meilleure. Mais de pareils bravos ressusciteraient un véritable mort.
(PORTE-SAINT-MARTIN)
7 février 1870.
Nous assistions à la première représentation de Lucrèce Borgia, en 1833. C'est un fait que nous n'avons pas l'intention de dissimuler pour nous rajeunir. Nous avouons même que nous faisions partie de la députation, envoyée à Victor Hugo par l'école romantique, qui ne voulait pas donner pour un drame en prose, trouvant cette concession bourgeoise, car, parmi ces fanatiques, ridicules peut-être aux yeux de la génération actuelle, il y avait un sentiment hautain de l'art et un amour vrai de la grande poésie; la lecture, dont l'effet fut immense, leva tous les scrupules, et les bandes d'Hernani promirent leur concours pour Lucrèce Borgia, qui n'en eut pas besoin, du reste, car la pièce alla toute seule aux nues. Nous avons donc vu Gennaro joué par Frédérick Lemaître, et Lucrèce ayant pour interprète Mademoiselle Georges; mais, n'ayez pas peur, nous n'abuserons pas de nos souvenirs, et nous ne ferons pas l'éloge du passé comme le vieillard d'Horace, laudator temporis acti, ou Nestor, le bon chevalier de Gerennia, vantant les hommes d'autrefois, beaucoup meilleurs et plus forts que ceux d'aujourd'hui. Peut-être au fond ne sommes-nous qu'une ganache romantique, comme Théodore de Banville s'appelait lui-même; mais nous aimerions qu'on ne s'en aperçoive pas trop, et nous serons aussi sobre que possible de radotages séniles.
Le public qui assistait à la reprise de Lucrèce Borgia, nouvelle au théâtre pour le plus grand nombre des spectateurs, était animé d'un esprit bien différent de celui qui nous poussait en 1833,—autre temps, autres chansons,—et la question d'art n'était pas évidemment ce qui le préoccupait le plus; mais nous avons tâché de nous isoler dans ce milieu bruyant et assagi, faisant abstraction de nos impressions anciennes, et de juger la pièce comme si nous la voyions pour la première fois.
Hé bien, après cet intervalle de tant d'années, remplies par des événements si imprévus, des doctrines si contradictoires, des évolutions de goût si diverses, Lucrèce Borgia nous a produit un effet aussi grand, plus grand peut-être qu'à la première représentation. Alors, ivre de lyrisme, fou de poésie, nous étions moins sensible au drame et à la situation scénique, et c'est par ces côtés que brille la première pièce en prose du poète d'Hernani ou de Marion Delorme. Rien de plus simple comme construction que ce drame d'un effet si puissant: il se compose de trois situations capitales largement développées, et formant d'admirables tableaux d'un dessin et d'une couleur superbes; on dirait trois fresques colossales encadrées dans les fines architectures de la Renaissance. L'œil les saisit d'un regard et en conserve une ineffaçable empreinte.—Affront sur affront.—Le Couple.—Ivres-morts.—Tels sont les titres sinistrement bizarres que le poète inscrit sur des cartouches à volutes contournées, au bas de ces peintures magiques d'un éclat sombre et farouche. Quoi de plus beau que cette scène sur la terrasse du palais Barbarigo, à Venise,où Maffio Orsini, Beppo Loveretto, don Apostolo Gazetta, Ascanio Petrucci, Alofeno Villettozo, dont les familles saignent de quelque meurtre, reprochent ses crimes à Lucrèce Borgia démasquée, et pour suprême affront lui jettent son nom au visage! Quel étonnant crescendo d'insultes! Nul poète depuis Shakespeare, n'a fait sonner d'un souffle plus vigoureux la «trompette hideuse des malédictions». Il y a dans cette scène sublime quelque chose de la grandeur épique d'Eschyle.
Le Couple, nous représente, avec une vérité effrayante, l'intérieur d'un ménage de tigres. C'est la même grâce perfide, la même scélératesse veloutée, la même force terrible voilée par des mouvements souples et câlins. A les voir aller et venir, le mâle et la femelle, comme dans la jungle de l'Inde, dans ce palais rempli de pièges, d'embûches et d'oubliettes, où l'on n'a qu'à frapper le mur pour en faire sortir un coupe-jarret l'épée à la main, ou un échanson portant des flacons empoisonnés, en est saisi involontairement d'une terreur secrète. Ces deux grands félins, échappés pour un instant de la ménagerie de l'histoire, ont une beauté monstrueuse dont le poète a fait merveilleusement ressortir le fauve caractère.
Quand, après avoir inutilement fait patte de velours et poussé d'hypocrites soupirs, Lucrèce sort toutes ses griffes, et, furieuse, revient au rauquement, qui est sa voix naturelle, on sent une fièvre d'épouvante vous courir sur la peau, et l'on craint que la tigresse ne saute du théâtre dans la salle, comme aux représentations de Van Amhy ou de Caster. Elle défend son petit comme elle peut, contre l'implacable et glaciale férocité de don Alphonse de Ferrare son quatrième mari.
Que dire du tableau: Ivres-morts? de ce souper chez la princesse Négroni, une de ces élégantes Locustes, au service des Borgia, qui savaient attirer les victimes couronnées de roses à ces banquets funèbres, et leur présenter avec un sourire la coupe remplie de poison? Quel chant sinistre que celui des moines se mêlant aux chansons de l'orgie, et comme on partage la terreur des convives en voyant s'ouvrir cette large porte qui découvre les cinq cercueils rangés en ligne, se détachant sur la draperie noire rayée d'une croix de drap d'argent, et Lucrèce debout au seuil, les bras croisés, dans l'orgueil satisfait de cette lâche vengeance si bien tramée et qu'eût admirée comme couvre d'art tout Italien du XVIe siècle! «Vous m'avez donné un bal à Venise, je vous rends un souper à Ferrare», résume superbement toute la pièce.
Les autres scènes intermédiaires sont tracées avec une simplicité magistrale, sans petite ficelle, allant droit au but comme des ruelles qui mènent aux grandes places par le plus court. Mais au coin de ces petites rues il y a toujours quelque tourelle curieusement ouvragée, quelque porche à statues, quelque balcon d'une serrurerie amusante. Même dans les portions les moins visibles du drame, l'art est toujours présent, comme dans les villes d'Italie de ce temps-là.
Quelques-unes de ces scènes, selon nous—et cela est une question de machiniste—ne devraient pas, comme elles le sont, être détachées en tableaux, mais jouées avec un simple changement à vue. L'auteur y gagnerait, et elles ne prendraient pas plus d'importance qu'il ne convient. Mais on a en France une superstitieuse horreur du changement à vue, dont Shakespeare pourtant fait un si large emploi.
Nous avions trouvé autrefois que cette prose si ferme, si nette, rehaussée de touches vigoureuses, rythmée en vue de luttes de dialogue, n'ayant pas besoin des vases d'airain dont on garnissait les théâtres antiques, pour arriver à l'oreille des spectateurs, avait toute la valeur d'art des plus beaux vers; nous sommes encore, après trente-sept ans, du même avis. Jamais plus magnifique langage n'a été entendu au théâtre. Quelques jeunes prétendent qu'il a vieilli. Oui, comme un tableau du Titien ou de Giorgione, que le temps couvre d'un voile d'or, rendant les lumières plus blondes, les tons plus chauds, et les ondes d'une profondeur plus mystérieuse.
C'était Madame Marte Laurent qui jouait le rôle de Lucrèce Borgia, jadis cr par Mademoiselle Georges. Nous n'établirons entre les deux artistes aucun fastidieux parallèle. Habituée au mélodrame, Madame Marie Laurent n'a peut-être pas toute l'ampleur tragique qu'il faudrait pour un drame de si haute et de si fière allure; mais elle a du feu, de l'intelligence, de la passion, des entrailles, et tout ce qu'elle peut donner, elle le donne sans réserve, sans crainte de se fatiguer; elle va jusqu'au bout de son talent. C'est beaucoup, et nous ne voyons pas dans le théâtre du drame une possibilité de Lucrèce supérieure.
On sait que cette terrible femme, trouvée charmante par les contemporains, était blonde. Lord Byron possédait une mèche de cheveux de Lucrèce, oubliée dans une lettre d'amour, et qui avait la couleur de l'or rouge. En artiste soigneuse, Madame Marie Laurent s'est conformée à cette tradition; il n'est pas nécessaire pour être 'terrible d'avoir des cheveux noirs comme de l'encre: les lionnes sont blondes.
Le rôle de Lucrèce offre cette difficulté que l'amour maternel ne pouvant s'avouer, y prend souvent les apparences de l'amour même: Gennaro, à ses accords, s'y trompe; Giubetta s'y trompe; le grand-duc de Ferrare s'y trompe; mais le public ne s'y trompe pas. Il est dans la confidence, il sait bien que Gennaro est le fils de Lucrèce et de ce Jean Borgia jeté dans le Tibre par l'homme à cheval qu'a vu le batelier de Ripetta, et dont Beppo Loveretto raconte la lugubre histoire au commencement du drame. Cette nuance est d'autant plus difficile à maintenir, que Lucrèce ne se livre à aucun monologue pour se dire ce qu'elle sait mieux que personne, se sert de Giubetta sans lui rien confier, et ne livre son secret que dans la suprême explosion du dénouement, lorsqu'elle crie à Gennaro, à travers un râle de mort: «Je suis la mère!» L'actrice a délicatement et profondément marqué cette différence. Elle a été très belle dans la grande scène de la malédiction, où elle tombe foudroyée sous l'anathème crié par toutes ces bouches vengeresses, ou plutôt sous la douleur immense d'être méprisée et haïe désormais de Gennaro. Ses câlineries avec le duc, au second acte, étaient peut-être un peu trop visiblement forcées: il ne fallait pas autant souligner l'intention secrète. Quand elle supplie Gennaro de boire le contre-poison, et qu'il refuse, en disant que c'est peut-être là le poison, elle a eu un mouvement superbe de probité méconnue qui se révolte contre l'injustice. Les ironies féroces du troisième acte ont été rugies par elle avec une étonnante profondeur de haine satisfaite, et à la dernière scène elle s'est montrée touchante et pathétique: on oubliait l'empoisonneuse pour plaindre la mère.
Pourquoi Taillade, ayant à représenter un jeune capitaine d'aventure, un Italien du temps des Borgia, s'est-il fait une tête anglaise, entièrement rasée, coiffé à la Titus, et ressemblant au portrait de Kemble dans le rôle d'Hamlet? Nous ne nous expliquons pas ce singulier caprice, qui altère sans raison la physionomie du personnage. Comme on a souvent reproché à Taillade d'être trop nerveux, trop saccadé, trop convulsif dans son jeu, il affecte maintenant une manière froide et sobre: il gesticule à peine, et ne se laisse plus entraîner au drame. Si Shakespeare interdit aux comédiens «de scier l'air avec leurs bras, et de mettre la passion en lambeaux, voire même en loques», il leur recommande aussi «de ne pas être trop apprivoisés, et de faire accorder le geste et la parole avec l'action.» Que Taillade, dont nous estimons fort le talent, s'abandonne davantage à sa nature, il sera beaucoup meilleur. Gennaro, malgré sa destinée mystérieuse, doit être plus franc et plus ouvert que cela.
Mélingue est le plus admirable don Alphonse d'Este duc de Ferrare, qu'on puisse rêver. Il est seigneurial et princier; a la grande tournure d'un portrait de Bronzino, et quand il dit: «Le nom d'Hercule a été souvent porté dans notre famille», il semble qu'il est digne de le porter lui-même. Sous sa manche de soie tailladée, on sent un bras musculeux, capable de tenir l'épée. C'est un homme comme ces temps-là en produisaient, un bandit-héros, un tyran, amateur des arts, un empoisonneur galant et courtois, profond, politique, et digne de l'admiration de Machiavel.
18 février 1843.
Le Théâtre-Français a répété activement les Burgraves, de Victor Hugo. Mademoiselle Théodorine vient d'être engagée expressément pour jouer le rôle de la sorcière Guanhumara. Ce nom, un peu rébarbatif, signifie tout simplement Geneviève. Duprez pourrait chanter aujourd'hui, à la place du nom si doux de Tchin Fra, celui de Guanhumara qui n'est pas plus dur assurément. Mademoiselle Théodorine est bien jeune sans doute pour représenter une vieillarde de quatre-vingts ans; mais nous nous accommodons plus volontiers de voir une jeune femme en jouer une vieille, que de voir une vieille en jouer une jeune. C'est du reste une habitude toute prise, les rôles marqués sont remplis par des jeunes gens, il suffit d'être sexagénaire pour débuter dans les ingénues.
Les petits journaux, comme d'ordinaire, donnent à l'avance de prétendus extraits des Burgraves: qui une tirade, qui un hémistiche, qui un vers: ils en sont pour leurs frais d'invention. C'est autant de besogne faite pour les parodistes, qui, avec cette facilité d'imagination qui les caractérise, ne manqueront pas d'en farcir leurs rapsodies. Jamais peut-être Victor Hugo ne s'est élevé si haut. Épique, homérique, sont les épithètes les plus modérées qui conviennent pour qualifier cette nouvelle œuvre. Cela se passe entre géants, dans un monde d'airain et de pierre de taille. Les plus petits ont sept pieds, les plus jeunes ont cent ans. La forme choisie par le poète est la trilogie, ou la journée espagnole: l'exposition, le nœud, le dénouement; disposition simple, logique, naturelle, et qui depuis longtemps devrait être adoptée. La longueur de la pièce est d'ailleurs la même, et sa durée sera celle d'une tragédie en cinq actes. On fait espérer cette solennelle et triomphante représentation pour le 8 mars, jour qu'il faut marquer avec une pierre blanche.
(THÉÂTRE-FRANÇAIS)
13 mars 1843.
Autrefois, sur le bord des rochers qui hérissent les bords du Rhin, se dressaient, au milieu des nuées, des donjons inaccessibles habités par des burgraves, bandits-gentilshommes, voleurs homériques, qui rançonnaient les passants, pillaient les convois, et remontaient ensuite à leurs nids avec leur proie dans les serres. Éventrées par les assauts, ébréchées par le temps, disjointes par l'envahissement de la végétation, les hautes tours des burgs abandonnés tombent pierre à pierre dans le fleuve, ou pendent formidablement sur l'abîme en fragments démesurés. Aux brigands héroïques bardés de fer ont succédé les filous et les escrocs. La ruse a pris la place de la force, les voyageurs ne sont plus détroussés que par les aubergistes. Dans ses admirables Lettres sur le Rhin, M. Victor Hugo, avec ce talent descriptif qui n'eut jamais d'égal, nous a fait parcourir quelques-uns de ces antiques repaires féodaux dont il sait tous les secrets, la salle d'armes, les caveaux aux voûtes surbaissées, l'escalier en colimaçon, le couloir qui circule dans l'épaisseur des murs, l'oubliette, au fond pavé d'ossements, la guérite en poivrière, accrochée aux créneaux comme un nid d'hirondelles, il nous a tout montré, il nous a promenés dans toutes les salles, à tous les étages. C'est sans doute en visitant un de ces donjons que l'idée des Burgraves est venue à l'illustre poète. Il aura d'abord, par le travail de la pensée, restauré les portions en ruines, remis à leurs places les pierres écroulées, rattaché le pont-levis à ses chaînes, rétabli les planchers effondrés, arraché le lierre et les herbes parasites, replacé les vitraux dans leurs mailles de plomb, jeté un chêne ou deux dans la gueule béante des cheminées, posé ça et là, dans l'embrasure des fenêtres, quelques chaises en bois sculpté; puis, quand il aura vu toutes les choses ainsi arrangées et remises en état dans le manoir seigneurial, la fantaisie lui aura pris d'évoquer les anciens habitants, car le poète a, comme la pythonisse d'Endor, la puissance de faire apparaître et parler les ombres. Hatto se sera présenté le premier, puis Magnus son père, puis Job l'aïeul, le cercle s'élargissant et se reculant toujours. Cette vision des temps disparus, M. Victor Hugo l'a réalisée et fixée en vers magnifiques, et il en est résulté la trilogie des Burgraves.
Lorsque la toile, en se levant, laisse les yeux des spectateurs pénétrer dans le monde fantastique que sépare du monde réel cet étincelant cordon de feu qu'on appelle la rampe, nous sommes au burg de Heppenheff, une de ces hautes demeures féodales, escarpées, inabordables, se cramponnant au rocher par des serres de granit, faisceaux de tours engagées les unes dans les autres, où la muraille continue la montagne à s'y méprendre, et dont les ruines de Château-Gaillard, près des Andelys, aux bords de la Seine, peuvent donner une idée à ceux qui n'ont pas vu les burgs du Rhin. Les nuages baignent les créneaux, et l'épervier, en passant, se déchire la plume au fer de la lance des sentinelles; les fossés sont des abîmes, où blanchit, tout là-bas, dans la vapeur bleue, l'eau savonneuse d'un torrent; le vertige vous prend, à vous pencher aux étroites fenêtres.
Nulle communication avec le dehors, pas un jour dans cette armure de pierre de taille, que revêt par-dessus l'armure de fer qui ne le quitte jamais, le vieux burgrave Job le Maudit, Job l'Excommunié, espèce de Goetz de Berlichingen centenaire, Titan du Rhin, qui veut mourir comme il a vécu, sans loi, sans maître; qui repousse d'un pied obstiné l'échelle de l'Empire appliquée à ses murailles, et, pour montrer qu'il est en révolte ouverte contre la société, plante un grand drapeau noir sur sa plus haute tour. Cette grande salle délabrée, où l'abandon tamise sa poussière fine, où l'humidité verdit les pierres, où l'araignée travailleuse suspend ses rosaces aux nervures brisées, c'est la galerie des portraits seigneuriaux du burg de Heppenheff.
Au fond l'on, voit flamboyer, à travers les pleins-cintres d'une galerie romane, un coucher de soleil aux teintes menaçantes et sanguinaires. Le premier étage de ce promenoir se compose de piliers courts, trapus, écrasés, à l'attitude massive, aux chapiteaux fantastiques; le second, de colonnettes plus légères et plus rapprochées; par l'interstice des arcades, se découvrent en perspective les sommets des remparts et des autres tours du burg. Des lumières scintillent déjà aux barbacanes, d'où s'échappent par éclats de stridentes fanfares de clairons, et de tumultueux refrains de chansons à boire. Hatto, le plus jeune et le plus méchant des burgraves, est en train de banqueter avec ses compagnons. La chose dure depuis le matin, et a toute la mine de se vouloir prolonger; on ne s'arrête pas en si beau chemin. Au vacarme insolemment joyeux de la fête se mêle, par instants, le bruit sinistre de pas lourds et de feuilles froissées; ce sont les captifs, les esclaves qui reviennent du travail, conduits par un soldat, le fouet en main. Certes, si jamais l'on a pu se croire en sûreté dans son antre, c'est bien le comte Job. La herse est baissée, le pont-levis ramené; l'archer veille à son poste; la chambre du comte, avec sa porte étoilée d'énormes clous, de serrures compliquées de secrets, est comme une forteresse au cœur de la première; les esclaves sont enchaînés solidement; les cachots ont des profondeurs inconnues, et ne lâchent jamais leur proie. Que peut craindre le vieux Prométhée, sur son roc? qu'il ne descende du ciel un vautour envoyé par Jupiter!
Eh bien, dans ce manoir si bien gardé, malgré les remparts, malgré les sentinelles, a su se glisser un ennemi. Vous voyez cette vieille, triste, dévastée, avec cette tristesse d'orfraie, son morne et froid regard de spectre, ses deux talons qui résonnent sur les dalles comme les talons du Commandeur, son nom rauque et bizarre, ses allures sinistrement mystérieuses: c'est la Haine c'est la Vengeance, c'est Guanhumara, pauvre esclave vendue et revendue vingt fois, qui a traîné les bateaux qui vont d'Ostie à Rome et qui, changeant sans cesse de maître et de climat, a vécu pendant soixante ans de tout ce qui fait mourir. Dans cette variété d'infortunes, à travers bette existence errante, elle a trouvé des secrets merveilleux; effrayante pour les tigres eux-mêmes, elle a cueilli dans les forêts monstrueuses de l'Inde les herbes puissantes qui donnent la vie ou la mort; durant les immenses nuits des pôles, où les étoiles brillent six mois aux cieux, elle a médité sur les forces secrètes des astres et des philtres, elle a conversé avec les noirs esprits et lentement combiné le plan de sa vengeance que Satan lui-même ne pourrait désirer plus complète: elle erre à travers ce manoir dont elle connaît tous les replis, dont elle a sondé tous les souterrains; car on lui laisse une espèce de liberté, en considération de quelques cures surprenantes qu'elle a faites. Elle inspire à ses compagnons d'infortune une espèce d'effroi vague, de terreur superstitieuse, et elle se promène ayant toujours autour d'elle un cercle de solitude. Pendant qu'elle s'est tapie, hargneuse, muette et sombre dans son coin, les prisonniers causent entre eux des mystères du burg, et se disent tout bas des paroles dont l'écho leur fait peur.
On a vu au cimetière Guanhumara qui, les manches relevées, préparait une horrible mixture avec des os de morts, en murmurant une incantation bizarre; cette fenêtre aux barreaux défoncés, qui s'ouvre sur l'abîme et qui laisse descendre une trace de sang sur la muraille jusque dans dans les eaux du torrent, cette fenêtre qui donne du jour à ce caveau dont on ne connaît plus l'entrée, on y a vu trembler une lueur. Un fantôme habite ce trou perdu. «En quel temps louche, mystérieux et plein d'événements étranges vivons-nous? Tout chancelle, tout croule! La violence, le meurtre, le pillage, règnent sans obstacle. Les choses ne se passaient pas ainsi du temps de Barberousse. Ah! s'il vivait encore, il saurait bien châtier l'insolence des burgraves. Mais il n'est pas mort définitivement, dit un captif, il y a une prédiction ainsi conçue: Barberousse sera cru mort deux fois», et renaîtra deux fois. Le comte Max-Edmond l'a vu près de Lautern, dans une caverne du Taurus, au-dessus de laquelle tourne sans cesse un cercle de corbeaux. Il était là assis gravement sur une chaise d'airain: ses longs cils blancs lui descendaient jusque sur les joues, et sa barbe, autrefois d'or, aujourd'hui de neige, faisait trois fois le tour de la table de pierre sur laquelle appuyait son coude. Quand le comte Max-Edmond s'approcha, Barberousse ouvrit les yeux, et demanda si les corbeaux s'étaient envolés: «Non, Sire!» répondit le comte, et le fantôme-empereur se rendormit,—Chimères, chansons, histoires de nourrice, contes à dormir debout, que tout cela! Barberousse s'est noyé dans le Cydnus, en face de toute l'armée.—Mais on n'a pas retrouvé son corps. «Qui sait! la prédiction accomplie une fois, ne peut-elle pas l'être deux? dit quelqu'un de la troupe, moins sceptique que les autres. J'ai vu, il y a longtemps à l'hôpital de Prague, un gentilhomme Dalmate nommé Sfrondati, enfermé comme fou, et qui racontait l'histoire que voici: pendant sa jeunesse, il était écuyer chez le père de Barberousse, qui, effrayé des prédictions faites à la naissance de son enfant, l'avait donné à élever sous le nom de Donato, à un autre fils bâtard qu'il avait eu d'une fille noble. Le duc Frédéric avait caché son rang à ce bâtard, de peur d'exciter son ambition; et en lui confiant son fils légitime il ne lui avait rien dit autre chose, sinon: Voici ton frère. Les deux frères eurent une querelle, quand Donato eut vingt ans, à propos d'une fille corse qu'ils aimaient tous deux; l'aîné se crut trahi, et tua l'autre ainsi que Sfrondati, ou du moins il s'imagina les avoir tués. Au bord d'un torrent, des pâtres recueillirent deux corps sanglants et nus que les eaux avaient jetés sur la rive: c'étaient Sfrondati et Donato; ils n'étaient pas morts; on les guérit, et Sfrondati n'eut rien de plus pressé que de ramener Donato à son père; l'affaire fut étouffée, Fosco disparut, s'enfuit en Bretagne, et ne revint que bien des années après. Quant à Sfrondati, son esprit s'était troublé, et n'avait plus que de vagues lueurs de raison. Le duc Frédéric, voulant assoupir tout cela, l'avait fait enfermer. On ne savait ce qu'était devenue la fille corse, vendue à des bandits, à des corsaires. A son lit de mort, Frédéric avait fait venir son fils, et lui avait fait jurer sur la croix de ne chercher à tirer vengeance de son frère que quand celui-ci aurait cent ans révolus, c'est-à-dire jamais. Fosco, sans doute, est mort sans savoir que son père Othon était le duc Frédéric et son frère Donato l'empereur Barberousse.» Tels sont, à peu près, les discours que font entre eux les esclaves, marchands, bourgeois et militaires, chacun jetant son mot et sa rime avec cet imprévu et cette habileté qui caractérisent M. Victor Hugo dans ses conversations, qui tiennent lieu du chœur antique au drame moderne.
Quand les captifs ont achevé leurs récits, le soldat-gardien fait claquer son fouet, et les chasse devant lui, attendu que Monseigneur Hatto et la compagnie doivent venir visiter cette aile du château; et il ne faut pas que les regards soient choqués par la vue de ces misérables.
Les jeunes burgraves ne se hasardent pas souvent de ce côté, car c'est là que Magnus et Job se sont creusé leur tanière. Cet escalier ténébreux conduit aux salles qu'ils habitent. Job trône là-dedans sous un dais de brocart d'or, ayant à ses côtés son fils Magnus qui lui tient sa lance. Immobiles, pensifs, ils restent silencieux des mois entiers. Ils songent à leurs exploits, à leurs crimes peut-être, car, malgré leur air patriarcal, le père et le fils sont au fond devrais bandits, et s'ils n'ont pas les vices efféminés des époques de décadence, ils ont toute la rudesse féroce et toute l'âpreté brutale des temps primitifs. Ce sont des êtres de fer, toujours habillés de fer; ils n'ont d'autre robe de chambre que la cotte de mailles, ils vivent dans leur armure et ne se meuvent que dans un cliquetis d'acier. Pour Hatto et ses amis, ils trouvent plus commode d'être vêtus de velours et de soie, de passer leur vie dans de longs festins, de se couronner de fleurs, d'embrasser les belles esclaves, et de laisser le gros de la besogne à des brigands subalternes, espèces de chiens ou de faucons dressés à rapporter la proie. Ils préfèrent le choc des verres à celui des épées, et peut-être, quoiqu'on disent les aïeux homériques, n'ont-ils pas tout à fait tort.
Les captifs retirés, on voit paraître une pâle et blanche figure. Est-ce une vision, est-ce un ange égaré dans cette caverne de chats-tigres? D'une main, elle s'appuie sur une suivante, de l'autre sur le bras du franc archer Olbert, beau jeune homme de vingt ans qui l'aime et qu'elle aime; elle s'assoit ou plutôt se laisse tomber dans un fauteuil près le vitrail haut en couleur, qu'elle se fait ouvrir pour jeter sur la campagne un regard, le dernier peut-être, car elle est poitrinaire, car elle va mourir. Ce corps si charmant le tombeau le réclame; cette âme si pure et si douce, les anges rappellent!... Millevoye est devenu célèbre pour quelques vers sur ce sujet, que cette scène de Régina et Olbert efface comme un rayon de soleil fait disparaître un pâle reflet de lune. Jamais poésie plus ravissante, plus tendre, plus mélancolique, plus amoureusement parfumée des senteurs que l'air exhale de son urne, n'a caressé l'oreille humaine. C'est le charme indéfinissable de la musique, plus le sens et les images. L'amour d'Olbert se répand en effusions lyriques d'une ardeur et d'une tendresse incomparable! «Tu vivras!» s'écrie-t-il avec un accent que donne la foi de la passion, lorsque la jeune fille enivrée, éperdue, pousse un cri de désespoir sublime en sentant que la vie lui échappe, et se trouve trop aimée pour mourir.
Olbert s'adresse à Guanhumara. Ne tient-elle pas la vie ou la mort dans sa puissante main? Guanhumara ne pourra lui refuser la vie de Régina. Des liens mystérieux unissent d'ailleurs Olbert à la sinistre vieille. C'est un enfant qu'elle a volé et dont elle a pris soin pour quelque projet formidable et terrible, et même, sans vous faire attendre plus longtemps, nous vous dirons qu'Olbert n'est autre que Georges, un enfant que Job a eu dans sa vieillesse, à plus de quatre-vingts ans, comme un patriarche qu'il est; la diabolique vieille l'a pris comme il jouait sur la pelouse, et l'a emporté dans le pli de ses haillons; elle l'a élevé avec une horrible pensée de meurtre et de vengeance, elle veut punir le fratricide par un parricide, car, s'il ne s'agissait que de tuer Job, dans lequel vous avez déjà reconnu l'assassin de Donato, ce serait la chose la plus simple du monde. Guanhumara n'a-t-elle pas à son service toute une pharmacie empoisonnée, jusquiame, euphorbe, sucs du mancenillier et de l'arbre upa?
Mais cela serait trop doux, trop simple, trop peu corse. Olbert lui dit: «Peux-tu sauver Régina?—Oui; mais que m'importe qu'elle meure!—Oh! je rachèterais sa vie au prix de mon âme, si Satan en voulait!—Es-tu bien décidé?... Vois ce flacon, que Régina en boive une goutte chaque soir, elle vivra. Mais pour l'obtenir de moi, il faut me faire le serment de tuer, quand je voudrai, où je voudrai, qui je voudrai, sans grâce ni merci, comme un assassin, comme un bourreau.—Je le jure». Le pacte conclu, Guanhumara tire de sa ceinture une petite fiole. Dans cette liqueur noirâtre sont quintessenciées la vie, la santé, la fraîcheur. Allons, ce n'est pas payer trop cher.
Une faible bouffée de vent apporte encore un bruit de chœur et de trompettes. C'est Hatto qui s'avance suivi de sa bande joyeuse, le verre à la main, des roses sur la tête. La conversation est des plus animées, car on a fait de nombreuses saignées aux deux tonnes de vin d'écarlate que la ville de Bingen donne chaque année au comte Hatto. Chacun raconte ses exploits et ses bonnes fortunes; la liste en est longue! L'un se vante d'avoir pillé, l'autre d'avoir faussé un serment sur l'Évangile, et mille autres peccadilles de ce genre; mais pendant que ces messieurs babillent de la sorte, la porte du donjon s'est ouverte. Un spectacle étrange se présente aux yeux. D'abord c'est Magnus, vêtu de buffle et d'acier, ayant sur les épaules une grande peau de loup dont la gueule s'ajuste derrière sa tête en manière de casque. Il a le poil mélangé, il s'appuie sur une énorme hache d'Ecosse; quoique vieux il annonce une vigueur colossale, des muscles invaincus. Sur la marche supérieure se tient debout un second personnage, plus âgé, à la tète chauve, aux tempes veinées, dont la barbe tombe en longues cascades blanches sur la poitrine comme celle du Moïse de Michel-Ange; c'est Job, autrefois Fosco. A côté de lui se tiennent Olbert et un écuyer portant la bannière noire et rouge.
Les compagnons de Hatto sont trop occupés d'eux-mêmes pour s'apercevoir de l'arrivée de Magnus et de Job qui gardent un silence de granit, jusqu'à l'instant où l'un des convives se vante de n'avoir pas tenu son serment. Magnus prend alors la parole et lance une de ces magnifiques apostrophes, familières à M. Victor Hugo, sur la vieille loyauté allemande, sur la différence des serments et des habits d'autrefois, avec les serments et les habits d'aujourd'hui. Jadis tout était d'acier, maintenant tout n'est que soie et clinquant; les vêtements et les paroles, rien ne dure.
Les jeunes burgraves ne font pas grande attention à ce discours, accoutumés qu'ils sont aux allocutions homériques de leurs grands-parents. Le jeune comte Lupus entonne une chanson que nous reproduisons ici, parce que la musique, quoique charmante, a un peu couvert les paroles, qui certes méritaient d'être entendues tout à fait pour la nouveauté de la coupe et la franchise du jet:
L'hiver est froid, la bise est forte;
Il neige là-haut sur les monts;
Aimons, qu'importe,
Qu'importe, aimons.
Je suis damné, ma mère est morte,
Mon curé me fait cent sermons;
Aimons, qu'importe,
Qu'importe, aimons.
Belzébuth, qui frappe à ma porte,
M'attend avec tous ses démons;
Aimons, qu'importe,
Qu'importe, aimons.
Pendant que Lupus chante, les autres, penchés à la fenêtre, s'amusent à jeter des pierres à un mendiant qui semble vouloir demander l'hospitalité: «Quoi! s'écrie Magnus en sortant de sa torpeur, c'est ainsi qu'on reçoit un mendiant qui supplie, un hôte envoyé par Dieu même? De mon temps, nous avions aussi cette folie, nous aimions les chants, les longs repas, mais quand venait un malheureux ayant froid, ayant faim, on remplissait un casque de monnaie, une coupe de vin, on l'envoyait au vieillard, qui continuait gaiement sa route, et l'orgie recommençait de plus belle, sans remords et sans soucis». «Jeune homme, taisez-vous! dit à Magnus le burgrave centenaire. De mon temps, lorsque nous chantions plus haut encore que vous et que nous nous réjouissions autour d'une table colossale sur laquelle on servait des bœufs entiers couchés sur des plats d'or, si un mendiant se présentait devant la porte du burg, on l'allait chercher, les clairons sonnaient, et le vieillard s'asseyait à la plus belle place. Enfants! rangez-vous!... Ecuyers, allez chercher cet homme, et vous, clairons, sonnez comme pour un roi!» On exécute les ordres de Job, et bientôt on voit se dessiner dans la rougeur du soir, encadré par une arcade du promenoir, au sommet de l'escalier, un pèlerin avec un manteau déchiré, des sandales poudreuses, et une barbe qui lui tombe jusqu'au ventre. Les clairons sonnent une seconde fanfare et la toile baisse sur ce tableau, l'un des plus grands, des plus épiques qui soient au théâtre, et qui, dans l'effet grandiose de l'idée et de la forme, n'a d'équivalent que la scène de l'affront, dans Lucrèce Borgia.
Au commencement de la seconde partie, le mendiant débile, un de ces beaux monologues poétiques où M. Victor Hugo résume, dans une soixantaine de vers, la situation d'un pays, le caractère d'une époque. Il excelle à construire des espèces de plan à vol d'oiseau, où l'on découvre sous une forme distincte et réelle tous les événements d'un siècle. Du haut de sa pensée la tête vous tourne, comme du sommet d'une flèche de cathédrale. C'est un enchevêtrement de piliers, d'arcs-boutants, de contreforts, une complication qui étonne et décourage. On sent que pour sortir de là il ne faut pas être moins qu'un Charlemagne, un Charles-Quint, un Barberousse. Aussi le mendiant, si royalement accueilli par Job, est-il l'empereur Frédéric Barberousse lui-même. Toute cette politique transcendante, en vers d'une beauté cornélienne, est joyeusement interrompus par l'entrée de Régina, la joue en fleur, l'œil humide d'un gai rayon, la bouche épanouie: le philtre de Guanhumara a produit son effet; la pâle enfant, si blanche et si transparente qu'elle eût pu servir de statue d'albâtre à coucher sur son propre tombeau, entretenue soudain à la vie, au bonheur, comme évoquée par les drogues souveraines de la sorcière.
Olbert est si radieux de bonheur, qu'il a presque oublié la condition fatale posée par Guanhumara. Elle a tenu sa promesse, il faut qu'il tienne la sienne; car la sorcière peut, avec un second philtre, faire replonger dans l'ombre de la tombe la souriante figure qu'elle vient de lui arracher.
Job ne se sent pas d'aise; il n'a pas été sans voir, par-dessus son grand fauteuil d'ancêtre, Olbert et Régina nouer leurs regards, et se renvoyer leurs âmes dans un sourire. Il comprend que ces deux enfants s'aiment, et qu'il faut les marier. Une secrète sympathie l'entraîne d'ailleurs vers Olbert; ce front chaste et fier, cet œil, assuré lui plaisent et le ravissent; c'est ainsi qu'il était lui-même à vingt ans, c'est ainsi que serait son Georges, enlevé, tout jeune, et sacrifié par les Juifs dans un sabbat. Olbert ne connaît ni sa mère ni son père; mais qu'importe! Lui, Job, n'est-il pas bâtard d'un comte, et légitime fils de ses exploits? L'obstacle à tout ceci, c'est Hatto, à qui Régina est fiancée. Il faut d'abord gagner du terrain: Olbert et Régina fuiront par une poterne secrète dont Job leur donne les clefs. Le vieillard se charge du reste: les amants vont partir, la joie aux yeux, le paradis au cœur; mais le démon est là, dans l'ombre, qui ricane et qui grince. Guanhumara, accrochée comme une chauve-souris par les ongles de ses ailes dans quelque coin obscur, a tout entendu. Elle va prévenir Hatto, qu'Olbert enlève sa fiancée. Hatto accourt rugissant et furieux. Olbert lui crache son mépris à la face, le provoque, l'insulte; mais Hatto repousse du pied son gant, en l'appelant faussaire, misérable, esclave et fils d'esclave: «Tu n'es pas l'archer Olbert: tu te nommes Yorghi Spadaceli: je te ferai chasser à coups de fouet par mes valets de chiens; je ne veux pas me battre avec toi. Si quelqu'un de ces seigneurs prend ton parti, j'accepte le combat contre lui, à toute arme, à l'instant, ici même, deux poignards sur la poitrine nue». Le mendiant, qui a écouté cette scène avec une indignation contenue, s'écrie: «Je serai le champion d'Olbert.—Voilà qui est bouffon! Nous tombons de l'esclave au mendiant! Qui donc êtes-vous, pour vous avancer ainsi!—Je suis l'empereur Frédéric Barberousse, et voici la croix de Charlemagne!» Cette révélation soudaine terrifie d'étonnement toute l'assemblée. «Barberousse, dit Magnus, je saurai bien te reconnaître; voyons ton bras! En effet, tu portes la trace du fer triangulaire dont mon père t'a marqué. Messeigneurs, je déclare que c'est bien l'empereur Frédéric Barberousse.» L'empereur, son identité constatée, se livre aux reproches les plus violents; il prend chaque burgrave à partie, dit son fait à chacun avec cette éloquence soudaine et terrible, ces grondements et ces tonnerres qui rappellent les colères des héros de l'Edda. En entendant ces rugissements léonins que pousse le vieil empereur indigné de tant de lâchetés, de trahisons et de rapines, les plus hardis frissonnent et se courbent; Magnus seul reste debout, sa haine gronde plus haut encore que la colère de Barberousse. Les burgraves, enhardis par l'exemple de Magnus, commencent à entourer Frédéric d'un cercle plus resserré et plus menaçant. La hache énorme du géant va faire voler en éclats l'épée de l'empereur, lorsque Job le maudit, qui n'a encore pris aucun parti dans cette querelle, s'approche de Magnus, lui met la met sur l'épaule et dit en s'agenouillant: «Frédéric a raison; lui seul peut sauver l'Allemagne, soumettons-nous». Barberousse, redevenu maître de la scène, dispose de tout à son gré, donne des ordres, envoie les uns à la frontière, condamne les autres à rendre ce qu'ils ont pris, fait mettre en liberté les captifs, et charge des chaînes qu'on ôte à ceux-ci, les plus coupables des burgraves: «Maintenant, Fosco, va m'attendre où tu te rends chaque soir», dit Barberousse à voix basse au vieux burgrave, qui reste atterré; car nul au monde ne le connaît à présent sous ce nom; tous ceux qui l'ont su reposent depuis longtemps dans la tombe.
A la troisième partie, nous sommes dans le caveau perdu, un endroit effrayant et lugubre, aux échos inquiétants, aux profondeurs pleines de ténèbres: un soupirail grillé de barreaux dont trois sont tordus et défoncés, laisse filtrer un blafard rayon de lune qui dessine sur la muraille opposée une empreinte blanche comme un suaire. Job est assis, accoudé à un quartier de pierre, près d'une petite lampe tremblotante que l'humidité fait grésiller, et qui ne sert qu'à rendre les ténèbres visibles. 11 déplore sa chute; il est enfin vaincu, lui le demi-dieu du Rhin, le grand révolté, le vieil aigle de la montagne; il repasse dans sa mémoire toutes les actions de sa vie, Donato, Ginevra, Georges, son enfant perdu, ce remords et ce désespoir de toute heure. À ses sombres lamentations, l'écho répond obstinément: «Caïn!» L'écho, c'est Guanhumara, qui s'avance, tranquille et terrible, sûre de sa vengeance. Elle se dresse devant le burgrave, qui frissonne pour la première fois de sa longue vie, et se fait reconnaître par un récit bref et saccadé, où elle retrace en peu de mots toutes les circonstances du crime qui s'est commis dans le caveau perdu. «Maintenant, écoute ceci. Ton fils Georges est vivant, c'est moi qui l'ai volé et qui l'ai élevé pour ma vengeance: le fils tuera le père; un parricide pour un fratricide, ce n'est pas trop. Georges, c'est Olbert. Il a fait un pacte avec moi. J'ai rappelé Régina à la vie à la condition qu'il frapperait une victime désignée par moi. La vie que j'ai donnée à Régina, je puis la lui reprendre. Cela me répond de la résolution d'Olbert.—Olbert sait qu'il va tuer son père? Non; meurs voilé, c'est la seule grâce que je t'accorde.» Des pas chancelants se font entendre dans la profondeur du souterrain; c'est Olbert qui arrive éperdu, vacillant, pour tenir sa fatale promesse. Ici a lieu une scène admirable où l'âme est tendue, torturée, où les pleurs jaillissent des yeux les plus secs. Personne n'a jamais su faire parler l'amour paternel comme l'auteur des Feuilles d'automne, de Notre-Dame de Paris et des Rayons et les ombres. Job ne veut pas mourir sans avoir embrassé son enfant; il rejette son voile, s'élance dans les bras d'Olbert, agité lui-même de pressentiments terribles, et, tout en assurant qu'il n'est pas son père, il lui prodigue les caresses les plus paternelles. «Tue-moi; tu ne peux pas laisser mourir ta Régina; d'ailleurs, tu me crois vénérable, je ne suis qu'un coupable, qu'un Satan; sois l'archange vengeur, frappe sans crainte: j'ai poignardé mon frère!» Olbert, malgré les supplications éperdues de Job, hésite encore à faire son métier de bourreau.
Guanhumara, le voyant chanceler dans ses résolutions, s'avance, et lui dit: «Régina ne peut plus attendre qu'un quart d'heure». Olbert, hors de lui, s'élance le couteau à la main; mais il est retenu par Barberousse, qui surgit tout à coup du sein de l'ombre, et qui dit: «Ginevra, cette vengeance est inutile. Donato n'est pas mort. Donato, c'est moi. Fosco, lorsque tu tenais mon corps penché sur l'abîme, tu as murmuré une phrase que nul au monde n'a pu entendre:—A toi la tombe; à moi l'enfer!» Fosco tombe à genoux, râlant: «Grâce! Pardon!» Barberousse le relève, et le presse sur son cœur.
Guanhumara, ou plutôt Ginevra, désarmée, ressuscite tout à fait la fiancée d'Olbert, et comme désormais sa vie n'a plus de but, elle avale le contenu d'une petite fiole, et tombe foudroyée par le poison. En effet, à quoi bon, quand on est vieille, hideuse à voir, retrouver un amant adoré à vingt ans? Pourquoi remplacer par une réalité affreuse un fantôme charmant, un souvenir plein de grâce et de fraîcheur?
Cette analyse, que nous avons faite avec toute la religion due à l'œuvre d'un grand poète, quoique longue, est bien incomplète encore; nous aurions voulu, ambition au-dessus de nos forces, reproduire quelques traits de ces figures sauvages et gigantesques, qui rappellent par leurs formes violentes, leurs mouvements terribles, leurs allures de lion en colère, les illustrations dessinées par le célèbre peintre allemand Cornélius, pour l'histoire des Nibelungen. Pourrons-nous seulement comme il convient, louer cette versification ferme, carrée, robuste, familière et grandiose, qui annonçait le poète souverain, comme dirait Dante? A chaque instant, un vers magnifique qui d'un grand coup de son aile d'aigle vous enlève dans les plus hauts cieux de la poésie lyrique. C'est une variété de ton, une souplesse de rythme, une facilité de passer du tendre au terrible, du plus frais sourire à la plus profonde terreur, que nul écrivain n'a possédée au même degré.
Le public s'est montré digne, cette fois, de la grande œuvre qu'on représentait devant lui. II a écouté avec le respect qui convient au peuple de l'Athènes moderne, l'œuvre de son premier poète, applaudissant les beaux endroits, n'inquiétant pas l'action pour un détail hasardeux, ou d'une bizarrerie relative. Aussi, il faut dire que jamais assemblée pareille ne s'était réunie pour écouter une œuvre humaine. Tout ce que Paris, le cerveau du monde, renferme de savant, d'intelligent, de passionné, de célèbre et d'illustre à un titre quelconque, se trouvait à l'appel: la littérature, les arts, le théâtre, la politique, la banque, l'élégance, la beauté, toutes les aristocraties. Chaque loge renfermait au moins une renommée. Il n'y a, dans ce temps, que M. Victor Hugo qui préoccupe à ce point la curiosité et l'attention publiques. Qu'on lui soit favorable ou hostile, tout le monde s'occupe de ses œuvres. Un drame de lui est toujours un événement, un sujet de discussions; lui seul peut substituer les querelles littéraires aux querelles politiques.
Il serait sans doute facile (assez de critiques le feront) de chercher noise au poète sur un détail, sur une entrée, sur une sortie; mais cela importe peu; les esprits médiocres excellent toujours dans ces mécanismes et ces adresses. Pour notre part, nous aimons assez les beautés choquantes, et nous acceptons parfaitement un peu de bizarrerie, de barbarie, de mauvais goût, si l'on veut, pour arriver à certains vers éclatants et soudains qui font dresser l'oreille à tout véritable poète, comme une fanfare de clairons à tout cheval de guerre. Il y a chez M. Victor Hugo une qualité, la plus grande, la plus rare de toutes dans les arts: la force! Tout ce qu'il touche prend de la vigueur, de l'énergie, de la solidité; sous ses doigts puissants, les contours se dessinent nettement; rien de vague, rien de mou, rien d'abandonné au hasard. Il a cette violence et cette âpreté de style qui caractérisent Michel-Ange: son génie est un génie mâle,—car le génie a un sexe.—Raphaël est un génie féminin, ainsi que Racine; Corneille est un génie mâle. Nul ne se rapproche davantage de la grandeur sauvage d'Eschyle: Job a des tirades qui ne seraient pas déplacées dans le Prométhée enchaîné. L'imprécation de Guanhumara, quand elle prend la nature à témoin de son serment de vengeance est un des plus beaux morceaux de notre littérature, c'est l'ampleur et la poésie à pleine volée de la tragédie antique, bien différente de la tragédie classique:
... O vastes cieux! ô profondeurs sacrées!
Morne sérénité des voûtes azurées!
Lueur dont la tristesse a tant de majesté!
Toi qu'en un long exil je n'ai jamais quitté!
Vieil anneau de ma chaîne, ô compagnon fidèle!
Je vous prends à témoin! Et vous, murs, citadelles,
Chênes qui versez l'ombre au pas du voyageur,
Vous m'entendez! Je voue à ce couteau vengeur
Fosco, baron des bois, des rochers et des plaines,
Sombre comme toi, nuit! vieux comme vous, grands chênes!
Quelle merveilleuse puissance il a fallu pour faire revivre ainsi toute cette époque évanouie et fondue dans la nuit du passé douteux, reconstruire ce monde de granit habité par des géants d'airain, rebâtir pierre à pierre, avec une patience d'architecte du moyen âge, ce burg inaccessible et formidable, aux murailles où circulent des couloirs ténébreux, aux caveaux pleins de mystères et de terreurs, avec ses vieux portraits de famille, ses panoplies qui rendent d'étranges murmures lorsque la bise les effleure de l'aile, et qui semblent être encore remplies par les âmes dont elles ont revêtu les corps! Quelle force de réalisation il a fallu pour mêler ainsi les fantômes de la légende aux personnages naturels, et mettre dans ces bouches impériales et homériques des discours dignes d'elles? Soutenir ainsi ce ton d'épopée, ce bel élan lyrique pendant trois grands actes, M. Hugo seul pouvait le faire aujourd'hui.
Les Burgraves ont été joués avec beaucoup de talent et d'ensemble. Ligier a très bien rendu les portions énergiques du rôle de Barberousse: Beauvallet et Guyon, aidés tous deux par des voix magnifiques, sont restés constamment à la hauteur de leurs personnages. Beauvallet, surtout, dans celui de Job, s'est montré tour à tour simple et majestueux, paternel et terrible. Cette création lui fait le plus grand honneur. Geffroy a rendu avec intelligence et chaleur le rôle d'Olbert. Mademoiselle Théodorine a pris rang tout de suite par la création de Guanhumara; nul doute qu'elle ne devienne une excellente reine tragique, et qu'elle ne rende d'importants services au drame moderne, qui lui a fait sa réputation.
14 décembre 1846.
On va reprendre les Burgraves maintenant que les esprits sont libres de toute préoccupation réactionnaire, nul douté qu'un public nombreux n'applaudisse à cette œuvre colossale, à cette tragédie épique, la plus énorme conception qui se soit produite à la scène depuis le Prométhée d'Eschyle.
Nous allons donc les voir encore, ces grands vieux bardés de buffle et de fer, se promener tout d'une pièce dans leur burg démantelé. Nous allons donc les voir encore ces titans de granit, se parler dans une langue de pierre versifiée, et se jeter à la tête des blocs d'alexandrins abrupts; ils vivront devant nous de cette vie formidable et surprenante des créations antérieures, comme les héros des Nibelungen, ou les figures de Michel-Ange, éclairés par les reflets sinistres des soleils disparus!
Quel que soit le succès de cette reprise.
«Le burg, plein de clairons, de chansons, de huées, se dresse inaccessible au milieu des nuées.
(PALAIS-ROYAL ET VARIÉTÉS)
LES HURES GRAVES.—LES BUSES GRAVES.
Nous avouons très humblement n'avoir jamais rien compris aux parodies. En effet, que peut-il y avoir de plaisant à mettre un cureur d'égouts à la place d'un empereur, un cocher de fiacre à la place, du seigneur élégant, une maritorne à la place d'une duchesse? La seule parodie amusante et curieuse des œuvres des grands maîtres est faite parleurs disciples et leurs admirateurs; ce sont eux qui par leurs imitations maladroites mettent en relief les défauts de l'ouvrage qu'ils copient. Le sérieux profond qu'ils apportent dans leurs exagérations est beaucoup plus comique que les inventions les plus saugrenues des parodistes. Les auteurs de vaudevilles qui jusqu'à présent ont fait la charge des pièces de M. Hugo n'ont pas le moins du monde le sentiment de la manière du poète. Les vers de leurs pièces, loin de donner l'idée du style et du rythme romantiques, ressemblent aux vers d'épître de M. Casimir Delavigne. On n'y trouve ni les tournures, ni les images, ni les coupes, ni les idées familières à la jeune école. Une caricature, pour être bonne, doit contenir les tracés réels du modèle, déviés, il est vrai, et accentués dans le sens du ridicule, mais cependant faciles à reconnaître au premier coup d'œil. Les parodistes ordinaires sont tellement étrangers aux idées poétiques, qu'ils ne peuvent même pas s'en moquer avec justesse. Nous défions qui que ce soit, sur vingt vers pris au hasard dans les Hures graves ou les Buses graves, de reconnaître que c'est de Victor Hugo qu'on a voulu se moquer.
Outre que les parodies frappent souvent à faux, elles ont l'inconvénient de ridiculiser même les plus belles choses; mais il n'en est pas moins convenu qu'elles font honneur aux ouvrages qui les provoquent. Rien n'aura donc manqué au succès des Burgraves, ni l'ardente sympathie des lettres et de toute la presse, ni les applaudissements et l'argent de la foule, ni l'opposition systématique qui s'attaque à toutes les grandes idées, car un désordre paraît être organisé depuis quinze jours pour entraver la pièce, et une dizaine de malveillants prétendent troubler l'impartial plaisir du public. On se récrie aux meilleurs endroits, on empêche d'entendre à chaque représentation ce qui a été applaudi à la représentation précédente. Nous devons dire aux siffleurs systématiques que c'est peine perdue. Le public libre qui vient aux Burgraves pour son argent, et qui écoute sérieusement une œuvre sérieuse, voudra qu'on la lui laisse entendre. Ensuite, il prononcera. Mais, quelle que soit son opinion, il saura la prendre dans la pièce, et non dans la tyrannie violente de quelques envieux ameutés.
14 mai 1849.
Les défauts de l'école romantique sont des qualités poussées à l'excès. Les qualités de l'école dite du bon sens consistent en mérites négatifs: timidité, froideur, prudence, amour du commun. Les peintres de l'Empire pouvaient se moquer de Rubens, de Rembrandt, du Tintoret, de Ribera et autres maîtres violents! mais en faire un pastiche ou une caricature, avec leur dessin poncif et leurs coloris de papier de salle à manger, leur eût été parfaitement impossible. Ce que nous disons là pour MM. Jules Barbier et Michel Carré à l'endroit de M. Vacquerie est vrai de toutes les parodies en vers que l'on a faites des pièces de Victor Hugo. Ces parodies sont écrites en vers plus classiques que le récit de Théramène, et singent bien plutôt Andromaque que Hernani et Bérénice que les Burgraves; quelques cassures de vers absurdes, que n'ont jamais employées les romantiques, très habiles dans la métrique, et les plus grands harmonistes de rythmes qu'ait possédés la littérature française, constituent tout le comique de ces parodies, molles, fades, inintelligentes.
7 juin 1852.
S'il y a quelque chose de triste au monde, c'est une vente après décès. La foule entre de plain-pied dans un intérieur fermé jusque-là, et qui ne s'ouvrait qu'à la parenté ou qu'à l'amitié; elle se promène partout, avide et curieuse, surtout si le mort a joui de quelque célébrité, profanant les recoins secrets, bourdonnant autour de l'autel des lares domestiques. Ces meubles, qui gardent encore l'empreinte de la vie, ces livres laissés ouverts sur une table, comme pour reprendre plus tard la lecture; ces pendules au balancier immobile, où l'œil du maître a lu sa dernière heure; ces portraits des aïeux, ou d'êtres plus chers encore; ces tableaux, orgueil de la maison; tous ces petits objets familiers dont se compose la physionomie d'une maison, s'en vont dispersés comme des feuilles éparpillées au vent, de-ça, de-là, perdant le sens que leur donnait leur réunion, commencer ailleurs une autre existence, souvenirs abolis, hiéroglyphes indéchiffrables désormais. Certes, c'est là un spectacle navrant, plein d'idées lugubres, et de réflexions amères! Mais ce qu'il y a encore de plus morne et de plus pénible à voir, c'est la vente du mobilier d'un homme vivant, surtout quand cet homme se nomme Victor Hugo, c'est-à-dire le plus grand poète de la France, maintenant en exil comme Dante, et qui apprend par expérience combien il est douloureusement vrai, le vers du vieux gibelin:
Il est dur de monter par l'escalier d'autrui.
Nous avons sous les yeux, au moment où nous écrivons ces lignes, une mince brochure bleue dont voici le titre:
«Catalogue sommaire d'un bon mobilier, d'objets d'art et de curiosité, meubles anciens en bois de chêne sculpté, bois doré et laque du Japon, pendules en marqueterie de Boule, bronzes, porcelaines de Saxe, de Chine, du Japon, faïences anciennes, verreries de Venise, terres-cuites, bustes en marbre, médaillons en bronze, tableaux, dessins, livres, Voyage en Égypte, armes anciennes, rideaux, tentures, tapis et tapisseries, couchers, porcelaines, batterie de cuisine, etc., dont la vente aux enchères publiques aura lieu, pour cause du départ de M. Victor Hugo, rue de la Tour-d'Auvergne, n° 37, par le ministère de Me Ridel, commissaire-priseur, rue Saint-Honoré, 335, assisté de M. Manheim, marchand de curiosités, rue de la Paix, 8, chez lesquels se distribue le présent catalogue.»
Nulle élégie ne nous a plus ému que cette simple nomenclature, qui, sous son aridité de style, de vérité, cache un poème de muette douleur. C'est comme une nénie de séparation éternelle, comme l'adieu d'un voyage sans retour. A quoi bon des meubles, à celui qui n'a plus de foyer, et qui va errer de rivage en rivage sur la terre étrangère, suivi du petit groupe de la famille, hélas! déjà diminué par la mort. Pourquoi conserver cette maison veuve où le maître ne rentrera plus? Que ferait d'un lit, d'une table, d'un fauteuil, le poète qui n'a plus que le monde pour patrie?
Fatales nécessités, sur lesquelles nous devons nous taire, et qu'il ne nous appartient pas de discuter, mais qu'il nous est permis au moins de déplorer, car nous avons été le disciple, l'admirateur, et nous sommes toujours l'ami du grand homme ainsi frappé. Qui nous eût dit, après les soirées triomphales d'Hernani, de Lucrèce Borgia, de Ruy Blas, lorsque, perdu, nous l'un des plus obscurs, dans un flot de jeunesse enthousiaste, nous suivions le poète, attendant un sourire, un mot amical, une poignée de main, que le Maître Suprême, le dieu de la poésie, que nous n'abordions qu'avec des terreurs et des tremblements, aurait un jour besoin du secours de notre plume, afin d'annoncer la vente de son mobilier pour cause de départ, et d'ajouter, par la publicité, quelque obole à son pécule d'exil!
Il nous répugne vraiment par trop de dépoétiser par une énumération de commissaire-priseur cet intérieur où nous avons passé des heures si douces, dans une charmante intimité, écoutant une de ces conversations d'art, de voyage ou de philosophie, comme on n'en entendra plus. Nous aimons mieux en retracer la physionomie vivante, et, par ce léger crayon fait à la hâte, conserver la figure des lieux et la place des objets. Ces quelques lignes seront peut-être plus tard consultées comme documents pour la biographie du poète.
M. Victor Hugo, après un long séjour à la place Royale, avait transporté, rue de la Tour-d'Auvergne, dans une vaste, calme et solitaire maison propice à la rêverie et au travail, et des fenêtres de laquelle on aperçoit Paris en panorama, espèce d'océan immobile qui a sa grandeur comme l'autre. On traversait une cour déserte, l'on montait, et au premier l'on trouvait, le logis hospitalier du poète, modeste demeure pour un si grand nom, et où les étrangers, venus, de loin pour le saluer, s'étonnaient de ne trouver ni portiques, ni colonnes de marbre.
Dès l'antichambre, le goût particulier du poète se déclarait, car nul n'a plus imprimé le cachet de sa fantaisie aux lieux qu'il habitait: des fontaines chinoises, des vases en faïence de Rouen, des armoires en laque du Japon, décoraient cette première pièce.
Le petit salon d'attente, revêtu de cuir de Cordoue gaufré et doré, encadrant deux panneaux, de tapisserie gothique de très vieille date, plus ancienne, même que la tapisserie de Bayeux, s'éclairait par une fenêtre à vitraux allemands ou suisses; une cheminée en chêne sculpté, une glace à cadre de terre cuite où se déroulaient, à travers les arabesques de l'ornementation, les principales scènes du roman de Notre-Dame de Paris, un buste de nègre en pierre de touche, quelques fragments de boiserie antique, une grande pendule en marqueterie, en écaille et en cuivre, une chaise longue et un fauteuil en bambou de Chine, tel était l'ameublement de ce petit salon, dont la plus grande singularité consistait en un lutrin mobile tournant comme une roue, et destiné à porter des in-folio sur ses palettes; une vieille Bible ouverte et posée sur ses rayons faisait comprendre l'usage et l'utilité de ce meuble de bénédictin.
Nous n'en avons pas encore dit la principale richesse, un dessin magnifique représentant les bords du Rhin, illustration du livre exécutée par la main qui l'a écrit.
Victor Hugo, s'il n'était pas poète, serait un peintre de premier ordre; il excelle à mêler, dans des fantaisies sombres et farouches, les effets de clair-obscur de Goya à la terreur architecturale de Piranèse; il sait, au milieu d'ombres menaçantes, ébaucher d'un rayon de lune ou d'un éclat de foudre les tours d'un burg démantelé, et, sur un rayon livide de soleil couchant, découper en noir la silhouette d'une ville lointaine avec sa série d'aiguilles, de clochers et de beffrois. Bien des décorateurs lui envieraient cette qualité étrange de créer des donjons, des vieilles rues, des châteaux, des églises en ruine, d'un style insolite, d'une architecture inconnue, pleine d'amour et de mystère, dont l'aspect vous oppresse comme un cauchemar.
De ce petit salon on entre dans la chambre à coucher du poète qui ressemble un peu à la chambre de la Tisbé. Un lit à colonnes salomoniques et à dossiers dorés en occupe le fond avec ses amples pentes de vieux damas des Indes. Les murs sont tapissés de tentures de Chine, et le plafond est orné d'une peinture allégorique de Châtillon, représentant une femme couchée, souriant à un personnage vêtu comme Pétrarque et qui étudie dans un grand livre. Dans la cheminée, faite de morceaux, raccordés de bas-reliefs gothiques, se prélassent deux mornes chenets de fer, enlevés sans doute à l'âtre colossal de quelque burg du Rhin, et sur lesquels Job et Magnus ont peut-être appuyé leurs pieds chaussés d'acier.
Tout un monde de chimères, de potiches, de sculptures, d'ivoires, jonche les étagères, reflétés par des miroirs de Venise au cadre de cuivre estampé; un beau banc de bois de chêne, du travail gothique le plus délicatement fenestré et fleuri, y sert de canapé. Dans un coin se cache la petite table sur laquelle ont été écrits tant de beaux vers, de drames pathétiques et de pages impérissables. Une boussole ancienne, des cachets, un encrier, un coffret de fer précieusement ouvragé, chargent le vieux tapis qui la recouvre. Aux murs sont appendus plusieurs dessins de maîtres, dont quelques-uns portent des épigraphes.
Le salon, tendu en damas de soie bleue, est plafonné d'une grande tapisserie à sujets tirés de Télémaque; des nègres en bois doré supportent des torchères: une cheminée en velours rouge avec des figures en plâtre aussi doré; des glaces anciennes, des tableaux de Saint-Evre, de Paul Huet, de Nanteuil, de Boulanger; des portraits du poète, de sa femme et de ses enfants, un buste monumental par David, des portes de laque du Japon, et un grand meuble de satin blanc à fleurs, forment la décoration de cette pièce, la plus vaste du logis.
La salle à manger qui la précède est tendue de tapisseries anciennes, garnie de dressoirs en chêne sculpté, de torchères et de lustres hollandais.
Sur les étagères et les bahuts s'entassent des porcelaines du Japon, des faïences de Rouen et de Vincennes, des verres de Bohême ou de Venise, mille curiosités entassées une à une par la fantaisie patiente du poète, en furetant les vieux quartiers des villes qu'il a parcourues.
Tout ce poème domestique va être démembré et vendu hémistiche par hémistiche, nous voulons dire fauteuil par fauteuil, rideau par rideau. Espérons que les nombreux admirateurs du poète s'empresseront à cette triste vente, qu'ils auraient dû empêcher, en achetant par souscription le mobilier et la maison qui le renferme, pour les rendre plus tard à leur maître, ou à la France, s'il ne doit pas revenir. En tout cas, qu'ils songent que ce ne sont pas des meubles qu'ils achètent, mais des reliques.
17 octobre 1854.
Tout en regardant Mademoiselle Georges, nous songions malgré nous, à travers le mélodrame, à cette grande épopée des Burgraves où marche, en faisant résonner ses pieds de marbre sur les dalles de granit, cette vieille titanique et farouche, plus grande que la Sybille de Michel-Ange, plus effrayante que la Porkyas de Gœthe, cette gigantesque personnification de la haine, Guanhumara, colosse tragique, moitié Euménide, moitié sorcière, et que nulle actrice au monde ne serait capable de représenter comme Mademoiselle Georges.
Comme elle serait belle dans ce rôle surhumain, comme elle serait à l'aise, parmi ces chevaliers géants, mastodontes féodaux d'un âge disparu! Comme elle dirait avec des lèvres de bronze ces grands alexandrins qui rendent des sons d'armures entrechoquées! Comme elle porterait de manière à faire honte à la pourpre, le haillon de l'esclavage!
Mais laissons là le rêve, et revenons à la réalité.
Octobre 1857.
Il y a bien longtemps que Mademoiselle Georges est belle, et l'on pourrait dire d'elle ce que le paysan disait d'Aristide: «Je te bannis parce que cela m'ennuie de t'entendre appeler Juste».
Nous ne ferons pas comme ce brave manant grec, quoi qu'il soit évidemment plus difficile d'être toujours beau que d'être toujours juste. Cependant Mademoiselle Georges semble avoir résolu cet important problème; les années glissent sur sa face de marbre sans altérer en rien la pureté de son profil de Melpomène grecque.
Sa conservation est bien autrement miraculeuse que celle de Mademoiselle Mars, qui n'est, du reste, aucunement conservée, et ne peut plus faire illusion dans les rôles de jeune première qu'à des fournisseurs de la République et à des généraux de l'Empire.
Malgré le nombre exagéré de lustres qu'elle compte, Mademoiselle Georges est réellement belle, et très belle.
Elle ressemble à s'y méprendre à une médaille de Syracuse ou à une Isis des bas-reliefs.
L'arc de ses sourcils, tracé avec une pureté et une finesse incomparables, s'étend sur deux yeux noirs pleins de flammes et d'éclairs tragiques; le nez, mince et droit, coupé d'une narine oblique et passionnément dilatée, s'unit avec son front par une ligne d'une simplicité magnifique; la bouche est puissante, arquée à ses coins, superbement dédaigneuse, comme celle de la Némésis vengeresse qui attend l'heure de démuseler son lion aux ongles d'airain. Cette bouche a pourtant de charmants sourires épanouis avec une grâce tout impériale, et l'on ne dirait pas, quand elle veut exprimer les passions tendres, qu'elle vient de lancer l'imprécation antique ou l'anathème moderne.
Le menton, plein de force et de résolution, se relève fermement, et termine par un contour majestueux ce profil, qui est plutôt d'une déesse que d'une femme.
Comme toutes les belles femmes du cycle païen, Mademoiselle Georges a le front plein, large, renflé aux tempes, mais peu élevé, assez semblable à celui de la Vénus de Milo, un front volontaire, voluptueux et puissant, qui convient également à la Clytemnestre et à la Messaline.
Une singularité remarquable du col de Mademoiselle Georges, c'est qu'au lieu de s'arrondir intérieurement du côté de la nuque, il forme un contour renflé et soutenu qui lie les épaules au fond de la tête sans aucune sinuosité, diagnostic de tempérament athlétique, développé au plus haut point chez l'Hercule Farnèse.
L'attache des bras a quelque chose de formidable pour la vigueur des muscles et la violence du contour. Un de leurs bracelets ferait une ceinture pour une femme de taille moyenne. Mais ils sont très blancs, très purs, terminés par un poignet d'une délicatesse enfantine et des mains mignonnes frappées de fossettes, de vraies mains royales, faites pour porter le sceptre, et pétrir le manche du poignard d'Eschyle et d'Euripide.
Mademoiselle Georges semble appartenir à une race prodigieuse et disparue; elle vous étonne autant qu'elle vous charme. L'on dirait une femme de Titan, une Cybèle mère des dieux et des hommes, avec sa couronne de tours crénelées; sa construction a quelque chose de cyclopéen et de pélasgique. On sent en la voyant qu'elle reste debout, comme une colonne de granit, pour servir de témoin à une génération anéantie, et qu'elle est le dernier représentant du type épique et surhumain.
C'est une admirable statue à poser sur le tombeau de la Tragédie, ensevelie à tout jamais.
14 janvier 1867.
Il est de ces figures qui laissent dans le souvenir une trace tellement radieuse qu'elles semblent devoir être immortelles; même quand depuis longtemps déjà elles sont disparues de la scène, elles restent mêlées à la vie, on s'en occupe, et leur nom ailé voltige sur les lèvres des hommes. Elles sont entrées, quoique réelles, dans ce monde des types créés par les poètes, où l'âge, le temps, les dates n'existent plus; l'ombre de la retraite ne peut pas éteindre leur éclat. Quoiqu'on ne les voie plus, elles sont présentes, et l'on a peine à s'imaginer qu'elles subissent le sort commun. Mademoiselle Georges était une de celles-là; on aurait cru qu'elle durerait éternellement, comme cette superbe Melpomène de Velletri, du Musée des Antiques, qu'on eût prise pour le portrait anticipé de l'illustre tragédienne.
Elle avait près de quatre-vingts ans, la grande Georges, et les générations d'admirateurs s'étaient succédé devant elle, et les fils comme les pères vantaient sa beauté indestructible. Le temps, edax rerum, semblait avoir peur d'altérer ce pur marbre; il le respectait, il le ménageait, sachant bien que la Nature serait longue à reproduire un pareil chef-d'œuvre. Georges était faite à la taille des tragédies d'Eschyle; sur le théâtre de Bacchus, elle eût, dans l'Orestie, joué Clytemnestre sans cothurnes. Et ce n'était pas seulement une statue digne de Phidias, une forme merveilleuse et parfaite: l'intelligence, la passion, le génie animaient ce beau corps; une âme brûlait dans cette perfection sculpturale.
Cette Melpomène, que les Grecs n'eussent pas rêvée plus belle, plus sévère et plus grandiose, savait sortir de son temple à colonnes doriques, et entrer, la tête haute, dans le décor compliqué du drame; son profil magnifique ne se détachait pas moins pur d'une tenture en cuir de Cordoue que d'un velum de pourpre. Elle était chez elle à Venise et à Ferrare, comme à Rome ou à Mycènes, et en venant de l'antiquité dans le moyen âge elle ressemblait à Hélène dans le château gothique de Faust. La déesse se devinait à travers le costume. Chose étrange, elle a été l'idole des classiques et l'idole des romantiques. Quelle Clytemnestre, quelle Agrippine, quelle Cléopâtre, quelle Sémiramis! disaient les uns.—Quelle Lucrèce Borgia, quelle Marie Tudor, quelle Marguerite de Bourgogne! répondaient les autres. Et les deux partis avaient raison: le drame lui doit autant que la tragédie.
Nous n'avons connu Mademoiselle Georges qu'après 1830, et pour ainsi dire dans la phase moderne de son talent. Quoique dès lors elle eût passé l'âge qu'on appelle jeunesse pour les autres femmes, elle était de la plus étonnante beauté. C'est toujours avec éblouissement que nous nous rappelons le sourire par lequel elle ouvrait le second acte de Marie Tudor, à demi couchée sur une pile de carreaux, vêtue de velours nacarat à crevés de brocart d'argent, sa main royale effleurant les cheveux bruns de Fabiano Fabiani agenouillé. Son profil nacré se découpait sur un fond d'une richesse sombre; elle étincelait, elle nageait dans la lumière; elle avait des fulgurations de beauté, des élancements d'éclat, et représentait comme dans un rêve la puissance enivrée par l'amour. Avant qu'elle eût dit un mot, des tonnerres d'applaudissements qui ne pouvaient s'apaiser retentissaient du parterre au cintre.
Comme elle était belle aussi dans Lucrèce Borgia, quand elle se penchait sur le front de Gennaro endormi, et avec quelle fierté terrible elle se redressait sous le foudroiement d'insultes lorsque son masque arraché trahissait son incognito! On voyait, à travers la lividité de sa colère impuissante, luire comme une réverbération d'enfer le projet de quelque épouvantable vengeance. De quel ton elle disait au duc, dans la scène des flacons: «Don Alfonse de Ferrare, mon quatrième mari!» Et ce rugissement de tigresse quand, au dernier acte, elle montrait leurs cercueils à ses convives empoisonnés! «Vous m'avez donné un bal à Venise, je vous rends un souper à Ferrare!» Qui ne se souvient de cette phrase? Sa voix stridente en scandait chaque syllabe avec une lenteur cruelle qui augmentait l'oppression des cœurs. C'était là de la vraie terreur, de la vraie, passion, du vrai drame. En ce temps-là, pour jouer ces œuvres hardies, il y avait un quatuor sublime: Frédérick Lemaître, Bocage, Mademoiselle Georges, Madame Dorval. Il n'en reste plus qu'un seul, de ces tiers artistes, le plus grand peut-être, Frédérick. Le siècle, en avançant, se dépeuple, et tous ces grands morts nous ne voyons pas qui les remplacera dans l'avenir encore obscur; car Rachel, cette flamme ardente dans ce corps frêle, est partie avant Georges.
Quoique appartenant à une autre génération, Mademoiselle Georges a été notre contemporaine par ses succès dans le drame moderne; elle avait quitté Eschyle pour Shakespeare—ce n'est pas là une défection—et s'était généreusement associée aux efforts de notre école. Elle nous a ébloui, ému, passionné; elle a fait passer sur nous le grand souffle des terreurs tragiques. Son souvenir est lié à celui d'œuvres qui ont été les événements de notre jeunesse, et il nous semble qu'une partie de nous-même s'en aille avec elle. Ainsi, pièce à pièce, l'édifice où nous avons vécu s'écroule, et chaque pierre qui tombe porte un nom illustre suivi d'une épitaphe: Les représentants de nos anciens rêves s'évanouissent, nos interlocuteurs d'autrefois entrent dans l'éternel silence, nos types de beauté s'effacent; nos amours, nos admirations ne sont plus; notre idéal a fui.
Il nous faut chercher un autre milieu, faire de nouvelles connaissances, accoutumer nos yeux à des visages inconnus, trouver d'autres gloires, inventer des talents, prendre la jeunesse où elle est, admirer ce qui vient, tâcher de lire les livres qu'on imprime, d'écouter les pièces qu'on joue; en un mot, refaire de fond en comble le mobilier de notre vie. C'est le train du monde, et l'on aurait tort de s'en plaindre. Chaque flot luit un moment sous le rayon, et puis rentre dans l'ombre. Heureuse encore la vague qui reçoit le reflet de lumière! Mais avec quelque courage qu'on s'enfonce dans le mystérieux avenir, on ne peut se défendre d'un mélancolique retour sur soi-même, à chacune de ces morts qui diminuent le nombre des témoins et des compagnons de notre passé; on songe avec effroi qu'on va bientôt être comme un étranger, dont personne ne sait l'origine et les antécédents, parmi la génération actuelle; un douloureux sentiment de solitude s'empare de votre âme, et l'on se dit que peut-être on eût bien fait dé s'en aller avec les autres.
L'illustre tragédienne repose sur la colline aux arbres verts, ayant pour linceul le manteau noir de Rodogune, qu'elle portait à sa représentation d'adieu. Ainsi un soldat tombé dort dans son manteau de guerre.
Nous n'avons pas envie de faire la biographie de Mademoiselle Rachel. Cette curiosité vulgaire qui cherche des détails insignifiants ou mesquins, nous déplaît plus que nous ne saurions le dire. Cependant, nous croyons pouvoir, sans manquer aux convenances, fixer quelques traits de la physionomie générale de l'illustre tragédienne, dont cette périphrase remplaçait presque le nom.
Mademoiselle Rachel, sans avoir de connaissances ni de goûts plastiques, possédait instinctivement un sentiment profond de la statuaire. Ses poses, ses attitudes, ses gestes s'arrangeaient naturellement d'une façon sculpturale, et se décomposaient en une suite de bas-reliefs. Les draperies se plissaient, comme fripées par la main de Phidias, sur son corps long, élégant et souple; aucun mouvement moderne ne troublait l'harmonie et le rythme de sa démarche; elle était née antique, et sa chair pâle semblait faite avec du marbre grec. Sa beauté méconnue—car elle était admirablement belle—n'avait rien de coquet, de joli, de français, en un mot; longtemps même elle passa pour laide, tandis que les artistes étudiaient avec amour, et reproduisaient comme un type de perfection ce masque aux yeux noirs, détaché de la face même de Melpomène! Quel beau front, fait pour le cercle d'or ou la bandelette blanche! quel regard fatal et profond! quel ovale purement allongé! quelles lèvres dédaigneusement arquées à leurs coins! quelles élégantes attaches de col! Quand elle paraissait, malgré les fauteuils à serviette et les colonnades corinthiennes supportant des voûtes à rosaces en pleine Grèce héroïque, malgré l'anachronisme trop fréquent du langage, elle vous reportait tout de suite à l'antiquité la plus pure. C'était la Phèdre d'Euripide, non plus celle de Racine, que vous aviez devant les yeux: elle ébauchait à main levée, en traits légers, hardis et primitifs comme les peintres des vases grecs, une figure aux longues draperies, aux sobres ornements, d'une austérité gracieuse et d'un charme archaïque qu'il était impossible d'oublier, désormais. Nous ne voudrions en rien diminuer sa gloire, mais là était l'originalité de son talent: Mademoiselle Rachel fut plutôt une mime tragique qu'une tragédienne dans le sens qu'on attache à ce mot. Son succès, déjà si grand chez nous, eût été plus grand encore sur le théâtre de Bacchus, à Athènes, si les Grecs avaient admis les femmes à chausser le cothurne; non pas qu'elle gesticulât, car l'immobilité fut au contraire l'un de ses plus puissants moyens, mais elle réalisait par son aspect tous les rêves, de reines, d'héroïnes et de victimes antiques, que le spectateur pouvait faire. Avec un pli de manteau elle en disait souvent plus que l'auteur avec une longue tirade, et ramenait d'un geste aux temps fabuleux et mythologiques la tragédie qui s'oubliait à Versailles.
Seule, elle avait fait vivre pendant dix-huit ans une forme morte, non pas en la rajeunissant, comme on pourrait le croire, mais en la rendant antique, de surannée qu'elle était peut-être; sa voix grave, profonde, vibrante, ménagère d'éclats et de cris, allait bien avec son jeu contenu et d'une tranquillité souveraine. Personne n'eut moins recours aux contorsions épileptiques, aux rauquements convulsifs du mélodrame, ou du drame, si vous l'aimez mieux. Quelquefois même on l'accusa de manquer de sensibilité, reproche inintelligent à coup sûr: Mademoiselle Rachel fut froide comme l'antiquité, qui trouvait indécentes les manifestations exagérées de la douleur, permettant à peine au Laocoon de se tordre entre les nœuds des serpents, et aux Niobides de se contracter sous les flèches d'Apollon et de Diane. Le monde héroïque était calme, robuste et mâle. Il eût craint d'altérer sa beauté par des grimaces; et d'ailleurs nos souffrances nerveuses, nos désespoirs puérils, nos surexcitations sentimentales eussent glissé comme de l'eau sur ces natures de marbre, sur ces individualités sculpturales que la fatalité pouvait seule briser après une longue lutte. Les héros tragiques étaient presque les égaux des dieux, dont ils descendaient souvent, et ils se rebellaient contre le sort, plus qu'ils ne pleurnichaient. Mademoiselle Rachel eut donc raison de ne pas avoir, comme on dit, de larmes dans la voix, et de ne pas faire trembloter et chevroter l'alexandrin avec la sensiblerie moderne. La haine, la colère, la vengeance, la révolte contre la destinée, la passion, mais terrible et farouche, l'amour aux fureurs implacables, l'ironie sanglante, le désespoir hautain, l'égarement fatal, voilà les sentiments que doit et peut exprimer la tragédie, mais comme le feraient des bas-reliefs de marbre aux parois d'un palais ou d'un temple, sans violenter les lignes de la sculpture, et en gardant l'éternelle sérénité de l'art.
Aucune actrice, mieux que Mademoiselle Rachel, n'a rendu ces expressions synthétiques de la passion humaine personnifiées par la tragédie sous l'apparence de dieux, de héros, de rois, de princes et de princesses, comme pour mieux les éloigner de la réalité vulgaire et du petit détail prosaïque. Elle fut simple, belle, grande et mâle comme l'art grec, qu'elle représentait à travers la tragédie française.
Les auteurs dramatiques, voyant la vogue immense qui s'attachait à ses représentations, rêvèrent souvent de l'avoir pour interprète. Si quelquefois elle accéda à ces désirs, ce ne fut, on peut le dire, qu'à regret, et après de longues hésitations. Bien qu'on la blâmât de ne rien faire pour l'art de son époque, elle sentait avec son tact si profond et si sûr qu'elle n'était pas moderne, et qu'à jouer ces rôles offerts de toutes parts elle altérait les lignes antiques et pures de son talent. Elle garda toute sa vie son altitude de statue, et sa blancheur de marbre. Les quelques pièces jouées en dehors de son vieux répertoire ne doivent pas compter, et elle les quitta aussitôt qu'elle le put.
Ainsi donc Mademoiselle Rachel n'a exercé aucune influence sur l'art de notre temps; mais, en revanche, elle n'en a pas subi. C'est une figure à part, isolée sur son socle au milieu du thymélé, et autour de laquelle les chœurs et les demi-chœurs tragiques ont fait leurs évolutions selon le rythme ancien. On peut l'y laisser, ce sera la meilleure figure funèbre sur le tombeau de la tragédie.
Nous disions tout à l'heure que Mademoiselle Rachel n'avait exercé aucune influence sur la littérature contemporaine; nous avons parlé d'une manière trop absolue: elle ne s'y mêla pas, il est vrai, mais, en ressuscitant la vieille tragédie morte elle enraya le grand mouvement romantique qui eût peut-être doté la France d'une forme nouvelle de drame. Elle rejeta aux scènes inférieures plus d'un talent découragé; mais, d'un autre côté, par sa beauté, par son génie, elle fit revivre l'idéal antique, et donna le rêve d'un art plus grand que celui qu'elle interprétait.
Dans la vie privée, Mademoiselle Rachel ne détruisait pas, comme beaucoup d'actrices, l'illusion qu'elle produisait en scène; elle gardait au contraire tout son prestige. Personne n'était plus simplement grande dame. La statue n'avait aucune peine à devenir une duchesse, et portait le long cachemire comme le manteau de pourpre à palmettes d'or; ses petites mains, à peine assez grandes pour entourer le manche du poignard tragique, maniaient l'éventail comme des mains de reine. De près, les détails délicats de sa figure charmante se révélaient, sous son profil de camée, dans la corolle du chapeau, et s'éclairaient d'un spirituel sourire. Du reste, nulle tension, nulle pose, et parfois un enjouement qu'on n'eût pas attendu d'une reine de tragédie; plus d'un mot fin, d'une repartie ingénieuse, d'un trait heureux qu'on a recueillis sans doute, ont jailli de cette belle bouche dessinée comme l'arc d'Éros, et muette maintenant à jamais.
Triste destinée, après tout, que celle de l'acteur. Il ne peut pas dire comme le poète: Non omnis moriar. Son œuvre passagère ne reste pas, et toute sa gloire descend au tombeau avec lui. Seul, son nom flotte et voltige quelque temps sur les lèvres des hommes. Parmi la génération actuelle, qui se fait une idée bien nette de Talma, de Malibran, de Mademoiselle Mars, de Madame Dorval? Quel est le jeune homme qui ne sourie aux récits merveilleux de quelque vieil amateur se passionnant encore de souvenir, et ne préfère in petto une médiocrité fraîche et vivante, jouant l'œuvre éphémère du moment, aux clartés flambantes de la rampe? Aussi, nous autres sculpteurs patients de ce dur paros qu'on appelle le vers, n'envions pas, dans notre misère et notre solitude, ce bruit, ces applaudissements, ces éloges, ces couronnes, ces pluies d'or et de fleurs, ces voitures dételées, ces sérénades aux flambeaux, ni même, après la mort, ces cortèges immenses qui semblent vider une ville de ses habitants. Pauvres belles comédiennes, pauvres reines sublimes! L'oubli les enveloppe tout entières, et le rideau de la dernière représentation, en tombant, les fait disparaître pour toujours. Parfums évaporés, sons évanouis, images fugitives! La gloire sait qu'elles ne doivent pas vivre, et leur escompte les faveurs qu'elle fait si longtemps attendre aux poètes immortels.
16 janvier 1838.
Il y a une erreur enracinée chez tous les gens qui voient seulement l'extérieur du théâtre, une erreur banale et béotienne, c'est que les auteurs ou les acteurs du drame proprement dit doivent avoir communément la mine allongée, l'extérieur sombre, et un poignard catalan dans leur gousset. La gaîté semblerait une anomalie choquante à ces bons bourgeois s'ils la rencontraient sur le visage d'Alexandre Dumas ou de Bocage, de Victor Hugo ou de Frédérick Lemaître. Ils vous raconteront que Dumas a tué plusieurs matelots dans son voyage de Sicile; que Bocage va chaque matin pleurer au cimetière Vaugirard; que Victor Hugo habite une caverne non loin de Paris, et que Frédérick Lemaître a tenté nombre de fois de s'asphyxier sous les fenêtres d'une princesse russe.
L'esprit et la verve joyeuse qui caractérisent la conversation de Dumas, les allures tranquilles et paternelles de Victor Hugo, Bocage et Frédérick Lemaître, vêtus de bleu barbeau, et jouant au billard près de l'Ambigu, les confondraient de surprise.
Jugez ce que ce gros public doit penser nécessairement des actrices qui jouent le drame!
A leur tète se place naturellement Madame Dorval. Madame Dorval leur paraît une véritable victime. Quelle âme, quelle tristesse élégiaque empreinte dans ce regard doux et voilé! «Je suis sûr que c'est une femme qui pleure huit heures par jour», dit un miroitier à son voisin.—«On m'a dit qu'elle avait une chambre en velours noir». «Elle va à l'église», etc., etc.
C'est ainsi que le miroitier ingénu, qui a vu Madame Dorval dans Adèle, d'Antony, dans la femme du Joueur, dans Charlotte Corday, et surtout dans Marguerite, du Faust de Gœthe, rôles empreints de tout le génie douloureux et de la passion résignée de Madame Dorval, juge cette grande comédienne. Heureusement que le bourgeois et le miroitier (Nous l'espérons bien pour l'honneur du corps des journalistes), n'écrivent ni biographies ni feuilletons.
Madame Dorval est une de ces natures privilégiées qui doivent échapper au sens vulgaire; elle ne se révèle guère qu'à son monde d'initiés, à ses amis on à ses auteurs habituels. Cette Adèle d'Antony, dont le sourire a tant de tristesse et de larmes, déploie chez elle tous les trésors de son esprit naturellement vif et joyeux. Le propre de l'esprit de Madame Dorval, c'est une gaîté franche et de bon aloi, naïve et jeune comme la chanson de l'oiseau qui court les épis, obligeante et vous mettant tout de suite à l'aise, qui que vous soyez, ce qui est le propre des véritables riches en fait d'esprit, nobles cœurs qui tendent la main aux plus pauvres. La conversation de Madame Dorval ne s'alimente jamais de ces lieux-communs si tristes, que Voisenon appelle de bons amis qui ne manquent jamais au besoin; elle se pend, au contraire, le plus follement du monde, aux branches de la folie ou du paradoxe, secouant l'arbre à le briser, animant tout, raillant tout, imprudente à se dépenser de cent mille façons, et ne concevant pas que l'on puisse faire des économies.
Nullement ambitieuse de l'effet, n'affichant aucune prétention au mot, Madame Dorval l'atteint sûrement; toutes ses témérités d'esprit sont heureuses. La candeur de cet esprit est son cachet, il vous monte au nez comme le bouquet du meilleur vin. Ce qu'il y a d'inouï chez Madame Dorval, c'est qu'elle pourrait à coup sûr en tirer un autre parti. Nous ne craignons pas de dire que si Madame Dorval voulait écrire n'importe quel livre sans le signer, le livre serait lu. Nous tenons en main un album où Madame Dorval a consigné quelques pensées et maximes d'écrivains de tous les pays; cet album est une Babylone de choses; on y rencontre les noms de Schiller, de Victor Hugo, de Napoléon, de Jésus-Christ, de Mahomet, de Sainte-Beuve, etc., etc. Ces extraits divers sont le résultat des lectures de Madame Dorval; mais leur choix indique une fantaisie et une humour que rien ne peut rendre. Vous diriez, à parcourir ce livre, écrit, en entier de la main de Marie Dorval, que vous suivez le fil d'une de ces bacchanales admirables de Jordaëns: les pensées se croisent avec les histoires, la poésie avec la prose; il y a des calculs d'arithmétique et des prédictions d'astronomie. Tout cela danse en spirale fantasque, tout cela forme autant de fusées qui semblent éclairer la route parcourue jusqu'ici par madame Dorval.
Nous nous sommes entendu demander plus d'une fois par des gens de province, moins béotiens que le miroitier précité: «Madame Dorval a-t-elle de l'esprit?» Nous avons répondu à ces gens que nous ne pouvions décemment présenter chez l'aimable actrice: «L'avez-vous vue dans la Jeanne Vaubernier, de M. Balissan de Rougemont?»
Ce rôle est, en effet, une des meilleures preuves de l'esprit de madame Dorval. Elle le joue en comédienne qui a de l'ironie et du trait dans chaque pli de son éventail. Il ne faut pas que M. Balissan de Rougemont se rengorge pour cela, car c'est bien malgré lui que madame Dorval a déployé tant de finesse joyeuse dans cette fable banale. Les bonnes comédiennes jouent quelquefois de bons tours aux mauvais auteurs; un tour comme celui-ci est une noble vengeance.
Afin que cet article rassure pleinement les gens qui persistent à croire que madame Dorval habite un tombeau, nous voulons bien leur dire que son salon a l'air d'une véritable succursale de celui de Marion Delorme. On y trouve tout le confortable et toute l'élégance du jour, des albums, des tableaux, des statuettes, un piano, des fleurs, de la tapisserie et des porcelaines. Nous n'y avons pas vu de voile noir, de poison des Borgia, de lame de Tolède, ni de stylets. On y prend du thé, on s'y étend sur de bons sofas, on y cause avec des gens d'esprit, on se permet d'y rire de certaines actrices, et l'on y voit assez rarement des acteurs.
1er juin 1849.
Ce qui a tué Madame Dorval, c'est sa trop vive sensibilité, c'est la passion, l'enthousiasme, l'âme trop prodiguée, l'huile brûlée vite dans une lampe ardente, l'indifférence, le dédain de certains grands théâtres, le silence qui se faisait autour d'un nom naguère retentissant, et surtout le regret d'un enfant perdu, car, ainsi que le dit Victor Hugo, le grand poète:
Ces petits bras son forts pour vous tirer en terre!
Nous connaissions à peine madame Dorval, et, cependant, il nous semble avoir perdu une amie intime; une part de notre âme et de notre jeunesse descend dans la tombe avec elle; lorsqu'on a de longue main suivi une actrice à travers les transformations de sa vie de théâtre, qu'on a pleuré, aimé, souffert avec elle, sous les noms dont la fantaisie des poètes la baptise, il s'établit entre elle et vous,—elle figure rayonnante, vous spectateur perdu dans l'ombre,—un magnétisme qu'il est difficile de ne pas croire réciproque.
Quand de cette bouche aimée s'envolent les pensées secrètes de votre cœur, avec les vers du maître admiré que vous récitez en même temps qu'elle, il vous semble que c'est pour vous seul qu'elle parle ainsi, pour vous seul qu'elle trouve ces accents qui remuent toute une salle, pour vous seul qu'elle a choisi ce rôle, pour vous seul qu'elle a mis cette rose dans ses cheveux, ce velours noir à son bras; réalisant le rêve des poètes, elle devient pour le critique une espèce de maîtresse idéale, la seule peut-être qu'il puisse aimer. Les vers d'Alfred de Musset:
S'il est vrai que Schiller n'ait aimé qu'Amélie,
Gœthe que Marguerite et Rousseau que Julie,
Que la terre leur soit légère,—ils ont aimé!
s'appliquent tout aussi justement aux feuilletonistes qu'aux poètes.
Adèle d'Hervey, Ketty Bell, Marion Delorme, vous avez vécu pour nous d'une vie réelle; vous ne fûtes point de vains fantômes fardés, séparés de nous par un cordon de feu; nous avons cru à votre amour, à vos larmes, à vos désespoirs; jamais chagrins personnels ne nous ont serré le cœur etrougi la paupière autant que les vôtres; et si nous avons survécu à votre mort de chaque soir, c'est l'espérance de vous revoir le lendemain, plus tristes, plus plaintives, plus passionnées et plus charmantes, qui nous a soutenu. Ah! comme nous avons été jaloux d'Antony, de Chatterton et de Didier!
Un grand vide se fait dans l'âme lorsque les choses qui ont passionné votre jeunesse disparaissent les unes après les autres: où retrouver ces émotions, ces luttes, ces fureurs, ces emportements, ce dévouement sans bornes à l'art, cette puissance d'admiration, cette absence complète d'envie qui caractérisèrent cette belle époque, ce grand mouvement romantique qui, semblable à celui de la Renaissance, renouvela l'art de fond en comble, et fit éclore du même coup Lamartine, Hugo, Alexandre Dumas, Alfred de Musset, Sand, Balzac, Sainte-Beuve, Auguste Barbier, Delacroix, Louis Boulanger, Ary Scheffer, Devéria, Decamps, David (d'Angers), Barye, Hector Berlioz, Frédérick Lemaître et Madame Dorval, disparue trop tôt de cette pléiade étincelante, dont elle n'était pas une des moins lumineuses étoiles!
Frédérick Lemaître, que nous venons de nommer, et Madame Dorval formaient un couple théâtral parfaitement assorti. C'était la vraie femme de Frédérick, comme Frédérick était son vrai mari,—sur la scène, bien entendu.—Ces deux talents se complétaient l'un par l'autre et se grandissaient en se rapprochant. Frédérick était l'homme qu'il fallait pour faire pleurer cette femme; mais aussi, comme elle savait l'attendrir quand sa fureur était passée! quels accents elle lui arrachait! Qui ne les a pas vus ensemble, dans le Joueur par exemple, dans Peblo, ou le Jardinier de Valence, n'a rien vu; il ne connaît ni tout Frédérick, ni toute madame Dorval. Frédérick doit aujourd'hui se sentir bien veuf.
Ce bonheur d'avoir rencontré un talent pareil au sien, avec qui elle puisse engager une de ces belles luttes dramatiques qui soulèvent les salles, a manqué, jusqu'à présent, à mademoiselle Rachel.
Le talent de madame Dorval était tout passionné, non qu'elle négligeât l'art, mais l'art lui venait de l'inspiration; elle ne calculait pas son jeu geste par geste, et ne dessinait pas ses entrées et ses sorties avec de la craie sur le plancher: elle se niellait dans la situation du personnage, elle l'épousait complètement, elle devenait lui, et agissait comme il aurait agi: de la phrase la plus simple, d'une interjection, d'un oh! d'un mon Dieu! elle faisait jaillir des effets électriques, inattendus, que l'auteur n'avait pas même soupçonnés. Elle avait des cris d'une vérité poignante, des sanglots à briser la poitrine, des intonations si naturelles, des larmes si sincères, que le théâtre était oublié et qu'on ne pouvait croire à une douleur de convention.
Madame Dorval ne devait rien à la tradition. Son talent était essentiellement moderne, et c'est là sa plus grande qualité; elle a vécu dans son temps, avec les idées, les passions, les amours, les erreurs et les défauts de son temps; dramatique et non tragique, elle a suivi la fortune des novateurs, et s'en est bien trouvée. Elle a été femme où d'autres se seraient contentées d'être actrices: jamais rien de si vivant, de si vrai, de si pareil aux spectatrices de la salle, ne s'était montré au théâtre: il semblait qu'on regardât, non sur une scène, mais par un trou, dans une chambre fermée, une femme qui se serait crue seule.
Le Théâtre-Français doit avoir le remords de ne s'être pas attaché cette grande actrice, comme il aura plus tard le regret d'avoir laissé Frédérick, un acteur plus grand et plus vaste que Talma, s'abrutir à la Porte-Saint-Martin ou courir la province.
Nous avons au moins une consolation: ces éloges, fleurs funèbres que nous jetons sur la tombe de la grande actrice, nous n'avons pas attendu qu'elle y fût couchée pour les lui offrir: elle a pu, vivante, jouir de cette admiration compréhensive et passionnée, de ces louanges enthousiastes, ambroisie plus douce aux lèvres des artistes que le vin de la richesse dans des coupes d'or ciselées. Nous ne sommes pas de ces panégyristes posthumes qui n'exaltent que les défunts, et vous reconnaissent toutes les qualités possibles dès que vous êtes cloué dans la bière. Pourquoi ne pas être tout de suite, pour les contemporains de génie ou de talent, de l'avis de la postérité? pourquoi ces effusions lyriques adressées à des ombres?
Le plus lointain souvenir que nous ayons sur madame Dorval, c'est la première représentation de Marion Delorme. Le drame venait de la prendre au mélodrame; la poésie au patois du boulevard. Aussi, comme elle était heureuse, et fière, et rayonnante! comme elle semblait à son aise dans cette grande passion et dans ce grand style! comme elle planait d'une aile facile, soutenue par le souffle puissant du jeune maître! Nous la voyons encore avec ces longues touffes de cheveux blonds mêlés de perles, sa robe de satin blanc, et se faisant défaire par dame Rose.
Le dernier rôle où nous l'ayons vue, c'est Marie-Jeanne, une autre Marie, car ce nom quittait le sien lui sied à merveille. Ce n'était plus la brillante courtisane attendrie et purifiée par l'amour, c'était la pauvre femme du peuple, la mère de douleurs du faubourg, ayant dans le cœur les sept pointes d'épée, comme la Marie au Golgotha.
Ce n'était plus la haute poésie dramatique, mais c'était du moins la vérité simple et touchante qu'il fallait à son talent naturel, qu'elle avait un peu compromis dans des tentatives tragiques, dans la Lucrèce de Ponsard, par exemple; car elle aussi, la pauvre femme, ignorante dans toutes ces discussions, et qui ne savait que son cœur, avait eu un instant de doute et de faiblesse. Elle s'était laissée aller à l'école du bon sens et avait voulu débiter des songes comme une tragédienne du Théâtre-Français. Heureusement, elle n'a fait qu'un pas dans cette voie fatale. Elle avait reconnu à temps qu'il ne faut pas sortir de son sillon, et que les idées et les passions de la jeunesse doivent se continuer dans la maturité du talent, non pas châtiées et refroidies, mais éperonnées et poussées avec plus de fougue et de fureur encore: tels ces génies qui vieillissent en devenant plus sauvages, plus ardents, plus altiers, plus féroces, exagérant toujours leur propre caractère, comme Rembrandt, comme Michel-Ange, comme Beethoven.
14 janvier 1853.
Depuis bien des années, pour notre part, nous n'avons jamais manqué une des créations de Frédérick Lemaître, et nous le connaissons dans tous ses aspects: c'est toujours un noble et beau spectacle que de voir ce grand acteur, le seul qui chez nous rappelle Garrick, Kemble, Macready, et surtout Kean, faire trembler de son vaste souffle shakespearien les frêles portants des coulisses des scènes du boulevard.
Qu'importe le tréteau à l'inspiration! Frédérick n'a-t-il pas fait s'entasser tout ce que Paris avait de plus aristocratique et de plus élégant dans ce bouge étroit des Folies-Dramatiques, où Robert Macaire se réveillait le lendemain de l'exécution, éclairé et rajeuni par la guillotine, dédaigneux désormais de faire «suer le chêne sur le trimard» comme un vulgaire escarpe, et comprenant que M. Gogo était une moins compromettante victime que ce bon M. Germeuil à la culotte beurre frais? On aurait été l'entendre sous les toiles d'une baraque foraine, devant une rangée de chandelles non mouchées, entre quatre lampions fumeux.
Il est singulier qu'un acteur de ce génie n'ait pas tout d'abord fait partie de la Comédie-Française.—Balzac, il est vrai, n'était pas de l'Académie.—Ces talents excessifs effrayent toujours un peu les corps constitués.—Cela a nui à la Comédie-Française, non à Frédérick, que les poètes et les habiles ont accompagné dans sa carrière nomade. A la Porte-Saint-Martin, il a trouvé Richard d'Arlington, Gennaro, Don César de Bazan; à la Renaissance, Ruy Blas; aux Variétés, Kean; à la Gaîté, Paillasse; sans compter cent drames qu'il a fait vivre de sa vie puissante et qui semblaient des chefs-d'œuvre lorsqu'il les jouait.
Frédérick a ce privilège d'être terrible ou comique, élégant et trivial, féroce et tendre, de pouvoir descendre jusqu'à la farce et monter jusqu'à la poésie la plus sublime, comme tous les acteurs complets; ainsi il peut lancer l'imprécation de Ruy Blas dans le conseil des ministres et débiter le pallas de paillasse sur une place de village. Richard d'Arlington, il jette sa femme par la fenêtre avec la même aisance qu'il cuisine la soupe au choux du saltimbanque et porte son fils en équilibre sur le bout de son nez. Il dit: «En avant la musique» aussi bien que
Je le tiens écumant sous mon talon de fer.
ou
Je crois que vous venez d'insulter votre reine.
Dans Robert Macaire, ce Méphistophélès du bagne, bien plus spirituel que l'autre, il a élevé le sarcasme à la trentième puissance et trouvé des inflexions de voix inouïes et des gestes d'une éloquence incroyable.
Il a été plus beau que jamais dans Paillasse.
29 octobre 1857.
La disette de beautés est si grande parmi les femmes de théâtre, qui devraient être un choix entre les plus charmantes, que nous sommes obligés d'aller chercher loin de la scène, dans le demi-jour de la vie privée, une blanche et svelte figure dont les rares apparitions ont laissé un vif souvenir à tous les gens qui s'inquiètent encore en ce siècle de la grâce, de la finesse et de l'élégance, et qui lisent de ravissants et d'harmonieux poèmes dans une inflexion de ligne, dans un geste, dans une œillade, dans une certaine manière de retirer ou d'avancer le pied; choses, après tout, bien plus sérieuses et plus importantes que les niaiseries prétentieuses dont s'occupent les hommes graves.
C'est dans le petit rôle de la princesse Négroni de Lucrèce Borgia que mademoiselle Juliette a jeté le plus vif rayonnement. Elle avait deux mots à dire et ne faisait en quelque sorte que traverser la scène. Avec si peu de temps et si peu de paroles elle a trouvé le moyen de créer une ravissante figure, une vraie princesse italienne, au sourire gracieux et mortel, aux yeux pleins d'enivrements perfides; visage rose et frais qui vient de déposer tout à l'heure le masque de verre de l'empoisonneuse, si charmante, d'ailleurs, qu'on oublie de plaindre les infortunés convives, et qu'on les trouve heureux de mourir après lui avoir baisé la main.
Son costume était d'un caractère et d'un goût ravissants: une robe de damas rose à ramages d'argent, des plumes et des perles dans les cheveux; tout cela d'un tour capricieux et romanesque comme un dessin de Tempeste ou de della Bella. On aurait dit une couleuvre debout sur sa queue, tant elle avait une démarche onduleuse, souple et serpentine. A travers, toutes ses grâces, comme elle savait jeter quelque chose de venimeux! Avec quelle prestesse inquiétante et railleuse elle se dérobait aux adorations prosternées des beaux seigneurs vénitiens!
Nous avons rarement vu un type dessiné d'une manière si nette et si franche; et quoique mademoiselle Juliette ait une plus grande réputation comme jolie femme que comme actrice, nous ne savons pas trop quelle comédienne aurait découpé aussi rapidement une silhouette étincelante sur le fond sombre de l'action.
La tête de mademoiselle Juliette est d'une beauté régulière et délicate qui la rend plus propre au sourire de la comédie qu'aux convulsions du drame; le nez est pur, d'une coupe nette et bien profilée; les yeux sont diamantés et limpides, peut-être un peu trop rapprochés, défaut qui vient de la trop grande finesse des attaches du nez; la bouche, d'un incarnat humide et vivace, reste fort petite même dans les éclats de la plus folle gaieté. Tous ces traits, charmants en eux-mêmes, sont entourés par un ovale, du contour le plus suave et le plus harmonieux; un front clair et serein comme le fronton de marbre blanc d'un temple grec couronne lumineusement cette délicieuse figure; des cheveux noirs abondants, d'un reflet admirable, en font ressortir merveilleusement, par la vigueur du contraste, l'éclat diaphane et lustré.
Le col, les épaules, les bras sont d'une perfection tout antique chez mademoiselle Juliette; elle pourrait inspirer dignement les sculpteurs, et être admise au concours de beauté avec les jeunes Athéniennes qui laissaient tomber leurs voiles devant Praxitèle méditant sa Vénus.
FRAGMENTS
. . . . . . .
Dans son cadre, que l'ombre moire,
Au lieu de réfléchir mes traits,
La glace ébauche, de mémoire,
Le plus ancien de mes portraits.
Spectre rétrospectif qui double
Un type à jamais effacé
Il sort du fond du miroir trouble
Et des ténèbres du passé.
Dans son pourpoint de satin rose,
Qu'un goût hardi coloria,
Il semble chercher une pose,
Pour Boulanger ou Devéria.
Terreur du bourgeois glabre et chauve,
Une chevelure à tous crins
De roi franc ou de roi fauve
Roule en torrents jusqu'à ses reins
Tel, romantique opiniâtre,
Soldat de l'art qui lutte encor,
Il se ruait vers le théâtre
Quand d'Hernani sonnait le cor.
. . . . . . .
Les vaillants de dix-huit cent trente,
Je les revois tels que jadis.
Comme les pirates d'Otrante,
Nous étions cent, nous sommes dix.
L'un étale sa barbe rousse
Comme Frédéric dans son roc,
L'autre superbement retrousse
Le bout de sa moustache en croc.
Drapant sa souffrance secrète
Sous les fiertés de son manteau
Petrus fume une cigarette
Qu'il baptise papelito.
Celui-ci me conte ses rêves,
Hélas! jamais réalisés,
Icare tombé sur les grèves
Où gisent les essors brisés.
Celui-là me confie un drame
Taillé sur le nouveau patron
Qui fait, mêlant tout dans sa trame,
Causer Molière et Calderon.
Tom, qu'un abandon scandalise,
Récite «Love's labours lost»,
Et Fritz explique à Cidalise
Le «Walpurgisnachtstraum» de Faust.
. . . . . . .
Le château du Souvenir, Émaux et Camées.
Nous nous sommes attaché, dans cette étude, aux figures nouvelles, et nous leur avons donné une place importante, car c'était celles-là qu'il s'agissait avant tout de faire connaître. Mais pendant cet espace de temps, les maîtres n'ont pas gardé le silence. Victor Hugo a fait paraître les Contemplations, la Légende des siècles, les Chansons des rués et des bois, trois recueils d'une haute signification, où se retrouvent avec des développements inattendus les anciennes qualités qu'on admirait dans les Orientales et les Feuilles d'automne. Des Contemplations date la troisième manière de Victor Hugo, car les grands poètes sont comme les grands peintres: leur talent a des phases aisément reconnaissables. La pratique assidue de l'art, les enseignements multiples de la vie, les modifications du tempérament apportées par l'âge, l'élargissement des horizons vus de plus haut, tout contribue à donner aux œuvres, selon l'époque où elles se sont produites, une physionomie particulière. Ainsi, le Raphaël du Sposalizio, de la Belle Jardinière, de la Vierge au voile n'est pas le Raphaël des chambres du Vatican et de la Transfiguration; le Rembrandt de la Leçon d'anatomie du docteur Tulp ne ressemble guère au Rembrandt de la Ronde de nuit, et le Dante de la Vita nuova fait à peine soupçonner le Dante de la Divine Comédie.
Chez Hugo, les années, qui courbent, affaiblissent et rident le génie des autres maîtres, semblent apporter des forces, des énergies et des beautés nouvelles. Il vieillit comme les lions: son front, coupé de plis augustes, secoue une crinière plus longue, plus épaisse et plus formidablement échevelée. Ses ongles d'airain ont poussé, ses yeux jaunes sont comme des soleils dans des cavernes, et s'il rugit, les autres animaux se taisent. On peut aussi le comparer au chêne qui domine la forêt; son énorme tronc rugueux pousse en tous sens, avec des coudes bizarres, des branches grosses comme des arbres; ses racines profondes boivent la sève au cœur de la terre, sa tête touche presque au ciel. Dans son vaste feuillage, la nuit brillent les étoiles, le malin chantent les nids. Il brave le soleil et les frimas, le vent, la pluie et le tonnerre; les cicatrices même de la foudre ne font qu'ajouter à sa beauté quelque chose de farouche et de superbe.
Dans les Contemplations, la partie qui s'appelle Autrefois est lumineuse comme l'aurore; celle qui a pour titre Aujourd'hui est colorée comme le soir. Tandis que le bord de l'horizon s'illumine incendié d'or, de topaze et de pourpre, l'ombre froide et violette s'entasse dans les coins; il se mêle à l'œuvre une plus forte proportion de ténèbres, et, à travers cette obscurité, les rayons éblouissent comme des éclairs. Des noirs plus intenses font valoir les lumières ménagées, et chaque point brillant prend le flamboiement sinistre d'un microcosme cabalistique. L'âme triste du poète cherche les mots sombres, mystérieux et profonds, et elle semble écouter dans l'attitude du Pensiero de Michel-Ange «ce que dit la bouche d'ombre».
On a beaucoup plaint la France de manquer de poème épique. En effet, la Grèce à l'Iliade et l'Odyssée; l'Italie antique, l'Énéide; l'Italie moderne, la Divine Comédie, le Roland Furieux, la Jérusalem délivrée; l'Espagne, le Romancero et l'Araucana; le Portugal, les Lusiades; l'Angleterre, le Paradis perdu. A tout cela, nous ne pouvions opposer que la Henriade, un assez maigre régal puisque les poèmes du cycle carlovingien sont écrits dans une langue que seuls les érudits entendent. Mais maintenant, si nous n'avons pas encore le poème épique régulier en douze ou vingt-quatre chants, Victor Hugo nous en a donné la monnaie dans la Légende des siècles, monnaie frappée à l'effigie de toutes les époques et de toutes les civilisations, sur des médailles d'or du plus pur titre. Ces deux volumes contiennent, en effet, une douzaine de poèmes épiques, mais concentrés, rapides, et réunissant en un bref espace le dessin, la couleur et le caractère d'un siècle ou d'un pays.
Quand on lit la Légende des siècles, il semble qu'on parcoure un immense cloître, une espèce de campo santo de la poésie dont les murailles sont revêtues de fresques peintes par un prodigieux artiste qui possède tous les styles, et, selon le sujet, passe de la roideur presque byzantine d'Orcagna à l'audace titanique de Michel-Ange, sachant aussi bien faire les chevaliers dans leurs armures anguleuses que les géants nus tordant leurs muscles invincibles. Chaque tableau donne la sensation vivante, profonde et colorée d'une époque disparue. La légende, c'est l'histoire vue à travers l'imagination populaire avec sas mille détails naïfs et pittoresques, ses familiarités charmantes, ses portraits de fantaisie plus vrais que les portraits réels, ses grossissements de types, ses exagérations héroïques et sa poésie fabuleuse remplaçant la science, souvent conjecturale.
La Légende des siècles, dans l'idée de l'auteur, n'est que le carton partiel d'une fresque colossale que le poète achèvera si le souffle inconnu ne vient pas éteindre sa lampe au plus fort de son travail, car personne ici-bas n'est sur de finir ce qu'il commence. Le sujet est l'homme, ou plutôt l'humanité, traversant les divers milieux que lui font les barbaries ou les civilisations relatives, et marchant toujours de l'ombre vers la lumière. Cette idée n'est pas exprimée d'une façon philosophique et déclamatoire, mais elle ressort du fond même des choses. Bien que l'œuvre ne soit pas menée à bout, elle est cependant complète. Chaque siècle est représenté par un tableau important et qui le caractérise, et ce tableau est en lui-même d'une perfection absolue. Le poème fragmentaire va d'abord d'Ève à Jésus-Christ, faisant revivre le monde biblique en scènes d'une haute sublimité et d'une couleur que nul peintre n'a égalée. Il suffît de citer la Conscience, les Lions, le Sommeil de Booz, pages d'une beauté, d'une largeur et d'un grandiose incomparables, écrites avec l'inspiration et le style des prophètes. La décadence de Rome semble un chapitre de Tacite versifié par Juvénal. Tout à l'heure, le poète s'était assimilé la Bible; maintenant, pour peindre Mahomet, il s'imprègne du Coran à ce point qu'on le prendrait pour un fils de l'Islam, pour Abou-Bekr ou pour Ali. Dans ce qu'il appelle le cycle héroïque chrétien, Victor Hugo a résumé en trois ou quatre courts poèmes, tels que le Mariage de Roland, Aymerillot, Bivar, le Jour des Rois, les vastes épopées du cycle carlovingien. Cela est grand comme Homère et naïf comme la Bibliothèque bleue. Dans Aymerillot, la figure légendaire de Charlemagne à la barbe florie se dessine avec sas bonhomie héroïque, au milieu de ses douze pairs de France, d'un trait net comme les effigies creusées dans les pierres tombales, et d'une couleur éclatante comme celle des vitraux. Toute la familiarité hautaine et féodale du Romancero revit dans la pièce intitulée Bivar.
Aux héros demi-fabuleux de l'histoire succèdent les héros d'invention, comme aux épopées succèdent les romans de chevalerie. Les chevaliers errants commencent leur ronde, cherchant les aventures et redressant les torts, justiciers masqués, spectres de fer mystérieux, également redoutables aux tyrans et aux magiciens. Leur lance perce tous les monstres imaginaires ou réels, les andriagues et les traîtres. Barons en Europe, ils sont rois en Asie de quelque ville étrange, aux coupoles d'or, aux crénaux découpés en scie; ils reviennent toujours de quelque lointain voyage, et leurs armures sont rayées par les griffes des lions qu'ils ont étouffés entre leurs bras. Eviradnus, auquel l'auteur a consacré tout un poème, est la plus admirable personnification de la chevalerie errante et donnerait raison à la folie de Don Quichotte, tant il est grand, courageux, bon et toujours prêt à défendre le faible contre le fort. Rien n'est plus dramatique que la manière dont il sauve Mahaud des embûches du grand Joss et du petit Zéno. Dans la peinture du manoir de Corbus, à demi-ruiné et attaqué par les rafales et les pluies d'hiver, le poète atteint à des effets de symphonie dont on pouvait croire la parole incapable. Le vers murmure, s'enfle, gronde, rugit comme l'orchestre de Beethoven. On entend à travers les rimes siffler le vent, tinter la pluie, claquer la broussaille au front des tours, tomber la pierre au fond du fossé, et mugir sourdement la forêt ténébreuse qui embrasse le vieux château pour l'étouffer. À ces bruits de la tempête se mêlent les soupirs des esprits et des fantômes, les vagues lamentations des choses, l'effarement de la solitude et le bâillement d'ennui de l'abandon. C'est le plus beau morceau de musique qu'on ait exécuté sur la lyre.
La description de cette salle où, suivant la coutume de Lusace, la marquise Mahaud doit passer sa nuit d'investiture, n'est pas moins prodigieuse. Ces armures d'ancêtres chevauchant sur deux files, leurs destriers caparaçonnés de fer, la targe aux bras, la lance appuyée sur le faulcre, coiffées de morions extravagants, et se trahissant dans la pénombre de la galerie par quelque sinistre éclair d'or, d'acier ou d'airain, ont un aspect héraldique, spectral et formidable. L'œil visionnaire du poète sait dégager le fantôme de l'objet, et mêler le chimérique au réel dans une proportion qui est la poésie même.
Zim-Zizimi et le sultan Mourad nous montrent l'Orient du moyen âge avec ses splendeurs fabuleuses, ses rayonnements d'or et ses phosphorescences d'escarboucles sur un fond de meurtre et d'incendie, au milieu de populations bizarres venues de lieux dont la géographie sait à peine les noms. L'entretien de Zim-Zizimi avec les dix sphinx de marbre blanc couronnés de roses est d'une sublime poésie; l'ennui royal interroge, et le néant de toutes choses répond avec une monotonie désespérante par quelque histoire funèbre.
Le début de Ratbert est peut-être le morceau le plus étonnant et le plus splendide du livre. Victor Hugo seul, parmi tous les poètes, était capable de l'écrire. Ratbert a convoqué sur la place d'Ancône, pour débattre quelque expédition, les plus illustres de ses barons et de ses chevaliers, la fleur de cet arbre héraldique et généalogique que le sol noir de l'Italie nourrit de sa sève empoisonnée. Chacun apparaît fièrement campé, dessiné d'un seul trait du cimier au talon, avec son blason, son titre, ses alliances, son détail caractéristique résumé en un hémistiche, en une épithète. Leurs noms, d'une étrangeté superbe, se posant carrément dans le vers, font sonner leurs triomphantes syllabes comme des fanfares de clairon, et passent dans ce magnifique défilé avec des bruits d'armes et d'éperons.
Personne n'a la science des noms comme Victor Hugo. Il en trouve toujours d'étranges, de sonores, de caractéristiques, qui donnent une physionomie au personnage et se gravent ineffaçablement dans la mémoire. Quel exemple frappant de cette faculté que la chanson des Aventuriers de la mer! Les rimes se renvoient, comme des raquettes un volant, les noms bizarres de ces forbans, écume de la mer, échappés de chiourme venant de tous les pays, et il suffit d'un nom pour dessiner de pied en cap un de ces coquins pittoresques, campés comme des esquisses de Salvator Rosa ou des eaux-fortes de Callot.
Quel étonnant poème que le morceau destiné à caractériser la Renaissance et intitulé le Satyre! C'est une immense symphonie panthéiste, où toutes les cordes de la lyre résonnent sous une main souveraine. Peu à peu le pauvre sylvain bestial, qu'Hercule a emporté dans le ciel par l'oreille et qu'on a forcé de chanter, se transfigure à travers les rayonnements de l'inspiration et prend des proportions si colossales, qu'il épouvante les Olympiens; car ce satyre difforme, dieu à demi dégagé de la matière, n'est autre que Pan, le grand tout, dont les aïeux ne sont que des personnifications partielles et qui les résorbera dans son vaste sein.
Et ce tableau qui semble peint avec la palette de Vélasquez, la Rose de l'infante! Quel profond sentiment de la vie de cour et de l'étiquette espagnoles! comme on la voit cette petite princesse, avec sa gravité, d'enfant, sachant déjà qu'elle sera reine, roide dans sa jupe d'argent passementée de jais, regardant le vent qui enlève feuille à feuille les pétales de sa rose et les disperse sur le miroir sombre d'une pièce d'eau, tandis que le front contre une vitre, à une fenêtre du palais, rêve le fantôme pâle de Philippe II, songeant à son Armada lointaine, peut-être en proie à la tempête et détruite par ce vent qui effeuille une rose.
Le volume se termine, comme une Bible, par une sorte d'apocalypse; Pleine mer, Plein ciel, la Trompette du jugement dernier, sont en dehors du temps. L'avenir y est entrevu au fond d'une de ces perspectives flamboyantes que le génie des poètes sait ouvrir dans l'inconnu, espèce de tunnel plein de ténèbres à son commencement et laissant apercevoir à son extrémité une scintillante étoile de lumière. La trompette du jugement dernier, attendant la consommation des choses et couvant dans son monstrueux cratère d'airain le cri formidable qui doit réveiller les morts de toutes les Josaphats, est une des plus prodigieuses inventions de l'esprit humain. On dirait que cela a été écrit à Pathmos, avec un aigle pour pupitre et dans le vertige d'une hallucination prophétique. Jamais l'inexprimable et ce qui n'avait jamais été pensé n'ont été réduits aux formules du langage articulé, comme dit Homère, d'une façon plus hautaine et plus superbe. Il semble que le poète, dans cette région où il n'y a plus ni contour ni couleur, ni ombre ni lumière, ni temps ni limite, ait entendu et noté le chuchotement mystérieux de l'infini.
Les Chansons des rues et des bois, comme le titre l'indique, marquent dans la carrière du poète une espèce de temps de repos et comme les vacances du génie. Il conduit au pré vert de l'idylle, pour y brouter l'herbe fraîche et les fleurs, ce cheval farouche près duquel le Pégase classique n'est qu'un bidet de paisible allure, et que seuls peuvent monter les Alexandres de la poésie. Mais ce coursier formidable, à la crinière échevelée, aux nasaux pleins de flamme, dont les sabots font jaillir des étoiles pour étincelles et qui saute d'une cime à l'autre de l'idéal à travers tes ouragans et les tonnerres, se résigne difficilement à cette halte, et l'on sent que, s'il n'était entravé, il regagnerait en deux coups d'aile les sommets vertigineux et les abîmes insondables. Pendant que sa terrible monture est au vert, le poète s'égaye en toutes sortes de fantaisies charmantes. Il remonte le cours du temps, il redevient jeune. Ce n'est plus le maître souverain que les générations admirent, mais un simple bachelier qui, ennuyé de sa chambrette encombrée de bouquins poudreux, court les rues et les bois, poursuivant les grisettes et les papillons. Il ne fait le difficile ni pour le site, ni pour la nymphe. Pour lui Meudon est Tivoli, et Javotte Amaryllis. Les lavandières remplacent très bien Léda dans les roseaux, et les oies prennent des blancheurs de cygne. Le petit vin d'Argentueil a des saveurs de nectar dans le verre à côtes du cabaret. L'imagination du poète transforme tout et sait mettre sur le ventre d'une cruche vulgaire la paillette lumineuse de l'idéal.
Dans ce volume, Victor Hugo a renoncé à l'alexandrin et à ses pompes et n'emploie que les vers de sept ou de huit pieds séparés en petites stances; mais quel merveilleux doigté! Jamais le clavier poétique n'a été parcouru par une main plus légère et plus puissante. Les tours de force rythmiques se succèdent accomplis avec une grâce et une aisance incomparables. Liszt, Thalberg, Dreyschock ne sont rien à côté de cela. A la fin du volume, le poète enfourche sa monture impatiente, lui donne de l'éperon et s'enfonce dans l'infini.
A l'occasion de la reprise de Lucrèce Borgia, Théophile Gautier reçut de Victor Hugo la lettre suivante:
Hauteville-House, 9 février 1870.
«Mon Théophile, comment vous dire mon émotion? Je vous lis, et il me semble que je vous vois. Nous revoilà jeunes comme autrefois, et votre main n'a pas quitté ma main. Quelle grande page vous venez d'écrire sur Lucrèce Borgia!
«Je vous aime bien. Vous êtes toujours le grand poète et le grand ami.
«VICTOR HUGO.
«Voici mon portrait: il vote pour vous.»
Cette lettre était accompagnée d'une photographie du maître, le bras appuyé contre un fauteuil, avec cette dédicace:
JE VOUS OFFRE UN FAUTEUIL
A THÉOPHILE GAUTIER
VICTOR HUGO.
2 FÉVRIER 1833, 2 FÉVRIER 1870.
Théophile Gautier avait échoué à l'Académie Française, en 1869, quelques mois auparavant, lors de l'élection d'Auguste Barbier.
Les deux dates que porte cette photographie sont de la première représentation et de la reprise de Lucrèce Borgia.
| I. | — | 1830. | |
| II. | — | Le gilet rouge. | |
| III. | — | La présentation. | |
| IV. | — | Un buste de Victor Hugo. | |
| V. | — | La place Royale. | |
| VI. | — | La première d'Hernani. | |
| VII. | — | Procès de Victor Hugo contre la Comédie-Française. | |
| VIII. | — | Reprise d'Hernani par autorité de justice. | |
| IX. | — | Débuts de Mlle Émilie Guyon dans Hernani. | |
| X. | — | Reprise d'Hernani (12 février 1844). | |
| XI. | — | Reprise d'Hernani (10 mars 1845). | |
| XII. | — | Reprise d'Hernani (8 novembre 1847). | |
| XIII. | — | A propos d'Hernani au théâtre Italien. | |
| XIV. | — | La reprise d'Hernani (21 juin 1867). | |
| XV. | — | Lettre à Sainte-Beuve. | |
| XVI. | — | Prospectus pour Notre-Dame de Paris. | |
| XVII. | — | Un drame tiré de Notre-Dame de Paris. | |
| XVIII. | — | Angelo. | |
| XIX. | — | Mademoiselle Rachel dans Angelo. | |
| XX. | — | Victor Hugo dessinateur. | |
| XXI. | — | Première de Ruy Blas (Renaissance). | |
| XXII. | — | Reprise de Ruy Blas (28 février 1872). | |
| XXIII. | — | Vers de Victor Hugo. | |
| XXIV. | — | Le Drame. | |
| XXV. | — | Reprise de Marion Delorme (9 novembre 1839). | |
| XXVI. | — | Reprise de Marion Delorme (1er décembre 1851). | |
| XXVII. | — | Diane, d'Augier, et Marion Delorme. | |
| XXVIII. | — | Une lettre de Victor Hugo. | |
| XXIX. | — | Gastibelza (Opéra national). | |
| XXX. | — | Changements à vue. | |
| XXXI. | — | Lucrèce Borgia (Théâtre Italien). | |
| XXXII. | — | Lucrèce Borgia (Odéon). | |
| XXXIII. | — | Lucrezia Borgia (Théâtre Italien). | |
| XXXIV. | — | Lucrèce Borgia (Porte-Saint-Martin). | |
| XXXV. | — | Les Burgraves. | |
| XXXVI. | — | Les Burgraves (Théâtre-Français). | |
| XXXVII. | — | Reprise des Burgraves. | |
| XXXVIII. | — | Parodies des Burgraves. | |
| XXXIX. | — | Parodies et pastiches. | |
| XL. | — | Vente du mobilier de Victor Hugo. | |
| XLI. | — | A propos du mélodrame intitulé: la Chambre ardente. | |
| LES INTERPRÈTES DE VICTOR HUGO. | |||
| XLII. | — | Mademoiselle Georges. | |
| XLIII. | — | Mort de mademoiselle Georges. | |
| XLIV. | — | Mademoiselle Rachel. | |
| XLV. | — | Madame Dorval. | |
| XLVI. | — | Mort de Madame Dorval. | |
| XLVII. | — | Frédérick Lemaître. | |
| XLVIII. | — | Mademoiselle Jupette. | |
| XLIX. | — | Château du souvenir. | |
| L. | — | Études sur la Poésie française. | |
| LI. | — | Lettre de Victor Hugo. |
End of the Project Gutenberg EBook of Victor Hugo, by Théophile Gautier
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VICTOR HUGO ***
***** This file should be named 51977-h.htm or 51977-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/5/1/9/7/51977/
Produced by Laura Natal Rodriguez and Marc D'Hooghe at
http://www.freeliterature.org (Images generously made
available by the Hathi Trust.)
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.